Portrait
Les univers de Frédéric Jacques Temple
 À quoi tiennent le charme et l’intérêt d’une œuvre qui couvre une telle profusion de genres où consonnent la poésie, le roman, les mémoires, la biographie, la correspondance, la traduction, les revues, les sciences naturelles, la critique cinématographique, musicale et dramaturgique, le récit de voyages, la monographie d’artistes et le journalisme ? Certains liront séparément les éléments disparates du corpus sans s’apercevoir qu’ils sont intrinsèquement liés les uns aux autres. D’autres peut-être plus clairvoyants sauront dépasser l’apparent cloisonnement des disciplines et l’aspérité des circonstances pour retenir à chaque occurrence le cheminement intérieur d’un passeur providentiel, l’univers intime d’un littérateur d’exception. Les seize contributeurs requis pour tenter de circonscrire le mieux du monde « Les Univers de Frédéric Jacques Temple » contribuent à révéler, selon Pierre-Marie Héron et Claude Leroy (universitaires coordonnant l’ouvrage) « l’étonnante palette de ses identités, les horizons qu’il a fait siens des deux côtés de l’Atlantique ou de la Méditerranée, et son goût si caractéristique du dialogue ».
À quoi tiennent le charme et l’intérêt d’une œuvre qui couvre une telle profusion de genres où consonnent la poésie, le roman, les mémoires, la biographie, la correspondance, la traduction, les revues, les sciences naturelles, la critique cinématographique, musicale et dramaturgique, le récit de voyages, la monographie d’artistes et le journalisme ? Certains liront séparément les éléments disparates du corpus sans s’apercevoir qu’ils sont intrinsèquement liés les uns aux autres. D’autres peut-être plus clairvoyants sauront dépasser l’apparent cloisonnement des disciplines et l’aspérité des circonstances pour retenir à chaque occurrence le cheminement intérieur d’un passeur providentiel, l’univers intime d’un littérateur d’exception. Les seize contributeurs requis pour tenter de circonscrire le mieux du monde « Les Univers de Frédéric Jacques Temple » contribuent à révéler, selon Pierre-Marie Héron et Claude Leroy (universitaires coordonnant l’ouvrage) « l’étonnante palette de ses identités, les horizons qu’il a fait siens des deux côtés de l’Atlantique ou de la Méditerranée, et son goût si caractéristique du dialogue ».
Francis Carco loue sa musique intérieure
Né de souche aveyronnaise à Montpellier le 18 août 1921 (son père, Emmanuel, est avocat ; sa mère, Geneviève Bosc est fille de professeur de médecine), il partage son enfance entre le Larzac (à Fondamente) et la mer (à Haute-Plage, à la Grande-Motte), très tôt influencé par un grand-père naturaliste (Frédéric Bosc). « Enfant, j’ai vécu avec les plantes et les animaux, confie-t-il à la revue "Septimanie" en juin 2000. Je regrette de ne plus avoir les herbiers que j’avais composés entre 8 et 15 ans ; le premier, sous l’influence d’un instituteur d’Uchaud, Monsieur Bonijoli, qui passait ses vacances à l’Espérou. Il m’apprit à reconnaître les fleurs de l’été : centaurées, digitales, épilobes, campanules, que j’étalais, le soir, sur des feuilles de papier de boucherie - un bon papier caca d’oie qui faisait buvard - et pressais entre deux planchettes sous le poids 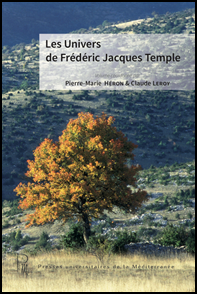 d’un galet roulé de torrent. » « Spectateur attentif de mes transes paléontologiques, rappelle-t-il en outre, mon grand-père m’offrit le monumental ouvrage de Marcellin Boule, alors pape incontesté de la vie pétrifiée. Ce fut ma Bible pendant dix ans, avec "L’Archéologie préhistorique" de Joseph Déchelette, sous l’impulsion d’un oncle archéologue (Pierre) qui m’entraînait sur le Larzac pour fouiller les tumuli. Il était dit que j’entrerais au Musée de l’Homme. »
d’un galet roulé de torrent. » « Spectateur attentif de mes transes paléontologiques, rappelle-t-il en outre, mon grand-père m’offrit le monumental ouvrage de Marcellin Boule, alors pape incontesté de la vie pétrifiée. Ce fut ma Bible pendant dix ans, avec "L’Archéologie préhistorique" de Joseph Déchelette, sous l’impulsion d’un oncle archéologue (Pierre) qui m’entraînait sur le Larzac pour fouiller les tumuli. Il était dit que j’entrerais au Musée de l’Homme. »
En 1942, ses premiers poèmes sont salués par l’écrivain Francis Carco qui le complimente en ces termes : « Vous avez plus que le don… (comme disait le père Hugo), vous avez votre musique intérieure, votre rythme ». Cette année-là, la famille se rend à Alger : lui fréquente la librairie d’Edmond Charlot, « Les Vraies Richesses » ; il sympathise avec les auteurs de la revue Fontaine créée trois ans auparavant par Max-Pol Fouchet, un organe qui deviendra sous l’Occupation une tribune intellectuelle de référence. Engagé dans les Spahis algériens à Batna, il prend part aux combats contre l’Afrika korps du maréchal Rommel en Tunisie 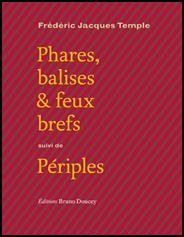 et embarque pour l’Italie avec le Corps expéditionnaire français du général Alphonse Juin. Jalons de la Campagne d’Italie, les Abruzzes, Monte Cassino et le Garigliano dont il témoigne dans des ouvrages (La Route de San Romano, Les Eaux mortes) lui valent la sympathie de l’écrivain et journaliste italien Curzio Malaparte. D’autres rencontres catalyseront en amitiés durables, celles d’Henri Pichette, Henry Miller, Joseph Delteil, Blaise Cendrars, Joë Bousquet et Pierre Soulages. Jusqu’à la création du groupe de la Licorne, en 1949, avec les poètes Henk Breuker (Hollandais) et François Cariès, un cénacle qui ouvre une librairie à Montpellier, publie des Cahiers de poésie et édite une feuille littéraire baptisée Prospectus.
et embarque pour l’Italie avec le Corps expéditionnaire français du général Alphonse Juin. Jalons de la Campagne d’Italie, les Abruzzes, Monte Cassino et le Garigliano dont il témoigne dans des ouvrages (La Route de San Romano, Les Eaux mortes) lui valent la sympathie de l’écrivain et journaliste italien Curzio Malaparte. D’autres rencontres catalyseront en amitiés durables, celles d’Henri Pichette, Henry Miller, Joseph Delteil, Blaise Cendrars, Joë Bousquet et Pierre Soulages. Jusqu’à la création du groupe de la Licorne, en 1949, avec les poètes Henk Breuker (Hollandais) et François Cariès, un cénacle qui ouvre une librairie à Montpellier, publie des Cahiers de poésie et édite une feuille littéraire baptisée Prospectus.
Un homme de radio et de télévision
Blaise Cendrars et Joseph Delteil ont parrainé ses débuts en journalisme en 1948. Démobilisé en janvier 1946, il a déjà « pigé » dans des journaux et magazines à Paris et au Maroc. De 1948 à 1954, au Centre d’essai radiophonique de Montpellier créé et dirigé par Pierre Bourgoin, il produit des émissions consacrées à la littérature, aux voyages et aux arts (Du monde entier au cœur du monde, Larguez les amarres, Carnet de poche). À partir de 1950, il exerce parallèlement une activité à plein temps d’agent commercial pour la  société pétrolière Antar. Nommé en 1954 responsable de la RTF (Radiodiffusion-télévision française) pour le Languedoc-Roussillon (stations de Montpellier, Nîmes et Perpignan), il assure jusqu’à sa retraite en 1986 les mêmes fonctions directoriales au sein de l’institution devenue ORTF (Office de radiodiffusion-télévision française) puis FR3 (France Régions 3). À la radio de Montpellier, il reçoit des écrivains et des artistes : Richard Aldington, Georges Brassens, Henry Miller, Joseph Delteil, Lawrence Durrell, Nicolas Guillén, Camilo José Cela, Federico Mompou, entre autres. Il conçoit et tourne plusieurs films à destination du petit écran : Chez Lawrence Durrell réalisé par Daniel Costelle, L’Itinéraire du Hussard (d’après Giono), André Chamson ou La Terre Promise avec Jean Carrière, Jean Hugo ou Un reflet du Paradis avec Jacques Rouré, Le Monde merveilleux de Paul Gilson réalisé par Philippe Agostini avec Nino Frank. « Plus largement, remarque Pierre-Marie Héron, le poète a aimé utiliser la radio au service de la poésie imprimée, en lançant des poèmes comme on lance des graines, avec l’espoir qu’ils germent "dans la conscience des auditeurs". » Il y dénonce aussi le « négationnisme culturel dont souffre le Sud », selon la formule de l’écrivain et dramaturge Jean-Claude Forêt, se qualifiant en 1970 au revuiste Jean Chatard (Le Puits de l’Ermite) « comme un occitan de langue française. Francophone, mais occitan. J’espère que le montre ce que j’écris ».
société pétrolière Antar. Nommé en 1954 responsable de la RTF (Radiodiffusion-télévision française) pour le Languedoc-Roussillon (stations de Montpellier, Nîmes et Perpignan), il assure jusqu’à sa retraite en 1986 les mêmes fonctions directoriales au sein de l’institution devenue ORTF (Office de radiodiffusion-télévision française) puis FR3 (France Régions 3). À la radio de Montpellier, il reçoit des écrivains et des artistes : Richard Aldington, Georges Brassens, Henry Miller, Joseph Delteil, Lawrence Durrell, Nicolas Guillén, Camilo José Cela, Federico Mompou, entre autres. Il conçoit et tourne plusieurs films à destination du petit écran : Chez Lawrence Durrell réalisé par Daniel Costelle, L’Itinéraire du Hussard (d’après Giono), André Chamson ou La Terre Promise avec Jean Carrière, Jean Hugo ou Un reflet du Paradis avec Jacques Rouré, Le Monde merveilleux de Paul Gilson réalisé par Philippe Agostini avec Nino Frank. « Plus largement, remarque Pierre-Marie Héron, le poète a aimé utiliser la radio au service de la poésie imprimée, en lançant des poèmes comme on lance des graines, avec l’espoir qu’ils germent "dans la conscience des auditeurs". » Il y dénonce aussi le « négationnisme culturel dont souffre le Sud », selon la formule de l’écrivain et dramaturge Jean-Claude Forêt, se qualifiant en 1970 au revuiste Jean Chatard (Le Puits de l’Ermite) « comme un occitan de langue française. Francophone, mais occitan. J’espère que le montre ce que j’écris ».
Rêves d’enfance
 L’auront durablement marqué James Fenimore Cooper, Jack London, Henry David Thoreau et Jules Verne dont il dévore les écrits après les cours, entre 1928 et 1936, à l’Enclos Saint-François, un collège à l’anglaise bâti sur des terrains occupés par des vignes incultes et d’antiques écuries. Dans l’institution montpelliéraine fondée par le chanoine Charles Prévost, il découvre en rêve l’Amérique et ressent une impérieuse vocation pour les mots et les voyages. Ces voyages seront autant nombreux que féconds, en Europe, en Afrique du Nord et aux Amériques. Dans les Laurentides, au nord de Montréal, il entretient un fraternel compagnonnage avec le poète Gaston Miron rencontré en 1980. Au Nouveau-Mexique, chez les indiens Pueblos, il poursuit l’exploration des voies d’une « nouvelle alliance entre l’homme et la nature ». « Appelez-le Achab, incite Alain Borer dans la préface de "Phares, balises & feux brefs" (recueil auréolé du prix Apollinaire en 2013) : il vous raconte ses pêches à la baleine au large de Nantucket, explique comment dépecer le chacal, dans le grand Sud marocain, puis tanner sa peau au soleil et au sel. » « Cet amateur de lointains inaccessibles est un remarquable poète, souligne Jean Carrière, un écrivain qui prend les mots dans une pâte bien fermentée, comme celle du pain complet. » « L’écriture de Temple balance entre deux postulations opposées, considère François Amy de la Bretèque (professeur émérite d’études cinématographiques à l’université Paul-Valéry Montpellier 3). La première est le style sec, celui du Code civil comme aurait dit Stendhal, celui des notes du journaliste. La deuxième est au contraire le style "fleuri", épanoui, où l’écriture prend son temps, la phrase se développe, les adjectifs souvent rares s’accumulent. Elles renvoient, selon moi, à deux modèles visuels distincts, le style sec de "La Route de San Romano" et le style lent des romans. » « Les poèmes de Temple, analyse Robert Sabatier ("Histoire de la poésie française", Albin Michel, 1988), reproduisent les mouvements de la vie chaude et sensuelle, palpitante, plus solaire que nocturne et mystérieuse cependant, avec ses tensions, ses torsions, ses correspondances, ses battements de sang dans les artères. Les éléments, les saisons, les forces telluriques parcourent les unions de mots en d’intenses vibrations, comme si l’homme portait dans son corps l’univers qui le porte ».
L’auront durablement marqué James Fenimore Cooper, Jack London, Henry David Thoreau et Jules Verne dont il dévore les écrits après les cours, entre 1928 et 1936, à l’Enclos Saint-François, un collège à l’anglaise bâti sur des terrains occupés par des vignes incultes et d’antiques écuries. Dans l’institution montpelliéraine fondée par le chanoine Charles Prévost, il découvre en rêve l’Amérique et ressent une impérieuse vocation pour les mots et les voyages. Ces voyages seront autant nombreux que féconds, en Europe, en Afrique du Nord et aux Amériques. Dans les Laurentides, au nord de Montréal, il entretient un fraternel compagnonnage avec le poète Gaston Miron rencontré en 1980. Au Nouveau-Mexique, chez les indiens Pueblos, il poursuit l’exploration des voies d’une « nouvelle alliance entre l’homme et la nature ». « Appelez-le Achab, incite Alain Borer dans la préface de "Phares, balises & feux brefs" (recueil auréolé du prix Apollinaire en 2013) : il vous raconte ses pêches à la baleine au large de Nantucket, explique comment dépecer le chacal, dans le grand Sud marocain, puis tanner sa peau au soleil et au sel. » « Cet amateur de lointains inaccessibles est un remarquable poète, souligne Jean Carrière, un écrivain qui prend les mots dans une pâte bien fermentée, comme celle du pain complet. » « L’écriture de Temple balance entre deux postulations opposées, considère François Amy de la Bretèque (professeur émérite d’études cinématographiques à l’université Paul-Valéry Montpellier 3). La première est le style sec, celui du Code civil comme aurait dit Stendhal, celui des notes du journaliste. La deuxième est au contraire le style "fleuri", épanoui, où l’écriture prend son temps, la phrase se développe, les adjectifs souvent rares s’accumulent. Elles renvoient, selon moi, à deux modèles visuels distincts, le style sec de "La Route de San Romano" et le style lent des romans. » « Les poèmes de Temple, analyse Robert Sabatier ("Histoire de la poésie française", Albin Michel, 1988), reproduisent les mouvements de la vie chaude et sensuelle, palpitante, plus solaire que nocturne et mystérieuse cependant, avec ses tensions, ses torsions, ses correspondances, ses battements de sang dans les artères. Les éléments, les saisons, les forces telluriques parcourent les unions de mots en d’intenses vibrations, comme si l’homme portait dans son corps l’univers qui le porte ».
Frédéric Jacques Temple © Oxana Khlopina

- Les Univers de Frédéric Jacques Temple, sous la direction de Pierre-Marie Héron et Claude Leroy, Presses universitaires de la Méditerranée, 390 pages, 2014 ;
- Phares, balises & feux brefs suivi de Périples, de F. J. Temple, éditions Bruno Doucey, 144 pages, 2012 ;
- Dans l’erre des vents, de F. J. Temple, éditions Bruno Doucey, 88 pages, 2017 ;
- Le Chant des limules, de F. J. Temple, éd. Actes Sud, 120 pages, 2003 ;
- Beaucoup de jours, de F. J. Temple, éd. Actes Sud, 400 pages, 2009.
Varia : la demande d’asile en France
« Les étrangers sollicitant l’asile doivent démontrer que les motifs qui les ont poussés à venir en France sont en accord avec ceux stipulés par la convention de Genève de 1951 qui définit un réfugié comme étant une personne "craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, [qui] se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel  elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut, ou en raison de ladite crainte ne veut y retourner".
elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut, ou en raison de ladite crainte ne veut y retourner".
« En 2012, 41 254 personnes de plus de soixante-dix nationalités différentes ont demandé l’asile en France. Parmi les premiers pays de provenance on comptait la République démocratique du Congo, la Russie, le Sri Lanka, le Kosovo, la Chine et le Pakistan. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides estimait à 176 984 le nombre de personnes sous sa protection en 2012, sans compter les mineurs accompagnant au moins un parent.
« En 2012, le taux de reconnaissance du statut de réfugié était de 9,4 % en première instance, et de 16,6 % après un recours. Les pourcentages pour la période de mon enquête oscillaient entre 8 et 16 % en première instance, et entre 11 et 25 % au recours. Faute de statistiques officielles, l’association France Terre d’asile avait effectué à cette époque une comparaison montrant que les requérants hébergés en CADA, Centre d’accueil pour demandeurs d’asile en France (4 150 places réparties dans soixante centres sous sa gestion) obtenaient l’asile en première instance à 71,3 %, alors que ce taux n’était que de 16,4 % au niveau national (2005).
« Depuis 1991, une circulaire interdit le droit au travail aux demandeurs d’asile. Plus précisément, cette régulation stipule que si, à l’occasion d’une offre d’emploi, aucun candidat de l’Union européenne ne se présente, un demandeur d’asile peut y prétendre avec succès. Elle exige par ailleurs que ce dernier soit entré régulièrement sur le territoire. Actuellement, dans le cadre de la transposition de la directive européenne dite "accueil", le requérant peut solliciter une autorisation provisoire de travail s’il n’a pas le résultat de sa demande d’asile au bout d’un an ou s’il a déposé un recours contre un premier rejet. La personne est alors soumise aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers ; l’accès au marché de l’emploi étant prioritairement réservé aux nationaux et aux étrangers en situation régulière, il ne sera autorisé à occuper un poste que si, dans la branche d’activité et la zone géographique considérées, le nombre de demandes d’emploi n’est pas supérieur au nombre des offres. Dans la pratique, l’obtention de cette autorisation est de fait exceptionnelle. Au cours de mon terrain, je n’ai jamais rencontré de demandeur d’asile travaillant avec une telle autorisation. Cela ne change donc en rien l’impossibilité pratique de travailler légalement introduite par la circulaire de 1991. »
Extrait de « Le temps dilaté, l’espace rétréci : le quotidien des demandeurs d’asile », une étude de Carolina Kobelinsky, de l’École des hautes études hispaniques et ibériques, Casa de Velázquez de Madrid, étude issue de la revue « Terrain », éditions de la Maison des sciences de l’homme, n° 63, septembre 2014, 164 pages, dans un dossier intitulé « Attendre ».
Carnet : petits secrets et petits-enfants
J’observe l’aïeule à la dérobée : sa parentèle célèbre son quatre-vingtième anniversaire dans ce parc cerné de pins parasols. Quels secrets cache-t-elle, quels trésors comme celui-là qui envahit tristement son visage alors qu’elle regarde jouer ses petits-enfants ?
Vertige du témoin
Des gendarmes, des sapeurs-pompiers et une ambulance qui emmène vraisemblablement un blessé : un accident de la circulation s’est produit quelques instants auparavant sur la route de Ponteau, à Martigues. Le témoin que je suis ressent comme un vertige sa propre responsabilité d’automobiliste et l’importance de la vie d’autrui, ainsi que la portée inimaginable des imprudences.
(Mercredi 12 avril 2017)
Réunion familiale
Vins capiteux des Côtes-du-Rhône, la provision d’optimisme a échauffé les esprits. Et la discussion, au lieu de prolonger des propos inoffensifs, s’est mise à tourner sur elle-même avec les mêmes incompréhensions comme un vieux comédien qui sourit et s’incline sans cesse sur le devant de la scène.
(Jeudi 4 mai 2017)
Lecture critique
Des noms pas faciles à porter
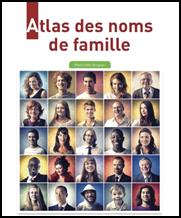 Avec l’Italie et les anciennes colonies françaises du continent africain, la France est en tête des pays réunissant le plus grand nombre de familles portant des patronymes aussi savoureux ou/et inattendus qu’Assassin, Batard, Bobard, Bourrique, Cléopâtre, Cocu, Cornichon, Crétin, Gogo, Pochard, Saligot, Spaghetti et Vilain. L’« Atlas des noms de famille en France » (éditions Archives & Culture) rassemble un florilège de ces noms pour le moins insolites. Laurent Fordant, son auteur, nous apprend ainsi qu’un sieur Croquemort exerce la profession de médecin, qu’un autre nommé Bourreau est chirurgien-dentiste, qu’un adjudant Vachier fait carrière dans l’infanterie de marine, et que l’abbé Clochard exerce son ministère dans cinq paroisses des Deux-Sèvres. Il souligne d’autres curiosités : presque tous les Coucou du pays ont tressé leur nid en Gironde ! Les Nichon se dissimulent dans le département du Cher. Les Robinet coulent des jours heureux au cœur des Ardennes. Les Python ont colonisé la Haute-Savoie. Un tiers des Loubard de l’hexagone est issu d’Ille-et-Vilaine. Et que dire des Bonaparte qui ont fait souche, non en Corse-du-Sud, mais dans le Calvados ?
Avec l’Italie et les anciennes colonies françaises du continent africain, la France est en tête des pays réunissant le plus grand nombre de familles portant des patronymes aussi savoureux ou/et inattendus qu’Assassin, Batard, Bobard, Bourrique, Cléopâtre, Cocu, Cornichon, Crétin, Gogo, Pochard, Saligot, Spaghetti et Vilain. L’« Atlas des noms de famille en France » (éditions Archives & Culture) rassemble un florilège de ces noms pour le moins insolites. Laurent Fordant, son auteur, nous apprend ainsi qu’un sieur Croquemort exerce la profession de médecin, qu’un autre nommé Bourreau est chirurgien-dentiste, qu’un adjudant Vachier fait carrière dans l’infanterie de marine, et que l’abbé Clochard exerce son ministère dans cinq paroisses des Deux-Sèvres. Il souligne d’autres curiosités : presque tous les Coucou du pays ont tressé leur nid en Gironde ! Les Nichon se dissimulent dans le département du Cher. Les Robinet coulent des jours heureux au cœur des Ardennes. Les Python ont colonisé la Haute-Savoie. Un tiers des Loubard de l’hexagone est issu d’Ille-et-Vilaine. Et que dire des Bonaparte qui ont fait souche, non en Corse-du-Sud, mais dans le Calvados ?
Registre paroissial et livret de famille
« L’origine des patronymes tels qu’ils existent aujourd’hui se situe au XIIe siècle, explique l’historienne et généalogiste Marie-Odile Mergnac. À cette époque, les individus ont des prénoms, souvent bibliques, peu variés (Abel, Isaac, Samuel ou Simon). Pour distinguer les homonymes entre voisins, on se donne des surnoms : Jean le Petit, Jean de la Rivière… Ceux-ci qui dès lors dénotent une grande variété se transmettent ensuite de façon héréditaire, par le père. » À partir du Moyen Âge, les surnoms donnés puisent leurs caractéristiques dans le physique (Chauve, Legras, Leroux), la morale (Brave), la géographie (Bayonne, Picard), la topographie (Dujardin, Duval, Delalande, Pommier), la profession (Boulanger, Fournier, Masson) ainsi que dans les patois des provinces françaises. Ainsi une même caractéristique distinguait le chef de famille de noms différents suivant les régions : le forgeron s’appelait « Maréchal » dans le Val de Loire, « Lefèvre » dans le Nord-Pas-de-Calais, « Le Goff » en Bretagne, « Favre » dans le Sud-Est ou « Schmitt » en Alsace-Lorraine ; hors de France, on le nomme « Smith » en Angleterre, « Herrera » en Espagne  et « Kovac » en Serbie. En 1539, l’inscription de ces (sur)noms dans les registres paroissiaux devient obligatoire ; mais la transcription apparaît souvent approximative et fluctuante, la majorité de la population étant analphabète. Instauré en 1877, le livret de famille imposera et fixera une orthographe définitive. Nombre de nos contemporains s’efforcent aujourd’hui de trouver l’origine de leur nom auprès d’officines généalogistes. Certains sont parfois très étonnés de découvrir que leur patronyme a été forgé tardivement ou qu’il a été choisi par une tierce personne voire une institution. Ainsi, au lendemain d’un décret napoléonien de 1808, les familles juives qui étaient dépourvues de nom - car il n’existait que des registres tenus par des prêtres catholiques - ont dû se choisir un patronyme. Ce fut aussi le cas des esclaves antillais affranchis en 1848, lesquels étaient désignés par leur unique prénom, des enfants trouvés et des personnes jugeant leur nom malsonnant ou stigmatisant.
et « Kovac » en Serbie. En 1539, l’inscription de ces (sur)noms dans les registres paroissiaux devient obligatoire ; mais la transcription apparaît souvent approximative et fluctuante, la majorité de la population étant analphabète. Instauré en 1877, le livret de famille imposera et fixera une orthographe définitive. Nombre de nos contemporains s’efforcent aujourd’hui de trouver l’origine de leur nom auprès d’officines généalogistes. Certains sont parfois très étonnés de découvrir que leur patronyme a été forgé tardivement ou qu’il a été choisi par une tierce personne voire une institution. Ainsi, au lendemain d’un décret napoléonien de 1808, les familles juives qui étaient dépourvues de nom - car il n’existait que des registres tenus par des prêtres catholiques - ont dû se choisir un patronyme. Ce fut aussi le cas des esclaves antillais affranchis en 1848, lesquels étaient désignés par leur unique prénom, des enfants trouvés et des personnes jugeant leur nom malsonnant ou stigmatisant.
La France, championne des patronymes
L’histoire des patronymes n’est pas toujours celle qu’on croit. Autrefois, « connard » signifiait brave et hardi tandis que bordel qualifiait une ferme en bois. « Dans le Toulousain, explique M.-O. Mergnac, Bataille désignait le sonneur de cloches alors que dans la région de Lille, il signalait des gens bagarreurs. » « L’ancêtre des Lelièvre avait de grandes oreilles, ironise le généalogiste Jean-Louis Beaucarnot ; il courait très vite ou au contraire si lentement que, par dérision, on l’appelait Lelièvre ». Selon Mme Mergnac, les surnoms des cours d’école ont intégré massivement le processus de dénomination. « Il est important, parfois, de réconcilier les gens avec leur nom, estime M. Beaucarnot, qui se souvient d’un M. Soutif rassuré d’apprendre que son patronyme venait du mot « soutil », signifiant « subtil, avisé ».
« Aujourd’hui, huit noms de famille sur dix sont portés par moins de cinquante personnes en France, remarque Mme Mergnac. Et si 300 000 individus s’appellent "Martin", 300 000 Français sont seuls à porter leur patronyme. » Songez en tout cas que la France détient le record du monde du nombre de patronymes : on y recense 1 200 000 noms de famille, contre seulement 1 200 en Chine…
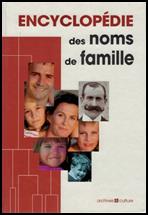
- Atlas des noms de famille, par Marie-Odile Mergnac, éditions Archives & Culture, 128 pages, 2014 ;
- Les Noms de famille et leurs secrets, de Jean-Louis Beaucarnot, éditions Robert Laffont, 336 pages, 2013 ;
- Encyclopédie des noms de famille, sous la direction de Marie-Odile Mergnac, éditions Archives & Culture, 592 pages, 2002 ;
- Atlas des noms de famille en France, par Laurent Fordant, éditions Archives & Culture, 190 pages, 1999.
Portrait
Marcel Broodthaers ou le fils à dada
 Le poète Marcel Broodthaers (Saint-Gilles-Bruxelles, 28 janvier 1924-Cologne, 28 janvier 1976) s’inscrit dès 1940 dans la filiation de René Magritte (Lessines, 1898-Bruxelles, 1967) dont l’influence ne se démentira à aucun moment dans les différents moments de ses travaux littéraires, cinématographiques et plastiques. Proche du groupe surréaliste-révolutionnaire (mouvement littéraire et artistique né en France vers 1919 et disparu en 1969), il vit de sa plume jusqu’en 1963 à Bruxelles effectuant quelques incursions à Paris et publiant plusieurs recueils dont Mon livre d’ogre, Minuit, La Bête noire et Pense-Bête : « C’étaient des poèmes, commente-t-il, signes concrets d’engagement, car sans récompense ». Marié à Maria Gilissen rencontrée en 1961, il a trente-neuf ans et un passé de reporter-photographe et de guide d’expositions lorsqu’il se décide à devenir artiste plasticien. Il plante alors dans le plâtre les derniers cinquante exemplaires de son ultime plaquette de poésie (Pense-Bête). Il en expose la sculpture, en avril 1964, chez Philippe Édouard Toussaint, galerie Saint-Laurent, à Bruxelles, intitulant l’exposition Moi aussi je me suis demandé si je ne pouvais pas vendre quelque chose et réussir dans la vie… « En ouvrant un espace dans lequel l’art plastique et la poésie fusionnent et contractent des relations inaccoutumées, il a inventé une forme d’art imprévue », assure l’écrivain et curateur Wilfried Dickhoff (Cologne, 1953) dans « Marcel Broodthaers - Livre d’images », le bel ouvrage composé par la fille du peintre, Marie-Puck Broodthaers.
Le poète Marcel Broodthaers (Saint-Gilles-Bruxelles, 28 janvier 1924-Cologne, 28 janvier 1976) s’inscrit dès 1940 dans la filiation de René Magritte (Lessines, 1898-Bruxelles, 1967) dont l’influence ne se démentira à aucun moment dans les différents moments de ses travaux littéraires, cinématographiques et plastiques. Proche du groupe surréaliste-révolutionnaire (mouvement littéraire et artistique né en France vers 1919 et disparu en 1969), il vit de sa plume jusqu’en 1963 à Bruxelles effectuant quelques incursions à Paris et publiant plusieurs recueils dont Mon livre d’ogre, Minuit, La Bête noire et Pense-Bête : « C’étaient des poèmes, commente-t-il, signes concrets d’engagement, car sans récompense ». Marié à Maria Gilissen rencontrée en 1961, il a trente-neuf ans et un passé de reporter-photographe et de guide d’expositions lorsqu’il se décide à devenir artiste plasticien. Il plante alors dans le plâtre les derniers cinquante exemplaires de son ultime plaquette de poésie (Pense-Bête). Il en expose la sculpture, en avril 1964, chez Philippe Édouard Toussaint, galerie Saint-Laurent, à Bruxelles, intitulant l’exposition Moi aussi je me suis demandé si je ne pouvais pas vendre quelque chose et réussir dans la vie… « En ouvrant un espace dans lequel l’art plastique et la poésie fusionnent et contractent des relations inaccoutumées, il a inventé une forme d’art imprévue », assure l’écrivain et curateur Wilfried Dickhoff (Cologne, 1953) dans « Marcel Broodthaers - Livre d’images », le bel ouvrage composé par la fille du peintre, Marie-Puck Broodthaers.
Une œuvre d’une incroyable profusion
Disparu le jour de son 52e anniversaire, en 1976, à Cologne où il résidait, il laisse une œuvre d’une incroyable profusion dont rend compte l’ouvrage : longs et courts-métrages, photographies, livres, dessins, objets, décors, sculptures, gravures, éphéméra, spatialisations texte-image, ainsi qu’une œuvre littéraire rassemblant des écrits théoriques et poétiques. Parmi les films et éditions remarquables, il convient de citer, pour la filmographie : La Clef de l’horloge -en l’honneur de Kurt Schwitters (1957), Le Corbeau et le Renard - d’après La Fontaine (1967), La Pipe satire (1969) et La Bataille de Waterloo (1975) ; pour les éditions : La Faute d’orthographe - Mea Culpa (1964), Rébus (1973), Les Animaux de la ferme (1975) et La Conquête de l’Espace. Atlas à l’usage des artistes et des militaires (1975).
Ses poèmes sont des objets, ses objets sont des mots : coquilles d’œuf, moules, frites, morceaux de bois, charbon, typographies, bouteilles, plastique embouti, apprêtés à la fois sur des supports ordinaires, tels table, chaise, marmite, pots, pelle, et des équipements techniques, comme des toiles photographiques et des écrans. Il propose des décors (terme préféré à installation), des films et des sortes de ready-made en référence à des écrivains, des poètes, des personnages qu’il admire au nombre desquels Charles Baudelaire, Marcel Duchamp, Jean de la Fontaine, Stéphane Mallarmé, Joseph Beuys, Honoré Daumier, René Magritte, Kurt Schwitters, Jacques Offenbach, Richard Wagner et Sigmund Freud. En 1968, il fonde à son domicile de la rue de la Pépinière, à Bruxelles, son propre Musée d’art moderne, département des Aigles, un musée itinérant principalement constitué de fiches, de cartes postales et d’emballages et dont il assume la conservation jusqu’en 1972. Résident londonien l’année suivante, il y montre en 1975, à l’Institut d’art contemporain (New Gallery), une exposition appelée Décor, a conquest by Marcel Broodthaers, où il met en scène des objets de location.
Une réflexion acide sur le statut de l’art
Deux manifestations d’importance interviennent en cette même année 1975, à quelques mois seulement de sa disparition. Au Centre national Georges Pompidou, à Paris, L’Angelus de Daumier permet au public de lire des objets puis de les nommer dans l’ordre de leur présentation, et cela dans le but de reconstituer des phrases polysémiques. À la Städtische Kunsthalle de Düsseldorf, 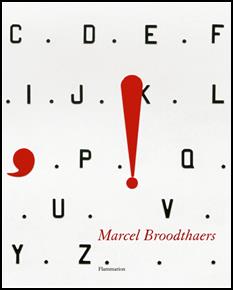 il rassemble sous le titre « L’aigle de l’oligocène jusqu’à nos jours », à l’enseigne de sa « Section des figures », plus de 300 tableaux (objets, sculptures, publicités, etc.) provenant de 44 musées ou collections privées, tous marqués du symbole de l’aigle. À chaque pièce inventoriée est annexé un cartel qui indique « Ceci n’est pas un objet d’art », « formule obtenue par la contraction d’un concept de Duchamp et d’un concept antithétique de Magritte, explique-t-il, ce qui m’a servi à décorer l’urinoir de Duchamp de l’insigne de l’Aigle fumant la pipe »… Fatalement qualifié de conceptuel et confronté au dadaïsme et au minimal, « son travail constitue plutôt, selon l’historien de l’art Gérard Durozoi (Paris, 1942) une réflexion acide sur le statut de l’art - et du musée - dans la société contemporaine, par le biais de mini-fictions dérisoires, d’allusions à la culture officielle, d’objets volontairement insignifiants, de dessins simultanément ironiques et déprimants ».
il rassemble sous le titre « L’aigle de l’oligocène jusqu’à nos jours », à l’enseigne de sa « Section des figures », plus de 300 tableaux (objets, sculptures, publicités, etc.) provenant de 44 musées ou collections privées, tous marqués du symbole de l’aigle. À chaque pièce inventoriée est annexé un cartel qui indique « Ceci n’est pas un objet d’art », « formule obtenue par la contraction d’un concept de Duchamp et d’un concept antithétique de Magritte, explique-t-il, ce qui m’a servi à décorer l’urinoir de Duchamp de l’insigne de l’Aigle fumant la pipe »… Fatalement qualifié de conceptuel et confronté au dadaïsme et au minimal, « son travail constitue plutôt, selon l’historien de l’art Gérard Durozoi (Paris, 1942) une réflexion acide sur le statut de l’art - et du musée - dans la société contemporaine, par le biais de mini-fictions dérisoires, d’allusions à la culture officielle, d’objets volontairement insignifiants, de dessins simultanément ironiques et déprimants ».
Dès lors qu’elle intègre le circuit marchand et la publicité, considérait-il, l’activité artistique atteint le sommet de la vulgarité et de l’inauthenticité. Aussi identifiait-t-il le Pop Art américain à l’expression du système économique. En fait, « Marcel Broodthaers s’est toujours défié des prétentions messianiques de l’art, estime le critique d’art Marcadé (Bordeaux, 1948). Il développera toute sa vie un art discret, fragile, opposant la faiblesse et la maladresse aux suffisances et outrecuidances des visions du monde se réclamant des "grandes idées" ». Il ne fait aucun doute que la postérité se souviendra de lui entre Marcel Duchamp et René Magritte.
Marcel Broodthaers en 1967
© Photographie Philippe de Gobert
- Marcel Broodthaers - Livre d’images, par Marie-Puck Broodthaers, avec des textes de Wilfried Dickhoff et Bernard Marcadé, éditions Flammarion, 320 pages, 2013.
Lectures complémentaires :
- Dictionnaire de l’art moderne et contemporain, sous la direction de Gérard Durozoi, éditions Hazan, 680 pages, 1993 ;
- Nouveau Dictionnaire des artistes contemporains, par Pascale Le Thorel, éditions Larousse, 360 pages, 2010.
Varia : les temples du ciel
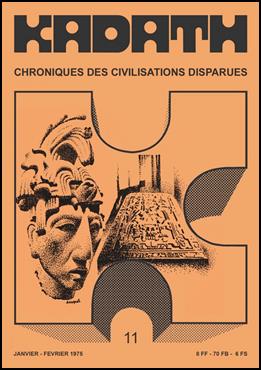 « Qui parle mégalithe fait penser aussitôt à Stonehenge, le grand Temple du Ciel anglais et aux menhirs et dolmens aussi nombreux qu’énigmatiques retrouvés sur presque tous les continents, mais avec prédominance sur les bords atlantiques. Ainsi a-t-on lié le mégalithisme à l’homme dit de Cro-Magnon, brachycéphale, élancé, blond, de type celtique, qui présente la même dispersion. Si certains ont voulu lier le phénomène mégalithique aux Celtes, d’autres l’ont assimilé à des hommes dits aux "vases calice qui s’en allaient par petits groupes, d’un bout à l’autre du monde, répandre une connaissance technique supérieure de la métallurgie (bronze, fer, sans doute même alliages légers).
« Qui parle mégalithe fait penser aussitôt à Stonehenge, le grand Temple du Ciel anglais et aux menhirs et dolmens aussi nombreux qu’énigmatiques retrouvés sur presque tous les continents, mais avec prédominance sur les bords atlantiques. Ainsi a-t-on lié le mégalithisme à l’homme dit de Cro-Magnon, brachycéphale, élancé, blond, de type celtique, qui présente la même dispersion. Si certains ont voulu lier le phénomène mégalithique aux Celtes, d’autres l’ont assimilé à des hommes dits aux "vases calice qui s’en allaient par petits groupes, d’un bout à l’autre du monde, répandre une connaissance technique supérieure de la métallurgie (bronze, fer, sans doute même alliages légers).
Si la pyramide de Chéops (et son phénomène de l’éclair aux équinoxes, nouvellement détecté) a provoqué des discussions quasi sans fin entre savants modernes, archéologues, architectes et hermétistes, c’est qu’il y avait matière à très longue discussion. Et ce n’est pas sans raison, son secret étant une unité de mesure de l’univers révélée dans ses dimensions et que le non moins énigmatique Sphinx désigne venant non pas de l’est, là où se lève le soleil, mais de l’ouest, où se serait englouti, selon Platon, le continent de l’Atlantide. Cette unité de mesure connue des initiés, savants de l’antiquité, Rose-Croix du Moyen Age et de la Renaissance, est symbolisée par le fameux G des francs-maçons et des géomètres, c’est-à-dire le G de la Géométrie et du Graal.
Les données des pyramides se trouvent dans les cathédrales du Moyen Âge, dans celle de Chartres notamment, parce que les constructeurs des cathédrales appartenaient aux compagnonnages initiatiques descendants des constructeurs de l’antiquité, comme Vitruve, dont le savoir venait des prêtres-astronomes dits les "Veilleurs du Ciel". Et ces Veilleurs du Ciel n’appartenaient pas à un culte proprement dit, mais à une Connaissance, à une Gnose représentée par le Un pythagoricien, l’Unité de cette fameuse nuit mythologique ayant engendré le monde visible et invisible, assimilée à un œuf d’argent.
Mesurer l’univers, c’était comprendre Dieu ; mais à cette fin, il fallait mesurer la terre. Ce fut peut-être une des raisons des mégalithes qui tracent des alignements orientés sur les constellations avec une précision ahurissante, qu’a priori on pourrait croire liés à des points de mire réalisés de nuit au moyen de feu, de jour au moyen de fumée, mais qu’excluent des tracés en régions montagneuses et bouleversées, ce qui fait entrer des considérations géométriques, trigonométriques, sinon aériennes, inconciliables avec ce que nous connaissons du passé. Ces Veilleurs du Ciel de l’antiquité, soigneusement camouflés d’ailleurs en "ânes" pour des raisons bien compréhensibles de sécurité, voyageaient beaucoup, avaient des liens d’amitié avec les Veilleurs du Ciel du monde entier, réalisant ainsi une chaîne de tradition initiatique d’enseignement oral. »
Extrait de « Les Temples du ciel », par Alfred Weysen, une chronique issue de la revue « Kadath, chroniques des civilisations disparues », n° 11, janvier-février 1975, 38 pages, Bruxelles.
Carnet : des saisons et de l’opinion
Spécialiste des questions d’énergie et d’environnement, le journaliste Cédric Philibert (auteur de « La Terre brûle-t-elle ? » Calmann-Lévy, 1990) doit toujours et encore redire à nombre de nos contemporains que « les saisons ne doivent pas leur existence à l’orbite elliptique de la Terre, mais bien à l’inclinaison (en grec klino, qui a donné "climat") de l’axe de rotation de notre planète sur elle-même, par rapport au plan de sa rotation autour du Soleil. »
(Mercredi 17 mai 2017)
Salle d’attente
Dans la salle d’attente, ils ne pipent mot, bougent à peine, baissent les yeux, mal assis sur l’arête des fauteuils, intimidés comme des lycéens convoqués par le censeur.
En un éclair !
Le geste du marchand de textile sur le marché forain de Sausset-les-Pins, dimanche matin, m’a littéralement happé quand il déchire le tissu d’un seul coup : l’étoffe s’ouvre exactement droit avec une sorte de sifflement sec et bref, un éclair qui ne permet pas d’erreur.
Le cancer de la haine
Je m’en veux de ne pas avoir entendu les propos qui inquiétaient certains de mes amis. Je n’ai pas su reconnaître le cancer de la haine qui en dévorait les mots. À présent, la haine charrie une ses résurgences les plus noires, la peur, fatal corollaire de l’inquiétude.
(Vendredi 26 mai 2017)
Lecture critique
Le cours magistral de J.-F. Billeter sur l’art chinois de l’écriture
 Pour mener à bien, à la fin des années cinquante, ses séries d’aquatintes sur la tauromachie, Pablo Picasso (1881-1973) se sert de pinceaux que le peintre chinois Zhang Daqian (1899-1983) lui a offerts à Antibes en 1956. « On distingue tout de suite dans votre travail que vous maniez le pinceau avec vigueur, analyse le peintre chinois, mais, voyez-vous, il y a un très gros problème : vous ignorez tout de la façon correcte d’utiliser un pinceau chinois ! Et c’est pareil pour l’encre, continue-t-il en désignant les travaux de son interlocuteur, tous vos traits sont semblables, sans aucune nuance ! »
Pour mener à bien, à la fin des années cinquante, ses séries d’aquatintes sur la tauromachie, Pablo Picasso (1881-1973) se sert de pinceaux que le peintre chinois Zhang Daqian (1899-1983) lui a offerts à Antibes en 1956. « On distingue tout de suite dans votre travail que vous maniez le pinceau avec vigueur, analyse le peintre chinois, mais, voyez-vous, il y a un très gros problème : vous ignorez tout de la façon correcte d’utiliser un pinceau chinois ! Et c’est pareil pour l’encre, continue-t-il en désignant les travaux de son interlocuteur, tous vos traits sont semblables, sans aucune nuance ! »
« L’écriture effilochée, les encrages plats de ce "torero" montrent qu’il n’a tenté à aucun moment de faire jouer la pointe, qu’il s’est contenté d’écrire et d’étaler l’encre à la manière occidentale, renchérit Jean-François Billeter (Bâle, 1939), confirmant l’assertion de Zhang Daqian dans son remarquable "Essai sur l’art chinois de l’écriture et ses fondements" : il ne suffit pas de tenir en main un pinceau chinois pour savoir s’en servir. L’art de manœuvrer la pointe du pinceau constitue le véritable secret de la calligraphie, le précieux savoir que chaque calligraphe hérite de ses devanciers et lègue à ses successeurs. »
Richesse et secrets de la calligraphie
Plusieurs dizaines d’années ont été nécessaires au sinologue bâlois pour acquérir le détachement et la profondeur de champ nécessaires à saisir toute la richesse et la signification cachée de la calligraphie chinoise. Selon lui, l’art de l’écriture est lié à la tradition lettrée confucianiste même si le taoïsme philosophique a imprégné la sensibilité de certains calligraphes de renom. J.-F. Billeter explique que la calligraphie a moins souffert que les autres beaux-arts des vicissitudes de la vie politique en République populaire de Chine parce qu’elle ne pouvait être soumise aux canons du réalisme socialiste. Rappelons que l’écriture chinoise se compose de milliers de caractères qui correspondent chacun à un mot ou à l’idée d’un mot. Les mots du chinois sont monosyllabiques et invariables, la syntaxe y est essentiellement affaire d’ordre des mots dans la phrase. On constate qu’il suffit de 3 730 caractères pour écrire les 44 300 mots les plus fréquents. Un élément de comparaison est apporté par le Grand Dictionnaire des caractères chinois, "Hanyu da zidian" (Chengdu/Wuhan, 1990), qui recense plus de 60 000 caractères, bien que beaucoup d’entre eux restent rarissimes ou désuets ou bien qu’ils reposent sur de simples variantes graphiques. Ces caractères ou idéo-phonogrammes observent un système de classement qui consiste à réunir sous une même rubrique ceux qui ont en commun le même élément pictographique - l’élément de l’arbre par exemple - et à les ordonner ensuite selon le nombre de traits qui s’ajoutent à l’élément classificateur. « Xu Shen (58-148), philologue chinois qui semble avoir inventé ce système, a établi une liste de 540 éléments classificateurs, note J.-F. Billeter. Elle a été remplacée au XVIIe siècle par une liste réduite de 214 éléments qui est restée en usage jusqu’à nos jours. »
Le chiffre de leur identité
Seconde partie de la technique calligraphique (la première concerne l’agencement des caractères), la manœuvre du pinceau est la plus difficile des deux, et la plus importante puisque c’est par elle que le caractère prend vraiment forme et devient une réalité sensible. Les Chinois accordent une certaine importance au fait de « faire tourner le pinceau », formule éloquente à exprimer l’essence d’une technique où il s’agit de faire tourner et virer sur elle-même la pointe de l’instrument sur le papier après l’avoir appliqué sur la pierre à encre. La qualité du pinceau dépend de la qualité de son poil ; les poils - appelés langhao, « poils de loup » - les plus souvent sollicités se trouvent être ceux de la chèvre, du lièvre et de la martre. Extraordinairement résistants et durables, les papiers les plus renommés sont les xuanzhi, les « papiers de Xuan » fabriqués dans la région de Xuancheng (l’ancienne Xuanzhou), dans le sud-est de l’Anhui, notamment à Jingxian. La meilleure pierre est celle des carrières de Duanxi ; appelée duanyan, elle est extraite depuis le VIIIe siècle sur la rive sud des gorges du Xijiang, près de Zhaoqing, dans le Guangdong ! Outre la sigillaire, la chancellerie, la courante et la cursive (gravées sur les stèles, les sceaux, les os, les lamelles de bambou ou coulées dans le bronze), la régulière est restée la forme la plus courante de l’écriture chinoise et n’a pratiquement plus varié jusqu’à la simplification de l’écriture introduite en Chine populaire dès 1956.
Le caractère calligraphié demeure pour les Chinois comme le chiffre de leur identité, nous apprend cet ouvrage. Exécutants ou simples assistants, le rite de l’écriture est pour eux la célébration de leur appartenance à une civilisation unique ; pour nous, il donne accès à l’un des noyaux de la pensée chinoise traditionnelle.
- Essai sur l’art chinois de l’écriture et ses fondements, par Jean-François Billeter, éditions Allia, 416 pages, 2010 ;
- Études sur Tchouang-tseu, par J.-F. Billeter, éd. Allia, 298 pages, 2008.
Relire :
- La Chine selon Jean-François Billeter, un portrait de l’auteur dans la chronique « Papiers collés » n° 9 du printemps 2014.
Portrait
Jean Giono, incomparable romancier
 Sylvie Durbet-Giono, sa fille cadette, a montré quel lecteur boulimique était Jean Giono (Manosque, 30 mars 1895-8 octobre 1970). Les rayons de la bibliothèque du Paraïs à Manosque livrent sans ordre aucun ses affinités littéraires, œuvres complètes de Stendhal, ouvrages de philosophie orientale, textes antiques (une Bible, L’Iliade et les tragiques grecs), les ouvrages de ses amis et les polars de la Série Noire qu’il reçoit tous, quatre volumes par trimestre, et qu’il lit d’affilée, allongé sur le divan, en guise de « lavage de cerveau ». L’éclectisme et la curiosité de l’esthète l’amènent à privilégier un groupe restreint d’auteurs dont certains deviendront des amis : Honoré de Balzac, Jean Carrière, Fiodor Dostoïevski, William Faulkner, Jean Froissart, André Gide, Roger Grenier, Jean Guéhenno, Prosper Mérimée, Machiavel, Jules Michelet, Friedrich Nietzsche, Jean Paulhan, Charles Péguy, Marcel Proust, Jean-Paul Sartre et Virgile. L’écrivain achète la maison du Paraïs, à Manosque, en 1930, grâce au succès de « Colline », son premier roman publié. Située montée des Vraies Richesses, au pied du Mont d’Or, à flanc de coteau, elle livre à la vue le moutonnement des toits rouges de sa ville natale où il ne tardera pas à hisser un hussard… Quelques mois auparavant, le Crédit du Sud-Est où il est employé étant en faillite, il décide de vivre de sa plume.
Sylvie Durbet-Giono, sa fille cadette, a montré quel lecteur boulimique était Jean Giono (Manosque, 30 mars 1895-8 octobre 1970). Les rayons de la bibliothèque du Paraïs à Manosque livrent sans ordre aucun ses affinités littéraires, œuvres complètes de Stendhal, ouvrages de philosophie orientale, textes antiques (une Bible, L’Iliade et les tragiques grecs), les ouvrages de ses amis et les polars de la Série Noire qu’il reçoit tous, quatre volumes par trimestre, et qu’il lit d’affilée, allongé sur le divan, en guise de « lavage de cerveau ». L’éclectisme et la curiosité de l’esthète l’amènent à privilégier un groupe restreint d’auteurs dont certains deviendront des amis : Honoré de Balzac, Jean Carrière, Fiodor Dostoïevski, William Faulkner, Jean Froissart, André Gide, Roger Grenier, Jean Guéhenno, Prosper Mérimée, Machiavel, Jules Michelet, Friedrich Nietzsche, Jean Paulhan, Charles Péguy, Marcel Proust, Jean-Paul Sartre et Virgile. L’écrivain achète la maison du Paraïs, à Manosque, en 1930, grâce au succès de « Colline », son premier roman publié. Située montée des Vraies Richesses, au pied du Mont d’Or, à flanc de coteau, elle livre à la vue le moutonnement des toits rouges de sa ville natale où il ne tardera pas à hisser un hussard… Quelques mois auparavant, le Crédit du Sud-Est où il est employé étant en faillite, il décide de vivre de sa plume.
 L’indicible de la Grande Guerre
L’indicible de la Grande Guerre
Né dans une famille modeste (son père Jean-Antoine, d’origine piémontaise, est cordonnier ; Pauline Pourcin, sa mère, d’origine picarde, est repasseuse), il quitte le collège à seize ans et travaille à l’agence locale du Comptoir d’escompte pour améliorer l’ordinaire de sa famille. L’enfance et l’adolescence le placent dans la familiarité d’une haute Provence bucolique mais rude où il côtoie les éleveurs et les bergers dont l’activité et les rites ancestraux décideront sans nul doute de sa vocation littéraire, originellement poétique (« Naissance de l’Odyssée » et « Pan »). La lecture des Classiques Garnier conforte les secrètes aspirations du commis de banque qui se trouve brutalement confronté au déracinement et à la barbarie sur le front de la Grande Guerre. Du Chemin des Dames au mont Kemmel, la jeune recrue subit l’innommable, le monstrueux des combats de tranchées dont il saura restituer sans pathos l’effroi et l’indicible à travers les pages du « Grand Troupeau » (1931).
 Au lendemain de l’épreuve de la Première Guerre mondiale, il manifeste un pacifisme radical, sans compromission, et dénonce la civilisation industrielle qui conduit inexorablement aux tensions entre les peuples et à l’engagement militaire. Son attachement à la littérature et la passion de l’écriture ne faiblissent point ; ils lui permettent de bâtir la géographie et le caractère d’un « Sud imaginaire » où il va mettre en scène les personnages et les décors de ses prochains romans et chroniques. Le 20 juin 1920, il épouse Élise Maurin, une jeune enseignante qu’il connaît depuis 1914 et à qui il lit ses premiers poèmes : elle lui donnera deux filles, Aline (née le 25 octobre 1926) et Sylvie (née le 11 août 1934).
Au lendemain de l’épreuve de la Première Guerre mondiale, il manifeste un pacifisme radical, sans compromission, et dénonce la civilisation industrielle qui conduit inexorablement aux tensions entre les peuples et à l’engagement militaire. Son attachement à la littérature et la passion de l’écriture ne faiblissent point ; ils lui permettent de bâtir la géographie et le caractère d’un « Sud imaginaire » où il va mettre en scène les personnages et les décors de ses prochains romans et chroniques. Le 20 juin 1920, il épouse Élise Maurin, une jeune enseignante qu’il connaît depuis 1914 et à qui il lit ses premiers poèmes : elle lui donnera deux filles, Aline (née le 25 octobre 1926) et Sylvie (née le 11 août 1934).
Un écrivain de grande lignée
S’il publie en 1937 le pamphlet « Refus d’obéissance » (« Je refuse d’obéir à la guerre »), il manque de prudence en livrant en 1942 à La Gerbe, hebdomadaire compromis avec l’occupant nazi, le roman inachevé « Deux cavaliers de l’orage » dont la publication prendra fin en mars 1943. Au moment des règlements de compte de l’après-guerre, ses adversaires de la droite nationaliste et certains intellectuels de gauche auront tôt fait de rejeter l’initiateur pacifiste des Rencontres du Contadour (lieu-dit sur la montagne de Lure) vers une droite à laquelle il n’appartient pas. Plus que son engagement, l’interprétation qu’en font ses détracteurs lui vaudra d’être emprisonné à deux reprises pendant le deuxième conflit mondial : en 1939 comme antimilitariste et en 1945 comme vichyste.
 Pourtant, l’homme n’a rien du prophète ni du guide moral : il est un écrivain de grande lignée, dans la filiation d’Herman Melville et de Paul Claudel ; il procède de la généalogie de ceux qui ont la folie la plus haute, celle de croire en la parole et au verbe. Aussi me paraît-il vain de vouloir à tout prix distinguer deux ou trois Giono, deux ou trois périodes. À mon sens, circonscrire les manières de Jean Giono risque d’occulter la diversité et la complexité de son œuvre et de ses constantes : la diversité dans le détail, la complexité dans l’agencement du récit, l’analyse des caractères, la mise en scène des relations entre les personnages, entre l’homme et la nature, le passé et le présent, le réel et l’imaginaire, et ces constantes qu’on identifie, telles des basses continues, dans la façon de construire et d’arpenter un espace, dans la qualification sensorielle des lieux, des atmosphères et des êtres, et la saisie des odeurs, des couleurs, des saveurs, des gestes et des bruits. L’œuvre est abondante, protéiforme : poésies, pièces de théâtre, scénarios de cinéma, textes de combat, essais, romans, récits, nouvelles et chroniques.
Pourtant, l’homme n’a rien du prophète ni du guide moral : il est un écrivain de grande lignée, dans la filiation d’Herman Melville et de Paul Claudel ; il procède de la généalogie de ceux qui ont la folie la plus haute, celle de croire en la parole et au verbe. Aussi me paraît-il vain de vouloir à tout prix distinguer deux ou trois Giono, deux ou trois périodes. À mon sens, circonscrire les manières de Jean Giono risque d’occulter la diversité et la complexité de son œuvre et de ses constantes : la diversité dans le détail, la complexité dans l’agencement du récit, l’analyse des caractères, la mise en scène des relations entre les personnages, entre l’homme et la nature, le passé et le présent, le réel et l’imaginaire, et ces constantes qu’on identifie, telles des basses continues, dans la façon de construire et d’arpenter un espace, dans la qualification sensorielle des lieux, des atmosphères et des êtres, et la saisie des odeurs, des couleurs, des saveurs, des gestes et des bruits. L’œuvre est abondante, protéiforme : poésies, pièces de théâtre, scénarios de cinéma, textes de combat, essais, romans, récits, nouvelles et chroniques.
« On écrit toujours sa biographie »
 « Pour saluer Melville » (1941) reste une étonnante biographie imaginaire (qu’il écrit après avoir traduit de l’anglais Moby Dick) ; l’autobiographie est superbement illustrée par « Jean le Bleu » (1932) ; l’intrigue policière surgit entre les pages de « L’Iris de Suse » (1970) ; par sa veine existentielle, « Un roi sans divertissement » (1947) décontenance le lecteur des textes panthéistes d’avant-guerre ; « Un de Baumugnes » (1929) enrichit l’écriture mémorielle de tous les jeux de l’invention romanesque ; « Les Âmes fortes » (1950) livrent un pan réaliste et burlesque de la comédie humaine à travers une histoire racontée à haute voix par deux narratrices ; les quatre titres du « Hussard sur le toit » (1951) forment un haletant roman picaresque doté d’une savante dramaturgie ; « L’homme qui plantait des arbres » (1953) confine à la prédication sociale, au plaidoyer écologique, proche par bien des aspects de « Regain » (1930) où l’auteur dépeint le rapport de l’homme à la nature.
« Pour saluer Melville » (1941) reste une étonnante biographie imaginaire (qu’il écrit après avoir traduit de l’anglais Moby Dick) ; l’autobiographie est superbement illustrée par « Jean le Bleu » (1932) ; l’intrigue policière surgit entre les pages de « L’Iris de Suse » (1970) ; par sa veine existentielle, « Un roi sans divertissement » (1947) décontenance le lecteur des textes panthéistes d’avant-guerre ; « Un de Baumugnes » (1929) enrichit l’écriture mémorielle de tous les jeux de l’invention romanesque ; « Les Âmes fortes » (1950) livrent un pan réaliste et burlesque de la comédie humaine à travers une histoire racontée à haute voix par deux narratrices ; les quatre titres du « Hussard sur le toit » (1951) forment un haletant roman picaresque doté d’une savante dramaturgie ; « L’homme qui plantait des arbres » (1953) confine à la prédication sociale, au plaidoyer écologique, proche par bien des aspects de « Regain » (1930) où l’auteur dépeint le rapport de l’homme à la nature. 
Dans « Giono - La mémoire à l’œuvre », Jean-Yves Laurichesse et Sylvie Vignes (Université de Toulouse-Le Mirail) soulignent avec pertinence la quintessence de l’œuvre d’un incomparable romancier : « Restant toujours à distance de l’autobiographie proprement dite, observent-ils, Jean Giono trouve dans le roman la liberté nécessaire pour faire et refaire ce "portrait de l’artiste par lui-même" ("Noé") qu’est selon lui toute œuvre d’art digne de ce nom : "J’essaie d’aller très loin dans l’expression de moi-même. J’essaie d’exprimer ce que je suis et les sentiments que j’éprouve. Ce sont toujours des autoportraits. Je crois qu’on écrit toujours sa biographie." »
Jean Giono le 2 juin 1963
© Photo Jacques Sassier/Archives éditions Gallimard
- Jean Giono - J’ai ce que j’ai donné, lettres établies, annotées et préfacées par Sylvie Durbet-Giono, éditions Nrf Gallimard, collection haute enfance, 232 pages, 2008 ;
- Le Grand Troupeau, de J. Giono, éd. Nrf Gallimard/Folio, 258 pages, 2015 ;
- Un roi sans divertissement, de J. Giono, éd. Gallimard/Folio, 256 pages, 2016 ;
- Le Chant du monde, de J. Giono, éd. Gallimard/Folio, 288 pages, 2016 ;
- Voyage en Italie, de J. Giono, éd. Gallimard/Folio, 222 pages, 2014 ;
- Provence, de J. Giono, textes réunis et présentés par Henri Godard, éd. Gallimard/Folio, 354 pages, 2016 ;
- Les Âmes fortes, de J. Giono, éd. Gallimard/Folio plus classiques, dossier et notes de Frédérique Parsi, lecture d’image de Bertrand Leclair, 401 pages, 2017 ;
- Le Moulin de Pologne, de J. Giono, éd. Gallimard/Folio, 192 pages, 2016 ;
- Faust au village, de J. Giono, éd. Gallimard/L’Imaginaire, 166 pages, 2008 ;
- L’homme qui plantait des arbres, de J. Giono, images de Joëlle Jolivet, ed. Gallimard Jeunesse, 40 pages, 2010 ;
- Giono - La mémoire à l’œuvre, sous la direction de Jean-Yves Laurichesse et Sylvie Vignes, Presses universitaires du Mirail, 348 pages, 2009.
Varia : Yuxi, berceau des musiciens et de l’hymne national
 « La ville était le noyau de l’ancien royaume Dian, fondé en 278 avant Jésus-Christ par une minorité ethnique du sud-ouest de la Chine, et dont le territoire couvrait principalement le centre et l’est du Yunnan. Après que le royaume Dian se soit désagrégé au cours de la période des Trois Royaumes (220-265) et de la période des Dynasties du Nord et du Sud (222-589), le centre politique et culturel du Yunnan s’est déplacé vers l’ouest à Erhai, et dès lors, Yuxi est entrée dans une période pâle de son histoire.
« La ville était le noyau de l’ancien royaume Dian, fondé en 278 avant Jésus-Christ par une minorité ethnique du sud-ouest de la Chine, et dont le territoire couvrait principalement le centre et l’est du Yunnan. Après que le royaume Dian se soit désagrégé au cours de la période des Trois Royaumes (220-265) et de la période des Dynasties du Nord et du Sud (222-589), le centre politique et culturel du Yunnan s’est déplacé vers l’ouest à Erhai, et dès lors, Yuxi est entrée dans une période pâle de son histoire.
« Après être restée dans le silence pendant plus de mille ans, Yuxi s’est réveillée en sursaut avec les canons du soulèvement de Chongjiu (9 septembre du calendrier chinois) le 30 octobre 1911. Considéré comme partie intégrante de la révolution chinoise de 1911, ce soulèvement a contribué au renversement du gouvernement des Qing (1644-1911) et à la fondation de la République de Chine (1912-1949).
« Si Vienne est la destination spirituelle des grands maîtres de la musique classique, Yuxi est son équivalent pour les musiciens chinois contemporains. C’est notamment la ville natale de Nie Er (1912-1935), compositeur de l’hymne national chinois La Marche des Volontaires. Son nom symbolise la voix d’une nation, exaltant la rêverie musicale de ses compatriotes.
« Dans le parc de Nie Er à Yuxi, on trouve un lac nommé Zhiyin (littéralement "âme sœur") dont la forme ressemble à un violon, accompagnant tranquillement la statue en cuivre de Nie Er installée sur la rive.
« Au-delà du domaine musical, Yuxi reflète aussi le rêve de l’humanité pour la vie. Au pied de la montagne Maotian, on a découvert des fossiles de mollusques vieux de 530 millions d’années. Dans la ville voisine au nord-ouest, les vestiges de l’homme de Yuanmou ont confirmé la présence des hommes dans la région 1,7 million d’années avant. […]
« Beaucoup d’ethnies minoritaires vivent à Yuxi, tels que les YI, Dai, Hani, Lahu, Bai, Miao, Yao et Hui. Ainsi il est très fréquent de pouvoir assister à leurs fêtes ethniques typiques. Par ailleurs, il existe un canton autonome mongol à Yuxi : Xingmeng. Son histoire commence en 1253, lorsque Kubilai Khan, le petit-fils de Gengis Khan, envoya 100 000 soldats dans le Yunnan pour le conquérir. En 1381, à la fin du règne des Yuan, un groupe de fonctionnaires mongols accrédités à Qutuoguan, dans le district de Tonghai, survécurent après avoir réussi à échapper au massacre par les militaires de la dynastie des Ming. Ils sont aujourd’hui le seul groupe perpétuant les caractères de l’ethnie mongole dans le Yunnan. […] »
Extraits de « Yuxi, un jade du Yunnan », un propos de Wu Meiling, dans la revue « La Chine au présent », mars 2015.
Carnet : le miroir aux alouettes
« Faire le Saint-Esprit, nous révèle Pierre Boulle (1912-1994), cela signifie que l’alouette, les ailes étendues immobiles, plane lentement au-dessus du miroir. » Dans « L’Îlon » (1991), son livre de souvenirs, l’écrivain raconte comment, initié par son père à la pratique de la chasse, il tirait la corde pour faire tourner le miroir aux alouettes et comment celles-ci, happées par les miroitements, s’exposaient aux tireurs en faisant le Saint-Esprit.
Parole du passant
« Tous les morts ont le même âge, écrit Jean Sulivan (1913-1980) dans ses chroniques de Parole du passant. C’est une évidence, puisque la mort est la disparition du temps. »
Théâtre à la Bouquerie
Il réside rue de la Bouquerie à Avignon. Il me rappelle que le quartier comptait jadis une corporation de bouchers spécialisés dans la viande de mouton, de chèvre et d’ovins en général. Il m’apprend aussi qu’un jeu de paume y fut édifié au XVIIe siècle où Molière venait jouer ses pièces et qu’il resta dans la famille de Nicolas Mignard, peintre et graveur baroque jusqu’à sa destruction en 1732. La même rue porte aujourd’hui un autre lieu scénique, le théâtre du Grand Pavois, créé en 2008.
(Mardi 2 juin 2017)
Lecture critique
De l’identité et de la modernité de la Bretagne
 Les travaux d’anthropologie ainsi que les études auxquelles se livrent depuis plus de quarante ans les animateurs de la revue trimestrielle Ethnologie française (fondée en 1971 par l’ethnologue Jean Cuisenier [Paris, 1927]) sont indispensables à la compréhension des sociétés et à l’explicitation des enjeux qu’elles suscitent. L’expertise et l’érudition de ses contributeurs permettent le plus souvent d’éclairer les aspects les plus divers, et parfois les plus inattendus, de la société européenne d’aujourd’hui. Les ethnologues y trouvent à la fois le cadre d’un débat fécond et la tribune d’une réflexion où ils s’ouvrent de plus en plus aux historiens, aux philosophes et aux sociologues. Aussi le dossier intitulé « Modernité à l’imparfait. En Bretagne » qui distingue le dernier numéro de l’année 2012 s’inscrit-il tout à fait dans cette démarche pluridisciplinaire.
Les travaux d’anthropologie ainsi que les études auxquelles se livrent depuis plus de quarante ans les animateurs de la revue trimestrielle Ethnologie française (fondée en 1971 par l’ethnologue Jean Cuisenier [Paris, 1927]) sont indispensables à la compréhension des sociétés et à l’explicitation des enjeux qu’elles suscitent. L’expertise et l’érudition de ses contributeurs permettent le plus souvent d’éclairer les aspects les plus divers, et parfois les plus inattendus, de la société européenne d’aujourd’hui. Les ethnologues y trouvent à la fois le cadre d’un débat fécond et la tribune d’une réflexion où ils s’ouvrent de plus en plus aux historiens, aux philosophes et aux sociologues. Aussi le dossier intitulé « Modernité à l’imparfait. En Bretagne » qui distingue le dernier numéro de l’année 2012 s’inscrit-il tout à fait dans cette démarche pluridisciplinaire.
Issus du Centre de recherche bretonne et celtique de l’université de Bretagne occidentale (Brest), Jean-François Simon et Laurent Le Gall qui ont coordonné cette livraison assurent que « la péninsule bretonne n’est ni plus ni moins moderne que n’importe quel autre territoire européen ». « Elle fut toutefois longtemps pensée, remarquent-ils, comme un bon thermomètre des avancées de la modernité puisque son invention en tant que région dotée d’une identité singulière au cours d’un XIXe siècle de l’industrialisation et du bond en avant fut le gage et le résultat d’un processus complexe qui l’archaïsa à l’aide de statistiques (la ligne Saint-Malo-Genève) et d’entreprises scientifiques et culturelles (imaginaire du celtisme, attrait touristique, typification des Bas-Bretons dans les travaux de la Société d’anthropologie de Paris, par exemples). »
La modernité n’est plus ce qu’elle était ? Certainement, mais la Bretagne non plus qui résiste tant bien que mal aux transformations qui affectent son quotidien recomposé, maladroitement parfois, par des enjeux planétaires qui bousculent et/ou changent les habitudes sociales et les mentalités, l’agriculture et l’élevage, la navigation et la pêche, l’environnement et la biodiversité, la religion et la politique, les traditions et le folklore. La révolution socio-économique des années 1950-1960 a profondément modifié les quatre départements de l’Ouest en l’espace de deux décennies. Selon Patrick Le Guirriec (université François Rabelais, Tours), elle a aussi instauré, à l’exemple du pays tout entier, une séparation très franche entre la ville et la campagne, avec l’implantation des entreprises et des politiques d’aménagement du territoire qui ont accentué la périurbanisation. Les festivals de grande consommation, les maisons sans ardoises et sans caractère, les algues vertes, les taux inquiétants d’alcoolisme chez les jeunes citadins, les ports de pêche envahis par les plaisanciers dénaturent avec plus ou moins d’acuité l’identité et l’âme bretonnes. Aussi le Conseil régional s’efforce-t-il de garantir avec l’« exception bretonne » et son rang de septième économie régionale la primauté de ses potaches au baccalauréat (comparativement aux autres régions de l’hexagone), l’activité de ses 900 hôtels, la quiétude de ses 700 campings, le développement de ses 14 000 établissements industriels et la sauvegarde de ses 2 900 monuments historiques. L’institution territoriale revendique de la même manière la singularité culturelle d’une Armorique multiséculaire que défendent et illustrent Paul Sérusier, Paul Gauguin, Raymond Depardon et Edgar Morin, entre autres personnages publics. Dès lors qu’elle se matérialise à travers la culture, confirment Jean-François Simon et Laurent Le Gall, l’identité se mue immanquablement en un objet politiquement exploitable à ne pas négliger. Cette Bretagne-là a la cote, veulent croire les universitaires brestois. La preuve ? Elle cartonne sur les écrans et l’île de Molène a été classée réserve de biosphère par l’Unesco !
- Modernité à l’imparfait. En Bretagne, revue « Ethnologie française », tome 42, octobre-décembre 2012, éditions Presses universitaires de France, publiée avec le concours de l’Institut des sciences humaines et sociales, du Centre national de la recherche scientifique, du Centre national du livre et des Presses universitaires de Paris-Ouest, 220 pages.
Portrait
Blaise Cendrars, aventurier et poète
 « De son propre aveu, il n’a pas exercé moins de trente-six métiers ; mais comme Balzac, il donne l’impression de les connaître tous. En faut-il quelques exemples ? Cendrars fut jongleur sur la scène d’un music-hall anglais à l’époque où Chaplin y faisait lui-même ses débuts : il fut marchand de perles et contrebandier ; il posséda une plantation en Amérique du Sud et y fit trois fois une fortune qu’il dissipa en moins de temps qu’il n’avait mis à l’acquérir. Mais lisez donc sa vie ! Elle est d’une richesse qui passe l’entendement. » En 1951, Henry Miller (1891-1980) connaît déjà les écrits de l’aventurier et poète. À travers un éloge daté du 28 juin 1951 et publié par Les Nouvelles littéraires (« Cendrars, mon maître », 5 janvier 1976, n° 2514), il raconte l’avoir reçu à son domicile parisien, au 18 de la Villa Seurat, visite impromptue intervenue peu après la parution en France de Tropique du Cancer (1934) : Blaise Cendrars (La Chaux-de-Fonds, 1er septembre 1887-Paris, 21 janvier 1961) a perçu, semble-t-il, dans ce roman autobiographique un certain nombre d’échos à sa propre démarche littéraire. « Il frappa un jour à ma porte et me tendit la main de l’amitié, se souvient le romancier américain. Je n’oublie pas non plus cette première critique éloquente et tendre, qui parut presque aussitôt dans "Orbes" sous la signature de Cendrars. » H. Miller place au plus haut « Moravagine » (1926) tout en confiant avoir éprouvé beaucoup de difficultés à en saisir toutes les subtilités à la lecture du texte original lu, au moment où il apprenait le français, à grand renfort de dictionnaire et en émigrant de bistrot en bistrot…
« De son propre aveu, il n’a pas exercé moins de trente-six métiers ; mais comme Balzac, il donne l’impression de les connaître tous. En faut-il quelques exemples ? Cendrars fut jongleur sur la scène d’un music-hall anglais à l’époque où Chaplin y faisait lui-même ses débuts : il fut marchand de perles et contrebandier ; il posséda une plantation en Amérique du Sud et y fit trois fois une fortune qu’il dissipa en moins de temps qu’il n’avait mis à l’acquérir. Mais lisez donc sa vie ! Elle est d’une richesse qui passe l’entendement. » En 1951, Henry Miller (1891-1980) connaît déjà les écrits de l’aventurier et poète. À travers un éloge daté du 28 juin 1951 et publié par Les Nouvelles littéraires (« Cendrars, mon maître », 5 janvier 1976, n° 2514), il raconte l’avoir reçu à son domicile parisien, au 18 de la Villa Seurat, visite impromptue intervenue peu après la parution en France de Tropique du Cancer (1934) : Blaise Cendrars (La Chaux-de-Fonds, 1er septembre 1887-Paris, 21 janvier 1961) a perçu, semble-t-il, dans ce roman autobiographique un certain nombre d’échos à sa propre démarche littéraire. « Il frappa un jour à ma porte et me tendit la main de l’amitié, se souvient le romancier américain. Je n’oublie pas non plus cette première critique éloquente et tendre, qui parut presque aussitôt dans "Orbes" sous la signature de Cendrars. » H. Miller place au plus haut « Moravagine » (1926) tout en confiant avoir éprouvé beaucoup de difficultés à en saisir toutes les subtilités à la lecture du texte original lu, au moment où il apprenait le français, à grand renfort de dictionnaire et en émigrant de bistrot en bistrot…

Un portrait saisissant et véridique de l’écrivain
Cet ouvrage-là, « Moravagine », est sans doute son chef-d’œuvre si on accorde à « L’Or » (1925) la réussite du conteur et les meilleurs accessits à la « Prose du Transibérien » (1913), « Rhum » (1930), « L’Homme foudroyé » (1945), « La Main coupée » (1946) et « Bourlinguer » (1948). Pourquoi est-ce son chef-d’œuvre ? Parce qu’il offre le portrait le plus saisissant, le plus véridique de l’écrivain, du moins tel qu’il se voyait, maudit et idiot. Effrayante histoire dont le « héros » est un rejeton de la famille royale de Hongrie qui s’échappe d’un asile après avoir tué et éventré sa fiancée Rita ; jeune psychiatre fou, Raymond la Science, prend part à la fuite barbare et sanglante de son patient à travers les révolutions et les meurtres… B. Cendrars a rédigé ce roman entièrement de la main gauche, celle du côté du cœur, à la machine à écrire, en la trempant furieusement dans un verre d’eau quand il a frappé trop brutalement sur les touches. 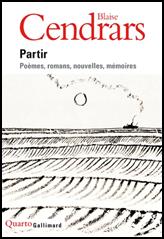 Il en a commencé l’histoire à l’époque où il écrivait des poèmes : il en composa 41 qui révèlent un langage nouveau si vanté par les historiens de la littérature. Il convient de retenir « Les Pâques », un ensemble de cent deux distiques rimés ou assonancés, regroupés en dix-sept séquences, un opus que l’apprenti envoya à son maître, Guillaume Apollinaire, et dont certains prétendent si son poème Zone ne doit pas beaucoup aux Pâques.
Il en a commencé l’histoire à l’époque où il écrivait des poèmes : il en composa 41 qui révèlent un langage nouveau si vanté par les historiens de la littérature. Il convient de retenir « Les Pâques », un ensemble de cent deux distiques rimés ou assonancés, regroupés en dix-sept séquences, un opus que l’apprenti envoya à son maître, Guillaume Apollinaire, et dont certains prétendent si son poème Zone ne doit pas beaucoup aux Pâques.
« Audacieux, il ne cultive pourtant pas l’audace littéraire pour elle-même, explique le critique littéraire Renaud Ego, mais seulement dans la mesure où elle accompagne ou suscite ses propres métamorphoses. Aux grandes laisses épiques des trois premiers poèmes ("Les Pâques", "La Prose du Transsibérien", et "Le Panama") succèdent les mystérieux "Poèmes élastiques", puis après la guerre "Les Sonnets dénaturés" riches de jeux typographiques, et surtout "Kodak", poème-collage réalisé à partir d’un roman-feuilleton de Gustave Le Rouge et d’un livre de Maurice Calmeyn, bien avant les tentatives similaires des poètes objectivistes américains, 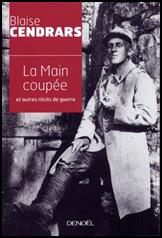 comme Charles Reznikoff ou Louis Zukovfski. » (À la première main du pluriel, revue La Pensée de midi, n° 8, été 2002).
comme Charles Reznikoff ou Louis Zukovfski. » (À la première main du pluriel, revue La Pensée de midi, n° 8, été 2002).
« Le lecteur qui découvre Cendrars est frappé par la discontinuité manifeste de son œuvre, souligne Claude Leroy (professeur à l’université de Paris X-Nanterre) qui a dirigé la première édition critique des textes de l’écrivain. [Son œuvre] se divise en périodes déterminées par des coupures franches, pondérées toutefois par de fortes variations à l’intérieur de chaque série. À la période des poèmes (eux-mêmes bien différents les uns des autres) a succédé celle des romans (qui, de "L’Or" à "Moravagine", ne se ressemblent pas non plus), puis celle des reportages et des histoires vraies, et enfin celle des Mémoires. »
Il ne cesse de brouiller les pistes
Outre Apollinaire, ses autres maîtres spirituels sont Remy de Gourmont, Jules Verne, Gérard de Nerval, Nietzsche, Schopenhauer, Rilke, Knut Hamsun, Gogol, Dostoïevski. L’œuvre est abondante et remplirait un rayon entier de bibliothèque. Il a tâté de tous les genres, même de la publicité, de la peinture et de la musique (il rêvait un temps de devenir musicien). N’a-t-il pas poursuivi des études de musicologie, de médecine, de philosophie et de théologie ?
 Souvent, dans ses récits, les faits sont masqués, les confidences biaisées, les personnages trompeurs, mais l’histoire ressemble curieusement à celle de Frédéric Louis Sauser (ses nom et prénoms véritables) même si le récitant se plaît à escamoter la chronologie de la réalité et de la fiction. Universitaire française originaire de Sibérie, Oxana Khlopina rappelle à bon escient que Cendrars ne cesse de brouiller les pistes : « Combien de fois déjà l’existence de personnages considérés jusque-là par les chercheurs comme purement imaginaires, symboliques, s’est finalement confirmée par la découverte de documents d’archives bien réels. »
Souvent, dans ses récits, les faits sont masqués, les confidences biaisées, les personnages trompeurs, mais l’histoire ressemble curieusement à celle de Frédéric Louis Sauser (ses nom et prénoms véritables) même si le récitant se plaît à escamoter la chronologie de la réalité et de la fiction. Universitaire française originaire de Sibérie, Oxana Khlopina rappelle à bon escient que Cendrars ne cesse de brouiller les pistes : « Combien de fois déjà l’existence de personnages considérés jusque-là par les chercheurs comme purement imaginaires, symboliques, s’est finalement confirmée par la découverte de documents d’archives bien réels. »
« Ce n’est pas sa manière d’écrire qui [attire], si sa façon de vivre. Pas vraiment. C’est sa façon d’exister qui fascine, remarque O. Khlopina - « du monde entier et au cœur du monde »… Inspiration, respiration. Systole et diastole. Un rythme éternel… - C’est la belle réponse que m’a faite le poète Frédéric Jacques Temple [Montpellier, 1921], lorsque je lui demandais en quoi son ami Blaise Cendrars avait influencé son œuvre » (6 mai 2012).
- Moravagine de Blaise Cendrars, par Oxana Khlopina, éditions Infolio, collection Le cippe - études littéraires, 128 pages, 2012 ;
- Partir - Poèmes, romans, nouvelles, mémoires, par Blaise Cendrars, édition établie et présentée par Claude Leroy, Quarto/Gallimard, 1372 pages, 2011 ;
- Poèmes, par B. Cendrars, édition de Camille Weil, illustrations de Donatien Mary, Gallimard/Folio Junior, 96 pages, 2013 ;
- Mon voyage en Amérique, par B. Cendrars, avec les dessins de l’auteur, notices de Christine Le Quellec Cottier, Gallimard/L’Imaginaire, 128 pages, 2015 ;
- La Main coupée et autres récits de guerre, par B. Cendrars, édition de Claude Leroy et Michèle Touret, avant-propos de Miriam Cendrars (fille de l’écrivain), éditions Denoël, 448 pages, 2013.
Varia : la forêt méditerranéenne en question
« La série supra-méditerranéenne du chêne pubescent est, de loin, la succession la plus importante des Alpes du Sud. Le stade climacique est une chênaie médiocre souvent infiltrée de pin sylvestre. La répartition des deux essences est variable, mais on peut estimer que le pin s’épanouit davantage quand le milieu est moins thermophile. Les stades de fruticées ou arbustifs sont dominés par le buis, le genêt cendré et la lavande qui identifient une étape bien marquée de la succession. Les pelouses précédant les formations arbustives sont caractérisées par Brachypodium pinnatum (brachypode penné), par Bromus erectus (brome dressé), par Festuca glauca (fétuque glauque) et Festuca vallesiana (fétuque du Valais). […]
« L’analyse pollinique, dans une démarche de paléoécologie, peut permettre de confirmer la dynamique sur un plus long terme et particulièrement les stades de stabilisation. C’est le cas en Basilicate (Italie du Sud) où un sondage pollinique réalisé en 1975, a montré que la hêtraie du Monte Sirino était présente depuis 3 000 ans sans modifications significatives. On peut en déduire qu’il y a eu une grande stabilité bioclimatique sur ce territoire, mais aussi que ce type de forêt a maintenu un équilibre stable et sans perturbation significative durant cette longue période. On peut donc considérer qu’il s’agit là d’un climax. […]
 « La résilience est l’état de plus forte dégradation subi par un écosystème lui permettant cependant de se redynamiser. En dessous de ce seuil, l’écosystème n’a plus la capacité de redémarrer une dynamique progressive. Il faut bien reconnaître que les potentialités naturelles des écosystèmes leur permettent des réactions positives souvent à un niveau de dégradation important. Encore faut-il que la répétition des perturbations ne constitue pas un blocage définitif avec une perte considérable de biodiversité. […]
« La résilience est l’état de plus forte dégradation subi par un écosystème lui permettant cependant de se redynamiser. En dessous de ce seuil, l’écosystème n’a plus la capacité de redémarrer une dynamique progressive. Il faut bien reconnaître que les potentialités naturelles des écosystèmes leur permettent des réactions positives souvent à un niveau de dégradation important. Encore faut-il que la répétition des perturbations ne constitue pas un blocage définitif avec une perte considérable de biodiversité. […]
« La capacité d’auto-transformation de chaque étape de la succession est étroitement inféodée à la composition spécifique de chacun des stades. La diversité spécifique va jouer un rôle important dans cette transformation favorisant le développement de certaines espèces végétales au détriment d’autres. La situation est identique pour la faune. Par exemple, les microarthropodes du sol vont modifier la nature de la litière au cours de la succession (Orgeas et al. 1998) tout comme les lombrics, ce qui va influencer le devenir de certaines espèces végétales et inversement. Il y aura un contrôle de la végétation sur la dynamique de la matière organique du sol (Quideau 2001). […] »
Extraits de « Dynamique de la végétation - Connaissances et processus », une étude de Gilles Bonin, professeur émérite de l’université de Provence issue d’un dossier « Concilier nature et systèmes productifs en forêt méditerranéenne », dans la revue « Forêt méditerranéenne », tome 36, numéro 4, décembre 2015, Marseille, 100 pages. En couverture, une peinture de David Tresmontant (Paris, 1957), « Au pied de la Sainte-Baume, un matin de mars », huile sur toile, 93 x 73 cm, 2016.
 In memoriam : le peintre
In memoriam : le peintre
Jean-Jacques Ceccarelli n’est plus
D’ascendance italienne, le peintre Jean-Jacques Ceccarelli est mort le vendredi 28 avril 2017 à Marseille où il est né le lundi 20 septembre 1948. Je l’avais rencontré à la fin de la décennie 1980-1990. Souhaitant l’inclure dans une de mes monographies d’artistes, « Ateliers du Sud - L’Esprit des lieux » (Edisud, 2004), nous avions eu plusieurs entretiens dans cette perspective d’avril à juillet 2002 en son atelier de la rue Estelle, à Marseille, dans l’ancien centre d’actinothérapie, une sorte de navire avec ses rambardes et sa verrière de bathyscaphe. « Le dessin, le trait est pour moi un moyen, un mode d’extrapolation, la canne de l’aveugle en somme, m’explique-t-il à cette époque-là. C’est comme un instrument qui me permet de circuler dans un territoire, le territoire de la feuille, le territoire de la toile. Ce qui m’intéresse avec le dessin, c’est d’inscrire du temps dans la page. Le dessin, aussi, c’est comme un tempo, comme la possibilité de jauger, de mesurer le temps, rejoignant ainsi les travaux du franco-polonais Roman Opalka dont l’œuvre est "une confrontation diabolique avec le temps qui passe". Quand je dessine, je ne fais pas autre chose qu’explorer l’espace (de la feuille, de la toile), dans l’attente, dans l’écoute de ce qui peut advenir du trait, en quête d’une forme. C’est une forme de jeu, en fait. Je m’invente un territoire, je m’invente un paysage, je m’invente plus sûrement encore des effets de surprise avec le trait et la couleur. » Évoquant les travaux de J.-J. Ceccarelli en janvier 2001, le poète Bernard Noël considère qu’ils consistent à créer un visible qui parle : « Ces choses, leur attirance s’exerce sans séduction et, vues de près, elles ne sont qu’entrelacs de taches et de traits, inlassable lancer de lignes, qui se courbent, se tressent, tourbillonnent. Vous êtes là-devant dans la seule présence du travail et, soudain, troublé d’apercevoir qu’à force de sillonner la surface la main y a déposé une sorte de ferment de visibilité, ferment qui, à peu près, fait dans la peinture ce que le cœur fait dans le corps. » L’artiste était depuis 1990 sociétaire de la galerie Jeanne Bucher-Jaeger à Paris.
Jean-Jacques Ceccarelli dans son atelier en 2002 © Photo Maurice Rovellotti
- Ateliers du Sud - L’Esprit des lieux, par Claude Darras, photographies de Maurice Rovellotti, éditions Edisud, 160 pages, 2004.





