







 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Retour à l'accueil du site |
|
Paris, du lundi 16 mars au 8 avril 1916. Georges Feydeau, à 54 ans, vient de créer sa dernière pièce (Hortense a dit : « Je m’en fous ! »). C’est alors un artiste célèbre et un homme d’une grande beauté séduisant et formidablement drôle qui a brûlé sa vie avec insouciance en se laissant prendre et désirer par les femmes sans jamais chercher à les conquérir ni les garder. Depuis son divorce il vit seul au Grand Hôtel Terminus devant la gare Saint-Lazare. « C’était en 1909. Il fuyait une énième dispute avec Marianne (...) De fait, il s’y entendait pour la torturer au moyen de cette arme immatérielle, de ce poison qui rend fou sans laisser de trace : le silence. Elle lui reprochait son addiction au jeu, ses achats de toiles de barbouilleurs impressionnistes. Elle lui reprochait de mener leur ménage à la ruine par un train de vie que ses droits d’auteur ne parvenaient plus à compenser (…) les scènes de ménage lui donnent envie de fuir. Lui qui en a fait la matière de son théâtre ne peut prendre part à aucune ». L’artiste sur le déclin qui a toujours puisé son inspiration dans sa vie de noctambule, notamment chez Maxim’s où il a sa table et ses habitudes, ne cesse de dilapider son argent notamment au jeu, dans la cocaïne et les conquêtes d’un soir ou prostituées dans l'espoir de stimuler ses facultés créatrices. C’est alors qu’il rencontre Virginie, jeune femme de 18 ans, veuve de guerre d’un ex-musicien employé au Gaumont-Palace. Si le cinéma, par patriotisme et affection, a alors embauché cette amoureuse du cinéma sans ressources pour tenir la caisse aux entrées, ce n’est pas là que le maître du vaudeville va faire sa connaissance mais elle qui sur le conseil d’un libraire d’ancien s’est rendue à son domicile pour lui proposer l‘acquisition d’une lettre autographe de Bonaparte adressée à Joséphine. Malheureusement, si l’artiste résiste mal à l’acquisition d’un tableau, l’histoire et la correspondance par contre l’intéressent peu. Pour atténuer la déception de cette charmante jeune fille, Feydeau lui offre un café, denrée rare dans cette période de guerre, et accepte de noter son adresse au cas où il changerait d’avis. Il en profitera pour l’inviter un peu plus tard à une première de sa nouvelle pièce et c’est là, en pleine angoisse face à un public bien trop silencieux, que son rire extraordinairement spontané et communicatif entraînera toute la salle avec elle jusqu’à la fin de la représentation. À la sortie, le dramaturge conquis la recherche, la reconnaît, la remercie chaleureusement et lui propose non seulement d’acquérir la fameuse lettre mais aussi de l’employer comme assistante pour l’aider à sortir cette pièce sur laquelle il travaille actuellement (Cent millions qui tombent) bloquée dans une impasse par un cheval qui s’y est immiscé et dont il ne sait comment se débarrasser proprement. Georges Feydeau, sur lequel plane un doute quant à ses origines et que certains pensent être le fils bâtard de Napoléon III, ouvre ainsi à son assistante les portes de ce milieu mondain du spectacle que la guerre a relégué au second plan et déflore pour elle, par bribes et non sans nostalgie, quelques épisodes de sa vie, de ses succès et de ses sources d'inspiration. Entre le riche et célèbre dramaturge d’âge mûr et la jeune femme de milieu modeste déjà éprouvée par la vie va naître une singulière connivence qui lentement dérivera en histoire d'amour. Dans le dernier chapitre de son livre l’auteur nous propulse en 1919. On y retrouve Feydeau atteint de troubles psychiques dus à un stade avancé de la syphilis dans une maison de santé de Rueil-Malmaison où le hasard lui fait côtoyer un autre résident célèbre qui n’est autre que Paul Deschanel, l’ex-président. Là, abandonné de tous à l’exception de son ami Sacha Guitry et de son fils Jacques, blessé de guerre, qui passent parfois l’y voir, celui qui n’est plus que l’ombre de lui-même, incapable dorénavant de se concentrer donc d’écrire et de peindre, préfère se perdre dans la lecture ou la contemplation d’un épais ouvrage illustré sur Napoléon retrouvé lors d’un déménagement familial. Quand un après-midi Jacques emmène son père au cinéma voir « Charlot soldat » de Charlie Chaplin, celui-ci certain d’avoir reconnu lors de la projection le rire de Virginie traverser la salle en est tout retourné. L’artiste à la raison désormais vacillante ne s’est pas trompé. Ils s’attarderont pour échanger quelques mots à la sortie. Georges Feydeau s’éteindra peu après en juin 1921. Feydeau s’en va se retrouve au croisementd’une biographie documentée sur le célèbre vaudevilliste qui apporte des renseignements d’ordre factuel, du biopic littéraire qui comble avec de la fiction et des anecdotes les interstices laissés vides par les biographies officielles – « pour l’intériorité du personnage, il m’a fallu imaginer, prendre le risque de me laisser porter par mon intuition en espérant qu’elle était juste, que Feydeau aurait pu dire ou penser cela, ou esquisser tel ou tel geste » explique Thierry Thomas dans une interview – et y ajoute le protagoniste central qu’est Virginie. Non seulement c’est elle qui globalement permet de rencontrer Georges Feydeau comme être humain avec ses failles, ses angoisses, ses dérives et non comme célébrité du passé mais elle représente aussi la jeunesse, l’avenir, et la modernité dans sa passion pour le cinéma et la littérature populaire comme Fantômas de Marcel Allain et Pierre Souvestre. Issue d’une famille dont le père était un typographe politiquement engagé, elle fait le trait d’union entre la Belle Époque (1890-1914) et l’élite intellectuelle bourgeoise dans laquelle son mentor avait joué un rôle prépondérant mais aussi son explosion des loisirs populaires, la période de la guerre et celle des Années Folles (1920-1929) avec le courant Dada et l’avant-garde surréaliste que Feydeau verra à peine mais auxquels Virginie, fascinée par André Breton, se joindra par le bais de ses connaissances typographiques. Cette comédie vivante de mœurs de cette époque se déroule strictement dans un Paris aux rues, hôtels, restaurants, théâtres et cabarets précisément nommés et localisés où Feydeau se dissout et s’annihile dans le spectacle de Paris en déambulant. Mais au-delà de l’exercice urbanistique et topographique c’est aussi un tableau du Paris littéraire, culturel et artistique de la Belle Époque qui s’anime ici sous nos yeux à travers les échanges entre Feydeau et ses proches comme Sacha Guitry, son ami le plus proche mais aussi Lucien, le père de celui-ci, qui avec Tristan Bernard, Albert Capus et Jules Renard, formait un quatuor d’inséparables nommés « les mousquetaires », enviés ou vilipendés pour leur indépendance, leurs insolences, leurs prises de position en faveur du capitaine Dreyfus, que Feydeau, Octave Mirbeau et Alfred Jarry, rejoignaient très régulièrement au café du Ritz. En 1913, Feydeau avait aussi été un des premiers à être touché par l’extraordinaire nouveauté et singularité de Marcel Proust qu’il avait eu l’occasion de rencontrer. Tout ce beau monde dînait bien évidemment chez Maxim's, dont Feydeau par sa pièce (La Dame de chez Maxim’s,1899) avait fait un lieu à la mode symbole de la réussite sociale incontournable pour son luxe, son bon goût et surtout sa clientèle composée de grands artistes comme Sarah Bernhardt mais aussi de toute l’élite intellectuelle, de riches banquiers, des aristocrates et des hommes politiques ainsi que des cocottes de luxe ou gigolos en quête d’une opportunité qui venaient agréablement mais avec tenue épicer le menu si besoin. Les noms des frères Goncourt, Paul Claudel, Victor Hugo, Léon Daudet (éditorialiste, fils d’Alphonse), Anatole France, Émile Zola, Eugène Labiche, Edmond Rostand, Dumas fils et quelques autres se retrouvent aussi cités au fil du récit. Feydeau s’en va évoque aussi longuement les ingrédients du succès de ce génie précoce que fut Feydeau en s’inspirant des propos de ses amis et des critiques de l’époque, restitués pour la plupart par le dramaturge mondain lui-même lors de ses échanges avec son assistante Virginie. Sacha Guitry disait de lui qu'il avait « le pouvoir de faire rire infailliblement. Mathématiquement ». Compter le rassure. Évaluer, chiffrer, le temps entre deux répliques ou les pas des acteurs qu’il dirige avec la même autorité qu’un chef d’orchestre, lui procure une sensation de maîtrise, la certitude d’être dans le vrai d’une invisible partition. Il possédait une mécanique implacable dans laquelle ce qui importe n’est pas la cohérence de la dramaturgie mais les répliques hilarantes et parfois ubuesques des protagonistes. Si la recherche des situations et de ces répliques est un travail ininterrompu qui occupe son esprit nuit et jour, il est sûr de ses effets comiques. Ainsi quand Virginie lui demande « Pourquoi faut-il que dans vos histoires, toutes les femmes soient des putains ? », il lui répond sans hésiter « Parce que les mères ne font pas rire (...) S’il n’y avait des portes, mon théâtre serait réduit à néant et moi à la mendicité ! Je vous l’accorde, mon public ne réclame que du déjà-vu, il est frileux, angoissé et plus tout jeune (…) Mes bonshommes et bonnes femmes parlent en roue libre en s’écoutant à peine. Ils ne maîtrisent aucun événement, pas même la bagatelle et ne disent rien qui mérite d’être souligné, comprenez-vous ? Il n’y a pas de profondeur. Ce qui importe c’est l’imbroglio (…) Une comédie est une tragédie racontée avec l’envie de rire ». Le théâtre de Feydeau est un théâtre sans amour où l’accomplissement du désir échoue systématiquement, une négation absolue, libératrice et glaçante de tout sentiment. Le mari, la femme et l’amant resteront les piliers, chancelants, de son théâtre et la clé de sa fortune. En somme il demeure fidèle au cocu. Le sens de ses pièces, si elles en ont un, ne le concerne pas. « Offenbach est le terreau sur lequel je fais pousser mes salades. Le rire est un absolu qui ne se discute pas. Entendre les rires qui se transforment en or. S’ils rient je suis sauvé. » Voilà l’image que le mondain cynique Georges Feydeau a voulu laisser à la postérité, occultant que derrière cet homme qui faisait éclater de rire ses contemporains se cachait un être solitaire traversé par la tristesse et la mélancolie. À l’ombre de ses vaudevilles, c’est un homme certes charmant et vif mais survolant la réalité, se barricadant devant la moindre émotion et apparemment incapable d’interférer avec les autres autrement qu’avec légèreté et élégance, qui se tient. Il était de ces enfants pour qui les passions des adultes sont indéchiffrables. Sur ce point, il n’a guère changé. Sa retenue, son défaut d’empathie allié à une distinction naturelle sont de notoriété publique. Il y a une énigme Feydeau et c'est cet inconnu, ce feu brûlant et secret d'une vie, qu’avec Feydeau s’en va Thierry Thomas a eu envie d'écrire, d'imaginer et de partager avec nous. L’immersion dans le monde du théâtre ou du Paris de la Belle Époque est aussi passionnante que réussie et le beau personnage de la jeune Virginie ajoutée ici comme improbable assistante durant quelques semaines auprès d’un Feydeau aussi fascinant que mystérieux l’humanise et nous en facilite agréablement l’accès et l’appréhension. Un premier roman efficace et prenant. Dominique Baillon-Lalande (04/10/24) |
Sommaire Lectures 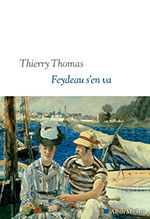 Albin Michel (Août 2024) 272 pages - 20,90 €
|
||||||