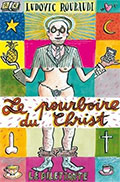Anton et Brubeck dont la mère a perdu la vie en accouchant de son deuxième garçon deux ans après la naissance du premier, vivent seuls avec leur père. L’éleveur de chevaux aime à raconter à ses enfants des histoires inspirées de sa vie ou des contes glanés çà et là comme celui de l’oiseau arc-en-ciel de l’Himalaya. Ses préférées sont le récit de sa jeunesse en ville chez un vieux Juif peintre de pianos à qui il avait été confié dès son plus jeune âge comme apprenti quand sa famille n’avait plus eu les moyens de le nourrir et celle de sa rencontre avec son épouse. Ils vivent grâce à l’élevage d’une centaine de chevaux que l’homme revend quand ils ont atteint trois ans. L’intendant du fort militaire situé à quelques jours de marche qui lui passe commande tous les ans est son principal client. Après les lourds dégâts produits par un déluge d’une exceptionnelle violence sur plusieurs jours, le père envoie donc le cadet auprès de Peck l’intendant pour le prévenir que leur rendez-vous annuel sera retardé d’un mois. Il lui faut rechercher les bêtes égarées, soigner celles qui se sont blessées et rassembler le troupeau avant d’effectuer la sélection nécessaire à l’armée. Quand huit jours plus tard l’adolescent n’est toujours pas revenu le père envoie l’aîné à sa recherche. Au fort, Anton ne retrouve aucune trace de Brubeck mais, suite à la fourberie indigne d’un adjudant alors que la guerre semble inévitable et le recrutement insuffisant, il se retrouve enrôlé de force dans l’armée. C’est pour lui le début d’une aventure mouvementée.
Dans la carriole pleine à craquer d’engagés volontaires ou non, il fait la connaissance de Spinoz, jeune typographe arrivé là à cause d’une paire de lunettes : « Avec mes lunettes j’étais un Juif dont personne ne voulait. Sans je devenais infirme et sans travail. – Tu aurais pu changer de ville ? – Mes anciens camarades me l’on proposé : va dans une ville où il y a un ghetto juif, Spinoz, et tu pourras vivre tranquillement. Mais j’ai refusé (…) Je sais ce que l’on fait aux ghettos quand les choses vont mal. (…) Alors je me suis engagé parce qu’à l’armée on se fout de mes lunettes. » Une formation à la dureattend celui qui est la plus jeune recrue. « Je suivais sans rien dire, par crainte et par épuisement et surtout parce que je me souvenais du conseil de Spinoz : On ne discute pas avec les gens qui crient. » C’est son ami qui trouvera pour eux deux le moyen d’échapper momentanément au cauchemar des hurlements, insultes et violences du sergent. « Le seul endroit où tu n’es jamais dérangé, c’est quand tu es dans la merde. Alors (…) on va se porter volontaire pour la corvée des latrines. Tant qu’on sera dedans, le sergent ne nous gueulera pas dessus, persuadé que nous souffrons déjà suffisamment. (…) Bien sûr il y avait les étrons en escadre sur la mer d’urine (…) le regard méprisant des autres (…) mais pendant cette heure de corvée nous avions le plaisir de la paix et du silence. Nous avions enfin le temps et la possibilité de parler de tout et de rien. »
C’est alors quela guerre est déclarée.
Très vite, les colonels arrivent au camp récupérer des soldats formés en vue de constituer leur section pour le combat. Anton et Spinoz font partie du premier départ. S’ensuivent des heures de marche jusqu’à la jonction avec d’autres fantassins, pauvres bougres comme eux, paysans, ouvriers, chômeurs et plus rarement militaires par vocation, rassemblés par les gradés devant une gare. Des wagons à bestiaux prêts à les transporter en territoire ennemi les y attendent. Une fois sur place, ils doivent marcher encore jusqu’à des villages isolés dont il leur faut piller les maisons, bousculant ou violant les femmes, maltraitant les hommes, tuant les bêtes pour emporter la viande, afin de briser toute velléité de résistance chez les populations locales. Quelques semaines plus tard ils approchent du front où un autre spectacle les attend. « La terre, le soleil et tout le bleu du ciel ont soudain explosé. (…) j’ai vu des bras et des jambes battre l’air alors que des torses disparaissaient sous les trombes de fer et de feu qui tombaient du ciel. (…) voilà donc la guerre où les hommes ne sont rien d’autre que des cibles à la mitraille, la guerre où la chair et le sang s’opposent à l’acier et à la dynamite. La guerre où vaincre ne servait à rien, puisqu’il fallait juste lutter pour ne pas mourir. »
Alors, pour tenir le coup face à l’horreur et permettre à ses frères d’armes d’oublier la peur, les blessures et les camarades morts sous leurs yeux, à la veillée près du feu Anton fouille sa mémoire à la recherche des histoires paternelles et se met doucement à leur redonner vie. Le pli fut pris et les soldats vinrent chaque soir de plus en plus nombreux écouter le conteur.
« Donne-leur de quoi se souvenir des belles choses » l’encourage Spinoz quand, ayant depuis longtemps épuisé le répertoire du père et rompu par les interminables marches à la poursuite des déserteurs et des retardataires de l’armée ennemie qui « avaient quitté le combat pour se réfugier dans le massacre », Anton ne trouve plus l’énergie d’inventer de nouvelles histoires pour un public toujours plus attentif qui réclame chaque soir sa dose d’apaisement et de rêves.
Et puis un soir, Anton raconte l’histoire du « labyrinthe du fou » dans laquelle le colonel voit une stratégie nouvelle pour traquer l’ennemi. Son sort et celui de son camarade Spinoz vont en être changés. Leur ordinaire en est amplement amélioré jusqu’à ce qu’un certain « roi des loups », une bête sauvage, un monstre suivi d’une meute assoiffée de sang, d’alcool et de femmes, les fasse enlever et conduire dans l’enfer de son antre. Ce fou halluciné qui se prend pour un dieu mais ne peut se passer de la belle Esperanza qui tire du piano auquel il l’a enchaînée des mélodies qui apaisent son sommeil, les y attend avec le sourire mauvais de celui qui va régler son compte à l’homme dont la rumeur rapporte qu’il peut prévoir les mouvements de sa horde et mettre ainsi en péril le royaume qu’il s’est construit.
La situation semble dès lors bien périlleuse mais « la laideur ne peut rien contre l’espoir et les rêves » comme le dira joliment peu après le candide à la belle Esmeralda….
Comme le titre le laisse entendre, (Requiem : cérémonie ou prière pour les âmes des défunts), la faucheuse est ici perpétuellement en action. Elle se manifeste dès l’enfance du père dans les campagnes décimées par la famine, par la mort en couches de la mère qui comme tant d’autres à cette époque laisse derrière elle des orphelins fragilisés, puis, une génération plus tard, lors des boucheries aveugles de la guerre ou, sorte de mort spirituelle, à travers la folie dans laquelle bascule parfois un soldat face aux horreurs auxquelles il a assisté ou qu’il a dû lui-même commettre. Mais, étrangement, si la mort est ici très présente, Nostra Requiem n’a rien d’une fresque tragique. Cette guerre indéterminée dont on ne connaît ni les pays belligérants, ni les dates, qui occupe les deux tiers du roman avec dans son sillage l’alcool et la violence, ne donne lieu ici ni à une restitution de la réalité, ni à un récit de genre, ni à un pamphlet pacifiste ou un plaidoyer antimilitariste, mais se trouve abordée de façon générique, expressionniste et subjective. Ludovic Roubaudi en fait un décor sombre, en noir taché de rouge, assez peu figuratif pour ne rien décrire ou dire directement mais propre à donner le ton, à créer l’atmosphère, à susciter l’émotion, avant d’y prendre ses aises en laissant libre cours à son imagination à travers le conte, le fantastique, la fable philosophique, le roman d’initiation, dans un patchwork de thèmes, de réflexions, de sentiments, de paraboles et d’images. Le roman finit ainsi par glisser de sa thématique première (les violences et l’absurdité de la guerre) à d’autres sujets comme la folie des hommes, les liens affectifs et familiaux, le vivant (végétal ou animal), la vie spirituelle et l’art (à travers la musique d’Esmeralda ou la magie de la littérature et du verbe si bien maîtrisé et habité par Anton). Utiliser, comme le fait l’auteur, le conte pour parasiter le récit de guerre avec des réflexions hors situation sur ce qui fait l’être et l’existence humaine, fonctionne d’autant mieux que, si le phénomène des batailles et luttes armées s’est reproduit sans fin et partout à travers l’Histoire, le conte, récit imaginaire nourri au lait de la vie et des hommes afin de distraire ou d’édifier celui qui le lit ou l’entend, est par nature un objet tout aussi universel et intemporel. C’est alors l’ensemble du roman qui se fait conte.
Le récit dont le narrateur est Anton, a pour colonne vertébrale le duo Anton-Brubeck, opposés comme Abel et Cain, l’ange des mots, de l’amour, de la beauté et de la lumière faisant face à celui de la débauche, la haine, la violence et les ténèbres. Dans la droite ligne des symboles communs à toutes les religions monothéistes, le Bien et le Mal, la Chair et l’Esprit, ici s’opposent ou s’affrontent, comme Dieu avec Satan. Mais si symbole il y a, ne cherchez aucun mysticisme dans tout cela. Tout l’art de Ludovic Roubaudi est d’avoir fait porter ce récit sophistiqué a priori sombre et manichéen par un personnage hors emploi, ni philosophe ni mystique, un tout jeune homme des campagnes à peine sorti de l’enfance, naïf et bienveillant qui, en s’exprimant avec une simplicité, une innocence et une candeur aussi désarmantes que touchantes, parvient avec une évidence quasi magique à incarner aux yeux du lecteur au cœur même des plus terribles scènes l’espoir et la force de vie. Le beau personnage de Spinoz, l’ami plus âgé, fidèle et discret, faux Juif mais vrai sage, plein de philosophie et de bon sens, par la relation fraternelle qu’ils entretiennent et les échanges dont ils nourrissent leurs esprits, vient à la fois compléter et mettre en valeur le rôle du Candide. « Il y a un monde entre le cœur et la bouche, un continent entre les oreilles et les mots et un infini entre l'esprit et le livre. »
Ce roman, tel une Dame Gigogne, femme géante avec une multitude d'enfantssurgissant du dessous de sa robe, venue des contes et du théâtre de marionnettes du dix-septième siècle, n‘est pas un livre de plus sur la guerre mais un récit multiple et hybride. Un conte philosophique porté par un Candide contemporain que son créateur ne désavouerait probablement pas, et qui nous charme par la puissance de son imaginaire autant qu’il nous conduit sur les chemins de la raison, la satire et la réflexion.
Un roman envoûtant et lumineux d’humanité, original et universel.
Dominique Baillon-Lalande
(08/03/20)