







 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Retour à l'accueil du site |
|
On est au seuil des années soixante-dix, à Voiron, petite ville ouvrière d’Isère dominée par la Vouise coiffée d’une statue de la Notre-Dame. C’est le début de l’été. Quand le père s’était retrouvé au chômage, la famille avait dû quitter la vieille maison qu’elle louait à dix kilomètres plus au sud pour un quatre pièces avec balcon à Voiron dans une HLM aux volets rouges. Ceux des immeubles d’à côté étaient bleus ou jaunes. Le père avait trouvé là un travail à l’usine de papier mais ça n’a pas duré. Ce fut la mère, ensuite, qui, avec son travail en usine de confection a fait bouillir la marmite. Avec eux vit alors Brigitte, la petite, Lucien, l’aîné qui fait son apprentissage de soudeur et s’entraîne tous les jours à vélo avec son collègue Rolland dans l’espoir d’être sur le podium de la course de la Vouise, et, entre les deux, le moyen. C’est lui qui, avec ses mots, nous raconte ici leur histoire commune. Pour ce garçon qui aime observer et apprendre et vient de terminer son CM2 avec un instituteur particulièrement autoritaire et brutal, la perspective d’entrer au collège en septembre prochain, à un quart d’heure de son quartier, est un vrai soulagement. « Toi tu es la tête ! Ton frère c’est les jambes. On ne peut pas tout avoir » comme le dit volontiers sa mère. « Tu te battras mal si tu penses trop, cogne et puis c’est tout », explique le frère brutal et dominateur à ce cadet qui partage sa chambre lors d’un entraînement improvisé. Le rapport entre ces deux-là s’avère rapidement quelque peu complexe. Le pire, pour le moyen, ce sont les nuits. La mère se relève pour vider les fins de bouteilles du père, « Brigitte traverse l’appartement comme un fantôme effrayé » entre veille et sommeil tandis que Lucien se lève sans bruit, « attrape le fantôme par son drap (…) dans le petit couloir sombre (…) l’enserre (…) la fait crier, lui fait mal. » Puis le silence revient sans que personne, jamais, ne semble troublé par ce que lui entend durant ces nuits « noyées de mensonges » dont on pourrait penser qu’elles ne sont que le fruit d’une imagination trop vive. Il devient cependant de plus en plus clair que le coureur cycliste qui se rêve « une machine à tuer » met en danger frère et sœur avec de mauvaises blagues et un penchant incontrôlé pour la violence et la perversité. Ce que le père, et pire encore Lucien, nourrissent chez les deux plus jeunes c’est un sentiment constant de peur, d’une peur diffuse. « Tout peut basculer à tout instant. Notre ordinaire est fragile, suspendu. Les cris dans la nuit, les disputes, les coups échangés dans la salle à manger (…) La peur même au sommet de la joie, quand elle survient. La peur incessante, celle qui poigne le cœur. La peur qui enserre, la peur qui réduit, la peur qui diminue la vie. La peur qui harcèle. La peur qui tord le ventre et monte à la tête. » Avec ces huit derniers jours de CM2 déclinés chacun dans un court chapitre, c’est à la fois la réalité sociale d’une famille ouvrière à problèmes vivant dans un quartier HLM de province à la fin des années soixante, une enfance volée et une autre détruite qui, à travers un quotidien toxique, s’exposent à nous. Tant de noirceur n’est supportable que par les jeux d’enfants et cette tendresse qui parfois traverse cette histoire et grâce au choix de l’auteur de faire porter le récit par un des enfants de la famille. Le fait que ce gamin de dix ans, intelligent, doté d’un instinct de conservation et un appétit de vie hors du commun, nous livre les événements avec simplicité et sensibilité, dans l’immédiateté, de l’intérieur et tels qu’il les a perçus, adoucit la charge dramatique des sujets abordés. De plus, si celui-ci observe tout avec beaucoup d’acuité et tente avec autant de vivacité que de maturité de comprendre le fonctionnement du monde et des siens pour y trouver sa place, une part de lui-même, pour tenir, regarde toujours un peu plus loin, vers un lendemain et un ailleurs indéfinis mais porteurs d’espoirs. C’est un personnage essentiellement positif qui équilibre le récit. Si les souvenirs que livre ce roman sont très sombres et très durs, les rapporter au présent à hauteur d’enfant, redonne une humanité aux personnages et, tout du moins dans la première partie de l’histoire, dédramatise les situations. L’enfant sait que l’ardoise chez l’épicier sera remboursée en fin de mois par le salaire de la mère et que celle-ci, malgré les coups et le couteau sur la gorge un soir de beuverie, encore émue par son amour de jeunesse ou parce qu’elle pense qu’elle l’a résolument dans la peau, continuera à protéger et à aimer ce mari et père défaillant. Le gamin, lui aussi se sent aimé, mal sans doute mais aimé, c’est donc avec une curiosité bienveillante qu’il observe ses parents, sans jugement et de façon plus intuitive qu’analytique car il est à l’âge des découvertes et sans présupposés sur la manière dont ils devraient se comporter, sans rancœur car il les aime en retour. La mère, sèche comme un coup de trique tant la vie l’a maltraitée, continue non sans maladresse à aimer ces enfants pour lesquels elle s’est transformée en bête de somme et cet homme autrefois capable de tailler des sifflets pour les enfants avec ce couteau reçu de son propre père et destiné ensuite à son jeune fils, de jouer avec lui au football, avant que l’alcool et le chômage en fassent une loque et ne le rendent violent et dépressif. Alors lui, le gamin, ce qu’il veut c’est comprendre leurs agissements pour agir en conséquence, les rendre plus heureux et se faire aimer d’eux plus encore. Même quand il a honte d’être pour tous « le fils du poivrot » et qu’il supporte mal les tentatives de suicide à répétition de son père, à aucun moment il ne se ressent personnellement victime du comportement paternel. L’ennemi est à l’extérieur, ce sont ceux qui insultent son père à travers lui. Difficile de faire plus noir que cette enfance qui cumule toutes les tares (misère, alcoolisme, violences, inceste et chape de plomb du secret), ligote le narrateur dans un quotidien empoisonné et lui offre fort peu de chances de trouver le soleil et l’équilibre. Difficile aussi pour l’auteur dans un tel contexte d’éviter le mélo et le misérabilisme. Mais c’est exactement là que le talent d’Hervé Bougel intervient : par la vivacité positive de son jeune double et par la magie de son écriture, il transformerait presque cela en un récit d’initiation. Un texte d’inspiration autobiographique dense et fiévreux, tel une pierre brute aux angles vifs, pour dire enfin avec une grande pudeur ce qui trop longtemps a été tu. Dominique Baillon-Lalande (24/03/21) |
Sommaire Lectures 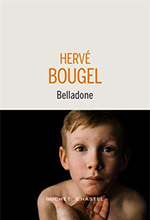 Buchet-Chastel (Janvier 2021) 144 pages - 14,50 €
|
||||||