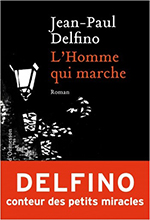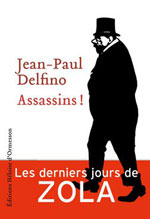Théophraste Sentiero est un quadragénaire sans histoires. Un homme transparent qui « s’il avait toujours caressé l’espoir de toucher à la tranquillité, n’avait jamais eu la prétention d’être heureux ». L’homme vit chez sa belle-mère dans un appartement parisien modeste au loyer non réévalué depuis 1948. Cécile, sa femme, partage donc son temps entre la prise en charge de la presque centenaire paralysée et l’éducation de leurs enfants de 12 et 14 ans. Pour nourrir l’ancêtre momifiée, l’épouse autoritaire, frustrée et encline aux jérémiades et les gamins indifférents qui les yeux rivés sur leurs téléphones ne lui adressent pas la parole, Théophraste, sans qualification mais n’ayant jamais connu le chômage, enchaîne courageusement et avec une régularité sans faille les petits boulots pénibles et mal payés. Quand le roman débute il s’apprête justement à en changer. Si la stabilité de ce nouveau travail consistant à repêcher vélos et trottinettes dans la Seine avait bien plu un temps à ce solitaire qui appréciait de passer ses journées en plein air au bord de l’eau, la récupération d’un chien en décomposition avait changé la donne. Depuis cet événement, l’angoisse d’avoir un jour un macchabée à remonter sur la berge ne le quittait plus et c’est en traînant les pieds qu’il prenait son poste. « De toute évidence, Théophraste Sentiero [...] depuis son enfance avait peur de tout. De la mère Tapedur comme du garçon de café, des récriminations de Cécile comme des réflexions de ses supérieurs. » Heureusement, pour le café du matin et avant le dîner familial, il passait par le Gay-Lu (abréviation de Gay-Lussac), bistrot à l’ancienne tenu depuis cinquante ans par Mme Jouve, dont La Guigne, Petit Pois, Cothurne et Gégène étaient les fidèle piliers. Inutile de préciser que l’annonce par la patronne de la vente de son bar à des Américains pour partir vivre sa retraite en Alsace dont sa famille était originaire avait provoqué une véritable panique chez les vieux poivrots dont Théo, tout comme elle, connaissait par cœur toutes les histoires mais qu’il aimait observer le verre à la main, le sourire aux lèvres et la tendresse au cœur. Pour lui cette nouvelle n’est qu’une contrariété supplémentaire.
Le roman commence par l’anniversaire de Théophraste le 25 décembre. Il s’est habitué à ce que fête et cadeaux d’anniversaire soient absorbés par Noël, avec un repas de famille élargi pour cette occasion au prétentieux Robert, frère de sa femme, et son épouse Ginette. Sauf que ce Noël là des tremblements incontrôlables et malvenus prennent possession de ses jambes et ses pieds sous la table du repas. À compter de ce jour, ces fourmillements irrépressibles ne cesseront plus. « Il ressentait alors dans ses membres inférieurs une irrépressible envie de bouger, de s'agiter. Sa chair fourmillait, picotait, démangeait tout à la fois. Par moments, il ressentait de véritables décharges électriques qui, selon leur intensité et leur durée, pouvaient le faire sourire ou grimacer. En journée, il lui suffisait de marcher pour dompter ce trouble. » Le médecin suspecte un syndrome des jambes sans repos ou un Tremblement essentiel et ne propose que des calmants pour les nerfs et l’épouse aux nuits perturbées par les mouvements désordonnés de son mari dans le lit conjugal l’exile sur le canapé du salon. C’est par lui-même que Théo découvre les vertus de la marche pour calmer ses membres inférieurs, devenant ainsi « l’homme qui marche ». Ce furieux besoin de marcher va permettre au hasard de lui offrir des rencontres inattendues et souvent belles comme celle d’un cul de jatte noir qui fait la manche, de l’Anglaise venue chaque jour peindre dans les jardins du Luxembourg, du Calabrais, ex-boxeur devenu kiosquier, de la grande Gisèle, ancienne prostituée qui court les cérémonies funéraires du quartier pour profiter du buffet. Mais surtout, à chaque coin de rue, Théophraste espère retrouver la belle et mystérieuse inconnue dont la silhouette aérienne entraperçue sur le Pont Neuf « avait mis le feu à son âme » pour peut-être, un jour, oser l’aborder.
Mais surtout, au gré des rencontres fortuites, il croise un étrange vieillard quasi aveugle du nom d’Anselme Guilledoux qu’il retrouve plus tard dans une vieille librairie poussiéreuse et sombre où une pluie battante l’a poussé à s’abriter. Le vieil aveugle bourru qui liquide son fond avant de fermer boutique ayant besoin de quelqu’un de vigoureux pour l’aider à remplir, déplacer et livrer des cartons, lui propose le poste. Théophraste qui n’a jamais lu un livre en entier et se sent devant les livres comme une poule devant un couteau, hésite un peu mais par pragmatisme, ayant quitté depuis peu le nettoyage fluvial qui l’angoissait trop, finit par accepter. Sa vie va en être changée. Au fil des jours des liens se tissent entre ce patron original aussi bienveillant qu’irascible et le quadragénaire confronté à un monde inconnu où petit à petit il trouve sa place. « Au Bonheur d’Antioche il se sentait bien, il était chez lui. […] Tant qu’il trouverait de la besogne à accomplir, il échapperait aux doutes et à l’ennui dans lesquels il se confisait rue de l’Estrapade. Au côté du vieil aveugle, il respirait. » Si Anselme, libraire passionné, est un bon conteur qui sait faire vivre chaque livre qui lui passe entre les mains suscitant la curiosité ou l’émotion du commis, il s’intéresse aussi au jeune homme et à la belle inconnue objet de ses fantasmes. Il le réconciliera aussi habilement avec l’agitation de ses jambes en voyant en elle une merveilleuse prédisposition à la marche et en cela une source d’exploration et de rencontres. Outre la livraison, la mission de Théo, qui sur ordre du libraire dédaigne les transports en commun pour laisser libre cours à ses pieds, est tenu de faire un compte rendu précis de sa course au vieil aveugle curieux. « Vous me direz le monde, non pas tel qu’il est, mais tel que vous, vous le voyez. Voilà qui sera propre à alimenter mes rêves. » L’attention que lui porte alors son patron et le plaisir gourmand qu’il manifeste en l’écoutant renvoient pour la première fois au marcheur compulsif une image positive de lui-même. Concentrées aux Ve et VIe arrondissements de Paris, les balades de Théo s’allongent et la santé du quarantenaire, sa silhouette et son teint tireront bénéfice des kilomètres ainsi accumulés. Cécile, à laquelle les transformations physiques et mentales de son mari n’ont pas échappé, ne sait pas trop si elle doit s’en réjouir ou s’en inquiéter, la liberté du corps allant de pair avec la liberté de penser et d’agir.
Drôle d’histoire que celle de cet homme écrasé par la routine et l’ennui qui, soudain pris en otage par ses pieds, va avec l’accompagnement d’un vieillard aveugle, misanthrope et grincheux qui s’est pris d’affection pour lui, s’ouvrir au monde, aux autres et à la vie. Cette version revisitée par Jean-Paul Delfino du thème classique de l’initiation ne manque ni d’originalité, ni de saveur.
Peu importe si le roman est censé se passer à notre époque (Cécile économise pour un lave-vaisselle, les adolescents ne décollent pas le regard de leur écran, les trottinettes envahissent les trottoirs de Paris, les Uber y ont remplacé les taxis, la nef de Notre-Dame est noircie par l’incendie, « l’estaminet comme on n’en ferait jamais plus et qui avait accueilli à son bord les enfants [...] de Blondin, Audiard, Prévert et autres Jeanson » se transforme en bar-restaurant avec « menu en anglais, en chinois et en japonais », « où le café est servi dans des gobelets en carton recyclable et l’alcool banni »…) , c’est bien un Paris disparu, celui de Doisneau ou de la pétulante Zazie de Queneau que l’écrivain choisit comme décor de son récit. Et ce portrait du vieux Paris populaire et poétique prend par moment les atours d’une déclaration d’amour à ce qu’était la capitale avant qu’elle ne devienne « un promenoir à touristes », « un ghetto pour bobos », qui « vit sur les vapeurs d’essence, sur ce qu’elle a été et qu’elle ne sera jamais plus », comme la décrit la tenancière du Gay-Lu avec nostalgie. Cet entrelacs entre passé et présent se retrouve aussi chez les personnages pittoresques gravitant autour de Théo. Ces figures plus ou moins désuètes de poivrots, mendiant, cocu, concierge, prostituées ou prêtre, dont les surnoms ne manquent pas de cocasserie, y sont croqués avec amusement et empathie et ont des échanges pleins de gouaille à la Audiard.
« – Quand on est atteint par la limite d’âge, on a le droit de plier les gaules et de se ranger des voitures. [...] Mais passer à l’ennemi ? Et nous l’apprendre comme ça, entre le p’tit crème, le croissant et la goutte ? Vous m’excuserez mais venant de vous, ça m’troue l’cul. Et faites excuses mais j’ai rien d’autre qui vient.
– Et avec un nouveau coup de calva ? Peut-être que la dragée passerait mieux, non ?
– Sincèrement j’sais pas. Cette nouvelle elle m’a éteint la soif.
– Alors ce sera peut-être un double calva ? Histoire de refaire les niveaux ? [...]
– Un double ? Vous savez parler aux hommes madame Jouve. »
Si Théophraste et Anselme tiennent le devant de la scène, à côté des habitués du Gay-Lu, de la famille de Théo et de la belle passante à la Brassens nommée sa Sylphide, image de l’espoir et du rêve, ce roman offre une belle galerie de portraits de femmes. La mère Tapedur tout d’abord, bignole caricaturale, raciste et aigrie que le héros déteste autant qu’il la craint. « La découper en fines lamelles, la donner à manger à une colonie de fourmis rouges, la faire frire dans un bain d’huile, l’étouffer peu à peu avec un sac plastique, la lapider de toutes petites pierres, l’épingler à la façon d’un gros cafard sur sa porte vitrée. A chacune de ses éventualités, l’irréprochable Théophraste Sentiero sentait son corps se couvrir de frissons de délice [...] Mais c’était un homme sans histoires. S’il endossait le costume de meurtrier dans ses fantasmes, il n’en demeurait pas moins conscient que ses épaules étaient, au propre comme au figuré, trop étroites pour celui-ci. » Les autres femmes, la bistrotière incarnant le bon sens populaire et une franche générosité, Madame Gisèle, ex-gagneuse d’un âge avancé convertie pour survivre en « «artiste de la rapine nécrologique » que la bonne humeur, la gentillesse et la vision pragmatique et positive de la vie rendent fort sympathique, sont elles des figures empathiques voire maternelles. Il en est de même pour l’Anglaise, cette artiste-peintre au modèle unique (une rose des sables ramenée d’un voyage qui s’effrite avec le temps) que Gisèle a bien connue comme consœur lors de leur folle jeunesse. Mais celle-ci, ancienne putain devenue artiste, sert aussi de pont entre l’univers de Gay-Lu et celui du Bonheur d’Antioche, venant faire écho à la fois aux propos de la grande Gisèle et à ceux d’Anselme. Elle partage aussi avec le libraire une aura de mystère. Le libraire aveugle (que j’aurais bien vu incarné au cinéma par Michel Piccoli) s’illustre par ses colères, son originalité, son érudition et sa clairvoyance.En effetle vieux fou philosophe qui tient de la fréquentation des livres et de ses lectures son expérience de la vie et sa connaissance du monde et des autres, est le premier à percevoir en Théo un être perdu fâché avec la vie qui a besoin d’aide, un terrain vierge à faire fructifier. « Anselme parlait, racontait, mettait en scène et jouait tout à la fois ces vies de femmes et d’hommes illustres [...] et lui, simple ignorant de toutes ces merveilles, il écoutait béat. » Et contre toute attente, le patronmisanthropesaura être pour le Petit phacochère nouveau-né le guide et le mentor qu’il lui fallait pour retrouver l’appétit de vivre et trouver le courage de prendre son envol. « Le monde n’est jamais définitif, clôturé, balisé [...] fini. Il n’est somme toute que ce que nous en faisons. » La magie du mystérieux bonhomme qui semble tout droit sorti d’un conte, opérera à merveille sur Théo mais aussi chez le lecteur qui se laisse pareillement embarquer à sa suite par cette étrange figure d’immortalité tant son charisme est prégnant.
C’est par son intermédiaire bien sûr qu’après l’hymne à Paris et celui à la marche à pied s’ajoute une nouvelle déclaration d’amour cette fois au livre, aux librairies (notamment la librairie lusophone Chandeigne et la librairie historique Delamain), à la lecture et à la littérature, troisième pilier de cette histoire. « La lecture [...] nous murmure à l’oreille que d’autres avant nous ont joui et souffert, qu’ils ont déjà éprouvé les doutes qui nous saisissent ou nous transcendent. » « Il faut lire pour voir le monde qui nous entoure à travers les yeux des autres. [...] Pour vous comme pour moi, jeune homme, le livre est notre seul espace de liberté. [...] Suivez cette piste, dévorez toutes les littératures, et vous verrez alors votre univers s’enfler à la façon d’un ballon de baudruche multicolore. » « Les mots, mon jeune ami, c’est là que réside le pouvoir véritable. D’ailleurs Dieu lui-même ne s’y est pas trompé. La première phrase de la Bible dit en effet ceci : au commencement était le Verbe. [...] Le Verbe est préexistant à toute chose [...] sans lui, rien ne se crée. »
Alors l’auteur visiblement amoureux de la langue française ne se contente pas d’imaginer des situations cocasses et de nous immerger dans une sélection de romans classiques qui ont marqué notre imaginaire collectif mais le fait de façon ludique et inventive en jonglant avec les mots d’hier et d’aujourd’hui, en se jouant des formules qui claquent et des expressions toutes faites, en abusant des métaphores, en se permettant des énumérations goûteuses, en nous régalant de dialogues hauts en couleur. Avec une remarquable précision et un indéniable savoir-faire, il insuffle ainsi à L’homme qui marche un humour réjouissant et un plaisir malin et contagieux.
L’homme qui marche, ou comment une curieuse maladie a sauvé la vie de Théophraste Sentiero, est un conte délicieux, plein d’humanité et résolument optimiste qui encourage chacun à suivre ses rêves et à ne pas oublier, notamment en ces temps de pandémie, que l’Art en général et la Littérature en particulier sont essentiels à l’homme et au bien-vivre. Un roman à mettre dans ses valises pour les vacances.
Dominique Baillon-Lalande
(08/07/21)