








 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||||||

Bologne
Vous avez écrit une trentaine d'ouvrages, pour moitié environ des romans et pour l'autre moitié des essais dont Histoire de la pudeur, Histoire du célibat. En quoi, les références historiques sont une passion pour vous ? L'histoire est une passion de jeunesse, que je ne peux expliquer qu'a posteriori. Au départ, c'était une passion purement linguistique. Moi qui ne suis doué pour aucune langue, j'ai toujours lu l'ancien français comme si c'était ma langue maternelle, et j'étais étonné qu'il semble incompréhensible autour de moi. J'ai entrepris des études de philologie romane pour entretenir cet intérêt qui reste pour moi inexplicable, et je me suis peu à peu spécialisé dans le moyen âge, dans tous les domaines : art, littérature, histoire, philosophie, paléographie, et même théologie et mystique, un paradoxe pour l'athée que j'étais et suis demeuré. Cette passion s'est élargie à l'ensemble du domaine historique quand j'ai commencé à écrire des livres et à assurer des cours d'iconologie qui ne pouvaient se cantonner dans le moyen âge. Alors pourquoi cette passion ? Je ne peux me l'expliquer que par ma relative indifférence à mon histoire personnelle. J'approche la cinquantaine, et les souvenirs m'intéressent aussi peu qu'à vingt ans. De même pour le futur : je n'attache pas une grande importance à mes projets personnels, auxquels je peux renoncer aussi facilement qu'à mes souvenirs. Je ne m'intéresse qu'à mon présent. En revanche, pour tout ce qui ne me touche pas, le passé et le futur sont des données essentielles, bien plus que le présent. Je ne parviens à m'investir que dans des entreprises pérennes, ou en tout cas durables, et le passé de notre civilisation m'a toujours passionné. Tout se passe comme si le présent était une affaire personnelle (l'histoire contemporaine, la politique, ne m'attirent guère) et le passé, comme le futur, une histoire collective. J'aime me sentir le maillon d'une chaîne qui me dépasse. Sans fausse modestie : le maillon a toute son importance, car sans lui, la chaîne est rompue, mais c'est la chaîne qui lui donne son importance. Quels éclairages ces références apportent-elles sur notre regard contemporain ? Dans ce cadre-là, c'est plus qu'un éclairage. Je suis convaincu que notre regard est constitué par la somme des regards qui nous ont précédés. J'ai été très marqué par la phrase de Bernard de Chartres : « Nous sommes des nains montés sur les épaules de géants. » Le passé se dépose par strates dans notre mémoire collective sous forme de lieux communs qui deviennent inconscients, et dont nous restons prisonniers si nous ne les faisons pas émerger à notre conscience. L'histoire m'intéresse comme matière vivante : je n'ai que très peu de curiosité pour l'histoire d'autres cultures, et c'est à l'histoire de la conscience humaine que je m'attache. On connaît « l'effet-papillon » de Lorentz : le battement d'ailes d'un papillon au Brésil finit par provoquer un typhon au Japon. Je pense que cet effet spatial a aussi une dimension temporelle, résumée par le non moins célèbre « nez de Cléopâtre » de Pascal. Dans notre regard sur le monde, nous sommes tributaires du moindre événement qui nous a précédés. Il ne s'agit pas de déterminisme : Voltaire se moquait déjà du jésuite qui, en se levant du pied gauche au lieu du pied droit, avait provoqué la mort d'Henri IV. Nous sommes libres d'assumer ou non notre passé collectif. Mais pour cela, il faut en prendre conscience. Et il ne s'agit pas non plus de relativiser l'importance du présent : par corollaire, chacun de nos actes engage l'avenir de la planète — et je ne pense pas ici à la responsabilité écologique de notre époque, mais au regard que nos successeurs porteront sur le monde qui les entoure, un regard que nous façonnons aujourd'hui. Nous ne parlerions pas d'amour de la même manière aujourd'hui si le romantisme n'avait à ce point idéalisé la passion amoureuse, et le romantisme n'aurait pu le faire sans vouloir réhabiliter l'amour courtois dans un contexte imprégné de cartésianisme. L'amour courtois lui-même n'aurait pas existé sans les distinctions chrétiennes entre charité et concupiscence, calquées sur les théories platoniciennes elles-mêmes héritières des sophistes. Ce sont ces chaînes inconscientes qui me passionnent. Dans l'un de vos romans, L'homme-fougère, la mémoire, l'identité à travers le temps sont au cœur du roman. Vous avez aussi écrit L'arpenteur de mémoire. Quel rôle joue la mémoire dans votre création littéraire ? Dans L'homme-fougère, je me suis penché, par la voie du roman, sur cette curieuse indifférence à mon propre passé, et je me suis imaginé confronté à mon histoire personnelle qui aurait pris son indépendance. Comment réagirait un homme qui aurait, avec de petites nuances, mon propre bagage, s'il était confronté à la concrétisation de ses refus. Bien sûr, j'ai aussitôt découvert que si les souvenirs, c'est-à-dire le recours volontaire au passé personnel, m'étaient indifférents, la réminiscence, c'est-à-dire l'émergence incontrôlable de ce passé personnel, constituait le fond de mon identité, comme de toute identité. La mémoire doit composer avec le souvenir et la réminiscence, en tenant compte du fait que notre identité n'est pas seulement fonction de nos choix, mais tout autant de nos refus, de tous les possibles inexploités qui ont aussi contribué à nous façonner. Pour un romancier, la question est d'autant plus importante qu'il travaille surtout sur ces refus. Mes personnages en effet ne sont jamais des projections de moi-même, mais, au contraire, ils naissent de ce que je n'ai pas été, d'un déficit de vie. Je veux vivre par procuration ce que j'aurais pu être si j'étais né au XVIIIe siècle, si j'avais vendu des encyclopédies au porte-à-porte ou si j'étais le fils du prince de Gehirnhautenzündung. Dans L'homme-fougère, j'ai été au bout de l'hypothèse en partant de mes données personnelles, mais en faisant prendre au(x) personnage(s) des choix inverses aux miens. Pour reprendre une formule d'Henry Bauchau, j'ai eu envie d' « appeler les choses par leur non ». Comment la mémoire intervient-elle dans nos vies et comment la mémoire collective peut-elle aussi jouer un rôle dans le parcours d'un écrivain ? Je ne peux bien entendu expliquer le processus d'une manière scientifique. Mais j'aime à penser que la mémoire obéit elle aussi à la fameuse hypothèse de Haeckel : « l'ontogenèse est une récapitulation abrégée et rapide de la philogenèse », autrement dit : la genèse de chacun (durant les neuf mois de la grossesse, mais aussi, pour moi, à chaque instant de notre vie, car nos actes ont leur propre genèse dans notre esprit) récapitule l'évolution de l'espèce (ou de la conscience humaine) depuis son origine. Si cette constatation n'a pas valeur scientifique (les évolutionnistes sont revenus de cette hypothèse pratique, mais indémontrable), elle m'aide à comprendre les comportements humains. Nous avons tous des comportements résiduels (comme on parle d'organes résiduels – par exemple l'appendice - qui n'ont plus de fonction dans l'organisme). L'histoire est tout entière en nous, à chaque moment. Dans cette optique, l'erreur des philosophies de l'histoire a été de croire à une évolution historique stricte. Dans le positivisme de Comte, par exemple, il était évident qu'on abandonnait le stade animiste en passant au stade religieux, puis aux stades métaphysique et positif. Mais il nous reste encore bien des comportements animistes (par exemple se fâcher contre un objet qui nous résiste…) et bien souvent les stades religieux, métaphysique et rationnel coexistent en nous. L'évolution ne se fait donc pas (ou pas seulement) historiquement, au niveau d'une culture déterminée (ce qui évite par ailleurs de distinguer des cultures primitives et évoluées…), mais en chacun de nous, et à chaque acte de notre vie. Chaque acte véhicule à notre insu, et en une fraction de seconde, toute la mémoire de l'humanité, sous forme de réflexes intégrés. Ces réflexes sont parfois nécessaires (pour réagir immédiatement en cas de danger), mais peuvent se révéler dangereux. La peur de l'autre, salutaire à certaines époques où il représentait souvent un danger, engendre le racisme. Et les clichés que celui-ci véhicule prennent des formes empruntées à la mémoire collective. C'est ainsi que des clichés (comme l'accusation de cannibalisme) lancés dans l'antiquité contre les conjurés de Caracalla, ont été repris contre les premiers chrétiens, avant d'être adressés par les chrétiens eux-mêmes contre les hérétiques et les sorciers, puis, sporadiquement, dans la propagande raciste. Ces réflexions très brièvement résumées ne constituent pas des hypothèses de travail, et encore moins une grille de lecture, mais elles m'invitent à me méfier des vérités intangibles en matière d'histoire et, dans mes romans, à me sentir responsable de toute la mémoire du monde. Plusieurs de vos textes sont des polars. Est-ce un genre que vous affectionnez particulièrement ? C'est vrai que dans mon adolescence, j'ai découvert la littérature par l'intermédiaire du roman policier (Agatha Christie, Exbrayat, Steeman…), même si, aujourd'hui, je n'en lis plus. Je ne renie pas mes lectures adolescentes, mais on met trop de choses derrière l'étiquette « polar » : l'enquête (qui continue à me fasciner), mais aussi l'atmosphère glauque, la violence systématique, la bipolarisation de la morale, qui ne me touchent guère. Ce que j'ai retenu du roman policier, c'est l'enquête, la structure du récit, le maintien du suspens, toutes choses qui ne sont par ailleurs pas limitées à ce genre. J'utilise volontiers l'énigme comme ressort dramatique, mais à la différence du roman policier, j'évite de la refermer sur une solution définitive. « L'énigme est divine ; la solution est humaine », dit Frédérick Tristan. Si l'écrivain est le démiurge de son roman, il a vite la tentation de l'Adam besogneux lorsqu'il veut boucler son récit. Je dois lutter contre cette tentation, qui n'est jamais celle de l'acte créateur, mais celle de la relecture. Il faut trouver un juste équilibre entre les deux. C'est pour cela que j'aime jouer avec le roman policier (mais aussi avec le fantastique, avec le conte initiatique…) en essayant de ne pas y succomber. Le roman policier doit être inquiétant dans sa lecture et rassurant à la fin. J'opte plutôt pour l'inverse. Il y a assez peu d'éléments inquiétants dans mes romans, et l'énigme repose rarement sur l'élucidation d'un meurtre. On m'a souvent classé, par commodité, dans la littérature policière, parce que j'en utilisais les recettes. J'ai tâché, pour en sortir, de construire un roman (Requiem pour un ange tombé du nid) sur le schéma inverse : un meurtre dont on connaîtrait le coupable, mais dont il faudrait identifier la victime. Le livre a aussitôt été catalogué comme roman policier… Vous avez écrit sur Sherlock Holmes. Pourquoi ce personnage ? Ce n'est pas Sherlock Holmes qui m'intéressait, mais le couple Holmes / Watson, qui symbolisait pour moi la bipolarisation de l'homme moderne depuis le XVIe siècle : le corps (Watson, le bon vivant et le médecin) et l'âme (Holmes, l'intelligence pure). Or, par ma culture médiévale, j'ai été habitué à raisonner par rapport à un homme tridimensionnel (corps, âme, esprit). La perte de la troisième dimension aplatit l'homme comme la photographie d'une statue. J'ai donc voulu introduire un troisième personnage dans le couple célèbre (mais j'aurais aussi bien pu choisir don Quichotte et Sancho Pança !). Bien sûr, en tant qu'athée, je ne pouvais pas donner à l'esprit le sens religieux que lui attribue la pensée médiévale. Mais cette petite étincelle divine qui met l'homme en contact avec son créateur représente bien, pour moi, tout ce qui nous dépasse, tout ce qui nous élève au-dessus de notre condition, et qui reste inexplicable selon la logique dualiste. Il m'a paru évident que l'esprit, dans notre société, est représenté par la poésie. J'ai donc mis un poète, Charles Cros, dans les pattes des deux détectives, et sa seule présence remet en question toutes leurs certitudes. Si chacun des trois, séparément, aboutit à un échec (Cros est un alcoolique raté, Holmes se drogue, Watson ne comprend rien à ce qui l'entoure), leur union révèle (au sens photographique du terme) ce qu'il y a de meilleur en eux. Le fantastique est aussi un domaine qui vous intéresse ? Même remarque que pour le roman policier. J'ai lu très peu de littérature fantastique, très peu de science-fiction, mais en revanche j'ai été nourri de merveilleux médiéval, de symbolisme et de surréalisme. On assimile trop facilement le fantastique à tout ce qui dépasse le réalisme strict. Je me suis pour ma part taillé ma part d'imaginaire entre le fantastique, le merveilleux et la science fiction. Je ne crois pas que le monde se résume à ce qui en est perceptible par nos cinq sens. Pour autant, je suis incapable de concevoir une transcendance, un monde qui échappe aux lois universelles. Toute forme de surnaturel, au sens commun du terme, m'est étrangère. Tout se passe comme si des sens supplémentaires nous permettaient, à certains moments, d'appréhender la même réalité d'une manière différente, révélant des rapports insoupçonnés entre les choses, créant des relations spatiales ou temporelles inadmissibles pour notre logique habituelle, un peu à la manière du hasard objectif de Breton. Ma représentation du monde a été fortement marquée par des expériences troublantes que j'ai faites autour de mes vingt ans et que j'ai tenté de cerner dans Le mysticisme athée. Si elles m'ont semblé proches de celles des mystiques médiévaux, elles ne m'ont pas converti. Elles m'ont appris en tout cas que ce que nous nommons « néant » n'est pas assimilable au « rien », à l'absence, au vide. Ce que j'ai vécu ne pouvant se traduire en mots, j'ai tenté de l'approcher par des mythes, comme celui de la frontière de brouillard entre les deux mondes. Puis j'ai créé mes propres mythes, comme celui du Troisième Testament, ce livre sans cesse réécrit et sans cesse effacé qui contient toutes les réponses aux questions des hommes. J'ai utilisé des livres de magie médiévale pour concevoir les livres sibyllins (Le secret de la sibylle). J'ai utilisé la machine à décerveler de Jarry pour retrouver le néant de la pensée de maître Eckhart. Tout cela peut donner à mes romans une coloration de fantastique ou de science fiction, mais il ne s'agit pas pour moi d'un genre littéraire. La grande différence, c'est que je n'utilise jamais un élément de fantastique gratuitement. Je crois que le monde a un sens, qui s'est perdu et que nous retrouvons par hasard, lors de certaines expériences fortes. Le rôle du roman est de tenter de le restituer, ou au moins de restituer l'espoir de le trouver. Le monde qu'il décrit n'est pas un autre monde (comme dans le roman de science fiction), mais le monde où nous vivons, perçu avec d'autres sens, où tout devient évident. C'est le monde du mystique, d'une certitude intuitive. Si, dans la vie et dans mes essais historiques, je vis dans le doute, le roman tel que je le conçois appartient à l'évidence, car il a sa nécessité intérieure. « Certitude. Certitude », note Pascal dans son Mémorial. Et cela n'a rien d'incompatible avec le doute cartésien. Voilà pourquoi je ne peux pas lire de fantastique, parce que, le plus souvent, il utilise un attirail de procédés gratuits qui m'agacent assez vite. Vous faites partie du mouvement littéraire « Nouvelle fiction ». Quel est l'apport de ces rencontres avec d'autres écrivains dans votre travail littéraire ? Le rôle de tout groupe d'écrivain est de laisser à chacun approfondir sa propre vision du monde et de la littérature en la confrontant à d'autres qui lui sont proches, mais sans les ériger en dogmes ou en règles d'écriture. Je suis venu à la Nouvelle Fiction avec mes expériences de mysticisme athée et ma culture médiévale. J'ai trouvé chez les auteurs de la Nouvelle Fiction des expériences qui m'ont semblé proches, nourries de culture chinoise, germanique, anglo-saxonne… Ce sont des accès différents, et complémentaires, à un imaginaire qui ne se laisse pas cerner par les descriptions traditionnelles du monde, mais qui se manifeste de manière indirecte, par les mythes, par les symboles, par la fiction. Nous partageons, je pense, la même quête du sens, qui passe par une destructuration du monde des apparences, de l'homme culturé, et de soi-même, bien sûr, une déstructuration, opérée par le roman. Ainsi peut-on débarrasser la fausse réalité dans laquelle nous vivons des conventions que l'on a accumulées au cours des siècles pour la rendre supportable. Vous avez participé à des ouvrages collectifs. Quel est l'intérêt pour vous d'écrire à plusieurs ? Comment se construit cette aventure ? Le roman collectif est un autre exercice, qui répond à d'autres buts, et que j'ai tenté dans un autre groupe. Le romancier a beau croire, comme Térence, que puisqu'il est un homme, rien de ce qui est humain ne lui est étranger, il est forcément limité par ses propres pensées et ses propres expériences. Imaginer collectivement des personnages, confier à d'autres romanciers le soin de les faire vivre, puis les incarner à mon tour, m'a été précieux pour élargir ma personnalité. Avec le groupe « Changaï », nous avons mené à terme trois romans collectifs. Si un seul a été publié (L'affaire Grimaudi), l'expérience a été à chaque fois enrichissante, et le troisième est sans doute le plus achevé. La façon de travailler est à chaque fois différente, mais repose sur un même principe : les chapitres sont écrits tour à tour par l'un d'entre nous, et nous nous réunissons entre deux chapitres pour discuter de la suite. Parfois, c'était le hasard qui désignait le rédacteur, à d'autres moments nous avons opté pour une périodicité stricte. Au troisième, nous avons spontanément trouvé une écriture qui, sans être la même, ne rompait pas l'unité de l'ensemble. Le travail du romancier est foncièrement solitaire. Le partager à la source est un exercice vivifiant. Vous avez aussi créé une revue littéraire, Ouvertures. Quel était le projet de cette revue ? Combien de temps a-t-elle duré ? Pourquoi avez-vous interrompu la publication ? J'ai fondé la revue Ouvertures quand j'avais vingt-deux ans, à la sortie de la Fac, et elle a gardé son rythme bimestriel pendant cinq ans. Quand je me suis installé à Paris, cela devenait difficile de poursuivre avec la même régularité et j'ai préféré arrêter que de la voir dépérir lentement. Son seul projet, et c'est la raison de son titre, était de concevoir la littérature en dehors des chapelles qui se regardaient en chien de faïence (et en chiens de chasse). De ce point de vue, l'échec était inévitable. Nous pensions pouvoir créer un lieu neutre où toutes les tendances pourraient être accueillies, pourvu qu'elles manifestent la même sincérité d'écriture. Nous nous sommes vite rendu compte que pour beaucoup, le mépris l'emportait sur la curiosité littéraire. Très vite, cependant, la revue a attiré ceux qui ne se sentaient à l'aise dans aucune coterie, des électrons libres de la littérature, parmi lesquels je me suis fait des amitiés durables. Cela m'a laissé une méfiance définitive pour les groupes littéraires. Les deux auxquels je me suis agrégé partagent le même refus de la pensée unique. Sur votre site d'écrivain, vous parlez de vos lectures. Ce n'est pas fréquent qu'un écrivain parle des autres écrivains. Quelle importance cela revêt-il pour vous ? Je ne conçois pas l'écriture sans la lecture, et mon passé de critique littéraire m'a donné envie de parler des livres que j'aime. Sans doute est-ce trop rare sur les sites d'écrivains, parce que cela prend du temps de rédiger un texte, parce que même s'il n'y a pas de pression sur un site personnel, on est toujours tributaire d'un milieu dans lequel le choix même d'un livre semble significatif. Cela peut créer un malaise vis-à-vis d'amis. Publier ses préférences, c'est aussi s'exposer personnellement. Mais je m'obstine, parce que beaucoup de livres qui m'ont marqué m'ont été recommandés par des amis écrivains dont je me sentais proche. Il me semble normal de transmettre le relais. Je me dis qu'un lecteur qui aime mes romans devrait aussi aimer ceux que j'aime. Et comme, souvent, ce ne sont pas ceux que recommande la critique traditionnelle, il est important d'en parler quelque part. Oui, j'aimerais beaucoup que les romanciers que j'apprécie fassent la même chose : je suis parfois en panne de bons livres, malgré l'augmentation constante de la production… Vous avez écrit Voyage autour de ma langue et Les grandes allusions, Dictionnaire commenté des expressions d'origine littéraire. Que représente la langue pour vous ? Tant de choses, et bien plus qu'un moyen de communiquer ma pensée ou mes émotions. C'est par la langue (et par la poésie) que j'ai connu les plus fortes expériences de ma vie, que j'ai tenté de raconter dans Le mysticisme athée. C'est la langue qui m'a donné non seulement accès au monde (c'est son rôle premier), mais à l'envers du monde, cette doublure de néant qui lui donne sa cohérence. C'est par le travail sur la langue que je tente de m'en rapprocher à nouveau. Mais en même temps, c'est la langue qui m'en empêche, car c'est elle qui donne forme à la pensée. Ce sont les mots qui m'empêcheront toujours de retrouver le vide intérieur total. J'entretiens avec la langue les mêmes rapports que maître Eckhart avec son Dieu. « Je prie Dieu de me délivrer de Dieu », disait-il. J'essaie par les mots de me libérer des mots. Vos analyses montrent avec beaucoup d'intérêt les fonctionnements des sociétés et des individus dans leurs modes de vie, dans leurs comportements amoureux. Quel est le rôle de l'écrivain dans ce travail ? Je ne serais pas un écrivain si je ne pensais qu'il construit le monde. Je pense qu'un écrivain se doit d'être mégalomane ; sinon, il n'est qu'un imposteur. De quel droit prendrait-il quatre ou cinq heures de vie à un lecteur si ce n'était pour bouleverser cette vie ? L'écrivain est démiurge, puisque le monde, dit la Bible, est la parole de Dieu. Du moins au moment de la création. Le lendemain, il est sain de se rendre compte qu'on n'est qu'un homme et qu'aucun de nos livres n'a bouleversé quoi que ce soit. C'est un vieux sujet de dissertation : l'écrivain influence-t-il la société ou ne sert-il que de chambre d'écho à des idées dans l'air du temps ? Soyons heureux s'il ne titille plus que les potaches et non les procureurs, car le temps des Ernest Pinard pourrait bien revenir. Pour ma part, je pense que l'écrivain doit avoir deux ambitions complémentaires : focaliser à un moment donné les idées neuves et leur donner la forme la plus appropriée à leur époque ; lorsque ces idées sont devenues des lieux communs, les dénoncer pour en libérer les esprits. Mais si un jour il tombe sur une idée véritablement originale, sur le mot du démiurge, il peut être sûr qu'ils ne rencontreront aucun écho. Vous avez aussi parlé de la pudeur, de la naissance interdite, du mariage en occident. Quelles ont été vos motivations pour aborder ces sujets ? Les « sujets » sont comme un écheveau : il faut l'avoir déroulé pour se rendre compte qu'il ne comporte qu'un seul fil. Avec le recul, je me rends compte que ce qui m'intéresse, c'est moins l'histoire des faits, des techniques, des comportements… que celle du regard que l'on pose sur eux. La pudeur est le regard posé sur la nudité. Dans La naissance interdite, je me suis plus intéressé à la manière dont se vivait la stérilité, volontaire ou non, qu'aux moyens de la procurer ou de la guérir. Les conceptions du mariage ou de l'amour m'ont plus retenu que l'évolution des rites ou des stratégies de séduction. Les lieux communs sur les boissons, plus que leurs techniques de fabrication… J'aime voir comment l'homme interfère avec l'histoire, et comment il résiste (ou non) à ceux qui la façonnent. Comment se définit un écrivain dans le monde actuel ? Quelle est sa part d'engagement dans la société ? Nous vivons à une époque où l'écrivain n'est plus le « maître à penser », parce que son audience directe (hors d'éventuelles interventions dans les médias) est restreinte. Son engagement dans une cause, quelle qu'elle soit, a moins d'impact que celui de n'importe quelle vedette de cinéma ou de télévision. Cela décourage souvent l'engagement, au sens sartrien du terme. Est-ce un bien ? Est-ce un mal ? Je n'ai jamais eu la vocation de maître à penser, et je ne m'en suis jamais reconnu. Pour autant, je ne souhaite pas n'être qu'un raconteur d'histoires. Je pense que le rôle de l'écrivain est de donner une matière à réfléchir plus qu'une réflexion. C'est pour cela que je préfère l'apologue, dont le sens est ouvert, à la fable, dont la morale est définie ; le symbole, ambivalent, à l'allégorie, univoque ; le conte à la nouvelle et le mythe au récit. Quant à l'essai historique, il doit se garder comme de la peste de toute velléité démonstratrice. Je ne souhaite pas aller plus loin dans l'engagement. Cela ne veut pas dire que je me désintéresse de la société dans laquelle je vis, mais que l'implication doit passer pour moi par la vie associative ou par l'action individuelle, pas par l'écriture. Par ailleurs, on a souvent parlé d'engagement de l'intellectuel, et rarement de responsabilité. C'est un sujet sensible, car l'acte créateur doit être totalement libre, et donc irresponsable. Mais la diffusion d'un texte, et les prises de position d'un écrivain sur d'autres sujets que ceux qu'il aborde dans ses écrits, ne sont plus des actes créateurs. On a beaucoup loué l'engagement d'écrivains qui se sont lourdement trompés et qui ont eu une influence considérable sur la diffusion de certaines idées. Cela mériterait une réflexion beaucoup plus approfondie, car l'appel à la responsabilisation de l'écrivain, mal comprise, peut déboucher sur une forme détournée de censure. La tendance actuelle à la judiciarisation de l'édition va hélas dans ce sens. À chacun de trouver son équilibre entre engagement et responsabilité. Vous êtes actuellement Secrétaire général de la Société des gens de lettres. En quoi cette fonction est un engagement pour vous ? J'y suis arrivé par hasard, et par curiosité. On m'a demandé assez rapidement d'assumer les fonctions de secrétaire général ; je les ai acceptées sans trop savoir ce à quoi cela m'engageait, et à un moment un peu difficile pour la SGDL. C'est devenu une part importante de ma vie. D'un point de vue personnel, je peux faire coïncider mon action présente et une histoire collective qui lui donne sens. Je me suis passionné pour les archives de la Société, mal répertoriées, pour le patrimoine matériel et spirituel qu'elle représente : une manière de vivre au quotidien mon goût pour l'histoire et la tradition. Mais si j'y suis resté, c'est parce que dans un monde où la littérature ouvre plus d'horizons qu'elle ne propose de chemins pour les atteindre, la solidarité des écrivains est essentielle, et que depuis plus de 150 ans, la SGDL s'est donné les moyens de cette solidarité. Il ne s'agit pas seulement d'aide financière, sociale ou juridique, mais aussi d'une écoute, de conseils, d'une présence qui sont souvent aussi précieux que le soutien temporaire que nous pouvons procurer. Enfin, c'est le lieu d'un combat nécessaire et collectif pour défendre un droit d'auteur de plus en plus menacé par la mondialisation (qui tente d'imposer le système du copyright) et par l'harmonisation des législations européennes. Dans l'indifférence la plus totale, on laisse se détériorer les conditions de la création. Or si l'on veut s'investir totalement dans l'écriture, cela suppose que l'on puisse vivre de l'écriture. Nous n'en sommes même plus, bien souvent, à la survie. Défendre une littérature de qualité, c'est aussi permettre aux écrivains de la créer dans des conditions décentes. Cela mérite un combat, même si les chances de le gagner sont minces. Propos recueillis par Brigitte Aubonnet |
    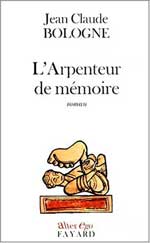              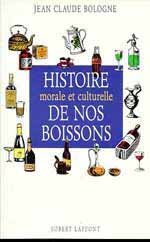 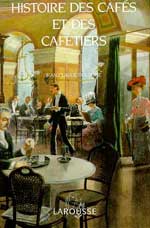 Vous pouvez visiter le site de Jean Claude Bologne : http://perso.wanadoo.fr/ jean-claude.bologne | |||||