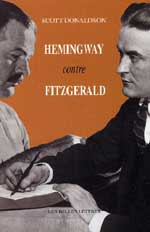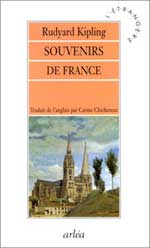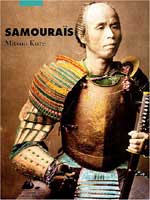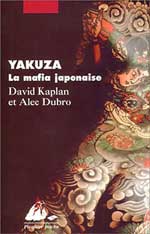|
|
 Carine
Carine
Chichereau
« C’est mon goût pour l’écriture
qui m’a amenée à la traduction. »
Comment êtes-vous venue à la traduction ?
Je suis venue à la traduction tout à fait par hasard, à une époque où je me destinais au journalisme. Je devais faire un stage dans la presse spécialisée, et j’ai eu la chance d’être prise à la prestigieuse revue Europe. Je suivais alors en parallèle des études d’anglais et l’on m’a demandé de traduire des textes sur Beckett, qui ont par la suite été publiés dans Europe. J’aimais avant tout écrire, et cette activité m’a beaucoup plu. Lorsque j’ai compris que le journalisme n’était pas pour moi, je me suis naturellement tournée vers la traduction. Oui, je pense en fait que c’est mon goût pour l’écriture qui m’a amenée à la traduction.
Quand vous parlez d'écriture est-ce de votre écriture personnelle ?
Oui, tout à fait. J'écris depuis l'enfance, et dès le collège j'ai formé l'espoir d'en faire mon métier. J'ai compris ensuite que mes romans ne suffiraient pas à me faire vivre, alors j'ai envisagé d'être journaliste - cela me paraissait être le seul métier d'écriture possible. Bien sûr, c'était une sorte de rêve de jeunesse, je me voyais déjà grand reporter pour Le Monde ! Mais ce qui m'intéressait avant tout c'était l'écriture au sens littéraire, voilà pourquoi j'ai finalement choisi la traduction quand j'ai découvert cette profession. En effet, quand on traduit, on écrit en permanence. C'est un peu comme les musiciens qui jouent des partitions de Mozart, Bach ou Berg. Ils y prennent du plaisir, et à côté, parfois, ils composent. L'avantage de la traduction, c'est qu'on écrit justement en suivant une partition. Traduire, c'est apprendre à écrire. Et inversement, il est nécessaire de savoir écrire pour bien traduire. Voilà pourquoi nous sommes administrativement rangés dans la catégorie des auteurs.
Quelle a été votre première traduction ?
Ma première traduction d’un livre complet pour l’édition a été L’Atlas de la Grèce Antique, pour Autrement. Cela me convenait parfaitement car j’avais fait des études assez classiques, et que le sujet me passionnait. C’était très mal payé, il y avait beaucoup de travaux de recherches, mais c’était vraiment intéressant.
Vous avez traduit des inédits d’Henry James. Comment cela s’est-il passé ?
La rencontre des textes de James s’est faite tout à fait par hasard, un jour où je flânais à l’American Library in Paris. J’étais au rayon des récits de voyage, et je tombe sur deux recueils de James comportant des textes sur la France, l’Italie, les Etats-Unis et l’Angleterre. Je n’en avais jamais entendu parler. J’ai essayé de savoir s’ils avaient été traduits : deux textes sur l’Angleterre et un sur les Etats-Unis étaient inédits en français. J’ai immédiatement songé qu’il fallait faire quelque chose, et j’ai cherché un éditeur. Elizabeth Boyer, des éditions Farrago, s’est montrée très intéressée.
Vous traduisez des auteurs que l’éditeur vous propose et d’autres que vous proposez à l’éditeur. Comment se différencient les deux démarches ?
Je suis toujours à l’affût des inédits. J’adore m’occuper d’un livre du début jusqu’à la fin : le choisir, puis essayer de le placer chez un éditeur, le traduire, écrire la préface. C’est un peu comme faire un bébé ! C’est votre projet à vous, on se sent beaucoup plus impliquée. Quand je traduis sur commande, même si j’éprouve toujours un certain goût pour ce que je fais (je refuse les livres qui ne m’intéressent pas), je ne suis pas forcément enthousiasmée par le texte. Quand je suis à l’origine du projet, que je me suis battue parfois pendant des années pour le faire aboutir, c’est que j’y crois vraiment, qu’il me transporte, dès lors le plaisir est décuplé. Et puis il y a cet espèce de sentiment de filiation… c’est très étrange.
Lisez-vous les autres livres de l’auteur quand vous avez un texte à traduire ?
Cela dépend du type d’ouvrage. S’il s’agit d’un vrai texte littéraire, oui. Je cherche à m’imprégner du style de l’auteur, à capter ses influences, ses « tics » d’écriture, à intégrer son rythme, à cerner les thèmes qui lui sont chers. L’idéal, bien sûr, est de suivre un auteur d’un livre à l’autre. Cela ne m’est pas encore arrivé, tout au moins pour les auteurs vivants, mais j’espère que ce sera pour bientôt. C’est d’autant plus enrichissant quand on noue une relation personnelle avec un auteur.
Comment approchez-vous le texte à traduire, globalement d’abord, en lisant entièrement le texte, ou au fur et à mesure ?
Je lis toujours un texte intégralement avant de le traduire. Plus il est difficile, plus je le relis, pour bien comprendre toutes ses dimensions, les différents niveaux de lecture possibles, et surtout les substrats qui ne sont pas forcément visibles lors d’une première lecture.
Comment intégrez-vous la musicalité des mots pour la redonner dans votre traduction ?
C’est à la fois difficile et passionnant. J’ai récemment traduit un roman irlandais que j’adore, Deux garçons, la mer, de Jamie O’Neill, où il y a profusion de jeux sur les sonorités. Dans ce livre le sens et l’histoire sont très importants, mais la poétique l’est tout autant. Parfois, il m’est arrivé pour mieux servir cette musicalité de faire une légère entorse au sens. Dans des descriptions, par exemple. Dans ce cas, j’essaie de trouver les mots français qui créeront l’effet équivalent. Parfois, quand cela me paraît trop difficile, pour ne pas alourdir la phrase en français, je « décale » un effet stylistique. Je le fais porter sur les mots suivants, la phrase suivante. Car il n’est bien sûr pas question de décalquer.
Comment se passe la réécriture du texte ?
Je travaille grosso modo en une seule fois. Je lis d’abord le texte pour parfaitement le comprendre, puis je me lance, comme une pianiste devant sa partition. C’est une tâche qui demande une grande concentration. Les phrases me viennent plus ou moins naturellement. Je décline ma phrase en français jusqu’à ce que je trouve la variante la plus proche, la plus fidèle et la plus intéressante. Ensuite, je relis, je relis, je relis… Jusqu’à ce que rien n’entrave plus ma lecture. Le texte prend alors sa cohérence propre en français.
Comment allie-t-on fidélité au texte et distance pour recréer un texte cohérent ?
C’est l’éternel problème : concilier littéralité et littérarité. Etre fidèle à la fois à la lettre et à l’esprit. Bien traduire les mots, tout en respectant l’économie de l’ensemble. C’est la principale différence entre la traduction et la version ! Concrètement, quand on aborde un nouvel auteur, au début, on a tendance à coller à l’original. Puis, plus on se familiarise, plus on s’imprègne du style de l’auteur, plus on est capable de prendre de la distance, sans bien sûr trahir son écriture. Je pense que c’est comme le travail d’un comédien qui essaie d’entrer dans son personnage. Au début, on tâtonne, on cherche, on en fait trop ou pas assez, et puis arrive un moment où l’on sent que ça y est, on est à l’aise, on a trouvé ses marques, en quelque sorte. C’est une sorte d’effet de mimétisme.
Quels auteurs avez-vous traduits ?
Parmi les classiques, j’ai eu la chance de travailler bien sûr sur James, mais aussi Dickens et Henry Miller, qui est l’un de mes écrivains favoris. A chaque fois, ce furent des projets que j’ai menés à bien. Ainsi pour Miller, la tâche s’est révélée assez facile : je connaissais bien sa façon d’écrire à force de le lire, et j’ai retrouvé quantité de correspondances avec d’autres textes. James en revanche s’est avéré une gageure, et j’ai proposé à une collègue et amie, France Camus-Pichon, qui connaissait intimement l’œuvre de James, de travailler avec moi. Ainsi avons-nous travaillé en nous relisant l’une l’autre, chacune voyant chez l’autre les points faibles, ce qui nous a permis non seulement de surmonter les difficultés, mais aussi d’enrichir nos textes respectifs. Ce fut une expérience très féconde, car il est rare dans notre profession d’avoir un véritable « retour » qui puisse nous permettre d’avancer, de progresser.
Pour les contemporains, rencontrez-vous les auteurs ?
Quand je le peux, oui. Grâce à une amie j’ai par exemple rencontré Jamie O’Neill, cité plus haut. Je suis allée le débusquer au fin fond du Connemara, et nous avons passé une journée à discuter de quantité de choses. Il m’a par la suite proposé de venir travailler avec lui, ce que je n’ai malheureusement pas pu faire. Toutefois, je pense que cette rencontre a permis une communication plus riche par la suite, car je lui ai posé des centaines de questions sur les traditions irlandaises et les mots qu’il employait.
Est-ce nécessaire ? Est-ce une aide ?
Je ne pense pas que cela soit nécessaire, mais c’est une véritable chance ! J’ai beaucoup regretté de ne pas avoir pu rencontrer lors de son passage à Paris Dennis Cooper, un auteur américain que j’ai traduit il y a quelques années. A l’inverse, j’ai fait la connaissance l’an dernier d’un auteur, Nassim Taleb, qui se situe curieusement aux confluents de la philosophie, du trading et de la recherche en sciences des probabilités, autant de domaines que je ne connaissais pas du tout. Il m’a ainsi expliqué beaucoup de choses sur son domaine qui ont facilité mon travail, et nos entretiens ont été intellectuellement très riches. Il m’a parlé de ses autres projets de livres, et j’espère pouvoir à nouveau travailler avec lui.
Gardez-vous des contacts après la traduction ?
Pour l’instant, cela ne s’est pas produit. Mais je pense que j’aurai peut-être la possibilité de revoir Nassim Taleb, qui vient souvent à Paris, car nous avons fait du bon travail et ses projets m’intéressent.
Propos recueillis par Brigitte Aubonnet
|
|
|


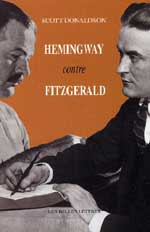
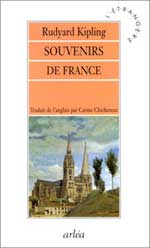

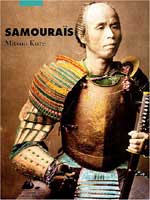
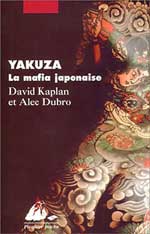


Mise en ligne :
mars 2006
|
|