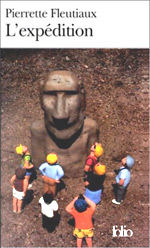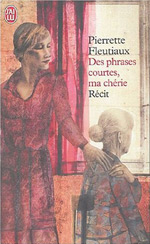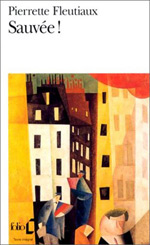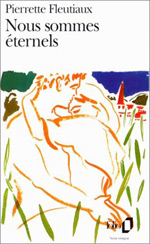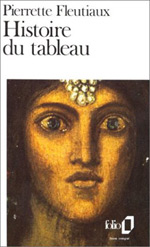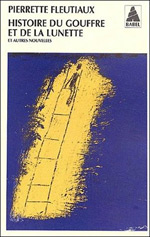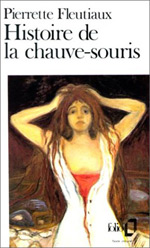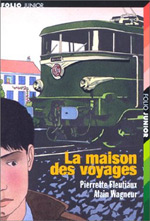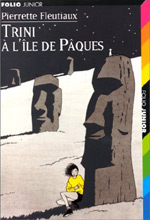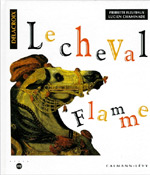|
|

Pierrette
Fleutiaux
Romancière (Prix Femina 1990) et nouvelliste (Goncourt de la Nouvelle 1984), Pierrette Fleutiaux explore l’intime dans le rapport à l’autre, à l’espace,
au temps : « C'est un temps de l'évolution intime, de l'évolution interne, au sein d'un temps historique. »
Vous avez écrit de nombreux romans, recueils de nouvelles mais est-il vrai que L'Expédition est l'un de vos romans préférés ?
C'est un livre sur un lieu (l'île de Pâques) profondément romanesque, très étrange, très puissant, où l'histoire de l'humanité se retrouve en condensé. J'ai repris la tradition et le style des explorateurs-chroniqueurs du XVIIIe siècle (Lapérouse, Cook) qui partaient pour combler les blancs de la carte du monde, sauf que mes personnages sont des touristes d'aujourd'hui ! J'ai pu aussi introduire des auteurs que j'aime profondément comme Melville, Pierre Loti. Il y a aussi ce jeu qui m'amuse toujours, celui de renverser les genres, les rôles. Dans les navigations anciennes, il n'y avait que des hommes. Là, les chefs sont des femmes, des scientifiques, et le subalterne est un jeune homme. J'ai féminisé les titres, comme la Commandant... Au Québec c'est absolument naturel puisque l'on dit une écrivaine, mais pas tout à fait en France.
Vous aimez beaucoup les voyages, vous avez séjourné dans l'Ile de Pâques ?
J'y ai passé trois semaines, avec une équipe de cinéastes. Mon roman opère par glissements : du récit de voyage contemporain (un groupe de touristes) aux chroniques humanistes des découvreurs du XVIIIe siècle, et de l'humour à l'infiniment sérieux. L'océan est le grand lieu de l'imaginaire : l'immensité, l'inconnu. L'île de Pâques est si petite qu'on sent battre l'océan tout le temps, de tous les côtés. Il n'y a qu'un seul village et tout le reste est désert. On voit parfois un cavalier, immobilisé comme une statue de marbre. Que fait-il ? Il regarde l'océan et je pensais à ces indigènes Rapa Nui qui autrefois ignoraient qu'il y avait d'autres êtres humains sur cette planète. Leurs immenses statues n'étaient toutefois pas tournées vers l'océan, mais vers l'intérieur. C'étaient des représentations d'ancêtres et elles étaient censées veiller sur le village.
C'est un voyage mais aussi une quête intérieure.
Tout récit de voyage, si petit soit-il est toujours aussi une quête intérieure, le voyage de votre psychisme.
C'est aussi une recherche sur le temps.
Le livre danse à travers différentes époques (celles, tragiques, du passé de l'île, mais aussi le présent (celui des habitants et des touristes), et peut-être l'avenir (l'île passant pour être un paradigme de notre planète). La quête de nos voyageuses se présente de façon tout à fait ordinaire. Celle qui s'intéresse à la langue, aux écritures, est une professeur, austère célibataire. La spécialiste de la flore est une charmante jeune femme un peu légère. Quant à la commandant, elle regroupe des documents pour écrire un livre. Sur l'Ile de Pâques, il y a en permanence une cinquantaine d'archéologues, de photographes, un volant de scientifiques, donc cela est tout à fait normal, mais il va leur arriver toutes sortes de choses, car mes "dames" sont aussi en quête du mystère du monde…
Des aventures, des confrontations, mais vous utilisez aussi beaucoup l'humour. Vous travaillez sur ordinateur ?
Oui, mais c'est un instrument qui a ses pannes, certains d'entre nous ne veulent pas l'utiliser par peur. Je ne peux pas m'en passer, ma pensée est au bout des doigts, sans ordinateur il n'y a plus d'écrivain, mais quand je suis arrivée sur l'Ile de Pâques avec un ordinateur et un appareil photographique neufs, ils ne marchaient plus ni l'un ni l'autre. Quant au modem, il était inutile car il n'y a pas de téléphone. Sur le plan touristique, c'était un voyage plutôt raté, mais du coup extrêmement enrichissant sur le plan littéraire. J'ai eu le sentiment fugitif que j'étais victime des esprits "Aku-Aku". Dans l'île, les morts sont présents tout le temps. Au-dessous de la surface, il y a un immense réseau de tunnels, de cavernes et de grottes qui ont été en partie explorés où les Rapa-Nui (les Pascuans) mettaient leurs trésors quand il y avait des arrivées de navires esclavagistes et où ils se cachaient. L'esprit des morts y réside. Il ne faut jamais entrer n'importe comment dans une caverne pour la visiter. Les Pascuans sont modernes, ils voyagent beaucoup. Les jeunes femmes n'hésitent pas à faire des enfants avec des étrangers, pour que le sang ne se raréfie pas, et ce n'est jamais mal considéré. D'une certaine façon, les enfants sont à tout le monde, ils ne sont jamais abandonnés. Avant il n'y avait qu'un bateau par an puis un avion par semaine, maintenant il y a quatre passages d'avion soit de Santiago du Chili, soit de Tahiti. Les Pascuans ont été brutalement confrontés à la modernité mais le passé est toujours là avec les anciennes superstitions. On sent physiquement cette présence cernée par le rugissement continuel de l'océan. On se sent comme entouré par la présence des esprits Aku Aku. J'avais l'impression que ces esprits voulaient me dire quelque chose. Du coup, quand je suis rentrée, j'ai commencé à lire des documents sur l'île, je suis allée au Musée de l'Homme et de la Marine et peu à peu le roman s'est construit. Je ne pouvais pas quitter cette île sans écrire un roman.
Dans beaucoup de vos romans le voyage joue un rôle important mais aussi le rapport de l'être à son espace. Dans Histoire de la chauve-souris, le personnage erre dans la vie. Le lieu est indéterminé. C'est un roman très métaphorique.
C'était mon premier roman et c'est l'histoire d'une initiation. Une jeune fille de seize ans quitte sa famille et entre dans la vie. Ce n'est pas facile d'affronter les autres. J'ai voulu rendre compte de cette difficulté, de cette solitude. J'ai imaginé que cette jeune fille se penche une nuit à sa fenêtre, à la périphérie d'une petite ville de province, ses longs cheveux coulent le long du mur et soudain un bruit : une chauve-souris est venue se nicher dans ses cheveux. Dans les campagnes, on racontait beaucoup de choses sur les chauves-souris et les femmes. Il y avait là une vision sombre de la féminité, un peu diabolique. Le postulat du roman est fantastique, puisque l'héroïne ne pourra se défaire de cet animal dans sa chevelure. Toutes les rencontres qu'elle fera se réaliseront à travers cette médiation. Il y a donc ceux qui trouveront "la chose" horrible, c'est velu, ça bouge et il y a ceux qui la trouveront très intéressante ! La chauve-souris représente ce qu'il y a de plus intime dans notre psychisme, le côté clair et le côté sombre…
Cela la renvoie à ses questionnements.
Oui, certains ne voient pas la chauve-souris, d'autres la voient trop. Dans la vie qui vous aime, qui ne vous aime pas, qui suis-je, quel est ce monde où je me trouve ? La chauve-souris permet de poser ces questions, ou plutôt de montrer comment on vit avec ces questions, et cela d'une façon inattendue, parfois drôle...
Vous avez une manière tout à fait personnelle d'étirer la réalité, on frôle le fantastique mais la réalité est toujours présente.
Oui, c'est très concret. Cette jeune fille quitte sa petite ville de province pour aller à Paris, ville des moyennes tours, puis elle va à New York, ville des grandes tours.
Il y a beaucoup de tours dans vos romans.
Les tours, c'est la ville, le symbole de la ville…
La tour représente à la fois la ville mais aussi la quête intérieure. On a l'impression qu'il y a le monde du haut et le monde du bas, une recherche personnelle dans les profondeurs que vous matérialisez dans l'espace. Cette jeune fille passe son temps à se chercher et l'on se demande si sa vie suffira et si elle se trouvera.
Elle a environ vingt ans et elle doit vivre avec cette bête, elle pare au plus pressé, elle la nourrit, elle en tient compte. Elle accepte finalement ce qu'elle est. C'est le parcours que doit faire un adolescent. Pour les jeunes filles c'est peut-être plus difficile que pour les jeunes hommes.
Histoire du tableau se passe à New York. Le lieu est plus défini que dans Histoire de la chauve-souris.
C'est une histoire très simple en apparence. Un jeune couple français est venu pour un an à New York. Lui est professeur d'université, elle enseigne la grammaire dans un centre culturel français, ils ont deux enfants et ils sont tout à fait ordinaires. Mais la jeune femme va rencontrer un peintre, il n'y aura pas d'histoire d'amour avec le peintre, mais avec un tableau. Elle va introduire ce tableau chez elle, et il l'entraînera dans une sorte de délire qui l'emmènera dans les bas-fonds de la ville jusqu'à ce que…
Dans ses bas-fonds à elle aussi car elle est dans une quête personnelle, dans la problématique de ses rapports aux autres, à sa famille. Le tableau causera un éclatement de la personnalité. Petit à petit, l'héroïne se recomposera avec les couleurs qui reprendront leur place. Toute une partie du récit se fait à travers les couleurs, celles qui arrachent et celles qui rassemblent. Après cette turbulence, sa personnalité se reformera.
Il y a tout un rapport aux objets.
Au début, ce couple d'intellectuels ne veut pas d'objets. Leur vie est bien réglée, ils sont dans le monde de la raison et de la pensée. Mais voici qu'arrive ce tableau, qui devient dans leur vie une force incontrôlable, sauvage, celle de l'art peut-être…
Pourriez-vous expliquer comment vous avez eu l'idée d'écrire Métamorphoses de la Reine ? Vous aimiez lire des contes, pourquoi avez-vous voulu en réécrire ?
Les contes de fée ne sont pas nécessairement des histoires gracieuses. C'est l'interprétation donnée aux passions humaines depuis des temps immémoriaux. J'aime sentir cette profondeur du temps. Je me suis retrouvée un moment à relire ces contes d'enfants et voilà que soudain je me demande quelle est la place qu'ils donnent à la femme adulte. Dans les contes de Perrault, c'est la méchante mère, la marâtre, la sorcière, la mauvaise en fait. J'ai eu comme un choc. Ces contes ne proposent donc aux petites filles qu'un seul rôle à l'horizon de leur vie d'adulte : celui de l'horrible bonne femme. Cette révélation a été très puissante et j'ai commencé à réécrire ces contes en inversant les rôles, en donnant à la femme adulte la place centrale. Elle a le pouvoir, c'est donc la reine et non le roi qui dirige. Elle a l'argent. Elle a aussi les beaux jeunes gens. A partir de cette modification fondamentale, on peut explorer beaucoup d'attitudes de notre époque. Perrault lui-même avait modifié les contes oraux pour convenir à la société de son temps. Dans le vieux conte paysan du Petit Chaperon Rouge, la fillette échappe au loup car elle est très maligne. Le loup l'a couchée dans son lit, (on voit donc les implications érotiques), mais elle dit qu'elle a un besoin pressant et réussit à se sauver. Perrault a écrit tout le contraire. Le petit chaperon rouge se fait manger : mesdemoiselles ne suivez pas le loup, obéissez à vos parents et laissez-vous marier comme ils l'entendent. L'évolution de l'interprétation des contes au fil des époques est très intéressante à suivre. Après avoir écrit ce livre, je me suis renseignée. La refonte des contes de fée se pratique beaucoup parfois de façon très militante, comme l'ont fait certaines féministes américaines, de façon un peu systématique. Les contes sont très utilisés aussi en psychothérapie. Pour moi, il y avait surtout l'intérêt de l'écriture : manier cette langue merveilleuse du XVIIe siècle, introduire des anachronismes (Cendrillon devient Cendron, va au bal en Harley-Davidson etc…), et grâce à ce jeu avec la langue, atteindre à des profondeurs de vérité, d'émotions qui seraient autrement restées lettre morte, ou plutôt lettre plate…
Nous sommes éternels est un roman important. Il y a aussi un univers tout à fait spécifique.
A l'époque, j'en avais un peu assez de travailler, j'avais envie d'écrire, en quelques mois, un "best-seller" ! On a parfois des idées un peu simplistes comme ça... Il y avait eu ce livre, Love Story, qui avait été un succès mondial. C'est un récit très simple, très américain, mais l'histoire tragique de ce tout jeune couple d'amoureux (la jeune fille meurt d'un cancer) avait fait le tour de la planète. Je voulais aussi raconter une histoire d'amour toute simple. Mais cela a tourné autrement tout de suite et je me suis retrouvée engagée dans une histoire complexe, qui m'a pris cinq ans de travail.
Au cœur de ce roman, le mal, le mal absolu tel que nous l'avons connu dans notre contexte européen, les camps de concentration et d'extermination. C'est le cœur du roman, mais on ne le sait pas tout de suite. Au début, une famille, où les rapports semblent mystérieux. Le père est avocat, il y a deux femmes, l'une, distante, réservée, avec toujours une sorte de voile sur le visage, l'autre très jeune, très jolie, un peu dérangée et qui rêve d'être danseuse. Et puis deux enfants, Estelle (l'aînée) et Dan. Le livre commence à la naissance du petit garçon. Les deux enfants ont un rapport très fort et exclusif. Il y a beaucoup d'amour dans leur famille, trop d'amour peut-être, mais ils perçoivent la présence d'une ombre, d'un non-dit menaçant. Ils se replient l'un sur l'autre et se créent un univers enfantin tout à eux. Ils vivent dans une petite ville. Les voisins – le père est camionneur et la mère comptable – marquent l'ancrage provincial français. Leur fils s'appelle Adrien, c'est un petit gars carré qui jalouse et méprise ses petits voisins mais en même temps ne peut se passer d'eux. Entre les trois enfants, un lien très fort, conflictuel et passionnel. Puis ils grandissent. Et il se passe quelque chose. Dan et Estelle, 13 et 18 ans, tombent amoureux, mais ils se croient frère et sœur, et ne peuvent s'avouer cet amour. Le garçon est un danseur avec un talent extraordinaire, il part à New York où il entre dans la troupe d'un chorégraphe que j'appelle Alwin mais que j'ai copié sur Merce Cunningham. Il croit ne pas aimer les femmes, fréquente les clubs homo et attrape le Sida. Sa sœur fait du droit comme son père et épouse un quelconque étudiant qu'elle n'aime pas. Une mécanique terrible s'est mise en marche, qui va causer la mort de leurs parents et les amener à la découverte partielle du passé de leur famille, puis à la révélation de leur amour. Ils ont quelques mois de bonheur, puis Dan, le jeune homme, meurt. La jeune femme survit. Il lui est insupportable que sa famille tant aimée ait ainsi disparu sans laisser de trace. Elle quitte le droit, revient à la musique, et décide de faire un opéra, comme un monument à leur souvenir. Tout le roman, en somme, est un récit adressé à une hypothétique compositrice d'opéra qui l'aiderait dans sa tâche de mémoire…
Il y a un lien avec la psychanalyse. Mon personnage préféré est le Docteur Minor, qui a existé, c'était le médecin que nous avions à New York. C'était un médecin à l'ancienne, d'origine russe. Quand il venait, il restait des heures, parlait. C'était un homme merveilleux. J'ai appris sa mort bien après mon départ des États-Unis et un jour, après la parution de mon roman, j'ai reçu une lettre d'une dame qui me demandait si par hasard l'homme dont je parlais dans Nous sommes éternels n'était pas son père. C'était très émouvant de retrouver sa fille. Il est difficile de parler de ce livre qui a pris cinq ans de ma vie et reste toujours chargé de beaucoup d'émotions.
C'est un livre tissé comme une toile d'araignée, avec des histoires entremêlées, de courts chapitres qui révèlent peu à peu la vérité du livre. Vous avez obtenu le Prix Femina avec ce roman, qu'est-ce que cela a changé pour vous ?
Cela donne un statut dans la maison d'édition tout en rapportant des droits d'auteur. Socialement aussi, cela donne un statut, et même dans votre famille. Vos obscurs travaux du soir sont enfin quelque chose, permettent d'acheter la maison de vacances pour la famille. Pendant un an, c'est formidable mais ensuite on est perdu. Qu'écrire ? Je me contentais de mon lectorat d'avant le Femina, je vendais à moins de 10 000 exemplaires, je ne pensais pas que l'on pouvait faire mieux. J'ai donc pris conscience que le livre était aussi une marchandise. J'avais peur de ne plus être "aimée" avec le roman suivant. C'est très perturbant parfois de passer d'une vie solitaire à une vie publique. Certains ont eu une grave dépression après un prix, ou leur couple éclate. C'est fragile parfois, un écrivain. Finalement, j'ai écrit mes nouvelles fantastiques habituelles, qui ont eu leur public habituel, c'est-à-dire petit ! Cela m'a soulagée.
Vous étiez dans un autre genre : les nouvelles et non le roman.
Pour moi, c'est toujours de l'écriture. Chaque fois, je prends une forme différente, cela m'ennuie d'écrire sans cesse le même livre. Je traite les mêmes problèmes : le rapport de l'individu, au monde, à la mort, aux autres, ce qui change, c'est la forme…
Au départ, choisissez-vous une forme ou s'impose-t-elle peu à peu ? Savez-vous si vous allez écrire 10 ou 800 pages ?
Jamais.
Vous avez aussi écrit un texte sur votre mère, Des phrases courtes, ma chérie. C'est une succession de chapitres très courts.
Je ne dirais pas sur "ma" mère, même si l'essentiel de mes observations sont de première main. Donc la mère, âgée, a dû aller habiter dans une maison de retraite et sa fille va lui rendre visite chaque fois qu'elle le peut mais pas souvent puisqu'elle habite loin. La fille est le témoin de cet enfoncement progressif : petit à petit tout se rétrécit, on a de moins en moins de forces, la vieillesse est comme un film de cellophane qui enveloppe la personne. Pourtant "cela" vit et lutte encore dans la tête, mais la cellophane se resserre. Mais cette cellophane vous enrobe aussi. Il y a une tyrannie de la mère qui génère toute une ambiguïté. Le rapport mère-fille est très compliqué. Chaque chapitre est une petite scène autour d'un micro-événement : la visite du médecin, l'achat d'une robe, la vue de la mère en combinaison... Acheter une robe à une très vieille dame, ce n'est pas simple et cela peut entraîner très loin. L'achat de la robe fait penser à ce qu'était la génération d'avant dans les campagnes, ce qu'était la féminité alors, ce qu'elle est aujourd'hui pour la narratrice, et pour la jeune fille de vingt ans. Cela renvoie à plusieurs époques, au passé de notre pays. Pour la jeune fille, la combinaison est un vêtement de ski coloré, alors qu'autrefois c'était un sous-vêtement qui protégeait et cachait le corps.
Il y a un superbe chapitre sur la peau, sur la pudeur. Votre mère avait remarqué que vous écriviez bien et elle vous donnait des conseils. Elle était à la fois fière et honteuse que vous écriviez. Un écrivain révèle ce dont on ne doit pas parler.
On est très pudique à la campagne. Elle avait gardé ses réflexes de campagnarde et donc les écrivains, les artistes ce n'est pas très sérieux. Les romans, elle les cachait dans son panier quand elle était jeune fille et qu'elle allait garder les bêtes aux champs. De voir sa fille engagée dans ce chemin-là l'inquiétait. C'est très complexe.
Elle écrivait aussi. La correspondance jouait un rôle important.
Oui, les femmes écrivaient des lettres.
Vos propres romans étaient cachés dans sa bibliothèque.
Oui, elle était fière et en même temps en avait honte.
Quel rôle a joué Beckett pour vous ?
Il a joué un grand rôle. Je suis une femme et les écrivains hommes et femmes, c'est différent. Je connaissais surtout la littérature anglaise. L'univers d'Emilie Brontë, par exemple, me correspond tout à fait, je veux dire correspond au paysage dans lequel j'ai grandi. Mais Beckett a une écriture qui m'a libérée. C'est l'écriture d'avant la grande barrière des sexes. C'est l'écriture de l'être humain tout nu, tout cru devant l'univers. Or j'ai longtemps voulu échapper à la féminité. Cela prend du temps, d'être une femme. La féminité, c'est aussi les rapports avec la mère, la grand-mère, la famille qui veut vous tenir. On attend d'une femme qu'elle soit la partie charnelle et solide du couple ou de l'humanité. Je voulais échapper à cela, et du coup j'ai longtemps été incapable d'aborder "les problèmes de la vie" dans mon écriture, parce que l'écriture, c'était justement aller contre tout cela. Or Beckett m'offrait un type d'écriture qui court-circuitait l'infernale pesanteur du roman. Kafka aussi a été capital pour moi. Si je ne l'avais pas lu, je ne sais pas si j'aurais pu écrire. Avec La métamorphose, j'ai découvert une forme d'écriture que je pouvais comprendre (il y a les rapports familiaux, sociaux, mais présentés sous un angle qui faisait sens pour moi). Et cela, dans la nouvelle Le Pont : "J'étais dur et froid. J'étais un pont, un pont jeté sur un ravin." Ce genre de phrase me donne des frissons.
Votre écriture crée un véritable univers, vous utilisez la métaphore pour parler des problèmes fondamentaux de l'être humain.
Cela ne veut pas dire que je vais écrire comme Beckett, Kafka ou Michaux mais ces écrivains m'ont permis de trouver une ouverture sur l'écriture. C'était une respiration. J'aime aussi l'humour chez Kafka et Beckett. Ils jouent avec la langue. A l'intérieur du texte de Beckett, il y a toujours une analyse sur le texte lui-même.
Il y a aussi toujours un rapport au temps dans votre écriture.
Oui, mais ce n'est pas un temps historique. C'est un temps de l'évolution intime, de l'évolution interne, au sein d'un temps historique.
Vous aimez lire aussi les philosophes.
Oui, par exemple Gilles Deleuze. Je ne comprends pas tout mais parfois, au milieu de cette écriture dense, s'ouvre comme une clairière, une soudaine vision, quelque chose qui vous stupéfie.
Comment alliez-vous lecture et écriture ?
Cela a toujours été de pair. J'ai deux manières principales de lire. L'une, peu discriminante, je peux lire n'importe quoi, je ne lis pas, j'avale ! Des polars, des thrillers américains, des histoires d'enfants, des romans gringalets et des romans obèses, dès que j'ai posé les yeux sur le début d'une histoire, il faut que j'aille jusqu'au bout. Ce type de lecture m'est précieuse en voyage, dans le métro, dans les aéroports (où on trouve justement ce type de livre), ces livres-là me font glisser à la surface du temps. Et puis l'autre type de lecture : celle qui peut m'aider dans mon écriture, non pas en me donnant de l'inspiration ou des modèles, mais simplement en me rappelant ce que c'est, l'écriture, en m'en redonnant le désir, parce qu'elle irradie de l'énergie. Ces livres-là font vibrer le temps, c'est tout à fait autre chose. J'ai besoin de ces livres-là pour me retrouver, moi, comme écrivain.
Propos recueillis par Brigitte Aubonnet
Cet entretien a paru dans Encres Vagabondes N° 29 en 2003.
|
|
|
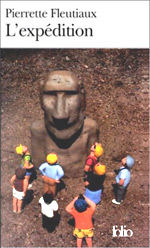

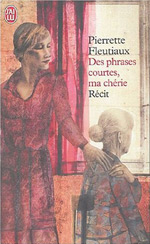

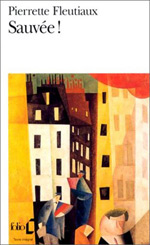
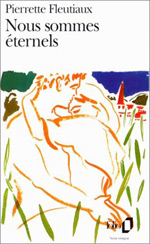

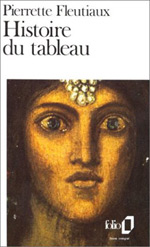
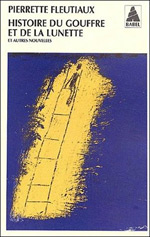
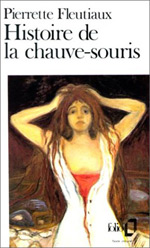

Pour la jeunesse :
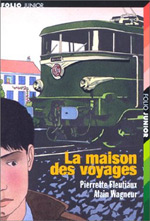
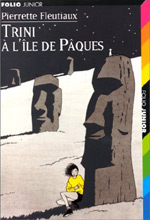


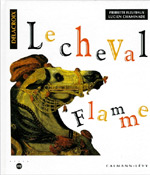
Pour visiter le site
de l'auteur :
www.pierrettefleutiaux.com
|
|