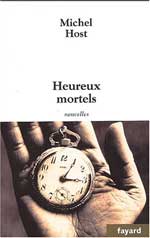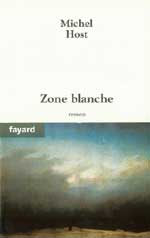|
|

Michel
Host
L'écriture est-elle entrée dans votre vie très tôt ? Quel rôle a joué la lecture ?
Dans l'émergence de la vocation d'écrire comme de toute autre, entrent le hasard, les parts du mystère et celles du désir né de l'inconnaissable. Hasard d'une première institutrice dont la grâce et la beauté furent une décisive révélation : Mademoiselle Bertin, évoquée dans « Les Attentions de l'enfance », nous initia, ma sœur et moi, aux formes, aux fables, aux contes, aux chansons et à quelques secrets de la nature. Mystères peu à peu révélés des jardins et des bêtes au cours d'une enfance en partie paysanne. Rencontre exceptionnelle, enfin, de deux professeurs habités par l'intelligence et la joie des mots, la certitude du pouvoir éveilleur des textes (ceux de la Renaissance, de François Villon et Charles d'Orléans, des poètes de La Pléiade, de Marot, Rabelais, Montaigne... le furent singulièrement), pratiquant une pédagogie de l'enthousiasme et de l'admiration plutôt que de la critique érigée en unique système de pensée. Cette conjonction heureuse est probablement un mystère en soi et la source de ce que j'appellerai l'élan de l'inconnaissable, soit ce mouvement qui vous conduit, par esprit d'imitation d'abord, puis par nécessité de combler vos manques – tout ce que justement vous ne connaissez pas –, à écrire à votre tour. Car on écrit, cela s'apprend vite, pour découvrir ce que l'on doit écrire.
Le rôle joué par la lecture est comparable à un big bang cérébral intime. Julien Gracq soutient avec raison, dans En lisant en écrivant, qu'« on écrit d'abord parce que d'autres avant vous ont écrit... » Du poème à la prose, de la prose au poème, s'effectue (s'effectuait) un voyage naturel qui allait des auteurs ancrés dans une tradition éducative (La Fontaine, Charles Perrault, Alphonse Daudet...), à d'autres dont nous avions le sentiment qu'ils relevaient davantage d'un choix personnel (Jules Verne, Dumas, Jack London, James Oliver Curwood...), pour aboutir à la découverte parallèle des classiques en même temps que des territoires élus et aventureux de nos lectures d'adultes.
Lorsqu'on a eu la chance de marcher dans de tels chemins, les chances de devenir écrivain, je le crois, ont augmenté.
La poésie a-t-elle été une nécessité pour vous ? Comment êtes-vous arrivé à l'écriture romanesque ?
J'ai été conduit à ne pas séparer les deux genres. Même si la poésie fut mon premier langage, j'ai pu mener parallèlement à elle le travail de la nouvelle et du roman. Ma conviction est que la poésie narrative existe bel et bien, qu'elle n'est pas moins intéressante que la poésie intimiste, voire nombriliste, et, à l'inverse, que le romanesque peut se peupler poétiquement, trouver des cadences et des enchaînements proprement poétiques.
Le fait est que j'ai éprouvé avec force ces deux désirs que les manuels de littérature jugent peu conciliables. Le passage de l'un à l'autre est allé de soi. Et toujours je vais de l'un à l'autre, alternativement plutôt que simultanément.
Cependant, au sujet de la poésie, j'ajouterai ceci : elle est la source, celle où véritablement un langage inconnu fait irruption, fait éruption, puis se traduit dans la langue partagée, dite maternelle. C'est une fantastique réaction en chaîne. Elle est la plus puissante des forces avec lesquelles nous luttons, que nous soumettons ou qui nous soumet. C'est plaisir et douleur, mêlés le plus souvent. Ce combat épuise les protagonistes, et aussi les figures de ce combat singulier, obligatoirement limitées dans l'espace et le temps : je ne m'explique pas autrement le silence auquel, comme Rimbaud, se sont vus réduits de nombreux poètes. La source se tarit, ou alors on acceptera de se répéter, de se parodier et, contredisant alors Héraclite, de se baigner chaque jour dans le même fleuve. De là vient que l'on écrit moins de courts poèmes que de longs romans.
Vos deux premiers romans, L'Ombre, le Fleuve, l'Eté puis Valet de nuit ont obtenu pour le premier le prix Robert Walser en 1984 et pour le deuxième le prix Goncourt 1986. Quel rôle ont joué ces deux prix dans votre parcours littéraire ?
Les prix, réalité simple ou sacré problème ? Je l'ignore.
Ma lassitude est réelle à parler de ces honneurs obtenus dès mes premières publications. L'écrivain « primé » est en butte à tous les soupçons, de celui de médiocrité – notoirement dans la bouche de médiocres – à celui d'intrigue et de faveur imméritée. La fable Le renard et les raisins est sans doute celle qui rend le mieux compte des enjeux d'un prix tel le Goncourt ! L'envie, la jalousie disent aussi leur mot en ces occasions : un écrivain des plus renommés et influents ne cesse aujourd'hui encore de proclamer sa rancœur de n'avoir pas été couronné à ma place ! Je l'estimais, il m'a contraint à voir sa petitesse. Mais j'ai cessé de me torturer à ce sujet, ne serait-ce que pour continuer à écrire.
Le prix Robert Walser (1984) me fut attribué alors que j'ignorais que mon roman L'Ombre, le Fleuve, l'Été était lu par un jury helvétique. Pour le prix Goncourt, décerné à Valet de nuit en 1986, c'est une histoire en soi, une saga intime et publique, et ce serait m'insulter et faire injure au jury que de penser que l'écrivain aussi débutant et peu introduit dans « le milieu » que j'étais alors, ait voulu et pu peser sur sa décision. Avec le recul, ma gratitude est tout acquise au jury Goncourt qui, sans en rien savoir, m'a encouragé dans un moment très difficile de mon existence. Quant aux jeux des éditeurs – ne voulant pas jouer les idiots – je dirais qu'ils leur appartiennent.
On devine combien ma perturbation fut grande. Cependant, dans mon parcours d'écrivain (le terme me convient d'autant mieux que je récuse celui de « carrière »), ces prix m'ont apporté une reconnaissance rapide dont les effets se font sentir aujourd'hui encore en termes de fidélité des lecteurs, un petit « bataillon » qui n'a toujours pas décroché. Ils m'ont aussi donné confiance parce que des personnalités sans liens avec le monde éditorial français pour l'un, des auteurs chevronnés pour l'autre, ont fait le choix de me distinguer. Je fais aussi mention du Grand prix de la nouvelle de la S.G.D.L. (2003) et du Prix du Livre de Picardie (1996), deux signes de reconnaissance qui m'ont beaucoup touché. Je dois encore à ces distinctions des facilités pour éditer – ce n'est nullement négligeable par les temps qui courent –, et je tâche à rendre ce privilège en aidant autant qu'il m'est possible des auteurs débutants, poètes, nouvellistes, romanciers, à publier à leur tour. Je n'oublie pas, dernière retombée, que de l'argent est lié aux prix, qu'il facilite bien des choses, mais aussi que, bien ou mal dépensé, il coule entre les doigts.
La relation à la mère et au père joue un rôle essentiel dans plusieurs de vos écrits. Les relations familiales ont-elles été un moteur déterminant pour écrire ?
La famille, si j'excepte l'amour véritable de mes grands-parents, a dès la prime enfance pris ses distances avec moi. Je ne l'ai donc pas connue selon l'affection mais, dans une chronologie implacable, selon l'éloignement d'abord, puis le total malentendu et l'inimitié, l'indifférence partagée enfin. Le manque, la frustration furent énormes : le roman Valet de Nuit, quelques nouvelles du recueil Les Cercles d'or, représentèrent donc, en manière de psychothérapie, la quête d'une mère acceptable – qui pourtant parut très inacceptable à d'aucuns –, et celle d'un père enfin présent, tout cela dans une transposition des lieux et des faits. Quête inaboutie, marquée d'implorations et de violences. Le sujet était encore trop brûlant. L'écriture fit ce qu'elle put, et moi ce que je pouvais alors. Il faut sans aucun doute voir dans mes non relations familiales « un moteur déterminant pour écrire ».
Votre enfance dans le Nord et le Pas de Calais est évoquée dans Les attentions de l'enfance. Comment s'est réalisée l'écriture de ces textes ?
Les attentions de l'enfance (1996) n'avaient pas pour objectif de peindre mes premières années, mais d'évoquer mes images formatrices et fondatrices : celles-là seules qui ne quittent votre mémoire que lorsque vous mourez. Images heureuses pour la plupart, qui se sont écrites sans difficulté, en suivant les pentes de la chronologie et des lieux où je vécus. La fin de la Seconde guerre y est évoquée telle que je la vécus. C'était un temps très différent du nôtre. Mes grands-parents y sont bien plus présents que mes parents. L'amitié des bêtes, la complicité enfantine, certaines personnalités et anecdotes marquantes y ont toute leur place. Cela reste dicté par le manque maternel fondateur et destructeur, le flash final très bref – En aucune maison – en témoigne. C'est aussi, à ce jour, mon seul écrit autobiographique : il me faudrait passer à l'adolescence, puis au jeune âge adulte... Outre que le moi n'est pas au centre de mes préoccupations, je ne sais trop comment aborder ces montagnes, ces jungles et ces déserts...
Le fleuve et la ville interviennent aussi souvent dans vos écrits. Sont-ils des personnages pour vous ?
Dans mon imagerie littéraire, il n'est à vrai dire qu'un seul fleuve et une seule ville : la Seine, Paris. Ils m'ont reçu au terme d'une adolescence difficile, devenant mes paysages neufs et ma nouvelle demeure. S'ils sont des personnages, idée que j'accepte, peut-être dois-je les voir comme des parents d'accueil. Valet de nuit s'ouvre sur une description de la Seine (mon éditeur ne trouvait pas bon qu'un roman commençât par une description) où le narrateur, accoudé au parapet d'un pont, contemple une péniche où se laisse bronzer une jeune femme légèrement vêtue : c'est le retour au paradis, la reconquête de l'harmonie, les retrouvailles avec le monde. Paris est femme, que je vois, autant qu'il me souvienne, dans ses « falbalas de pierre ». J'y rejoignais une femme et l'amour : le narrateur se confond totalement avec moi. Cette ville m'est aujourd'hui consubstantielle et indispensable. Elle a son métro, la morgue du quai de la Rapée, le Louvre, la République et la Bastille, ses quartiers enfin, tous personnes-personnages, son histoire, ses histoires !... On s'y nourrit de rencontres, de l'échange constant avec l'autre, de confrontations intellectuelles... ce qui n'a plus guère lieu dans le village bourguignon où je vais parfois me mettre au vert. D'autres villes me fascinent : New York, Buenos Aires... Je ne pourrais y vivre.
Vous avez écrit plusieurs recueils de nouvelles. Comment construisez-vous vos recueils ? Comment se détermine la forme du texte que vous allez écrire ?
Donner son orientation à un recueil de nouvelles n'est pas chose simple. Dans Images de l'Empire, c'est ma vision dudit « Empire », notre monde bringuebalant et chaotique, qui a en quelque sorte cimenté l'ensemble. Néanmoins le regard se porte sur des points très divers, du monde meilleur auquel accède l'accidenté à la ville lentement engloutie, de la façon dont on écrit les livres à la chute du Führer, de l'apparition d'un stylite redresseur de torts sur l'obélisque de la place de la Concorde à l'assassinat d'un architecte indigne, des crimes pol-potiens au regard porté sur un tableau de d'Edward Hopper... le tout encadré par deux attentats terroristes, le chroniqueur-narrateur disparaissant dans celui qui clôt le recueil et dont il est l'auteur.
Les Cercles d'or relève plus ou moins des mêmes intentions : la vision y étant plus proche de celle de l'adolescent que je fus, on n'y trouve pas d'équilibre véritable dans les éclairages et les situations, tout est sombre et d'un noir pessimisme. Heureux mortels donne plus de place à une fantaisie parfois débridée et à la sagesse du rire : la belle Lola Fisher quitte aimablement un mari gourou abusif, il pousse des fleurs exotiques sur le crâne de Bertrand Delavigne, cela lancera une mode et lui portera bonheur... Les situations absurdes ou difficiles offrent d'elles-mêmes les issues.
Quant à la forme du texte à écrire, je ne la programme pas : elle s'impose d'emblée, prend d'elle-même ses formes, que je reste attentif à ne pas laisser se contredire. Tout se détermine davantage à travers les niveaux de langue, les atmosphères liées aux événements, les cohérences indispensables... Je découvre le paysage au fur et à mesure que je le peins. Il se produit des ratages : mes « croûtes » vont alors directement à la corbeille à papier. L'erreur sur le choix d'une forme se paye assez cher : ainsi, la nouvelle Une des Cyclades fut mise vingt ans au placard, le temps qu'il me fallut pour deviner que le narrateur classique et omniscient, qui aplatissait et tuait le récit, devait s'effacer au profit d'un personnage intradiégétique (qu'on me pardonne la cuistrerie !), celui d'un médecin interrogeant son malade et reconstituant son parcours assassin avec lui : qu'un dialogue, donc, devait se substituer à la narration classique originelle.
Quelle est votre relation au fantastique puisque plusieurs de vos écrits s'en approchent ?
Le fantastique fait souvent irruption dans mes écrits. Sont-ils pour autant des récits fantastiques ? Les miens ne le sont jamais au départ. Des situations abracadabrantes se mettent en place. Des dérives s'imposent plus que je ne les impose : elles m'apportent plaisir et surprises ! Elles m'amusent, et je n'hésite pas à suivre mes intuitions, pensant que le lecteur me suivra. Dans Train de nuit, le voyageur monte dans son compartiment à son époque, il en descend dans une époque antérieure... Dans Son col de loutre, un professeur entre entièrement nu dans le collège où il enseigne, et le monde bascule. Il s'agit parfois de véritables portes de sortie : non que bloquée la narration doive forcer le passage qui la mènera à sa conclusion, mais simplement, comme dans un orgasme mal tempéré, tout explose. Ainsi, un jeune homme poursuit la jeune fille qu'il convoite, la retrouve dans une voiture du métro, elle l'humilie, il n'a plus que la solution de l'entraîner avec lui hors du monde connu : ils disparaissent dans le ciel parisien, crevant le plafond de la voiture.
Des nouvelles comme Transes du chat et Les chambres parallèles disent l'obsession scripturale, l'enfermement qu'elle requiert, l'accouchement difficile de l'écrivain projeté dans des lieux et des temps en effet parallèles, puis décalés, mêlés comme dans les rêves, investis, parcourus en sens inverse de la chronologie et des lois de la gravité. Il me semble que ce n'est pas le fantastique en tant que genre littéraire qui m'entraîne et me passionne, mais seulement ses pouvoirs révélateurs, ses magies, ses défis à la raison raisonnante, les traductions métaphoriques qu'il offre de situations bien réelles, comme si toujours je devais me convaincre que le monde n'est pas d'un seul tenant, univoque, sans possible mise en perspective : ne peut-on vivre l'agonie de Galba tout en suivant les évolutions d'une noce ridicule depuis le comptoir de la brasserie Le Cosmos ? Doit-on rester captif de la réalité, soumis à ses lois ? Tout cela, à mes yeux, ne relève que de la vérité de désirs, parfois de fantasmes très humains.
La Maison Traum est un récit drolatique, tragique, épique, politique et oulipique. Comment avez vous écrit et construit ce texte ? Quel est votre relation à la contrainte et à l'Oulipo ?
Je ne suis guère un adepte des théories et des techniques de l'Oulipo. L'invention me paraît devoir être plus directe. Cependant, c'est par goût de l'expérimentation, pour me démontrer à moi-même le caractère productif de la contrainte, que je me suis pris au jeu du lipogramme, soit la suppression d'un élément dans la totalité d'un texte : Perec l'avait fait pour le « E », dans La Disparition, je le fis pour chaque lettre de notre alphabet dans les 26 chapitres de ce court roman. Vite il m'apparut que la nécessité d'aller au sens que je souhaitais engageait le texte dans le détournement, la synonymie, voire la périphrase (le « pugilat britannique » remplacera la « boxe » si l'on s'interdit d'utiliser la lettre X, etc.) et donnait à la phrase un tour étrange, souvent humoristique, que j'accompagnai et accentuai à l'occasion, jusque dans ses cocasseries et ses étrangetés. Atteindre au sens n'étant jamais une impossibilité, j'allai au bout de l'effort. Le roman sortit, une seule critique voulut bien le feuilleter. N'ayant pas compris la règle du jeu, semble-t-il, elle en dit le plus grand mal. Des lecteurs qui lurent ce roman « drolatique, tragique, épique, politique, oulipique » et m'en parlèrent, aucun ne s'y était pas plus amusé qu'ennuyé. La contrainte est certes une aide puissante, mais je n'ai pas renouvelé l'expérience et ne pense pas le faire : ce livre sera mon hapax.
Quelle part donnez-vous à l'humour dans vos écrits ?
La maison Traum n'en manque sans doute pas. Par la force des choses peut-être. Pour mes autres livres, je ne sais. Comment définir son propre humour sans pose ni prétention ? Je crois « avoir de l'humour », au moins dans mes livres. Je m'y laisse aller davantage dans la nouvelle que dans le roman ; plus rarement dans les poèmes que j'écris. J'en joue sans vergogne lorsque, comme dans Graines de pages, je m'empare du regard des enfants dans leur lecture d'images, images d'enfants d'ailleurs, lisant ou utilisant les livres pour tout autre chose que la lecture : la mise en abyme, les miroirs affrontés, les jeux de mots abracadabrants vont alors à fond de train. Les couleurs de cet humour ? Habituelles : celles qui maquillent les rides, les écorchures de la bêtise, de la méchanceté et dissimulent le chagrin que nous cause le genre humain dans ce qu'il fait généralement le mieux : décevoir.
Vous avez écrit un dictionnaire que vous ne souhaitez pas publier. Pour quelles raisons ?
En premier lieu, comme beaucoup d'écrivains, je ne publie pas tout ce que j'écris. Il est des poèmes dormants, un roman né bancal... des choses de ce genre. Pour ce dictionnaire, il est entièrement rédigé et dort lui aussi dans mon ordinateur : j'ai voulu y donner mes définitions personnelles d'environ 500 mots et expressions courantes, avec commentaires et citations. Il a eu plusieurs titres successifs : L'électron libre... Petit vocabulaire de survie... etc. L'ayant promis à mon éditeur, puis relu, j'ai finalement refusé de le voir imprimer, l'ayant découvert, au-delà de l'humour, plus imprégné que je ne le pensais de ce nihilisme et de cette noirceur absolus qui m'escortent à certaines périodes de l'existence. J'ai estimé en conscience ne pouvoir le donner à lire ni à ma propre fille, ni à aucun des jeunes gens de notre temps, tous plongés dans le bain délétère d'un monde sans vision et sans projet. J'ai pensé, à tort ou à raison, qu'il ne m'appartenait pas d'apporter aujourd'hui ma pierre à l'édifice de la désespérance et de la désorientation. Pour qu'on en juge, voici trois définitions parmi les plus concises : ABOUTIR. Amabilis error. Où ? À quoi ? / ACCOUCHEMENT. Début d'une anecdote. / UN. De trop.
Vous faites partie du groupe de la Nouvelle fiction ? Quel est l'apport des rencontres avec d'autres écrivains ? Vous avez participé à des revues et à des ouvrages collectifs. Quel est l'apport de ces expériences ?
Je suis lié d'amitié avec la plupart des écrivains de ce « groupe ». Nous nous rencontrons souvent et en diverses occasions. Pourtant, si l'idée m'est venue d'entrer dans l'aimable troupe inventéepar Jean-Luc Moreau, je ne lui ai pas donné suite. J'étais, je pense, plus séduit par la perspective de la chaleur amicale d'une compagnie littéraire que par la théorie de « la nouvelle fiction », dont les contours et le contenu me semblent par ailleurs difficilement cernables en dépit des efforts de clarification des uns et des autres. Il apparaît, en outre, que ma façon de faire intervenir l'imaginaire et le fantastique dans mes romans et nouvelles est relativement différente de celle que préconise la charte des nouveaux fictionnistes. Serais-je un ancien fictionniste ? C'est fort possible, quoique depuis le nouveau roman on n'ait plus entendu parler de querelle des anciens et des modernes.
Cela dit, la rencontre avec d'autres écrivains, soit dans le cadre amical, soit dans celui d'entreprises comme celles de L'Art du bref – avec Richard Millet –, de Nouvelles Nouvelles – naguère, avec Daniel Zimmermann et Claude-Pujade Renaud –, ou de travaux partagés comme ceux que nous réalisions autour du Prix Le Heurteur (initié par Jean Claude Bologne), et réalisons dans le Groupe Changhaï, – avec Jean Claude Bologne, Alain Absire, Denis Borel, Annie Dana, Marie-Florence Ehret, Jean-Luc Moreau –, est une nécessité que je dirais vitale : l'écrivain travaille certes en solitaire, mais la rupture de cette solitude lui est indispensable, ne serait-ce que pour briser la possible routine de « l'atelier », échanger quelques mots sur les livres et l'état de la littérature, lire et découvrir des textes et des auteurs, dire du bien des uns et du mal des autres (ne nions pas nos faiblesses), rire, travailler à des œuvres collectives... Ce sont nos discrets salons littéraires, moins brillants que celui de la duchesse du Maine, moins éclectiques que celui de Mme de Tencin... Mais l'écrivain, pas plus que l'homme, n'est fait pour vivre seul.
Quant aux ouvrages écrits collectivement, si l'un a paru en son temps aux éditions du Rocher – L'affaire Grimaudi –, si un autre court en ce moment les maisons d'édition – Rouge Mémoire – , nous ayant permis de confronter nos idiosyncrasies, de tenter de les fondre dans un projet unique, de prendre conscience de certains impossibles... ils représentent tour à tour des expériences d'écriture, des excursions libres et libératrices, des exercices d'assouplissement, comme si nous travaillions « à la barre » ou au gymnase... Notre Groupe Changhaï œuvre aujourd'hui (avec lenteur) à un Dictionnaire des Mots inventés, et il achève un album – Les Changhaïana – très libre, drolatique, satirique, poétique, érotique et facétieux. Nous ne manquons pas de chantiers.
Quel rôle joue l'écrivain dans la société ? Doit-il s'engager ? Vous animez des ateliers d'écriture. Comment concevez-vous cette activité ?
La société d'aujourd'hui n'a plus besoin d'écrivains, ni davantage de peintres, de sculpteurs, d'authentiques musiciens, et à peine de restaurateurs dignes de ce nom. Disons qu'elle a été suffisamment paupériséeen termes de finances et d'esprit, pour se satisfaire des produits de consommation courante que lui propose le « marché » : livres de plage, harrypotérisation, houellebecquomania, davincicodification généralisées, impostures des « installations », rayures des toiles à matelas, emballages pontifiants, barbouillages – talentueux du reste ! – de chimpanzés dressés au nouveau cirque, rock'n roll décervelant, rap déstructurant, fast food Quick, malbouffe Mac Donald, l'ensemble étant jour et nuit prescrit par la pub et le people marketing.
L'écrivain peut dénoncer cet état de fait (et aussi le sociologue, le philosophe...) dans des ouvrages ciblés et cibleurs ; il peut (ils peuvent), à l'inverse, écrire dans la marge, à contre-courant, se situer esthétiquement ailleurs, aux antipodes... rien n'y fera, le caterpillar libéralo-mondialiste suit sa trajectoire, rien ni personne ne l'en fera dévier. Constat : l'écart s'accroît entre sous-culture de masse (que certain ministre voulut nous donner pour la culture) et culture réservée aux élites ; l'écrivain et ses livres ne jouent aucun rôle dans la société actuelle : c'est comme une soprano et un flûtiste tentant de faire entendre leur voix au milieu de la Foire du Trône. Le rôle de Gide, de Romain Rolland, en leur temps, oscillait entre ces deux fonctions : celle d'agitateur pour intellectuels germanopratins ou d'« idiot utile » , si agréable au Parti ! D'où la question de l'engagement.
Le mot « engagement » m'agace : référence sartrienne obligée sous nos latitudes, univocité politique, pose du « maître-à-penser-sinon-rien-ni-personne ! » et médiatisation forcenée des faux engagements : certain ministre portant sur l'épaule son petit sac de riz, certain intellectuel de salon et de plateau de télévision, authentique imposteur, se faisant bétacamiser, à plat ventre, à l'abri de quelque parapet dans l'ex-Yougoslavie... Je sais aussi la facilité qui consiste à prétendre que la pratique de l'art, de l'écriture... est un engagement en soi, une manière de résistance à l'effondrement intellectuel et moral que nous subissons. Je n'aime pas cette facilité, tout en sachant que chaque journée que je consacre au poème, je la dérobe au Veau d'or, à Wall Street et à l'exploitation de l'homme par les fonds de pensions américains. C'est pourquoi, comme bien des écrivains de notre temps, je m'engage plus discrètement, peut-être plus efficacement, du moins je l'espère.
Je m'engage dans mes textes, qui sans être de pure protestation ni des témoignages directs, offrent des moments de protestation, des images divergentes, précisent mes écarts, mes dégoûts, mes révoltes... Le recueil poétique Déterrages / Villes en est peut-être l'exemple le plus net. Je travaille aussi avec le jeune historien Saber Mansouri à un dialogue portant sur les relations Orient-Occident, et particulièrement sur l'immigration maghrébine en France : nous espérons publier ce dialogue, puis le faire fructifier et vivre par des rencontres, des débats... Enfin, les ateliers d'écriture que je conduis, je les considère comme partie intégrante de mon « engagement » personnel.
Ces ateliers se déroulent pour la plupart en milieux éducatifs dits « difficiles », et aussi avec des étudiants. Ils ont une durée appréciable, d'une année scolaire parfois. Mon projet constant est de « redistribuer » de cette culture qui m'a été accordée et que le système scolaire a aujourd'hui le plus grand mal à transmettre. J'aime à travailler en présence du professeur de français ou de lettres, à replacer les perspectives (parfois celles de textes ou d'œuvres étudiés en classe) dans des zones où la pédagogie, dans les circonstances actuelles, s'aventure difficilement : celle de tous les plaisirs du texte, que l'on éprouve mal si l'on se cantonne à la posture critique ; celle de la prise de conscience des capacités personnelles de création, d'invention, et aussi de partage gratifiant à travers la lecture à haute voix ; celle de l'ouverture culturelle sans tabous, autant que possible en relation avec ce que François Bon a appelé « l'héritage », avec la vie vécue concrètement, avec les cultures virtuellement ou réellement présentes dans une classe... Ce faisant, j'ai le sentiment d'ouvrir, de faire partager, de partager le fonds poétique du monde, de rapprocher, de réconcilier parfois. Je me livre tout entier dans ces ateliers – engagement sans réserve : l'homme tel qu'il est, l'ex-pédagogue bien tempéré, l'écrivain. Rien de plus émouvant, à mon sens, que de voir une petite Portugaise pénétrer avec finesse un haïku de Bashô, un jeune « Gaulois » marcher du même pas que Rimbaud quittant Charleville pour Paris ; un Chinois étudiant notre langue depuis à peine un an, vous déclarer : « Chez nous, au Sichuan, il y a un proverbe qui dit... ; une jeune Maghrébine vous demander votre appréciation sur le poème érotique où elle s'est risquée...
Comment et pourquoi avez-vous traduit Góngora ?
Je reprendrai ici, peu ou prou, les propos qui, dans la revue SALMIGONDIS (N°21), ont accompagné mes traductions de poèmes amoureux de la tradition mozarabe andalouse des XIIe et XIIIe siècles, et mon avis sur la traduction de l'espagnol Luis de Góngora.
Écrire, c'est traduire de toute façon, comme je le suggérais un peu plus haut, à propos de la poésie et du roman. Traduire les poèmes de Góngora – poète décrié en son temps et jusqu'au nôtre, honni ici, déclaré obscur et alambiqué ; admiré là, et considéré comme novateur et lumineux –, c'est rendre visibles son monde et sa vision de ce monde, donner à éprouver, autant que le permet l'acte de traduire, sa lumière, ses clairs-obscurs, sa cadence, sa musique... Quant à cet acte, dans ses hauteurs, vers le sacré, je m'en remets à la magnifique assertion de Georges-Arthur Goldschmidt, grand traducteur de l'allemand : « L'ordre de la traduction est de l'ordre de la parole. »
Pour le choix de Góngora (j'ai à ce jour traduit ses Sonnets, parus en 2002 aux éditions « Bernard Dumerchez », et sa Fable de Polyphème et de Galatée,à paraître chez Claude Rouquet (automne 2005), aux éditions de « L'Escampette »), outre le fait d'avoir rencontré son œuvre lors de mes études hispaniques, bien au-delà du désir de surmonter sa réelle difficulté, j'ai eu le sentiment de la possible et nécessaire transmutation dans la langue française de cette beauté occultée quoique éclatante et singulière. « L'objet aimé est ici le poème, mais aussi la pensée du désir, de l'élan de l'amour célébrés au-delà des "réalités périssables" des sentiments trop spontanément exprimés. » Je faisais ainsi allusion, dans ma brève préface au Polyphème, à l'esthétique de Góngora. Il y a aussi ce défi bien spécifique, lorsque l'on traduit ce poète, de ne pouvoir se résoudre à une sorte de mot à mot débouchant sur un obscur galimatias si l'on veut rendre perceptible dans notre langue le bouleversement systématique qu'il fait subir à la syntaxe espagnole : il faut de façon obstétricale travailler le français, le faire musiquer autrement sans tomber pourtant dans le couac et la cacophonie. Il est mille raisons de traduire Góngora, et mille plaisirs à le faire.
Propos recueillis par Brigitte Aubonnet (Été 2005)
|
|
|
Retour
au sommaire
des rencontres

Prix Goncourt 1986

Prix Robert Walser 1984

Editions Rhubarbe, 2005
Lire une présentation
de ce poème








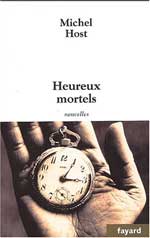
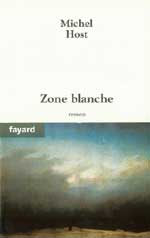
BRÈVE NOTICE AUTOBIOGRAPHIQUE
Michel Host. Né en 1942 (l’écrivain), en Flandre.
Enfance partagée entre petite ville de province et campagne, puis huit années de semi-réclusion, c’est-à-dire de pensionnat, dans un collège catholique.
Une formation littéraire, où entrent classiques français et étrangers : la Renaissance, singulièrement, lui a ouvert les yeux et l’esprit.
Échappe à la vie familiale à dix-neuf ans, se rend à Paris, tente d’y devenir instituteur (en est empêché par les obstacles mêmes que lui propose l’Éducation nationale), se marie à une artiste peintre, ne se soumet pas au « devoir » de guerre coloniale (Guerre d’Algérie) et entreprend des études supérieures en Sorbonne. Agrégé d’espagnol, il enseigne cette langue dans divers lycées – dont le lycée Janson de Sailly -, et ensuite la littérature espagnole du siècle d’Or aux étudiants de licence, puis aux capésiens et agrégatifs, dans le cadre du C.N.E.D. (Centre National d’Enseignement à distance).
A collaboré et collabore à différentes revues défuntes ou encore en vie : L’ Art du bref, Nouvelles Nouvelles, Regards, Quai Voltaire, L’Infini, Revue des Deux Mondes, L’ Atelier du roman, La Sœur de l’ange, Salmigondis, Lieux d’Être…
Fondateur et Grand Maître de l’Ordre du Mistigri, qui comporte aujourd’hui plus de 30 chevaliers, se destinant par des actions discrètes et concrètes à décentrer l’anthropocentrisme dominateur, exclusif et destructeur.
Parallèlement à la carrière de professeur, il entreprend d’écrire son premier roman. Six années de travail couronnées par le prix Robert Walser, et un accueil chaleureux dans la presse et le lectorat. Depuis, ont suivi des ouvrages appartenant à des genres variés : roman, nouvelle, poésie, traduction. A dû se résoudre à renoncer à l’écriture dramatique, pour laquelle il n’a aucun don. Il refuse de considérer ses activités d’écrivain comme une « carrière », préférant les situer dans l’optique d’une « trajectoire » et la logique vitale d’un état d’âme et d’esprit. Il tente d’appartenir à son temps en dirigeant des ateliers d’écriture en milieux scolaires dits « difficiles » et ailleurs.
Partageant cette conviction avec Voltaire, il est persuadé que l’être humain ne naît ni bon ni mauvais, mais que néanmoins il peut et doit être « bonifié ». Mme de Sévigné lui a aussi appris qu’ « il faut faire provision de rire pour l’éternité », car le rire bonifie.
Par ailleurs, avec Montaigne, Isaac Bashevis Singer, et un certain nombre de philosophes contemporains - Elisabeth de Fontenay, Florence Burgat entre autres, il s’est convaincu que l’inattention, le mépris, et très souvent la cruauté que les humains manifestent envers les animaux – dont ils se font les propriétaires et les bourreaux –, et envers tous les êtres de la seule nature, préludent au mépris et à la cruauté envers les hommes, et qu’est donc indispensable un renversement total du regard sur l’Autre. Des perspectives éducatives neuves, dans quelque société que ce soit, sont à mettre en œuvre afin que la barbarie et l’absurde n’aient pas le dernier mot.
Ses admirations, dans l’ordre de la pensée, sont nombreuses, mais elles vont d’abord à Socrate – qui ne laisse rien qui ne soit discuté ou pris pour argent comptant –, à Héraclite, au Christ («Aimez-vous les uns les autres»), à Rabelais, à Montaigne, à Jeremy Bentham (arithmétique des plaisirs, morale naturelle et le « ne fais rien que tu ne voudrais que l’on te fît), et à plusieurs autres.
Partage aujourd’hui ses jours et sa vie entre Paris et un village bourguignon, en compagnie de ses chattes - Artémis (+), Nejma, Tanit -, d’un félin du voisinage, M. Gris-Gris, et de quelques êtres humains.
N’a pas encore eu le temps de trouver la vie ennuyeuse.
|
|