








 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||||||
Né en 1958, médecin généraliste en région parisienne, Christian Lehmann a déjà publié une quinzaine de livres.
La médecine, le fantastique, la lutte entre le bien et le mal,
les relations amoureuses, la responsabilité des individus par rapport au conformisme de la société sont les thèmes qui irriguent son œuvre.
La Folie Kennaway est votre premier roman publié mais est-ce le premier écrit ? Non, avant, il y avait eu un premier texte qui est resté inédit, Les satins innocents, que j’avais écrit alors que j’étais étudiant en médecine et que je commençais à travailler dans un service de réanimation cardiaque. Ce n’était pas vraiment un roman… mais quand il a été terminé je l’ai envoyé à des éditeurs. Aujourd’hui, je remercie le ciel qu’il n’ait pas été publié. A l’époque, je pensais qu’il suffisait de se mettre devant sa machine à écrire, commencer à la première page et quand on était arrivé au bout de la trame narrative, on avait fini, on avait écrit un roman. J’ignorais des évidences comme le fait que toute chose écrite doit être réécrite. Je l’ai envoyé à plusieurs maisons d’éditions, certaines m’ont renvoyé un petit mot en me disant que c’était intéressant mais pas abouti, c’était le moins qu’on puisse dire. J’en ai cependant tiré une conclusion positive : je pouvais arri-ver au bout d’un travail de plus de cent feuillets. Il est très important de pouvoir finir ce qu’on a commencé si on veut apprendre de ses erreurs et passer à un stade supérieur. Le pire, c’est ceux qui n’ont que des débuts de romans dans leurs tiroirs parce qu’ils n’apprennent pas à terminer, ils ne confrontent pas les angoisses qui peuvent nous amener à passer à un stade supérieur. Je me suis dit qu’avant de me lancer dans un texte aussi long, il fallait que je maîtrise ce qu’est le travail d’écriture sur des textes plus courts. Donc, à la suite de cet « échec heureux », j’ai commencé à écrire des nouvelles d’environ dix à vingt feuillets, qui n’ont pas été publiées non plus, mais qui m’ont appris à jouer autour de la trame narrative, à utiliser le flash back, des découpages différents, oublier que je racontais des histoires, me souvenir que la forme pouvait avoir de l’importance et pas seulement le fond. Elles n’ont pas été publiées mais très bizarrement la trame narrative, l’histoire, les personnages de presque chacune d’entre elles se sont ensuite retrouvés dans les romans que j’ai écrits. Comme si de manière inconsciente, j’avais utilisé une certaine forme d’abondance narrative pour éviter que ça disparaisse dans les limbes de l’oubli en le figeant sous une forme qui n’était pas la forme la plus aboutie mais qui permettait au moins qu’il y ait une base de travail par la suite. Donc, j’ai écrit ces courtes nouvelles et franchement, surtout après l’échec des Satins innocents, j’étais persuadé qu’être publié était impossible. Et puis j’ai écrit une nouvelle un peu plus longue, cinquante à soixante feuillets, et j’en ai parlé à un ami qui est écrivain en Angleterre. Il m’a dit « ça a l’air très intéressant ce que tu me racontes, je ne peux pas le lire parce que tu écris en français mais je pense que maintenant tu dois le laisser de côté pendant un temps, laisser mariner, pour sortir du symbolique et donner à ces gens une existence ». Il avait raison, j’étais dans une écriture symbolique, une écriture de l’adolescence ou de la post-adolescence, où chaque personnage a une fonction, représente quelque chose, et je ne leur laissais pas la possibilité d’exister en tant qu’être virtuel. Donc, j’ai attendu six mois, et j’ai eu accès à un ordinateur (un Amstrad avec des disquettes un peu particulières). J’ai décidé de commencer par saisir mon texte pour obtenir une version plus propre. Et là, il s’est passé quelque chose qui a changé totalement ma façon de créer : lorsque j’ai fini de taper mes pages, je les ai regardées, évidemment c’était plus propre mais surtout ça n’avait plus rien à voir au niveau de la lecture, ça se lisait plus facilement. Je me suis posé la question de savoir pourquoi et je me suis rendu compte que de manière intuitive j’avais corrigé des erreurs ici ou là parce que c’était un peu long à taper, parce qu’il y avait un petit segment de phrase qui gênait, j’ai donc appris que c’est dans la réécriture qu’on écrit. Et puis j’ai appris une autre chose, plus personnelle : il y a peut-être des gens dont la prose est déjà un peu neutre, un peu sèche, et qui va devenir complètement aride en passant par le clavier ; moi, j’aurais tendance à avoir une prose trop floride, efflorescence d’adjectifs, d’adverbes, ce que les anglo-saxons appellent la « purple prose », la prose pourpre, et l’ordinateur remettait le curseur juste où il fallait. Il faut garder une certaine poésie, un certain lyrisme de l’écriture mais en resserrant les choses. Moi, ça m’a servi et je suis incapable d’écrire à la main aujourd’hui. Le clavier m’est indispensable. Et qu’est devenu ce texte ? La folie Kennaway. Ces 60 pages sont devenues 80 pages, et je me suis rendu compte que j’étais parti dans une œuvre de longue haleine, que ça commençait à ressembler à ce que pourrait être un jour un roman. Ça m’a pris trois ans mais je l’ai terminé. Il s’appelait alors Le murmure des ombres et je l’ai fait lire à plusieurs personnes autour de moi, des gens très différents, sans aucun lien avec le milieu littéraire, qui m’ont fait des critiques très justes dont j’ai tenu compte. J’ai tout corrigé, de façon à améliorer le texte, le désembourber d’un marécage de clichés dont je n’avais pas conscience. Ils m’ont rendu service parce que je savais qu’on ne donne pas un livre à un éditeur en disant « voilà, je n’ai pas le temps de faire mieux pour le moment mais vous me direz ce que vous en pensez ». Il n’est pas admissible de présenter à un éditeur autre chose que le meilleur de soi-même à un moment donné. Et La folie Kennaway a été publié. Et puisque, dans une sorte de mise en abyme, Kennaway écrit L’Evangile selon Caïn, vous aviez déjà ce livre en tête ? Tout à fait, c’était une des nouvelles d’avant, qui portait déjà ce titre. Et certaines des nouvelles que Kennaway écrit sont des titres qu’on retrouve par la suite… Il y avait un effet de miroir avec le personnage. Votre deuxième roman, La tribu, a été adapté au cinéma par Yves Boisset. Le livre est sorti le 10 janvier 1990 et à la fin du mois de janvier mon éditrice m’a appris qu’Alain Sarde avait acheté les droits de La tribu pour Yves Boisset. J’étais évidemment très surpris. Boisset avait lu le bouquin pendant un trajet en train et avait téléphoné à Alain Sarde en disant « il faut absolument que je te vois, j’ai le sujet de mon prochain film. » J’ai rencontré Yves Boisset, nous avons déjeuné ensemble, il était extrêmement chaleureux, communicatif, et j’ai osé lui dire : « écoute, tu vas avoir besoin d’un conseiller technique qui connaît la réanimation sur le bout des doigts, qui sait comment habiller les externes, comment ils posent leur stéto, il va falloir louer les salles parce qu’on va tourner dans un hôpital, tu n’en trouveras pas de meilleur que moi ! ». Comme le tournage allait avoir lieu pendant le mois d’août de cette année, je n’avais pas besoin de partir en vacances. Il a accepté je l’ai aidé pendant la période de préparation, on a choisi les acteurs : Stéphane Freiss, Catherine Wilkening, Jean-Pierre Bacri, Maxime Leroux, Georges Wilson, Jean-Pierre Bisson… C’était très excitant ! On a loué une aile entière d’un service de l’hôpital de Poissy qui était fermé normalement pendant l’été. Avec Frédérique, la fille de Philippe Noiret, qui est une très bonne amie et qui était sa première assistante, nous sommes allés louer des appareils chez Siemens… Et puis le tournage a commencé. Tous les jours pendant un mois et demi, du matin au soir, j’étais là… C’était une expérience très forte. Voir de l’intérieur comment se tourne un film, la tension nerveuse que ça représente… Deux fois par semaine, on courait au studio de Boulogne-Billancourt voir les rushes des trois jours auparavant. C’était un moment inoubliable. Après ces premiers livres, il y a une période, de 1995 à 2000, où vous avez écrit plusieurs romans pour la jeunesse. La folie Kennaway a été un grand succès, à la fois un succès populaire – le livre a été repris en Pocket – et un succès critique avec de très bons articles partout. La tribu aussi a très bien marché. Mais Un monde sans crime est sorti dix jours avant que les éditions Presses de la Renaissance disparaissent dans le giron des éditions Belfond et il n’a pas été défendu… C’était une horreur. Pourtant, c’est un livre qui m’importe beaucoup sur le plan politique et ce n’était pas très facile dans ces années-là d’évoquer le Rainbow Warrior et les années du mitterrandisme. Aussi, quand j’ai signé mon contrat pour L’évangile selon Caïn, je ne pouvais plus faire confiance à cet éditeur et je n’arrivais plus à écrire une ligne. A ce moment, une autre maison d’édition m’a demandé d’écrire pour les enfants. J’ai écrit un premier texte, puis un deuxième et finalement ce sont trois livres pour enfants qui ont été publiés à L’Ecole des loisirs. Geneviève Brisac trouvait dommage que je ne veuille pas m’attaquer au roman pour les adolescents parce que je connaissais très bien les jeux de rôles et les jeux vidéo… Elle a insisté et j’ai écrit No pasarán, le jeu qui a été un succès international, vendu à plus de cent cinquante mille exemplaires et traduit dans plusieurs langues… Un succès étonnant qui m’a fait voyager dans le monde entier. C’est vraiment très touchant quand des profs de lycée professionnel me disent que des élèves qui n’ont jamais rien lu de leur vie, lisent ce livre et qu’il les accroche. J’ai toujours pensé que c’était très difficile d’écrire pour les adolescents parce que, comme les enfants, ils disent facilement « le roi est nu ». N’importe qui travaillant dans un grand journal peut écrire un bouquin et se faire inviter par les copains à la télévision ou à la radio, dans l’attente du renvoi d’ascenseur… mais si on donne ce bouquin à un enfant ou à un collégien en disant c’est formidable, regarde, c’est M. Machin de l’Académie Française, il dira « j’en ai rien à faire ! ». Je considérais que c’était difficile mais j’ai écrit d’autres livres pour les ados, ça m’a donné du plaisir et ça a plutôt bien marché. Parallèlement, vous avez publié L’évangile selon Caïn au Seuil et un roman sur votre enfance, Une éducation anglaise, chez L’Olivier. Oui, mais je me moque des étiquettes. La nature du mal, publié à L’Ecole des loisirs, aurait pu paraître chez Rivages Noir et Une éducation anglaise aurait pu être publié à L’Ecole des loisirs. J’ai ce rêve d’un écrivain protéiforme qui serait un écrivain pour tout le monde, pouvant à un moment ou à un autre s’adresser à des gens différents. Avec le temps, les différences d’écriture ou de structures disparaissent, il ne reste qu’une différence fondamentale : le niveau d’innocence. Dans L’évangile selon Caïn, on retrouve ce thème de l’attrait de certains artistes pour le morbide qui était au cœur de La folie Kennaway. C’est interne, c’est en moi. Déjà, pour être médecin et réanimateur, il faut pouvoir passer outre certaines barrières et s’astreindre à faire et voir des choses que le commun des mortels préfère ignorer. Donc, déjà, en questionnant l’attrait de Kane et de Childs pour ces choses-là, c’est moi dont il est question. D’autre part, Childs et Kennaway dans La folie Kennaway et les deux frères Kane dans L’évangile selon Caïn, sont en fait, je m’en suis rendu compte plus tard, une façon pour moi d’affronter deux parties de moi-même. On va dire que Kennaway est un « gentil », un écrivain probablement moyen qui a eu un grand livre dans sa vie et qui, pour le reste, a un peu de mal, c’est un type sûrement très sympathique, en gros qui ne ferait pas de mal à une mouche, et Childs est un type brillantissime, pervers, monstrueux, que cette perversion fait souffrir d’ailleurs, ce n’est pas plaisant d’être lui, même pour lui, et ces deux-là s’aiment et s’affrontent. Nathan Kane et Sebastian Kane, c’est la même chose ; il y en a un qui est un écrivain moyen, qui a certainement une éthique de vie, et qui affronte son frère qui est un dingue de la plus haute espèce. Beaucoup de gens m’ont demandé, surtout après la sortie d’Une éducation anglaise s’il y avait un rapport avec mon frère et en fait non, ce n’est pas du tout ça, c’est le rapport que j’ai avec moi-même. J’ai à la fois en moi Childs et Kennaway et les deux frères Kane. Et ce n’est pas facile d’être le « méchant », je pense que ce n’est pas facile d’être Henry Childs, comme il le dit un moment. Il ne faut pas imaginer que celui qui a cette vision maudite des choses soit forcément un surhomme, qui en tire une jouissance… c’est plutôt sa malédiction de porter cette vision. Et s’il choisit de manière brutale de la faire partager au reste du monde, c’est peut-être parce qu’il considère qu’il ne doit pas être le seul à ressentir cette souffrance morale, mais ce n’est pas un démiurge, c’est quelqu’un à travers qui passe le courant. Dans ces romans, le mal est personnifié par le peintre ou le photographe et non par l’écrivain. Comme le dit Kane au début, quand il va dans la galerie de photos et qu’il voit cette œuvre (une photo de Witkin qui existe réellement, avec un enfant mort entouré de fragments de cadavres et de crustacés), il dit clairement que la photo, à la différence de la littérature, pose la question de « comment elle a été faite ». Ce qu’il appelle « l’esthétique du charnier » implique qu’à un moment son frère s’est trouvé dans cette morgue mal réfrigérée de Mexico. La photo n’est pas seulement une image ; quand on voit la photo, on imagine le photographe en train de réaliser son œuvre. C’est là qu’il y a cette distanciation avec le mot, la phrase, où, entre guillemets… « c’est dans la tête » que ça se passe. Je me souviens que Jacqueline de Romilly – après avoir lu L’évangile selon Caïn, qu’elle avait trouvé bouleversant – m’avait écrit « je suis heureuse de ne pas être dans votre tête ». Pourquoi ce besoin de situer ces romans en Angleterre ? Très longtemps, j’ai mieux connu la culture anglo-saxonne que la culture française. Je lisais beaucoup d’auteurs américains et anglais, je passais beaucoup de temps en Angleterre pendant les vacances, c’était un univers que je connaissais de l’intérieur. En France, j’étais un petit garçon et même s’il arrivait à ce petit garçon modèle de faire l’école buissonnière pour aller voler des bouquins à la librairie du coin, en règle générale, il avait de bonnes notes et faisait ce qu’on lui demandait. En Angleterre, par la grâce de ma cousine (Susan dans Une éducation anglaise), j’étais libre, j’étais un adolescent, presque un adulte en devenir, je pouvais me balader dans Soho, me frotter un peu à la vie et en sortir une expérience personnelle. L’Angleterre a longtemps été mon parc d’attraction, au sens large d’un lieu où tout peut arriver, un peu comme dans l’île des miracles de Pinocchio, où on risque aussi d’être transformé en âne… Dans certains de mes livres, j’ai gardé ça pour le côté « alien » qui perdait mes personnages. Kane, quand il arrive en Angleterre, est un peu perdu. Quant à la psychiatrie, je pense que la psychiatrie anglaise dans ces années-là était restée un art avant de devenir une industrie à prescrire du médicament. En France, il y avait une attention à la parole psychanalytique mais c’était une attention très intellectualisée, lacanienne, qui allait très mal avec ma compréhension intuitive des choses et de la psychologie humaine. Dans No pasarán, les ados trouvent leur jeu à Londres. On a l’impression que tout ce qui est fantastique (ou folie) prend sa source en Angleterre et que tout ce qui est médecine est à Villers. Oui, c’est vrai, quand on est dans le commentaire social ou politique à travers un roman comme Un monde sans crime, Une question de confiance ou La tribu, on est en France. Ici et maintenant. La littérature fantastique ou de science-fiction est pour moi très liée à l’Angleterre. Mais je situe de moins en moins souvent mes intrigues là-bas parce que j’y vais plus rarement et que c’est resté lié à l’adolescence, la période de la découverte des femmes, etc. Etre un jeune Français dans l’Angleterre des années 80, c’était déjà être « a stranger in a strange land » un étranger dans un pays étrange. Il suffisait de passer la Manche pour être dans un pays dont les us et coutumes étaient très différents d’ici. Ne plus être « noyé dans la masse ». On sait qu’on peut s’y perdre, ce qui arrive à chacun des protagonistes, mais on peut aussi y trouver beaucoup. Vous écrivez d’une manière continue, régulière, ou par périodes ? Il y a plein de moments où je n’écris pas. C’est Philippe Djian qui disait « ne réveillez pas un écrivain allongé au soleil sur une chaise longue, c’est un homme qui travaille. » Et ce n’est pas faux ! Le temps que j’ai passé à jouer à des jeux vidéo était un temps où sans le savoir j’étais en train d’écrire No pasarán, le jeu. Et c’est toujours comme ça. Je fais les choses qui à l’intuition me plaisent et un jour ou l’autre il y a un déclic, et ça nourrit une espèce de « chose » qui est là… sans que j’en ai conscience, pendant tout ce temps de fermentation, la structure narrative se met en place. En fait, je me mets en condition d’écriture, et à un moment, après avoir bien retenu la « chose », je sens qu’il faut que ça vienne et d’une certaine façon je la libère… A partir de ce moment-là, je ne me pose jamais la question de « trouver le temps ». Mon grand ami Garry, quand j’ai voulu écrire, m’a dit de coller un post-it sur l’écran : « Ça ne s’écrira pas tout seul ». Et le soir où je sais que je devrais écrire mais qu’il y a un truc à la télé, il y a le post-it sur l’écran ! Parfois je me mets devant l’ordinateur sans en avoir vraiment envie, je tapote, je corrige deux lignes et quand je me réveille, si j’ose dire, j’ai fini une page. Et quand on arrive à la fin du roman, il faut réécrire, retravailler… Vous construisez des structures parfois complexes, avec des retours en arrière… J’avais des plans très construits pour les deux premiers. Pour La folie Kennaway j’avais un mur entier avec des post-it de couleurs différentes avec des A1, B2, B3… J’ai fait la même chose pour La tribu. Pour Un monde sans crime, j’ai pensé que je pourrais peut-être ne plus faire de plan et commencer à tourner mon film dès que j’aurais bien mes personnages en tête… Ne pas avoir la visibilité finale de ce qui va arriver libère totalement la création, la narration, et laisse la possibilité d’être stupéfait par ce que font les personnages. Si tu connais de l’intérieur chacun de tes personnages, si tu en es imprégné, ton roman est déjà écrit … Pour L’évangile selon Caïn, je savais ce que je voulais dire mais j’ignorais comment j’arriverais au bout. Et ça a été monstrueusement pénible, à cause du thème. J’ai vraiment passé deux ans et demi dans un univers sordide, une fosse septique... Le roman le plus agréable à écrire a été Une éducation anglaise alors que le retour sur soi-même n’est pourtant pas forcément évident, mais il a vraiment été écrit dans l’allégresse, ce qui n’est pas toujours le cas. Vous retravaillez aussi vos textes au moment d’une réédition ? Quand il a été question de republier La folie Kennaway chez Rivages, je me suis dit qu’il datait d’une dizaine d’années et qu’il avait peut-être besoin d’un léger toilettage. Je pensais y passer un week-end, corriger quelques fautes de frappe, modifier une phrase ici ou là. J’ai commencé à le relire et dans les premières pages, je n’ai pas osé trop changer, mais au fur et à mesure il y avait des passages qui me pesaient vraiment, qui me gênaient, et je me suis mis à travailler, à changer… C’étaient plutôt des choses que j’enlevais, qui étaient en trop, et quand je suis arrivé au bout, je n’étais pas fier. Comme je n’avais pas vraiment retravaillé le début, j’ai eu peur que l’ensemble soit déséquilibré. J’ai donc recommencé et puis j’ai continué sur la deuxième partie parce que je trouvais encore des erreurs. Je l’ai fait trois fois ! Et j’ai beaucoup épuré. Pour Un monde sans crime et L’évangile selon Caïn, je n’ai pas changé grand chose. C’est là que je me suis aperçu que La folie Kennaway et La tribu faisaient vraiment partie de la période de l’apprentissage. Vous avez des projets pour L’Ecole des loisirs et L’Olivier ? Oui, je travaille à la suite de No pasarán, le jeu, qui pourrait paraître avant la fin de l’année. Ensuite, j’ai très envie de me remettre dans l’état d’esprit qu’il faut pour réfléchir à la suite de L’éducation anglaise. Après l’adaptation de La tribu, vous ne rêvez pas de réaliser vous-même un film ? Non, ça nécessite un physique à toute épreuve, c’est éreintant, c’est une cascade inimaginable d’emmerdements… Par contre, il y a trois ans, un ami de très longue date – qui est parti à l’université de Californie-Los Angeles faire du cinéma – est revenu et m’a dit : « Depuis les jeux de rôles de notre adolescence, de tout ce que je lis rien n’a jamais eu la même force et je voudrais savoir si parmi tes romans il y en a un qu’on pourrait monter à l’écran ». J’ai dit non pour les romans mais oui pour un sujet original auquel j’avais déjà réfléchi. On en a discuté ensemble, on vient de le terminer après un an et demi de travail, c’est parti aux Etats-Unis et…c’est en train de suivre son cours. Si ça se fait, ce sera formidable, mais on n’en est pas encore là. On y retrouve vos grands thèmes ? Il y a la médecine, le mal, le fantastique, les relations amoureuses, la responsabilité des individus par rapport au conformisme de la société… Mais je n’en dis pas plus pour le moment… http://christianlehmann.free.fr |
 La Folie Kennaway Rivages Noir, 1988 La Tribu Rivages Noir, 1990 Un monde sans crime Rivages Noir, 1993 L’Évangile selon Caïn Éditions du Seuil, 1995 & Points Seuil Une éducation anglaise Éditions de l'Olivier, 2000 Une question de confiance Rivages Noir, 2002 Patients, si vous saviez… Robert Laffont, 2003 Aux éditions L’École des Loisirs Pour les adolescents : No pasarán, le jeu, 1996 La Citadelle des cauchemars, 1998 La Nature du mal, 1998 Tant pis pour le Sud, 2000 Pour les enfants : Pomme et le magasin des petites filles pas sages, 1994 Taxi et le bunyip, 1995 Le Crocodile de la bonde, 1996 Le Père Noël n'existe même pas, 1998      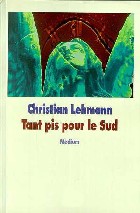 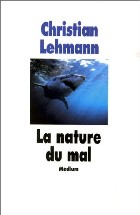 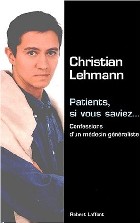 | |||||||