Lecture critique
Vivre à la campagne, le rêve des Français ?
Disons-le d’emblée, il n’est pas toujours salutaire d’écouter les économistes et les hauts fonctionnaires lorsqu’il s’agit de promouvoir les meilleures façons d’envisager le futur de nos contemporains. Ainsi, en 2010, aux termes d’un rapport sollicité par le gouvernement, Jacques Attali (Alger, 1943) préconisait de fusionner les petites communes pour en faire des entités à taille urbaine en matière de population. « Quelle absurdité ! », s’est exclamé l’animateur de radio et de télévision 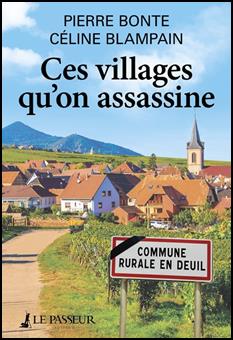 Pierre Bonte (Pérenchies, 1932) dont on connaît l’attachement à la ruralité française. Le rapporteur Attali proposait de ramener le nombre des communes de 36 000 à 6 000. L’idée avait été reprise en 2014 par l’ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy qui suggérait que cette réforme soit soumise à l’épreuve du référendum « dans la foulée de la prochaine élection présidentielle ». Si « les dieux n’ont pas voulu que François Fillon (Le Mans, 1954) puisse mettre son projet à exécution », selon la sentence de P. Bonte, la France rurale est restée pour de nombreux technocrates un espace archaïque à la disparition nécessaire et inéluctable. Au 1er mars 2019, le pays comptait encore trente-quatre mille neuf cent soixante-sept (34 967) communes, 5 % de moins qu’en 2010. Dans leur ouvrage « Ces villages qu’on assassine », Pierre Bonte et la journaliste Céline Blampain (Cousoire, 1988) déplorent l’inquiétante disparition des petits agriculteurs : trois millions d’entre eux ont cessé leur activité depuis cinquante ans emportant avec eux un certain art de vivre et un peu de l’âme du village. Ce qu’il reste des « territoires » ruraux est soumis, depuis une vingtaine d’années, à une concentration des services et à leur déménagement vers les zones les plus denses. « Entre 1980 et 2013, selon l’INSEE, le nombre des bureaux de poste a baissé de 36 %, celui des perceptions de 31 % ; moins 41 % pour les maternités, moins 28 % pour les gares, moins 13 % pour les gendarmeries.
Pierre Bonte (Pérenchies, 1932) dont on connaît l’attachement à la ruralité française. Le rapporteur Attali proposait de ramener le nombre des communes de 36 000 à 6 000. L’idée avait été reprise en 2014 par l’ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy qui suggérait que cette réforme soit soumise à l’épreuve du référendum « dans la foulée de la prochaine élection présidentielle ». Si « les dieux n’ont pas voulu que François Fillon (Le Mans, 1954) puisse mettre son projet à exécution », selon la sentence de P. Bonte, la France rurale est restée pour de nombreux technocrates un espace archaïque à la disparition nécessaire et inéluctable. Au 1er mars 2019, le pays comptait encore trente-quatre mille neuf cent soixante-sept (34 967) communes, 5 % de moins qu’en 2010. Dans leur ouvrage « Ces villages qu’on assassine », Pierre Bonte et la journaliste Céline Blampain (Cousoire, 1988) déplorent l’inquiétante disparition des petits agriculteurs : trois millions d’entre eux ont cessé leur activité depuis cinquante ans emportant avec eux un certain art de vivre et un peu de l’âme du village. Ce qu’il reste des « territoires » ruraux est soumis, depuis une vingtaine d’années, à une concentration des services et à leur déménagement vers les zones les plus denses. « Entre 1980 et 2013, selon l’INSEE, le nombre des bureaux de poste a baissé de 36 %, celui des perceptions de 31 % ; moins 41 % pour les maternités, moins 28 % pour les gares, moins 13 % pour les gendarmeries.
 » La corporation des médecins est atteinte d’une pareille désaffection et nombre de paroisses n’ont plus de curés. De plus, tempêtent les auteurs, de nombreux villages ruraux ne sont pas encore reliés aux réseaux Internet, à l’exemple de leurs ascendants qui avaient attendu trente ans avant de remiser lampes à huile ou à pétrole au profit de la fée électricité qui illuminait les appartements des grandes villes dès les années 1920 ! Au moment où 81 % des Français estiment idéal de vivre à la campagne, 95 % des ruraux affichent leur volonté de demeurer dans leurs villages. L’espoir d’un futur moins sombre que celui des économistes conclut « Ces villages qu’on assassine » : « Nous pensons que les aléas de la mondialisation, la menace du réchauffement climatique et le risque d’épuisement des ressources de la planète, vont nous contraindre à des changements profonds, et que les territoires ruraux ont un rôle majeur à jouer dans cette révolution sociale, économique et culturelle. »
» La corporation des médecins est atteinte d’une pareille désaffection et nombre de paroisses n’ont plus de curés. De plus, tempêtent les auteurs, de nombreux villages ruraux ne sont pas encore reliés aux réseaux Internet, à l’exemple de leurs ascendants qui avaient attendu trente ans avant de remiser lampes à huile ou à pétrole au profit de la fée électricité qui illuminait les appartements des grandes villes dès les années 1920 ! Au moment où 81 % des Français estiment idéal de vivre à la campagne, 95 % des ruraux affichent leur volonté de demeurer dans leurs villages. L’espoir d’un futur moins sombre que celui des économistes conclut « Ces villages qu’on assassine » : « Nous pensons que les aléas de la mondialisation, la menace du réchauffement climatique et le risque d’épuisement des ressources de la planète, vont nous contraindre à des changements profonds, et que les territoires ruraux ont un rôle majeur à jouer dans cette révolution sociale, économique et culturelle. »
Céline Blampain et Pierre Bonte
© Photo X, droits réservés
- Ces villages qu’on assassine, par Pierre Bonte et Céline Blampain, éditions Le Passeur, 200 pages, 2021.
Lire aussi :
- Pierre Bonte, le petit rapporteur des provinces rurales, portrait de Claude Darras dans les Papiers collés de l’automne 2019, revue Encres vagabondes, en relation avec « La Belle France - À la rencontre de nos villages », par Pierre Bonte, Le Passeur éditeur, 264 pages, 2019.
Portrait
Mer au milieu des terres, Mare Nostrum, Mer Blanche, Grande Mer…
David Abulafia raconte l’histoire de la Méditerranée
Très tôt, les travaux des historiens, auxquels Fernand Braudel (1902-1985) a donné un éclat tout particulier, ont mis en évidence le rôle tout à fait particulier de la Méditerranée qui, loin de séparer, a le plus souvent uni les peuples et les cultures qui occupaient ses rivages. Depuis l’Antiquité, la Grande Mer a attiré les navigateurs, curieux d’en explorer l’étendue et de découvrir les terres qui l’entourent. Professeur émérite d’histoire méditerranéenne à l’université de Cambridge, David Abulafia (Twickenham, 1949) s’attache - avec quel brio ! - à raconter l’histoire des peuples qui l’ont traversée et ont habité ses rivages, ses ports et ses îles. Son ouvrage, « La Grande Mer - Une histoire de la Méditerranée et des Méditerranéens » explique au gré de quels événements la Méditerranée en est venue à constituer un ensemble économique, politique, culturel et linguistique unique et remarquable, plus spécialement dans le parcours des civilisations, la richesse de son passé et les incertitudes de son devenir.
L’accès aux ressources provoque des conflits
Espace de mythes et de légendes, la Méditerranée a été le berceau des récits fondateurs de nombreuses civilisations, soit qu’elles échangent ou s’engendrent mutuellement, soit qu’elles entrent en conflit. Les légendes minoennes, l’errance d’Ulysse,  la course d’Énée s’y nourrissent tour à tour. Les grandes religions, polythéistes puis monothéistes avec la Bible, naissent sur ses bords. Troie et Carthage y périssent, Athènes y succombe, Israël s’y disperse et Rome, seul empire à l’avoir intégralement conquise, y triomphe avant de se dissoudre vaincue par sa politique d’extension. Nombreux sont les peuples qui s’y succèdent : Phéniciens, Grecs, Perses, Étrusques, puis, au Moyen Âge, Génois, Vénitiens et Catalans, et, avant 1800, Néerlandais, Anglais et Russes. Les conflits entre musulmans et chrétiens sont légion. L’historien anglais insiste sur le rôle important des marchands juifs, surtout au Moyen Âge, des négociants qui permirent notamment l’exécution de portulans et de mappemondes de grande qualité. Dès l’Antiquité, l’accès aux ressources multiples de l’espace méditerranéen entraîne de violents conflits. Les navires marchands sont incessamment pillés par des pirates qui se manifestent dès le XVe siècle ajoutant à leurs forfaits la réduction en esclavage : leurs razzias en quête de captifs se prolongeront jusqu’au XIXe s. Ces corsaires d’un nouveau genre sont d’origine variée, calabraise, albanaise, juive, génoise et même hongroise. Ils comptent Alger, Tripoli et Tunis, entre autres, comme ports de refuge.
la course d’Énée s’y nourrissent tour à tour. Les grandes religions, polythéistes puis monothéistes avec la Bible, naissent sur ses bords. Troie et Carthage y périssent, Athènes y succombe, Israël s’y disperse et Rome, seul empire à l’avoir intégralement conquise, y triomphe avant de se dissoudre vaincue par sa politique d’extension. Nombreux sont les peuples qui s’y succèdent : Phéniciens, Grecs, Perses, Étrusques, puis, au Moyen Âge, Génois, Vénitiens et Catalans, et, avant 1800, Néerlandais, Anglais et Russes. Les conflits entre musulmans et chrétiens sont légion. L’historien anglais insiste sur le rôle important des marchands juifs, surtout au Moyen Âge, des négociants qui permirent notamment l’exécution de portulans et de mappemondes de grande qualité. Dès l’Antiquité, l’accès aux ressources multiples de l’espace méditerranéen entraîne de violents conflits. Les navires marchands sont incessamment pillés par des pirates qui se manifestent dès le XVe siècle ajoutant à leurs forfaits la réduction en esclavage : leurs razzias en quête de captifs se prolongeront jusqu’au XIXe s. Ces corsaires d’un nouveau genre sont d’origine variée, calabraise, albanaise, juive, génoise et même hongroise. Ils comptent Alger, Tripoli et Tunis, entre autres, comme ports de refuge.
L’intelligente gouvernance des Romains
L’Empire romain a duré cinq siècles et la Méditerranée en était vraiment la Mare nostrum. Avec beaucoup d’intelligence, les Romains ont pris en compte toute la diversité culturelle des peuples conquis et ils se sont approprié l’essentiel de la culture grecque, instaurant au sein de leurs territoires l’égalité juridique, la pleine souveraineté, la liberté de circulation, le respect de la diversité culturelle, la paix - toute relative - en plus d’un commerce florissant. Fils adoptif de Jules César, Caius Octavius (63 av. J.-C- 14 apr. J.-C.) dit Octave avait compris, selon David Abulafia, que le plus grand trésor de l’Égypte ne se trouvait pas dans l’émeraude ou le porphyre, mais dans… les épis de blé nilotiques. Il souligne à cet égard : « La traque de la piraterie, l’acquisition de vastes étendues de terre en Méditerranée orientale et les guerres civiles romaines engendrèrent des conséquences politiques et économiques spectaculaires pour la Méditerranée. Les Romains garantissaient désormais la sécurité des mers, depuis le détroit de Gibraltar jusqu’aux côtes de l’Égypte, de la Syrie et de l’Asie Mineure. La transformation de la Méditerranée en un lac romain était totale. Le processus avait duré cent seize ans. » Bientôt (527-565), l’Empire byzantin (dit Empire romain d’Orient jusqu’au XIVe s.) prendra le contrôle d’une grande partie de la Méditerranée orientale, avant l’intrusion des cavaliers arabes (632-732) qui investissent les rives est et sud de la Grande Mer afin d’y répandre l’islam.
Varia : de la fonction du conte et des chansons de villages
« La fonction du conte, c’est dans un premier temps de divertir, comme le football divertit, comme le cinéma divertit… Mais, derrière cette fonction de divertissement, il y a des modèles sociaux, des modèles culturels, des valeurs. Les gens en général ne commentaient pas les contes, il n’y avait pas de morale explicite, contrairement aux contes de Perrault ou à la façon dont l’institution scolaire s’est un temps emparée des contes, en imaginant qu’ils portaient une morale explicite. Mais s’il n’y a pas de morale, il y a des modèles de comportements, et sans qu’on en tire une leçon claire au moment de la transmission, ces modèles fonctionnent comme modèles, avec leur feuilletage de sens, et travaillent les représentations. On dit que ça aide les enfants à grandir, notamment les contes merveilleux, ce qui est une réalité (bien qu’ils étaient aussi autrefois des contes d’adultes), mais ça aide surtout toute la structure sociale à se reconnaître ou à ne pas se reconnaître dans des récits référents, comme l’ont fait par la suite la littérature, le cinéma, l’école… qui au fond, ont remplacé le conte. Les contes qu’on transmet en Cévennes, en Provence ou en Bretagne aux XIXe-XXe siècles, à l’époque où œuvrent les collecteurs, sont des contes qu’on trouve déjà au XVIIIe, au XVIIe, et même au Moyen Âge. Cela interroge l’histoire des mentalités sur la longue durée.
 « […] Ce qui m’a un peu différencié de certains collecteurs, c’est que si je me suis intéressé à une culture qui certes disparaissait - le conte et la chanson populaires -, j’ai considéré d’emblée ces objets comme évolutifs, malgré qu’ils aient une évolution lente, alors que les anciens folkloristes voyaient en eux des objets fixes, ce qui était relativement vrai, mais aussi relativement faux. J’ai vu en eux des objets historiques. Et dans le même temps, j’ai interrogé la façon dont ces objets ouvraient sur des représentations de l’histoire.
« […] Ce qui m’a un peu différencié de certains collecteurs, c’est que si je me suis intéressé à une culture qui certes disparaissait - le conte et la chanson populaires -, j’ai considéré d’emblée ces objets comme évolutifs, malgré qu’ils aient une évolution lente, alors que les anciens folkloristes voyaient en eux des objets fixes, ce qui était relativement vrai, mais aussi relativement faux. J’ai vu en eux des objets historiques. Et dans le même temps, j’ai interrogé la façon dont ces objets ouvraient sur des représentations de l’histoire.
« Si l’on prend les corpus de contes ou de chansons en Cévennes, on peut voir en eux une historicité. Quoique traditionnels, c’est-à-dire transmis selon un mode de mémorisation strictement oral ou peu s’en faut, ils sont modelés par l’histoire. Et en même temps, comme récits référents, ils modèlent les représentations de l’histoire, et donc in fine l’histoire. On pourrait prendre des exemples. L’avènement, à partir des années 1880 dans les Cévennes, de ce qu’on appelle les "chansons de villages", chansons d’identité villageoise, est contemporain d’une mise en question des territoires anciens, de la façon dont les gens se projetaient sur ces territoires. Avant le XIXe siècle, il n’y a pas d’imaginaire ou de revendication de l’identité cévenole en tant que telle : l’identité cévenole commence à apparaître au moment où le pays ancien se défait devant l’émergence de l’industrie et des moyens de communication comme le train, le télégraphe… Face à cette remise en cause de l’identité territoriale comme pratique, d’autres espaces référentiels se construisent, qui sont des espaces de résistances, de recompositions. Les chansons de villages y participent. Face à l’ouverture traumatisante du territoire, l’identité de village sert de refuge. Les chansons de villages sont créées dans ce contexte historique et participent aux représentations de l’histoire en créant contre celle-ci un havre presque immobile. L’histoire peut advenir puisque le village, typifié dans les chansons, persiste. »
Dans « Histoire et récits », entretien de Jean-Noël Pelen, ethnologue, avec Maryline Crivello, professeur d’histoire moderne, et Isabelle Luciani, maître de conférences, toutes deux à l’université d’Aix-Marseille, publié dans la revue « Rives méditerranéennes », n° 48, 2014, UMR TELEMME, Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, Aix-en-Provence.
Carnet : crise de la démocratie
Plus d’un penseur l’assure, la démocratie est en crise aujourd’hui, non pas dans ses valeurs - elles tiennent bon ou presque - mais dans son exercice, dans ses pratiques, dans son éthique.
La chanson confisquée
« Un savetier chantait du matin jusqu’au soir » ; jusqu’au jour où on lui offrit un poste de radio.
(Gilbert Cesbron, « Journal sans date », tome 2, éditions Robert Laffont, 1967)
Voyage, voyage !
L’exotisme, on le sait bien, est un leurre. N’en restent que les tapis et les diseurs de bonne aventure. En revanche, le voyage connaît ses lois et sa philosophie qu’on assimile plus par la plante des pieds que par un exercice de méditation. Je répète à l’envi la citation de Montaigne voyageant à l’étranger : frotter et limer notre cervelle à celle d’autrui.
(Vendredi 21 juillet 2023)
Le dico de Calepino
Savant et religieux (augustin) italien, Ambrogio Calepio, dit Calepino (1436-1511) - nous lui devons le mot « calepin » - est l’auteur d’un dictionnaire qui a été réédité plus de deux cents fois (!) à partir de l’an 1502 jusqu’en 1789, en Italie, en France, en Suisse et aux Pays-Bas. Retenu parmi les premiers travaux lexicographiques du XVIe siècle naissant, l’Ambrosii Calepini Bergomatis Dictionarum a été traduit en latin (langue originelle) puis en italien, en grec et en hébreu.
Regret du critique
De plus en plus, la critique littéraire disparaît au profit de l’actualité littéraire.
Biographie sans masque
L’éditeur Robert Laffont a tenu la gageure de portraiturer Alain, Robert Brasillach, Paul Claudel, Graham Greene, Marcel Proust, Jules Romains, entre autres littérateurs, à l’enseigne d’une collection intitulée « Biographie sans masque ». Bigre ! mais qui donc parviendra à retrouver le visage de tel ou tel écrivain, chez qui tout est masque, jeux de rôles, parodie, arlequinade ?
Persévérance du poète
Quelle grandiloquence dans la prose, quelle emphase dans le récit : cette sexagénaire ne cesse de m’assiéger avec sa production livresque. Que lui dire ? J’imagine qu’elle déclame ses impromptus tout en s’observant dans un miroir, juchée sur ses tirades touchantes et maladroites comme une gamine sur ses premiers talons hauts.
(Jeudi 27 juillet 2023)
Lecture critique
Secrets et blessures d’enfance avec Sarah Perret
 Privés de leurs parents dès l’enfance, Jean et Ophélie, sa cadette, sont accueillis par leurs grands-parents, Jules Rey et sa femme Euphroisine née Besson, parents de leur mère Édith Rey. Plusieurs générations partagent la rudesse d’un quotidien rythmé par les travaux agricoles d’altitude dans un village du massif savoyard de la Chartreuse. L’aînée de la parentèle, Adèle Besson, y est entourée de la tendresse de deux de ses filles, Euphroisine et Séraphie, car la troisième, Florentine, a voulu rejoindre le carmel du Reposoir au début des années 1940. Malgré la bonne volonté et l’affection de leurs hôtes, les deux orphelins vivent plus ou moins bien leur intégration dans le nouveau foyer qui reçoit au hasard des saisons une flopée de cousins avec lesquels Jean partage les loisirs ludiques dont celui de découvrir le trésor du chevalier Rollet d’Entremont... Outre la légende de la confrérie des Sept, Entremont-le-Vieux porte les ruines du château de la Roche-Fendue et une station de ski, tandis qu’Épernay est célèbre pour sa ganterie : tous deux sont les sites les plus proches de la maison familiale, construite en 1839 par les grands-parents d’Adèle, Louis et Jeanne Rigaud. Constamment morigénée par son frère qu’elle chérit éperdument, Ophélie confie à sa poupée ses pensées et ses rêves dont la certitude que ses parents viendraient la rechercher. La fillette a nommé sa confidente de porcelaine du prénom de sa mère,
Privés de leurs parents dès l’enfance, Jean et Ophélie, sa cadette, sont accueillis par leurs grands-parents, Jules Rey et sa femme Euphroisine née Besson, parents de leur mère Édith Rey. Plusieurs générations partagent la rudesse d’un quotidien rythmé par les travaux agricoles d’altitude dans un village du massif savoyard de la Chartreuse. L’aînée de la parentèle, Adèle Besson, y est entourée de la tendresse de deux de ses filles, Euphroisine et Séraphie, car la troisième, Florentine, a voulu rejoindre le carmel du Reposoir au début des années 1940. Malgré la bonne volonté et l’affection de leurs hôtes, les deux orphelins vivent plus ou moins bien leur intégration dans le nouveau foyer qui reçoit au hasard des saisons une flopée de cousins avec lesquels Jean partage les loisirs ludiques dont celui de découvrir le trésor du chevalier Rollet d’Entremont... Outre la légende de la confrérie des Sept, Entremont-le-Vieux porte les ruines du château de la Roche-Fendue et une station de ski, tandis qu’Épernay est célèbre pour sa ganterie : tous deux sont les sites les plus proches de la maison familiale, construite en 1839 par les grands-parents d’Adèle, Louis et Jeanne Rigaud. Constamment morigénée par son frère qu’elle chérit éperdument, Ophélie confie à sa poupée ses pensées et ses rêves dont la certitude que ses parents viendraient la rechercher. La fillette a nommé sa confidente de porcelaine du prénom de sa mère, 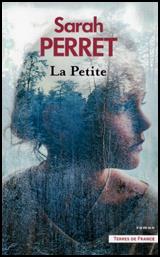 Édith, morte en couches à 37 ans moins d’un an après son jumeau, Daniel, décédé en novembre 1978. Même s’il poursuit une scolarité studieuse dans un collège où il fustige les seules habitudes carcérales du pensionnat, Jean n’est pas moins perturbé, obsédé par la latence de questions qui minent les arrière-pensées de la parentèle. Les siens parlent à mots couverts de la conversion de Florentine et de l’agression de sa nièce, Édith, par Francis, le fils de Julienne et Marcel Perrier, leurs voisins…
Édith, morte en couches à 37 ans moins d’un an après son jumeau, Daniel, décédé en novembre 1978. Même s’il poursuit une scolarité studieuse dans un collège où il fustige les seules habitudes carcérales du pensionnat, Jean n’est pas moins perturbé, obsédé par la latence de questions qui minent les arrière-pensées de la parentèle. Les siens parlent à mots couverts de la conversion de Florentine et de l’agression de sa nièce, Édith, par Francis, le fils de Julienne et Marcel Perrier, leurs voisins…
Professeur agrégé de lettres modernes, Sarah Perret (Chambéry, 1976) dévide la succession des événements à son fatal fuseau avec beaucoup de délicatesse et de talent. Elle prête parfois à ses personnages le vocabulaire francoprovençal en usage au bord du Guiers et du Cozon. Elle anime leurs faits et gestes dans un cadre qu’elle connaît bien, la Savoie de sa propre enfance, attentive aux paysages, aux topographies et à l’intimité des intérieurs, à ce qu’on peut appeler « l’esprit des lieux ».
Sarah Perret © Photo X, droits réservés
- La Petite, par Sarah Perret, Prix Jean Anglade 2022 du premier roman, Les Presses de la Cité, collection Terres de France, 256 pages, 2022.
Portrait
René Magritte, le Fantômas du surréalisme
Un jour de l’été 1909, dans le cimetière de Soignies (une cité wallonne où il passe régulièrement ses vacances auprès de sa tante Flora), René Magritte et une camarade de jeu aussi délurée que lui se livrent aux jeux interdits par la morale des grandes personnes. « Nous visitions les caveaux souterrains, racontera-t-il en 1938 lors d’une conférence, des caveaux dont nous pouvions pousser les lourdes portes de fer et nous remontions à la lumière où un artiste peintre peignait dans une allée. » De son enfance blessée par le suicide de sa mère qui se jette dans la Sambre en février 1912,  René-François-Ghislain Magritte (Lessines, 21 novembre 1898-Schaerbeek, 15 août 1967) ne retient rien d’autre que cette vision enchantée - l’artiste œuvrant sur le motif à un paysage de ruines mythiques : « l’art de peindre me paraissait alors vaguement magique et le peintre doué de pouvoirs supérieurs ».
René-François-Ghislain Magritte (Lessines, 21 novembre 1898-Schaerbeek, 15 août 1967) ne retient rien d’autre que cette vision enchantée - l’artiste œuvrant sur le motif à un paysage de ruines mythiques : « l’art de peindre me paraissait alors vaguement magique et le peintre doué de pouvoirs supérieurs ».
Homme de gauche et surréaliste
Ses études dans un athénée de Charleroi sont si médiocres qu’il doit les interrompre au niveau de la troisième, avant l’installation à Bruxelles des Magritte. Ses parents ne désavouent pas son inclination pour les arts plastiques et ils encouragent son entrée à l’Académie royale des beaux-arts (1916-1918), court passage au terme duquel il partage un atelier avec le peintre et poète Pierre-Louis Flouquet, élève de la même académie (comme André Delvaux). Léopold Magritte, son père, est tailleur et farouche anticlérical, sa mère, Régina Bertinchamps, modiste et fervente catholique ; deux garçons élargiront le cercle familial, Raymond (1900-1970) et Paul (1902-1975). Pour gagner sa vie, René recourt plusieurs années à des travaux publicitaires en qualité de graphiste et d’affichiste. Jeune adulte, il s’est encarté à trois reprises au Parti communiste, mais à chaque fois, il a rendu sa carte, réfractaire à toute autorité. Homme de gauche, il appelle de ses vœux la révolution prolétarienne et dénonce « l’idolâtrie pour l’art » qui gangrène son époque. Il adhère en 1926 au mouvement surréaliste belge dont le groupe Correspondance est animé par le poète marxiste Paul Nougé (1895-1967) et il se lie à Marcel Mariën (1920-1993), écrivain et poète, E.L.T. Mesens (1903-1971), musicien, écrivain et plasticien, et Louis Scutenaire (Ollignies, 29 juin 1905-Bruxelles, 15 août 1987), écrivain et poète. D’autres artistes et intellectuels ont déjà rejoint ou rejoindront ses intimes, à l’exemple de Rachel Baes, Achille Chavée, Paul Colinet, Camille Goemans, Irène Hamoir (femme de L. Scutenaire), Paul Hooreman, André Souris, Raoul Ubac et Jacques Wergifosse. En 1927, il rejoint Paris avec Georgette Berger, sa femme, une amie d’enfance retrouvée par hasard au jardin botanique de Bruxelles ! En fait, il s’est installé dans le Val de Marne, au Perreux-sur-Marne, afin de se rapprocher des surréalistes français, en particulier André Breton et Paul Eluard qu’il admire. Sa première exposition personnelle est présentée la même année à l’enseigne de ce mouvement. Dans les années trente et les années quarante, il prend part à toutes les grandes expositions du Surréalisme. 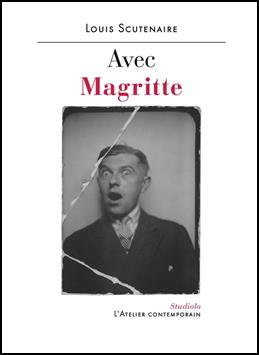 En 1946, il est à l’initiative du manifeste le Surréalisme en plein soleil, qui marque la scission entre les surréalistes belges et leurs collègues français. Ledit manifeste s’avère une virulente déclaration où, en parlant d’André Breton et de ses proches, il fustige les « …ancêtres [qui] tiennent à leur confortable renommée ou bien se sont résignés à abandonner la lutte. Cependant, l’expérience continue en plein soleil ».
En 1946, il est à l’initiative du manifeste le Surréalisme en plein soleil, qui marque la scission entre les surréalistes belges et leurs collègues français. Ledit manifeste s’avère une virulente déclaration où, en parlant d’André Breton et de ses proches, il fustige les « …ancêtres [qui] tiennent à leur confortable renommée ou bien se sont résignés à abandonner la lutte. Cependant, l’expérience continue en plein soleil ».
La révélation de Giorgio De Chirico
Impressionniste à 15 ans, futuriste à 20 ans et cubiste à 24 ans, René Magritte trouve sa voie cardinale à l’âge de 26 ans, ou tout au moins il conforte ses inclinations lorsque le poète Marcel Lecomte (1900-1966) lui révèle la peinture métaphysique de Giorgio De Chirico (1888-1978), peintre italien d’origine grecque, au travers d’une photographie du Chant d’amour : des gants de chirurgien près d’une tête de statue antique. « Ici, une poésie triomphante a remplacé l’effet stéréotypé de la peinture traditionnelle, dira-t-il à cet égard. C’est la rupture totale avec les habitudes mentales propres aux artistes prisonniers de leur talent, de leur virtuosité. Avec De Chirico, il s’agissait d’une vision nouvelle où le spectateur retrouvait son isolement et entendait le silence du monde ». En 1925, il prend la décision de ne peindre sur le papier ou la toile que des objets représentés avec le plus parfait académisme. Depuis longtemps, en effet, il s’intéresse au rapport entre l’image des choses et les vocables qui les désignent. Dès lors, une iconographie singulière se développe à bonne cadence dans ses travaux, montrant des objets (pions, grelots, pipe, cercueil, trombone), des fruits (pommes), des arbres, des oiseaux, des personnages (des hommes en noir coiffés d’un chapeau melon, des femmes nues ou des êtres voilés), des ciels, du feu et de l’eau. Il met en scène ces éléments selon un ordre nouveau et bouleversant, autrement dit là on nous ne les rencontrons jamais. Il joue sur le mystère, l’absurde, la contradiction, le paradoxe, l’insolite, le sens des mots, émettant des commentaires déroutants du style : « Ceci n’est pas une pipe », « J’aime la bière et les roses trémières » ou encore « Le Néant est la seule grande merveille du monde ». « Magritte s’empare de la réalité, remarque le poète Marc Alyn, et la retourne comme un gant, ou une peau de lapin » (Aujourd’hui Poème, n° 79, mars 2007).
Le grand œuvre d’un érudit
Le tableau intitulé La Trahison des images (1928-1929) se réfère à une réflexion de Michel Foucault (1926-1984) sur son essai Les Mots et les Choses (1966). Il entretient précocement des relations épistolaires avec le philosophe et ses confrères dont Alphonse de Waelhens, spécialiste belge de Martin Heidegger. Aussi toute son œuvre peut-elle être regardée à la lumière philosophique. Plus d’un titre de ses tableaux s’y rapportent : Éloge de la dialectique, la Condition humaine, le Principe d’incertitude, l’Aimable Vérité, la Lumière des coïncidences. Lecteur boulimique de Michel Foucault, Martin Heidegger, Maurice Leblanc, Gaston Leroux, Maurice Merleau-Ponty, Edgar Allan Poe, Robert Louis Stevenson, il publie en 1924, à vingt-six ans, des aphorismes rassemblés dans un ouvrage intitulé 391 qui souligne une fréquentation assidue du dadaïsme… qu’il condamne l’année suivante. En parallèle à son œuvre peint, il confectionne des assemblages d’objets (Ceci est un morceau de fromage, 1936) et des sculptures surréalistes (Bouteilles peintes, 1937-1950-1963, les Travaux d’Alexandre, 1967). Et à partir de 1956, il réalise des courts métrages surréalistes (le Dessert des Antilles, 1957 ; les Cartes changées). René Magritte ne disposait d’aucun atelier dans sa petite maison de la rue des Mimosas à Bruxelles. En pyjama ou en costume trois-pièces, il exécutait huiles, gouaches et dessins dans la salle à manger au milieu de meubles encaustiqués, de services d’argenterie bien astiqués et de bibelots en porcelaine. « Son matériel est très modeste, rapporte son ami Louis Scutenaire dans "Avec Magritte" : un chevalet, une boîte à couleurs, une palette, douze pinceaux, une ou deux feuilles de papier blanc dans un carton, une gomme, une estompe, une paire de ciseaux de couturière, un fragment de fusain et un vieux crayon noir ». L. Scutenaire l’a côtoyé durant dix-sept années. Il l’avait surnommé « le Fantômas du surréalisme » en référence à leur passion commune des héros de feuilletons et de bandes dessinées de leur adolescence où le maître du crime coudoyait le chef de gang Zigomar à la cagoule carminée et les Pieds nickelés. Le banlieusard du Hainaut laisse à la postérité une œuvre protéiforme, plus d’un millier de toiles à son actif, sans compter les gouaches et les dessins, innombrables, ainsi que les deux importantes décorations murales réalisées au casino de Knokke-le-Zoute (Le Domaine enchanté, 1953) et au palais des Beaux-Arts de Charleroi (La Fée ignorante, 1957).
René Magritte © Photo X, droits réservés
- Avec Magritte, par Louis Scutenaire, éditions L’Atelier contemporain, collection Studiolo, 192 pages, 2021.
Lectures complémentaires :
- Petit Dictionnaire des artistes modernes, par Pascale Le Thorel-Daviot, éditions Larousse, 336 pages, 1999.
Varia : ronces des bois et mûriers sauvages
 « Regroupées botaniquement sous le nom scientifique de Rubus fruticosus, les ronces des bois présentent une infinie diversité. Plus de 100 sous-espèces et plus de 1 000 variétés hybrides ont été recensées en Europe. De cette hétérogénéité est née une discipline spécifique entièrement dédiée à l’étude des mûriers sauvages : la batologie, du grec batos, la ronce. Les fleurs des mûres sont fécondées par des pollinisateurs, mais de nombreux Rubus ont aussi la capacité de se reproduire de manière asexuée. On parle alors d’apomixie : les graines sont de simples clones génétiquement identiques à la plante mère.
« Regroupées botaniquement sous le nom scientifique de Rubus fruticosus, les ronces des bois présentent une infinie diversité. Plus de 100 sous-espèces et plus de 1 000 variétés hybrides ont été recensées en Europe. De cette hétérogénéité est née une discipline spécifique entièrement dédiée à l’étude des mûriers sauvages : la batologie, du grec batos, la ronce. Les fleurs des mûres sont fécondées par des pollinisateurs, mais de nombreux Rubus ont aussi la capacité de se reproduire de manière asexuée. On parle alors d’apomixie : les graines sont de simples clones génétiquement identiques à la plante mère.
« Les pressés qui n’auraient pas la patience d’attendre la fructification peuvent goûter la fleur du murier, tout à fait comestible : elle décore joliment apéros et plats de crudités. Blancs à rose pâle, ses cinq pétales sont disposés autour d’une couronne d’étamines jaunes, comme chez l’églantier, le cerisier ou le fraisier. Sa forme rappelle clairement son appartenance à cette grande famille des rosacées qui regroupe quelque 5 000 espèces !
« Mais revenons à nos moutons. Je me souviens des instants où la ronce changeait de nom et devenait mûre. L’hostilité des épines faisait place à la caresse du fruit, une saveur à la fois acidulée et sucrée. Entre deux friandises, les égratignures étaient oubliées… »
Extraits d’un article, « Entre deux mûres », de Cathy Roggen-Crausaz et Denis Clavreul, dans la revue « Salamandre », n° 271, août-septembre 2022.
Carnet : œuvre et journal
Comment concilie-je mes notes de diariste avec les récits que je fabrique sous l’enseigne floue du « roman » ? Selon le principe du sablier, l’un des deux cônes de l’ustensile réversible ne se remplit que si l’autre s’épuise.
Qu’est-ce que le roman ?
Selon l’écrivain mexicain Carlos Fuentes (1928-2012), « Le roman est, j’en suis de plus en plus persuadé, le lieu privilégié où peuvent se croiser les destinées individuelles et collectives. Le roman est un carrefour. Le roman est une arène qui permet d’aller plus loin, plus profond, au-delà. Les personnages d’un roman peuvent, s’ils le veulent, faire parler des civilisations entières, éloignées, disparues, complexes, riches. »
(Jeudi 17 août 2023)
Promesse assassine
Soyez tranquille ! Je n’oublierai jamais le service que je vous ai rendu. (18 juin 1891)
(Jules Renard, Journal 1887-1910, Nrf Pléiade)
Regards hitchcockiens
Alfred Hitchcock (1899-1980) parle parfois dans ses mémos de « photographier une pensée » sur le visage ou le corps de quelqu’un. Il s’agirait de photographier un soupçon, un doute, un secret sur le visage d’un individu. Ce n’est pas la même chose que de photographier des gens qui parlent. En vérité, le réalisateur américain d’origine britannique cherchait à rendre visible, à travers le jeu d’un acteur, ce qui se passait à l’intérieur de lui, à faire surgir l’invisible. Chez Hitchcock, un regard peut voir quelque chose, mais plus que tout, il exprime quelque chose.
Duras ou le poids d’une plume
Après avoir commencé la lecture de la biographie de Frédérique Lebelley, « Duras ou le poids d’une plume », Marguerite Duras a dit simplement : « J’en ai lu les premiers chapitres, je n’ai rien reconnu. »
De l’économie, du capitalisme et du marxisme
De Lester Thurow (Les Fractures du capitalisme, éd. Village mondial, 384 pages, 2000), on retiendra l’analyse de l’économie actuelle. L’effondrement du communisme n’a pas seulement privé le capitalisme d’ennemi, il lui a offert une masse de travailleurs peu coûteux et bien formés en faisant basculer 1,9 milliard d’hommes dans l’économie de marché. Par quel miracle continuerait-on à payer des ouvriers allemands 30,33 dollars (environ 180 francs) de l’heure, alors que, dans la Pologne toute proche, on trouve le même niveau de qualification à 5,28 dollars (à peu près 30 francs) ? La concurrence des bas salaires atteint même les niveaux scientifiques les plus élevés. Pourquoi, demande notre auteur, payer un docteur américain en physique 75 000 dollars (450 000 francs) par an alors qu’on peut employer en Russie un Prix Nobel pour 100 dollars (600 francs) par mois ?
(Vendredi 18 août 2023)
Portrait
Un Marcel Proust sans masque
L’exercice que s’est imposé l’écrivain et historien Roger Duchêne (Saint-Nazaire, 1930-Marseille, 2006) n’allait pas de soi : révéler l’homme Marcel Proust derrière l’auteur de la Recherche, en passant la vie de son « modèle » au crible : l’enfance et l’adolescence, la parentèle et ses lieux de vie (Auteuil, Illiers, Cabourg, Beg-Meil), les amitiés au gré des humanités, l’apprentissage philosophique, l’initiation à l’art et à l’architecture, la formation musicale inséparable de la création littéraire, les fréquentations mondaines, la passion amoureuse et ses rapports 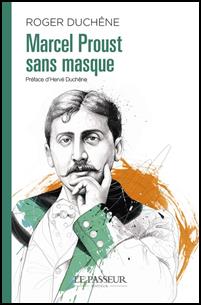 à la sexualité, les voyages et les séjours documentaires, la fabrique littéraire des prémices à la multiplicité des genres… Aussi la curiosité du lecteur recueille-t-elle dans l’ouvrage « Marcel Proust sans masque » une quantité phénoménale d’informations inattendues, la correction d’idées reçues, quelques confidences indiscrètes, des ragots et des commérages, des cancans et des aperçus pénétrants, aptes à découvrir les petits côtés du personnage. Avec ses domestiques et ses amis, le grand homme sait être capricieux et susceptible, insupportable et jaloux, inconstant et tyrannique. Il ne répugne pas non plus aux potins et aux ronds de jambes qui jalonnent autant sa vie publique que sa correspondance.
à la sexualité, les voyages et les séjours documentaires, la fabrique littéraire des prémices à la multiplicité des genres… Aussi la curiosité du lecteur recueille-t-elle dans l’ouvrage « Marcel Proust sans masque » une quantité phénoménale d’informations inattendues, la correction d’idées reçues, quelques confidences indiscrètes, des ragots et des commérages, des cancans et des aperçus pénétrants, aptes à découvrir les petits côtés du personnage. Avec ses domestiques et ses amis, le grand homme sait être capricieux et susceptible, insupportable et jaloux, inconstant et tyrannique. Il ne répugne pas non plus aux potins et aux ronds de jambes qui jalonnent autant sa vie publique que sa correspondance.
Il se découvre homosexuel au lycée Condorcet
Fils d’un grand médecin, Adrien Proust (1834-1903), professeur agrégé de médecine à la faculté de Paris, d’origine modeste et de souche beauceronne, et de la fille d’un agent de change d’origine juive, Jeanne Weil (1849-1905), pour qui il éprouva très tôt une affection exclusive et conflictuelle, il est l’aîné de deux garçons, son frère Robert (1873-1935) qui sera médecin urologue naquit deux ans après lui. Sa vie comme son œuvre ne se comprennent pas si l’on oublie la maladie, les crises d’asthme des foins (dès 1881) qui induisent d’infinies précautions domestiques à prendre, et l’urgence quasi obsessionnelle d’une œuvre à accomplir. Marcel Proust naît le 10 juillet 1871 à Auteuil, chez son grand-oncle Louis Weil (industriel, il fabriquait des boutons) : sa conception coïncide avec l’imminence du siège de Paris. « Ils étaient comme chez eux dans la propriété d’Auteuil achetée par Louis en 1857 à une actrice, Eugénie Doche, créatrice de "La Dame aux camélias", rapporte Roger Duchêne. Elle s’ouvrait au 96 sur une rue La Fontaine, qui devait son nom à une source et rien au fabuliste, dans un village qui, sans avoir parfaitement conservé le caractère agreste célébré jadis par Boileau, n’était pas encore un quartier de Paris. » En octobre 1882, il entre en cinquième au lycée Condorcet de Paris, où il fera ses études secondaires : cour du Havre, entre deux roulements de tambour, le concierge annonce la rentrée en classe et les proviseurs portent la redingote. En 1888, la littérature réunit les lycéens, Daniel Halévy, Jacques Bizet, Robert de  Flers, Robert Dreyfus, Louis de la Salle, Fernand Gregh et Marcel Proust. La bande des 7 s’intéresse aux écrits de Maurice Barrès et d’Anatole France et fonde des revues dont la Revue verte et Lilas (1888), puis Le Banquet (1892). Il se lie bientôt à Gaston de Caillavet, dont la mère tient salon : son ami Jacques Bizet lui fera connaître celui de sa mère, Mme Straus (née Geneviève Halévy), veuve du compositeur de Carmen, qui restera la confidente de l’écrivain jusqu’en 1922. De 1882 à 1889, le lycéen écrit poèmes, pastiches et textes courts (publiés dans la Revue blanche et le journal le Gaulois) et découvre son homosexualité. Il étudie ensuite le droit, les sciences politiques, la philosophie, les lettres, envisage puis rejette les carrières de diplomate, de clerc de notaire et de bibliothécaire à la Mazarine (1891-1895). Ses passions, le plus souvent éphémères, débouchent parfois sur des amitiés durables, comme celle qui l’unit jusqu’à sa mort au compositeur Reynaldo Hahn. Une tenace assiduité aux salons de Mme Aubernon, de la comtesse Laure de Chevigné, de Madeleine Lemaire, de la princesse Mathilde et d’Anna de Noailles élargit le cercle de ses connaissances, aristocrates, femmes et hommes politiques, grands bourgeois et journalistes. En fait, il compte sur les relations nouées dans ces milieux pour s’introduire dans le grand monde. Il met parfois en œuvre la même stratégie auprès de ses amis Alfred Agostinelli, Antoine Bibesco, Léon Daudet, Bertrand de Fénelon, Robert de Montesquiou et amies la comtesse Cordélia Greffulhe, Laure Hayman, Louisa de Mornand, Marie Nordlinger et Jeanne Pouquet.
Flers, Robert Dreyfus, Louis de la Salle, Fernand Gregh et Marcel Proust. La bande des 7 s’intéresse aux écrits de Maurice Barrès et d’Anatole France et fonde des revues dont la Revue verte et Lilas (1888), puis Le Banquet (1892). Il se lie bientôt à Gaston de Caillavet, dont la mère tient salon : son ami Jacques Bizet lui fera connaître celui de sa mère, Mme Straus (née Geneviève Halévy), veuve du compositeur de Carmen, qui restera la confidente de l’écrivain jusqu’en 1922. De 1882 à 1889, le lycéen écrit poèmes, pastiches et textes courts (publiés dans la Revue blanche et le journal le Gaulois) et découvre son homosexualité. Il étudie ensuite le droit, les sciences politiques, la philosophie, les lettres, envisage puis rejette les carrières de diplomate, de clerc de notaire et de bibliothécaire à la Mazarine (1891-1895). Ses passions, le plus souvent éphémères, débouchent parfois sur des amitiés durables, comme celle qui l’unit jusqu’à sa mort au compositeur Reynaldo Hahn. Une tenace assiduité aux salons de Mme Aubernon, de la comtesse Laure de Chevigné, de Madeleine Lemaire, de la princesse Mathilde et d’Anna de Noailles élargit le cercle de ses connaissances, aristocrates, femmes et hommes politiques, grands bourgeois et journalistes. En fait, il compte sur les relations nouées dans ces milieux pour s’introduire dans le grand monde. Il met parfois en œuvre la même stratégie auprès de ses amis Alfred Agostinelli, Antoine Bibesco, Léon Daudet, Bertrand de Fénelon, Robert de Montesquiou et amies la comtesse Cordélia Greffulhe, Laure Hayman, Louisa de Mornand, Marie Nordlinger et Jeanne Pouquet.
Le grand œuvre de la Recherche
Le jeune Proust témoigne d’une étonnante érudition. À dix-sept ans, dans un échange de correspondance il conseille à son camarade Daniel Halévy : « Lisez Homère, Platon, Lucrèce, Virgile, Tacite, Shakespeare, Shelley, Emerson, Goethe, La Fontaine, Racine, Villon, Théophile Gautier, Bossuet, La Bruyère, Descartes, Montesquieu, Rousseau, Diderot, Flaubert, Sainte-Beuve, Baudelaire, Renan, France. » Admiratif des écrits de George Sand, Augustin Thierry et George Eliot, il est aussi à l’aise en peinture (il apprécie Ernest Meissonier) qu’en musique (il aime à citer Gounod, Mozart et Wagner). En 1896, à vingt-cinq ans, il publie, en édition de luxe, chez Calmann-Lévy, son premier ouvrage, « Les Plaisirs et les Jours ». Préfacé par Anatole France, ce recueil de nouvelles, d’essais et de vers est accompagné des dessins de Madeleine Lemaire et de la musique de Reynaldo Hahn. Ardent dreyfusard, il se joint aux intellectuels qui demandent la révision du procès du capitaine Alfred Dreyfus le 14 janvier 1898. « Même en désaccord avec la ligne des socialistes anticléricaux, prétend l’auteur, Proust se classe sans ambiguïté parmi les socialistes en disant "nous". Il l’est par souci de justice, et c’est au nom de la justice qu’il accorde au christianisme, malgré ses "dangers", un droit à l’existence et à la liberté que lui contestent ses amis. » En 1899, il établit une étude sur l’œuvre de l’historien anglais John Ruskin, spécialiste d’architecture religieuse dont il préface et traduit certains ouvrages (dont La Bible d’Amiens). Aux Plaisirs et les jours succèdent « Jean Santeuil », ouvrage autobiographique (1896 à 1902) et « Contre Sainte-Beuve » (dès 1908) : aucun des deux ne sera publié de son vivant.
Premier volume d’« À la recherche du temps perdu », « Du côté de chez Swann », parut en 1913, publié à compte d’auteur chez l’éditeur Bernard Grasset. Deuxième volume de la Recherche, « À l’ombre des jeunes filles en fleurs » (1919) obtint le prix Goncourt, à 6 voix contre 4 qui allèrent aux Croix de bois de Roland Dorgelès. Suivirent « Le Côté de Guermantes » (1921) - dédié à Léon Daudet-, « Sodome et Gomorrhe » (1922) et, après son décès, « La Prisonnière » (1923), « Albertine disparue » (1925) et « Le Temps retrouvé » (1927). Mort d’une pneumonie le 18 novembre 1922, à 51 ans, Marcel Proust ne peut mener à bien la révision des derniers volumes d’« À la recherche du temps perdu » (écrits entre 1906 et 1911) : la publication posthume en est assurée par son frère Robert qui, aidé par Jacques Rivière et Jean Paulhan, à la tête de la Nouvelle Revue française, fait paraître « La Prisonnière », « Albertine disparue » et « Le Temps retrouvé ». « Proust n’avait pas manifesté de volonté pour ses obsèques, indique R. Duchêne. "Bien, dit son frère. Je ferai ce que nous avions fait tous deux pour nos parents." Céleste [Albaret, gouvernante de l’écrivain] s’est trompée en rapportant ces paroles. Adrien seul avait eu des funérailles catholiques. Celles de Marcel eurent lieu quatre jours après sa mort, le 22. Les amis eurent le temps de défiler (Léon Daudet accourut le premier), Helleu, Dunoyer de Segonzac de le dessiner, Man Ray de le photographier. La cérémonie se déroula à Saint-Pierre-de-Chaillot, sa paroisse. L’abbé Delouve prononça son oraison funèbre et donna l’absoute. On joua Pavane pour une infante défunte [de Maurice Ravel]. "Trop de tentures, trop de cierges, trop de musique, écrit Daniel Halévy. Mais il n’aurait pas trouvé que c’était trop." »
Roger Duchêne © Photo Louis Monier, droits réservés
- Marcel Proust sans masque, par Roger Duchêne, préface d’Hervé Duchêne, Le Passeur éditeur, 1160 pages, 2022.





