Les Papiers collés
de Claude Darras
Hiver 2023-2024
Carnet : Mains d’ouvriers
Les morts : leurs mains d’ouvriers : les belles mains, les mains qui savent tordre les aciers et cueillir une rose.
(Jules Mougin, « Usines, récits de jeunesse », éditions Plein Chant, 53 pages, 1975)
Écrire
Ce que j’ai appris, c’est qu’il est plus difficile d’écrire simplement qu’hermétiquement. L’hermétique doit être absorbé par le simple. Hölderlin le savait. Et Artaud.
(Georges Perros, « Échancrures 1977 », Œuvres, Quarto Gallimard, 2017)
Un délicat exercice
Il est toujours délicat d’écrire sur les ouvrages de prosateurs amis. Une règle et une seule s’impose : veiller à ce que la complaisance n’émousse pas le sens critique, l’accord de la conscience et de l’intégrité en somme.
La vérité, rien que la vérité !
Les écrits de Platon contiennent toute la philosophie. Nous nous en rendons compte lorsque nous relisons certains des dialogues de la République ou du Parménide et que nous prenons conscience de la difficulté de séparer l’ivraie du bon grain, c’est-à-dire de découvrir la vérité. Ce questionnement perpétuel fonde la conception du philosophe athénien, une recherche qui sous-tend une analyse logique parfois impitoyable.
L’épopée malrucienne
Avec La Condition humaine, André Malraux a fait sortir le roman des habitudes intimistes, petites-bourgeoises et provinciales où l’avaient relégué les Gide, les Chardonne et les Maurois. L’écrivain et journaliste Renaud Matignon (1935-1998) a émis en une boutade l’avis le plus pertinent sur le style malrucien : « C’est l’épopée, transmise par une dépêche d’agence. » Son collègue Claude Duneton, historien de la langue de surcroît, manifestait le même enthousiasme : « dans l’œuvre malrucienne, disait-il, la volonté du grandiose passe par le récit brutal des faits, par la rapidité, la concision d’une écriture sans ornement. »
(Vendredi 20 octobre 2023)
L’anecdote de l’œuf
Dans son Essai sur les mœurs et l’esprit des nations, Voltaire popularise de sa plume élégante l’anecdote de l’œuf. Envieux de sa réussite, des interlocuteurs de Christophe Colomb prétendaient que rien n’était plus facile que les découvertes qu’il avait effectuées. Aussi leur proposa-t-il de faire tenir un œuf debout. Comme aucun n’y parvenait, il cassa le bout de l’œuf, et le fit tenir. Cela était trop simple, rétorquent les assistants. Que ne vous en avisiez-vous donc ? répondit Colombo. Ce conte est rapporté du grand artiste Brunelleschi, qui réforma l’architecture à Florence longtemps avant que le navigateur génois existât.
(Samedi 21 octobre 2023)
|
Billet d’humeur
Hugues Capet, ancêtre d’Emmanuel Macron ?
Des paysans, un ébéniste et un bourrelier dans la Somme, des charpentiers, un couple d’épiciers et des cultivateurs en Bigorre : issu de la bourgeoisie picarde, le 25e président de la République française (né à Amiens le 21 décembre 1977) plonge ses racines à Abbeville, côté paternel, et à Argelès-Bagnères, par sa mère, Françoise Noguès (Nevers, 1939), médecin-conseil à la Sécurité sociale. Le généalogiste Jean-Louis Beaucarnot (Saint-Symphorien-de-Marmagne, 1953) a situé le plus ancien berceau des Macron à Authie, un village de 300 âmes aux confins de la Somme et du Pas-de-Calais. C’est là que les chercheurs ont remonté sa filiation jusqu’à un certain François Macron, ouvrier maçon, né sous le règne d’Henri IV au XVIe siècle. De la profession de manœuvre à l’enseignement médical, l’ascenseur social a doré le blason familial en trois générations avec le père du président, Jean-Michel Macron (Amiens, 1949), professeur de neurologie à Amiens. La branche paternelle porte même un aïeul anglais, George William Roberson, né en 1887 à Bristol, qui sera boucher à Abbeville puis hôtelier à Amiens, avant de divorcer après neuf ans de mariage d’avec Suzanne Leblond, l’arrière-grand-mère du chef de l’État. Autre singulière anecdote, par ses ancêtres de la branche Leblond, les Le Vaillant, seigneurs du Buisson et de la Pucelle, à Douai (Nord), Emmanuel Macron descendrait du fondateur de la dynastie des capétiens, le roi des Francs Hugues Capet (vers 939-996). Plus pittoresques trouvailles aux branches de la généalogie macronienne, les registres paroissiaux ont révélé la présence d’ascendants nommés Courtecuisse, Dugland et Nibard ainsi qu’une longue lignée de Bosseur (à Launoy, dans l’Aisne) !
|
Lecture critique
Dany Rousson aux confins de l’enfance
 Dans « Les Ricochets de la vie », entre Gard et Vaucluse, Dany Rousson fait entendre une douce mélopée, celle d’un monde qui n’est plus, aux confins de l’enfance et des souvenirs enfuis. Ainsi, à la lancinante rotation des roues à aube chassant l’eau de la Sorgue se mêle la résurgence, heureuse et mélancolique, des moments de vie vécus par Max Constantin, cet ancien cordonnier natif de Lussan (Gard), qui coule depuis 1947 une retraite banale à l’Isle-sur-la-Sorgue aux côtés de Jacquotte sa femme, et de Vénus, son épagneul breton. Aux vacances estivales de 1986, le cercle de famille se reforme avec la venue de leurs petits-enfants, Nans (onze ans) et Fanny (six ans), exilés à Lille en raison de l’activité de leurs parents, Bertrand et Nelly Lecœur. Au fil du temps et des confidences, on apprend que Nelly s’est éloignée de ses parents, au propre comme au figuré, et que Max a nourri jadis une relation adultérine avec Christy Mac Gregor, une sculptrice écossaise. Nans découvre que son grand-père cache, sous le pseudonyme de Jamax, une notoriété de peintre académique. La remémoration est parfois douloureuse mais elle permet aussi de recoller les morceaux d’une relation familiale meurtrie - avec notamment l’aide de Christophe, le frère de Nelly, surnommé « tonton Cristobal » par ses neveux. Dans « Les Ricochets de la vie », entre Gard et Vaucluse, Dany Rousson fait entendre une douce mélopée, celle d’un monde qui n’est plus, aux confins de l’enfance et des souvenirs enfuis. Ainsi, à la lancinante rotation des roues à aube chassant l’eau de la Sorgue se mêle la résurgence, heureuse et mélancolique, des moments de vie vécus par Max Constantin, cet ancien cordonnier natif de Lussan (Gard), qui coule depuis 1947 une retraite banale à l’Isle-sur-la-Sorgue aux côtés de Jacquotte sa femme, et de Vénus, son épagneul breton. Aux vacances estivales de 1986, le cercle de famille se reforme avec la venue de leurs petits-enfants, Nans (onze ans) et Fanny (six ans), exilés à Lille en raison de l’activité de leurs parents, Bertrand et Nelly Lecœur. Au fil du temps et des confidences, on apprend que Nelly s’est éloignée de ses parents, au propre comme au figuré, et que Max a nourri jadis une relation adultérine avec Christy Mac Gregor, une sculptrice écossaise. Nans découvre que son grand-père cache, sous le pseudonyme de Jamax, une notoriété de peintre académique. La remémoration est parfois douloureuse mais elle permet aussi de recoller les morceaux d’une relation familiale meurtrie - avec notamment l’aide de Christophe, le frère de Nelly, surnommé « tonton Cristobal » par ses neveux.
Ce roman est une sorte d’expérience proustienne : à l’exemple de certains personnages de la fable familiale, le lecteur est triste et comblé et, d’un autre côté, cela prouve qu’on avait perdu quelque chose. L’auteure a le goût - une fringale ! - du paysage et de la simplicité. Ainsi, évoquant l’Isle-sur-la-Sorgue : « Dès l’entrée, la vue s’ouvrait sur le canal bordé de fleurs, où dix-sept roues à aubes envahies par la mousse rappelaient, tout au long des quais, les vestiges d’une industrie textile autrefois florissante. Dans cette ancienne cité de pêcheurs, la douceur de vivre, de flâner dans les ruelles pavées, de traverser les ponts romantiques donnait l’impression que le temps était suspendu. Vivre ici était un privilège que l’ancien cordonnier ne reniait pas. Jacquotte disait de la Venise comtadine que c’était le plus bel endroit du monde. Bien que ce soit un peu chauvin, il fallait lui reconnaître un air de paradis ». Elle donne en outre un bon aperçu de l’acuité de sa vision et de la justesse de ses souvenirs, avec un indéniable talent pour attraper l’ineffable des jeux enfantins : 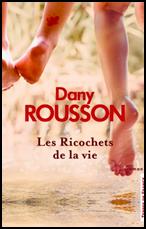 « Elles étaient parfaites. Leur taille, leur poids et leur surface si lisse qu’elles semblaient avoir été polies… Les pierres de ricochets […]. Le matin, Max avait vu son petit-fils faire des ricochets avec peu de réussite. Alors, il lui avait enseigné l’importance du choix de la pierre et de la position du corps lors du jet. Un exercice qui paraissait simple mais qui ne l’était pas tant que cela. Joignant le geste à la parole, il réussit un ricochet de dix impacts, puis un autre de douze. Nans n’en revenait pas. Aussitôt, il avait souhaité en faire autant, mais son grand-père avait expliqué que tout était affaire d’entraînement et de patience. Trouver les bonnes pierres sur les berges de la rivière, puis essayer encore et encore sans se décourager jusqu’à trouver le geste parfait. » « Elles étaient parfaites. Leur taille, leur poids et leur surface si lisse qu’elles semblaient avoir été polies… Les pierres de ricochets […]. Le matin, Max avait vu son petit-fils faire des ricochets avec peu de réussite. Alors, il lui avait enseigné l’importance du choix de la pierre et de la position du corps lors du jet. Un exercice qui paraissait simple mais qui ne l’était pas tant que cela. Joignant le geste à la parole, il réussit un ricochet de dix impacts, puis un autre de douze. Nans n’en revenait pas. Aussitôt, il avait souhaité en faire autant, mais son grand-père avait expliqué que tout était affaire d’entraînement et de patience. Trouver les bonnes pierres sur les berges de la rivière, puis essayer encore et encore sans se décourager jusqu’à trouver le geste parfait. »
Dany Rousson © Photo Lisa Sanchez, droits réservés
- Les Ricochets de la vie, par Dany Rousson, Les Presses de la cité, collection Terres de France, 320 pages, 2022.
Portrait
Quand Max Aub invente un peintre catalan
 Jusep Torres Campalans prétend que le développement spectaculaire de l’aviation l’a amené à échafauder les principes du cubisme. Quelques mois avant le vol historique de l’aviateur américain Wilbur Wright, le 21 septembre 1908, le peintre et théoricien confesse qu’« il y a là de nouvelles perspectives : les maisons apparaîtront comme des cubes, les champs comme des rectangles… ». De cette réflexion naquit le mot « cubisme », en conclut Max Aub (Paris, 2 juin 1903-Mexico, 22 juillet 1972) dans la biographie qu’il consacre à l’artiste catalan et anarchiste, intime de Pablo Picasso mais détracteur de Juan Gris et de Georges Braque, proche de Rainer Maria Rilke et de Guillaume Apollinaire. Bien qu’il soit l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages publiés dès 1925 (poèmes, contes, romans, théâtre, nouvelles, revues…) et dont plusieurs se rapportent à la guerre d’Espagne, Max Aub Mohrenwitz est méconnu dans son pays natal où seuls cinq de ses ouvrages ont été traduits en français : Les Bonnes Intentions, Crimes exemplaires, Manuscrit Corbeau, Jusep Torres Campalans et Dernières Nouvelles de la guerre d’Espagne. Notons cependant que Fable verte a été publiée en français à Bruxelles, en 1937. Jusep Torres Campalans prétend que le développement spectaculaire de l’aviation l’a amené à échafauder les principes du cubisme. Quelques mois avant le vol historique de l’aviateur américain Wilbur Wright, le 21 septembre 1908, le peintre et théoricien confesse qu’« il y a là de nouvelles perspectives : les maisons apparaîtront comme des cubes, les champs comme des rectangles… ». De cette réflexion naquit le mot « cubisme », en conclut Max Aub (Paris, 2 juin 1903-Mexico, 22 juillet 1972) dans la biographie qu’il consacre à l’artiste catalan et anarchiste, intime de Pablo Picasso mais détracteur de Juan Gris et de Georges Braque, proche de Rainer Maria Rilke et de Guillaume Apollinaire. Bien qu’il soit l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages publiés dès 1925 (poèmes, contes, romans, théâtre, nouvelles, revues…) et dont plusieurs se rapportent à la guerre d’Espagne, Max Aub Mohrenwitz est méconnu dans son pays natal où seuls cinq de ses ouvrages ont été traduits en français : Les Bonnes Intentions, Crimes exemplaires, Manuscrit Corbeau, Jusep Torres Campalans et Dernières Nouvelles de la guerre d’Espagne. Notons cependant que Fable verte a été publiée en français à Bruxelles, en 1937.
Un écrivain aux quatre nationalités
Né à Paris en 1903, d’un père allemand et d’une mère française dont il prend la double nationalité, Max Aub doit à la guerre de 1914-1918 son identité espagnole, son père étant contraint de s’installer en Espagne dès 1914 afin de n’avoir pas à prendre les armes contre la France. Il poursuit ses études à Valence, puis à Madrid, où il prend part aux mouvements littéraires de l’époque et notamment aux cénacles liés au surréalisme. De la même génération que Bergamin, Bunuel, Dali et Garcia Lorca, il écrit des pièces de théâtre dont les premières seront jouées grâce au soutien de Jules Romains. En 1930, il est porté à la direction du théâtre universitaire de Valence.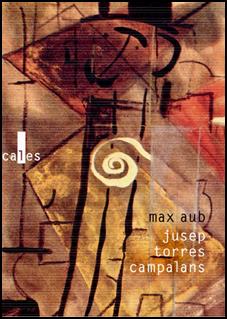 Il commence à écrire à la fin de la décennie 1930-1940 en espagnol. Durant la guerre civile, il est en poste d’attaché culturel du gouvernement républicain à l’ambassade d’Espagne à Paris, où, en 1937, il commande à Picasso une fresque pour l’Exposition universelle de la capitale : elle s’intitulera Guernica… Son journal révèle qu’il a rencontré à Paris plusieurs des amis connus en Espagne en 1936 ou après sa réinstallation à Paris en février 1939 : Louis Aragon, Jean Cassou, André Malraux et Tristan Tzara. En 1938-1939, il assiste André Malraux et Boris Peskine dans la réalisation du film de long métrage Espoir, sierra de Teruel, où il joue lui-même le rôle d’un aviateur allemand. En 1940, sur ordre du gouvernement de Vichy, il est interné au camp de Vernet (Pyrénées-Orientales), puis en Algérie, à Djelfa. En 1942, il embarque à Casablanca pour rejoindre Veracruz. Bientôt naturalisé mexicain, sa production littéraire, importante et reconnue, l’intègre parmi les écrivains espagnols qui comptent. Il publie des pièces de théâtre (San Juan, 1943 ; Mourir d’avoir fermé les yeux, 1945), la revue Sala de espera (littéralement « Salle d’attente », 1948-1951), une biographie, Jusep Torres Campalans (1958), des Contes mexicains (1959) et une série de romans sur la guerre civile (Le Labyrinthe magique, 1943-1968). Il commence à écrire à la fin de la décennie 1930-1940 en espagnol. Durant la guerre civile, il est en poste d’attaché culturel du gouvernement républicain à l’ambassade d’Espagne à Paris, où, en 1937, il commande à Picasso une fresque pour l’Exposition universelle de la capitale : elle s’intitulera Guernica… Son journal révèle qu’il a rencontré à Paris plusieurs des amis connus en Espagne en 1936 ou après sa réinstallation à Paris en février 1939 : Louis Aragon, Jean Cassou, André Malraux et Tristan Tzara. En 1938-1939, il assiste André Malraux et Boris Peskine dans la réalisation du film de long métrage Espoir, sierra de Teruel, où il joue lui-même le rôle d’un aviateur allemand. En 1940, sur ordre du gouvernement de Vichy, il est interné au camp de Vernet (Pyrénées-Orientales), puis en Algérie, à Djelfa. En 1942, il embarque à Casablanca pour rejoindre Veracruz. Bientôt naturalisé mexicain, sa production littéraire, importante et reconnue, l’intègre parmi les écrivains espagnols qui comptent. Il publie des pièces de théâtre (San Juan, 1943 ; Mourir d’avoir fermé les yeux, 1945), la revue Sala de espera (littéralement « Salle d’attente », 1948-1951), une biographie, Jusep Torres Campalans (1958), des Contes mexicains (1959) et une série de romans sur la guerre civile (Le Labyrinthe magique, 1943-1968).
« Les biographies sont toujours fausses… »
En 1949, il écrit pour le réalisateur Luis Buñuel le scénario de Los Olvidados (litt. « Les Oubliés »). Il s’attelle bientôt à la rédaction de la biographie du peintre catalan Jusep Torres Campalans (1886-1956) qu’il dit avoir rencontré dans le Chiapas en mars 1955. En réalité, Max Aub a inventé de toutes pièces Torres Campalans pour lequel il a rédigé une biographie imaginaire - mais donnée pour véridique - et produit plusieurs dizaines de dessins et de peintures, ceux-là même qui seront exposés à Mexico en 1958 (galerie Excelsior), à New York en 1962 (galerie Bodley) et à Madrid en 2003 (musée Reina Sofia). Aux cimaises du musée madrilène, les « fausses » œuvres de Jusep Torres Campalans voisinaient avec les « vrais » peintres de son entourage, Chagall, Gris, Matisse, Modigliani, Mondrian et Picasso ! Grâce à d’efficaces complicités (dont celles de Jean Cassou, Carlos Fuentes et André Malraux), la parution de l’ouvrage au Mexique et l’exposition qui l’avait accompagnée suscitent une multitude de réactions, d’articles et de commentaires. Dans l’ouvrage « Jusep Torres Campalans », l’invention se mêle si intimement aux faits réels, à l’actualité politique et artistique notamment, que beaucoup d’écrivains et d’historiens ou critiques d’art se demandèrent comment ils ne l’avaient jamais rencontré… Le canular connut à l’époque un grand retentissement et l’ouvrage fut traduit en français par Alice et Pierre Gascar en 1961 et publié par Claude Gallimard avec plusieurs dizaines d’illustrations de l’artiste fictif. En mars 1961, dialoguant avec la journaliste Nicole Zand (quotidien Libération), Max Aub précisait : « Pour moi il n'y a pas de frontière entre le réel et l'irréel. Campalans est un personnage de roman, et je veux qu'on le prenne pour tel. Dans un roman, on raconte une histoire, dans un tableau aussi. L'art, c'est de raconter une histoire. Plus ça ressemble à la vérité, mieux c'est. » Quelques jours plus tard, il expliquait à Pierre Joffroy, écrivain et journaliste : « Biographie ou roman ? J’hésitais entre les deux. Les biographies sont toujours fausses, et les romans toujours vrais… J’ai inventé une biographie. Et ma biographie est vraie précisément parce qu’elle est inventée. La preuve c’est que l’on s’y est trompé. »
Max Aub © Photo X, droits réservés
- Jusep Torres Campalans, par Max Aub, adapté de l’espagnol par Alice et Pierre Gascar, traduction revue par Lise Belperron, 68 reproductions d’œuvres, éditions Verticales, 336 pages, 2021.
Varia : parlez-vous sans-culotte ?
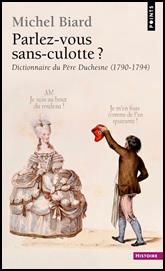 « An Quarante (s’en foutre comme de l’) « An Quarante (s’en foutre comme de l’)
« Comme on sait que je ne me contente pas de pareils mensonges et que je me fous comme de l’an quarante de leur eau bénite de cour […] » « […] qu’ils prêchent tant qu’ils voudront, dans les caves et dans les greniers et même dans des églises, qu’ils bâtiront ou qu’ils achèteront, pourvu que cela ne soit pas public, je m’en fous tout comme de l’an quarante ; mais les coquins ne s’en tiendront pas là. »
« S’en désintéresser totalement, s’en moquer. Ainsi, dans les passages ci-dessus, le Père Duchesne se "fout" successivement de l’"eau bénite de cour" que lui servent le roi et son entourage, puis des prêtres hostiles à la Révolution […].Si le sens de l’expression très tôt maniée par Hébert est donc limpide, en revanche, son origine est beaucoup plus discutée. Parmi de multiples explications (pour beaucoup fantaisistes), on notera que certaines penchent pour une déformation de l’expression populaire "s’en moquer comme de l’Alcoran", tandis que d’autres évoquent de façon plus simple une référence à une année. Mais laquelle ? L’an 40 en rapport avec le christianisme primitif ? 1040 et des motifs eschatologiques ? 1740, année de crise terrible en France ? 40 étant également un chiffre à symbolique religieuse (les quarante jours du déluge, les quarante heures du Christ au tombeau…), il est possible que l’expression puisse avoir un sens hostile aux superstitions à propos de ce chiffre. Quoi qu’il en soit, les Français du XXIe siècle qui emploient toujours cette formule et pensent souvent à une référence à l’année 1940 sont assurément sur une bien mauvaise piste. »
Extrait de l’ouvrage de Michel Biard, « Parlez-vous sans-culotte ? Dictionnaire du Père Duchesne (1790-1794 », éditions Points, 672 pages, 2011.
Carnet : éternel Orient
La ressemblance de certaines étapes orientales actuelles avec les rêves des orientalistes tient à ce que rien n’y a changé depuis longtemps, depuis les origines.
Le casse-tête de la biographie
Comment raconter une vie ? En commençant par les derniers jours du personnage ? Par ses premières amours ? En analysant ses faits ou œuvres les plus marquants ? « Quelle vie absurde qu’une biographie ! », soupirait le poète et romancier Pierre Louÿs (1870-1925). Il avait eu sans doute à le déplorer lui-même…
(Jeudi 9 novembre 2023)
Barbaries intégristes
Tristesse des croyances actuelles qui inclinent parfois à l’instrumentalisation politique de la religion. Les dieux des uns et des autres caricaturent l’histoire et les écritures, déforment les regards, agressent les consciences, alimentent les stéréotypes, nourrissent les barbaries intégristes de chaque camp. Vengeance et punition plutôt que miséricorde et pardon.
L’espace du désir et du mensonge
Selon l’écrivain italien Antonio Tabucchi (1943-2012), « Un voyage n’est qu’un alibi, peut-être une "occasion" comme dirait Eugenio Montale. Et puis, les voyages, comme toutes les choses qui agissent sur la mémoire, suscitent des souvenirs aussi faux que trompeurs, ils sont comme un désir vécu dans le passé. Mes voyages ne sont pas dignes de foi, ils fréquentent l’espace du désir et du mensonge. »
(Vendredi 10 novembre 2023)
La couleur de l’âme
Très souvent, dans ses écrits et dans ses lettres, Bernard Clavel (1923-2010) en appelait aux sentences de Jean Guéhenno (1890-1978). Il répétait souvent cette maxime de l’écrivain et critique breton : « Les impressions d’enfance marquent la couleur de l’âme ».
Rester soi-même
Le plus difficile dans l’écriture, c’est de rester soi-même quand on est traversé par les mille écritures des autres.
(Samedi 11 novembre 2023)
|
Billet d’humeur
À mille pieds sous terre
Des zoologistes américains (université de Blacksburg) et australiens (universités de Sydney et Melbourne) ont identifié le premier myriapode à posséder plus de mille pattes. Diplopode de la famille des siphonotidae (15 genres et une quarantaine d’espèces), l’Eumillipes persephone a été découvert à 60 mètres de profondeur dans un puits de forage minier des Eastern Goldfields, à 100 km de Norseman, une ville du sud de l’Australie occidentale. Littéralement « vrai mille-pieds », l’animal se réfère à Perséphone, fille de Zeus et Déméter qu’enleva Hadès, le maître des Enfers dans la mythologie grecque. L’animal ressemble à une ficelle d’à peine un millimètre de diamètre et mesure près de 10 centimètres de long. Il possède entre 198 et 330 diplo-segments et jusqu'à 1 306 pieds, ce qui en fait l'espèce au plus grand nombre de pattes et la première à en avoir 1 000 ou plus. Le mille-pattes perséphone a un exosquelette de couleur crème, des antennes imposantes, un bec pour se nourrir. Selon les chercheurs, sa forme allongée, la multiplicité de ses pieds et son absence d’yeux résultent d’une convergence évolutive avec une autre espèce, Illacme plenipes, qui détenait avant 2020 le record du nombre de pattes (750). L’espèce joue un rôle vital dans les écosystèmes qu’elle habite en mangeant des détritus et en recyclant les nutriments qu’elle ingère, plus spécialement toutes sortes de levures (champignons unicellulaires). Elle a, semble-t-il, recolonisé des cavités artificielles dans un sous-sol riche en minerai de fer et en roches volcaniques, milieu susceptible d’héberger une faune troglophile et cavernicole intéressante mais mal connue. Dans la région où ces mille-pattes ont été trouvés, la température en surface dépasse les 46°C et les précipitations sont inférieures à 300 millilitres par an. En revanche, à la profondeur à laquelle où ils ont été repérés, la température de l’eau n’excède jamais les 22°C. Selon les scientifiques, la date d’apparition des mille-pattes sur terre se situerait entre 15 et 1,5 million d’années : certaines espèces aujourd’hui éteintes dépassaient les deux mètres de long.
|
Lecture critique
La drôle de guerre des dictionnaires
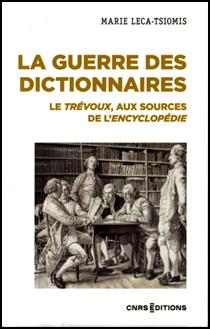 Avec les XVIIe et XVIIIe siècles, la France érudite entre dans l’âge des dictionnaires. L’un des plus importants d’entre eux fut le Dictionnaire de Trévoux, originellement nommé le Dictionnaire universel français et latin, qui se développa durant des décennies, de 1704 à 1771. La châtellenie de Trévoux, dans la Dombes (aujourd’hui dans l’Ain), n’est pas peu fière de ses presses qui éditent dès 1701 les Mémoires pour l’histoire des sciences et des beaux-arts, dits de Trévoux, puis à partir de 1704, le Dictionnaire universel français et latin. Lesdits Mémoires projettent en 1701 la publication du premier Dictionnaire de Trévoux mis au point par un collectif constitué en majorité de jésuites. « Lorsque parut à Trévoux, en 1704, un dictionnaire en trois volumes, intitulé "Dictionnaire universel français et latin", explique Marie Leca-Tsiomis, il s’agissait du pillage du Furetière revu par Basnage de Bauval [Henri, 1657-1710], mais cette fois sans aucun nom d’auteur. À aucun moment l’ouvrage plagié n’était cité et le dictionnaire était même présenté comme un travail original, conçu par le duc du Maine [Louis-Auguste de Bourbon, prince de Dombes, 1670-1736] et exécuté à son instigation et sous sa direction… » Professeur émérite à l’université Paris-Nanterre et spécialiste de l’Encyclopédie, à laquelle elle a consacré plusieurs études, l’auteure de « La Guerre des dictionnaires » a mené une longue et minutieuse enquête afin de reconstituer la chronologie des événements qui ont ponctué l’histoire de ce dictionnaire et des débats véhéments – conflits commerciaux, spirituels et idéologiques - qui ont opposé, entre France et Pays-Bas, lexicographes catholiques et auteurs réformés. Avec les XVIIe et XVIIIe siècles, la France érudite entre dans l’âge des dictionnaires. L’un des plus importants d’entre eux fut le Dictionnaire de Trévoux, originellement nommé le Dictionnaire universel français et latin, qui se développa durant des décennies, de 1704 à 1771. La châtellenie de Trévoux, dans la Dombes (aujourd’hui dans l’Ain), n’est pas peu fière de ses presses qui éditent dès 1701 les Mémoires pour l’histoire des sciences et des beaux-arts, dits de Trévoux, puis à partir de 1704, le Dictionnaire universel français et latin. Lesdits Mémoires projettent en 1701 la publication du premier Dictionnaire de Trévoux mis au point par un collectif constitué en majorité de jésuites. « Lorsque parut à Trévoux, en 1704, un dictionnaire en trois volumes, intitulé "Dictionnaire universel français et latin", explique Marie Leca-Tsiomis, il s’agissait du pillage du Furetière revu par Basnage de Bauval [Henri, 1657-1710], mais cette fois sans aucun nom d’auteur. À aucun moment l’ouvrage plagié n’était cité et le dictionnaire était même présenté comme un travail original, conçu par le duc du Maine [Louis-Auguste de Bourbon, prince de Dombes, 1670-1736] et exécuté à son instigation et sous sa direction… » Professeur émérite à l’université Paris-Nanterre et spécialiste de l’Encyclopédie, à laquelle elle a consacré plusieurs études, l’auteure de « La Guerre des dictionnaires » a mené une longue et minutieuse enquête afin de reconstituer la chronologie des événements qui ont ponctué l’histoire de ce dictionnaire et des débats véhéments – conflits commerciaux, spirituels et idéologiques - qui ont opposé, entre France et Pays-Bas, lexicographes catholiques et auteurs réformés.
Abbé de Chalivoy, Antoine Furetière (1619-1688) édita en 1690 un dictionnaire de langue de très grande ampleur qui dépassait tous les dictionnaires jusque-là publiés, y compris le Dictionnaire français de César-Pierre Richelet (1626-1698) ainsi que le projet de dictionnaire de l’Académie française. « Furetière offrait en trois volumes in-folio, explique Marie Leca-Tsiomis, un dictionnaire intégrant la langue populaire et la langue ancienne, mais aussi un recueil "universel", c’est-à-dire ouvert à la langue des sciences et des arts : en un temps où la rivalité avec le latin était encore forte, cette somme universelle marqua une étape importante dans le développement et la diffusion de la langue française. »
Ouvrage de compilation par nature, le dictionnaire suscita dès le XVIIIe s. débats et procès, les lexicographes, français et hollandais en l’occurrence, s’accusant mutuellement de pillage ou de plagiat : « dans la chronologie de la guerre des "Dictionnaires Universels" de langue française, à l’"Universel de Trévoux" de 1704 répliqua le dictionnaire de Basnage de 1708 ; puis parut le "Trévoux" de 1721 et, en 1725 et 1727, le dernier "Universel" hollandais, de Brutel de la Rivière [Jean-Baptiste, 1669-1742]. » Les lexicographes anglais ont eux aussi voix au chapitre dans cette « bataille des savoirs ». Ainsi s’accordait-on à dire que l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des arts et des métiers dérivait de la Cyclopædia d’Ephraïm Chambers (1680-1740). Mais, ce qu’on ignorait, apprend-on au fil de l’ouvrage, c’est que cette Cyclopædia or, an Universal Dictionary (Londres, 1728)avait largement puisé aux dictionnaires en langue française publiés dans les années 1720 : « Ce qui fait que lorsque les encyclopédistes se mirent au travail, ils héritèrent d’une traduction de l’ouvrage anglais qui, à leur grande surprise, provenait souvent lui-même d’ouvrages en français… Quels ouvrages ? Dans l’enchevêtrement des diverses sources qui donnèrent naissance aux grands dictionnaires du temps, Chambers avait clairement nommé ses prédécesseurs, au premier rang desquels : "the abbé Furetière, the editors of Trévoux, Savary, etc." ».
Brassant tout à la fois des connaissances relatives au vocabulaire, à la philologie, à l’histoire, à la géographie, à la physique, à la médecine, à la botanique, à la mécanique, à la métaphysique et à la théologie, le Dictionnaire de Trévoux préfigurait avantageusement la fameuse « Encyclopédie » dont le premier tome parut en 1751 (conduit par Diderot et d’Alembert). Véritable « Dictionnaire universel », il connut une prestigieuse descendance, notamment en 1863 avec le « Grand Dictionnaire » de Pierre Larousse dont le quinzième et dernier volume fut publié en 1876, un an après le décès de l’éditeur.
- La Guerre des dictionnaires - Le "Trévoux", aux sources de l’"Encyclopédie", par Marie Leca-Tsiomis, CNRS éditions, 232 pages, 2023
Portrait
Peintres de marines, une rétrospective de quatre siècles
Utile précision de Denis-Michel Boëll (né en 1951) en préambule de l’ouvrage « Les Peintres de marines - du XVIIe au XXe siècle », « Le genre de la marine naît bien avant que le terme ne fasse son entrée dans le "Dictionnaire" de l’Académie française, en 1762. Les scènes de ports et de navigation abondent au Moyen Âge dans l’enluminure, comme dans la tapisserie. À la Renaissance, en Flandre puis en Italie, les paysages peints s’ouvrent vers les lointains mais dans notre pays, seuls les cartographes se tournent vers l’horizon marin. Alors qu’au XVIIe siècle, la peinture de marine connaît une exceptionnelle floraison aux Pays-Bas, avant de s’exporter en Angleterre, elle ne franchit les portes de notre Académie que par l’admission d’une poignée d’artistes immigrés. Puis le pouvoir royal s’adresse à un Provençal installé depuis vingt ans en Italie, Claude-Joseph Vernet, qui donne au paysage portuaire ses lettres de noblesse. L’âge d’or de la peinture de marine en France va durer un siècle et demi. » Conservateur général du Patrimoine et directeur-adjoint du musée national de la Marine, l’auteur de ce magnifique ouvrage a pris le parti, pour étayer son argumentation, de choisir un peu plus de cent cinquante artistes au gré de quatre siècles se rapportant à l’histoire européenne de l’art maritime.
Le Lorrain, un précurseur
Dans l’Europe moyenâgeuse, les moines copistes embellissent les manuscrits au travers de l’enluminure : le Déluge et l’Arche de Noé, Daniel dans la fosse aux lions, La charité de Saint-Martin, Jonas jeté dans la gueule de la baleine comptent parmi les thèmes de l’imagerie, le plus souvent inspirée de la Bible. Les vies de saints en particulier sont joliment éclairées par de savants enlumineurs 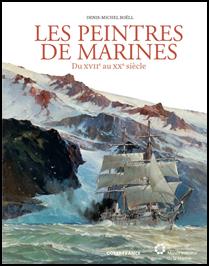 qui exploitent notamment la Légende dorée de Jacques de Voragine au XIIIe s. : « Deux épisodes de la vie de saint Nicolas donnent lieu à des figurations nautiques : le miracle des grains de blé, qui se renouvellent dans la cale des navires que l’évêque de Myre a fait décharger pour sauver la population de la famine, et le sauvetage d’un équipage pris dans la tempête à l’approche des côtes de Lycie. » Beaucoup plus tard, en Belgique, le premier mariniste anversois Andries Van Eertvelt (1590-1652) livre un tumultueux Combat naval de Lépante. Au XVIIe s., aux Pays-Bas, l’essor de la peinture de marine coïncide avec l’ascension économique et politique des Provinces-Unies qui se sont soustraites de la tutelle espagnole au siècle précédent. C’est un peintre néerlandais, Caspar Van Wittel (1653-1736), qui est un des initiateurs en Italie du veduta, ou védutisme, qui concerne la représentation perspective de paysages urbains parmi lesquels les cités côtières et la batellerie fluviale (Vue du môle avec la Piazzetta et le palais des Doges, 1697, musée du Prado). Citons, entre autres marinistes et dans les tonalités grises, argentées, ocres ou brunes, le délicat Jan Porcellis (1584-1632) et le maître des paysages aquatiques Jan Van Goyen (1596-1656). Évoquant Claude Gellée, dit « le Lorrain » (1600-1682), D.-M. Boëll considère que « tout artificiels qu’ils paraissent, ces paysages portuaires, par leur construction classique et par leurs effets d’atmosphère sereine, vont exercer une influence, au long des siècles suivants, tant sur Joseph Vernet [1714-1789] que sur Joseph Mallord William Turner [1775-1851], le maître romantique des paysages marins qui se dissolvent dans une lumière pré-impressionniste ». qui exploitent notamment la Légende dorée de Jacques de Voragine au XIIIe s. : « Deux épisodes de la vie de saint Nicolas donnent lieu à des figurations nautiques : le miracle des grains de blé, qui se renouvellent dans la cale des navires que l’évêque de Myre a fait décharger pour sauver la population de la famine, et le sauvetage d’un équipage pris dans la tempête à l’approche des côtes de Lycie. » Beaucoup plus tard, en Belgique, le premier mariniste anversois Andries Van Eertvelt (1590-1652) livre un tumultueux Combat naval de Lépante. Au XVIIe s., aux Pays-Bas, l’essor de la peinture de marine coïncide avec l’ascension économique et politique des Provinces-Unies qui se sont soustraites de la tutelle espagnole au siècle précédent. C’est un peintre néerlandais, Caspar Van Wittel (1653-1736), qui est un des initiateurs en Italie du veduta, ou védutisme, qui concerne la représentation perspective de paysages urbains parmi lesquels les cités côtières et la batellerie fluviale (Vue du môle avec la Piazzetta et le palais des Doges, 1697, musée du Prado). Citons, entre autres marinistes et dans les tonalités grises, argentées, ocres ou brunes, le délicat Jan Porcellis (1584-1632) et le maître des paysages aquatiques Jan Van Goyen (1596-1656). Évoquant Claude Gellée, dit « le Lorrain » (1600-1682), D.-M. Boëll considère que « tout artificiels qu’ils paraissent, ces paysages portuaires, par leur construction classique et par leurs effets d’atmosphère sereine, vont exercer une influence, au long des siècles suivants, tant sur Joseph Vernet [1714-1789] que sur Joseph Mallord William Turner [1775-1851], le maître romantique des paysages marins qui se dissolvent dans une lumière pré-impressionniste ».
Le cénacle officiel des marinistes
Académicien sous Louis XVI, Jean-François Hüe (1751-1823) est chargé en 1791 par l’Assemblée constituante de continuer la collection des ports de France initiée par Joseph Vernet. Les décennies suivantes, plusieurs artistes manifestent leur talent ou leur originalité dans la peinture de marines : Ambroise Louis Garneray (1783-1857) qui est le premier à montrer les activités des marins pêcheurs ; le baron Théodore Gudin (1802-1880) qui a vécu lui-même la vie des gens de mer ; Théodore Géricault (1791-1824) qui prend pour héros des gens ordinaires ; Eugène Isabey (1803-1886) qui met en scène chalutier, brick ou aviso ; Eugène Le Poittevin (1806-1870), un des inventeurs d’Étretat comme lieu de villégiature ; François-Edmond Pâris (1806-1893) qui a jeté les bases de l’ethnographie nautique ; Félix Ziem (1821-1911) que la recherche des effets de lumière sur l’eau a fait qualifier de pré impressionniste ; Gustave Caillebotte (1848-1894)  qui se représente à la barre du Roasbeef, dont il a dessiné les plans, et François Barry (1813-1905) qui exerçait le métier de… coiffeur. D’autres peintres méritent d’être cités, tels Richard Parkes Bonington (1802-1828), Johan Barthold Jongkind (1819-1891), Gustave Courbet (1819-1877), Eugène Boudin (1824-1898), Édouard Manet (1832-1883), Claude Monet (1840-1926), Georges Seurat (1859-1891) ou Mathurin Méheut (1882-1958). Depuis 1830, les peintres de la Marine disposent d’un cénacle officiel institué par les plus hautes autorités de l’État. Le corps des « peintres de la Marine » honore en quelque sorte l’attachement et les services rendus par les plus remarquables d’entre eux à la Marine, successivement royale, impériale ou républicaine. En 1941 est institué un Salon de la Marine qui promeut les œuvres des peintres appartenant à cette « corporation » et d’artistes candidats à les rejoindre. Parmi les peintres nommés, nous remarquons Marin-Marie (1901-1987) membre du corps en 1934, Roger Chapelet (1903-1995) et Albert Brenet (1903-2005), tous deux nommés en 1936, ainsi que Charles Lapicque (1898-1988) titulaire du titre en 1948. La peinture et le dessin sont les vecteurs les plus couramment utilisés par ces marinistes dont certains parfois illustrent des ouvrages de bibliophilie ou des journaux, créent des affiches illustrées, développent des bandes dessinées ou recourent à la photographie. Depuis l’aube du XXe s., ces peintres ou plasticiens nous épatent avec des panoramas brassés d’écume, de mémorables batailles navales, des naufrages apocalyptiques et des répliques de sardiniers bretons. Passionnés de navigation, le plancher des vaches leur bouge sous les pieds, sachons gré à Denis-Michel Boëll de nous avoir raconté leur histoire, qu’ils se réclament de mouvements aussi différents que le néo-impressionnisme, le fauvisme, l’abstraction ou l’art vidéo. qui se représente à la barre du Roasbeef, dont il a dessiné les plans, et François Barry (1813-1905) qui exerçait le métier de… coiffeur. D’autres peintres méritent d’être cités, tels Richard Parkes Bonington (1802-1828), Johan Barthold Jongkind (1819-1891), Gustave Courbet (1819-1877), Eugène Boudin (1824-1898), Édouard Manet (1832-1883), Claude Monet (1840-1926), Georges Seurat (1859-1891) ou Mathurin Méheut (1882-1958). Depuis 1830, les peintres de la Marine disposent d’un cénacle officiel institué par les plus hautes autorités de l’État. Le corps des « peintres de la Marine » honore en quelque sorte l’attachement et les services rendus par les plus remarquables d’entre eux à la Marine, successivement royale, impériale ou républicaine. En 1941 est institué un Salon de la Marine qui promeut les œuvres des peintres appartenant à cette « corporation » et d’artistes candidats à les rejoindre. Parmi les peintres nommés, nous remarquons Marin-Marie (1901-1987) membre du corps en 1934, Roger Chapelet (1903-1995) et Albert Brenet (1903-2005), tous deux nommés en 1936, ainsi que Charles Lapicque (1898-1988) titulaire du titre en 1948. La peinture et le dessin sont les vecteurs les plus couramment utilisés par ces marinistes dont certains parfois illustrent des ouvrages de bibliophilie ou des journaux, créent des affiches illustrées, développent des bandes dessinées ou recourent à la photographie. Depuis l’aube du XXe s., ces peintres ou plasticiens nous épatent avec des panoramas brassés d’écume, de mémorables batailles navales, des naufrages apocalyptiques et des répliques de sardiniers bretons. Passionnés de navigation, le plancher des vaches leur bouge sous les pieds, sachons gré à Denis-Michel Boëll de nous avoir raconté leur histoire, qu’ils se réclament de mouvements aussi différents que le néo-impressionnisme, le fauvisme, l’abstraction ou l’art vidéo.
Denis-Michel Boëll © Photo X, droits réservés
- Les Peintres de marines - Du XVIIe au XXe siècle, par Denis-Michel Boëll, éditions Ouest France/Musée national de la marine, 256 pages, 2016.
Varia : des singes prisonniers sur des îles flottantes…
« On a observé que des singes pouvaient parfois se retrouver prisonniers sur de "fausses berges" ou îles flottantes constituées d’un entrelacs de végétation, de branches et de troncs pouvant atteindre plusieurs centaines (voire milliers ?) de m2, qui se forment à l’embouchure des grands fleuves et peuvent dériver jusqu’à des îles assez éloignées du continent pour y débarquer leurs passagers involontaires.
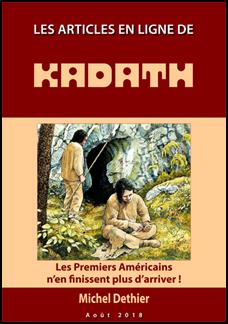 « On a récemment découvert sept dents vieilles de 21 millions d’années appartenant à un singe sud-américain aujourd’hui disparu, Panamacebus transitus (ancêtre des actuels capucins et sapajous), sur la partie nord de l’isthme de Panama, qui était alors un détroit large de 160 km. On peut supposer qu’alors, ces singes ont connu la même mésaventure que certains de leurs descendants connaissent encore parfois actuellement (Bloch & al., 2016). Peut-être les paresseux géants sont-ils passés de la même manière du nord au sud il y a 8 à 9 millions d’années et peut-être y a-t-il même eu des voyages encore plus longs, il y a 40 millions d’années, qui ont amené des primates et des rongeurs (munis de leurs parasites !) d’Afrique en Amérique du Sud. L’Atlantique était alors beaucoup plus étroit et des courants intercontinentaux menaient d’un continent à l’autre. On peut aussi imaginer que certains de nos lointains ancêtres (Homo erectus ou autre) se soient retrouvés dans une semblable situation, "à l’insu de leur plein gré"… C’est en tout cas une hypothèse qu’envisagent Picq & Lemire (2013).
« On a récemment découvert sept dents vieilles de 21 millions d’années appartenant à un singe sud-américain aujourd’hui disparu, Panamacebus transitus (ancêtre des actuels capucins et sapajous), sur la partie nord de l’isthme de Panama, qui était alors un détroit large de 160 km. On peut supposer qu’alors, ces singes ont connu la même mésaventure que certains de leurs descendants connaissent encore parfois actuellement (Bloch & al., 2016). Peut-être les paresseux géants sont-ils passés de la même manière du nord au sud il y a 8 à 9 millions d’années et peut-être y a-t-il même eu des voyages encore plus longs, il y a 40 millions d’années, qui ont amené des primates et des rongeurs (munis de leurs parasites !) d’Afrique en Amérique du Sud. L’Atlantique était alors beaucoup plus étroit et des courants intercontinentaux menaient d’un continent à l’autre. On peut aussi imaginer que certains de nos lointains ancêtres (Homo erectus ou autre) se soient retrouvés dans une semblable situation, "à l’insu de leur plein gré"… C’est en tout cas une hypothèse qu’envisagent Picq & Lemire (2013).
« De ces radeaux naturels, on passe évidemment à des radeaux construits de main d’homme ou à des pirogues monoxyles, simples, simples avec balanciers (praos) ou doubles (catamarans), beaucoup plus stables en haute mer, avec ou sans voile. La présence d’un mât et d’une voile, orientable ou non, sur les embarcations semble attestée dès 5000-6000 ans avant J.-C. (Carter, 2006). De telles embarcations pouvaient-elles remonter le vent ? Sans doute difficilement, mais les grandes pirogues polynésiennes à double voile (pouvant emporter jusqu’à 50 passagers) étaient (et sont toujours) très à l’aise par vent de travers (l’alizé du sud-est, par exemple) et louvoyaient sans problème. Anne Di Piazza, archéologue, chargée de recherche au CNRS, a publié en 2009 une étude détaillée de la navigation océanienne. »
Extrait du propos de Michel Dethier, archéologue wallon, « Les Premiers Américains n’en finissent plus d’arriver ! », issu de la revue Kadath, 57 pages, août 2018, Bruxelles.
Carnet : au petit bonheur des rencontres
Que voulez-vous ? J’ai la passion des mots et des choses de la nature. J’aime à partager cette inclination avec des inconnus que le destin et le hasard mettent sur mon chemin. J’en parle trop ? sans doute, mais toujours avec amitié et sobriété. Je pense que cette attitude, naturelle en somme, aiguise la sensibilité et l’intelligence. Elle me donne en tout cas l’occasion d’un dépaysement créateur.
De la critique
Journaliste et écrivain, François Nourissier (1927-2011) n’était pas tendre envers les praticiens de sa corporation, les critiques littéraires : « Inflation en tout genre. Manque de perspectives. La trompette au lieu du pipeau. Le langage de la haute couture pour vanter la salopette d’Uniprix ».
L’idéal de l’homme de lettres
Inimitable Gabriel Garcia Márquez ! L’écrivain colombien (1927-2014) estimait qu’il importait, pour tout homme de lettres, de poursuivre sans cesse la perfection de la structure du récit, la perfection du langage et celle de l’intensité qui est tout aussi importante. « Mon idéal, disait-il, serait d’écrire un livre dont chaque ligne relancerait le suspense. Un livre que le lecteur ne pourrait lâcher tant il voudrait savoir ce que dit, non pas le chapitre ou le paragraphe suivant, mais la ligne suivante. »
(Jeudi 30 novembre 2023)
Peseurs de mots
Valéry Larbaud baptisait « les peseurs de mots » : les traducteurs.
Le désarroi d’un journaliste
Jean-Claude Guillebaud reste un journaliste et un écrivain lucide. Dans l’ouvrage « La Trahison des lumières - Enquête sur le désarroi contemporain » (éditions du Seuil, 256 pages, 1995), il déplore que « le débat d’idées, la libre pensée sont exilés vers les marges, au bénéfice de l’impérialisme télévisuel qui pratique "l’avalement du monde" et de ses fonctions essentielles, justice, enseignement, politique, culture, économie. » Près de trente ans ont passé et l’observation reste d’une accablante actualité.
(Vendredi 1er décembre 2023)
|
Billet d’humeur
Le chardonneret en danger !
Poussé par le froid d’octobre à décembre, le chardonneret élégant ou chardonneret à tête noire (Carduelis carduelis) migre vers le sud en troupes nombreuses et se mêle fréquemment aux vols de la linotte mélodieuse (Carduelis cannabina). C’est le moment que choisissent les braconniers pour se saisir du passereau migrateur (dont il existe douze sous-espèces), si prisé pour la beauté de son plumage, l’agrément de son chant et sa docilité à l’apprivoisement. Les inspecteurs de l’environnement (de l’Office français de la biodiversité d’une part, de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage d’autre part) s’inquiètent de l’ampleur du trafic du volatile dont la population enregistre depuis 2010 un net déclin (réduction de 40 % de ses effectifs). Classée vulnérable sur la liste rouge des oiseaux de France, l’espèce subit en outre les conséquences de l’intensification de l’agriculture et le recul des prairies qui réduisent sa pitance. Des deux côtés de la Méditerranée, dans le sud de la France et au Maghreb l’attrait des autochtones pour le fringille granivore est d’ailleurs fort ancien. En Afrique du Nord, on a trouvé la trace de son usage domestique depuis le VIIIe siècle. Le chardonneret élégant - qui tient son nom de son goût particulier pour les graines du chardon - porterait chance au foyer qui le détient prisonnier. 9 à 25 cm de longueur pour 20 à 25 cm d’envergure, l’oiseau pèse entre 13 et 20 grammes et peut vivre 12 à 15 ans dans la nature, avec 2 nichées printanières successives de 4 ou 5 oisillons. Son habitat se situe dans les clairières, les friches, les bosquets, les haies, les cultures et les vergers, ainsi que dans les parcs, les jardins cultivés et sur les rives des cours d’eau. Sa beauté fascine les amateurs et charme les dessinateurs et les peintres. Avec le brun châtain du manteau, les taches blanches et jaunes des ailes, le masque facial rouge cramoisi autour d’un bec de corne rosée, son plumage bariolé n’a d’égal que le raffinement de son chant mélodieux de roulades et de trilles virevoltantes. Si bien que sa capture à l’état sauvage s’est accrue chez les trafiquants. Ceux-ci « écolent » leurs proies, c’est-à-dire qu’ils les exercent au chant en les encageant plusieurs mois avec un oiseau maître chanteur ou bien en leur faisant entendre des enregistrements sonores afin qu’ils apprennent à les imiter. Le trafic de l’oiseau chanteur et son commerce illégal n’ont pas faibli de part et d’autre de la Méditerranée. Sous le manteau, le prix d’un chardonneret élégant se négocie entre 100 euros (pour un apprenti chanteur) et 700 euros (pour un virtuose) ; il varie aussi selon que l’individu est domestiqué, muté ou issu d’un croisement avec un canari. La capture, la détention et/ou la commercialisation illégale de chardonnerets sont passibles de deux années d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amendes, mais les condamnations sont souvent moindres.
|
Lecture critique
Sacrifié de la BAC Nord : un combat pour l’honneur
« Fils et frère de flic. J’ai arraché mon grade de brigadier-chef en équilibre au-dessus d’une autoroute, dans le vide, pour sauver la vie d’une jeune comorienne déterminée à se suicider.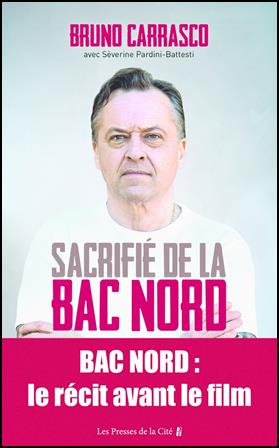 » Lorsqu’il révèle les circonstances de cette action, Bruno Carrasco, 54 ans, marié et père d’une fille et d’un garçon, compte trente années de police, dont neuf à la brigade anticriminalité (BAC) des quartiers nord de Marseille, appelée communément la BAC Nord (quatre-vingts policiers à l’effectif). En octobre 2012, le fonctionnaire a été mis en examen et placé en détention provisoire pour avoir manqué à ses obligations en qualité de chef de groupe. On lui reproche de ne pas avoir interpellé, au cours de différentes opérations de contrôle, des vendeurs et receleurs de drogues, d’avoir laissé certains d’entre eux repartir en possession de stupéfiants ou de ne pas avoir établi d’actes de procédure lorsque du cannabis, de la cocaïne ou d’autres drogues dures étaient confisqués avant d’être détruits. Six autres policiers de la même brigade ont été interpellés sur des griefs analogues. Au terme de trois années d’auditions, d’enquêtes, de procédures, de plaidoiries et de conseils de discipline, le brigadier-chef a été révoqué en dépit de la présomption d’innocence. « Sacrifié de la BAC Nord » raconte son combat pour recouvrer son honneur perdu. » Lorsqu’il révèle les circonstances de cette action, Bruno Carrasco, 54 ans, marié et père d’une fille et d’un garçon, compte trente années de police, dont neuf à la brigade anticriminalité (BAC) des quartiers nord de Marseille, appelée communément la BAC Nord (quatre-vingts policiers à l’effectif). En octobre 2012, le fonctionnaire a été mis en examen et placé en détention provisoire pour avoir manqué à ses obligations en qualité de chef de groupe. On lui reproche de ne pas avoir interpellé, au cours de différentes opérations de contrôle, des vendeurs et receleurs de drogues, d’avoir laissé certains d’entre eux repartir en possession de stupéfiants ou de ne pas avoir établi d’actes de procédure lorsque du cannabis, de la cocaïne ou d’autres drogues dures étaient confisqués avant d’être détruits. Six autres policiers de la même brigade ont été interpellés sur des griefs analogues. Au terme de trois années d’auditions, d’enquêtes, de procédures, de plaidoiries et de conseils de discipline, le brigadier-chef a été révoqué en dépit de la présomption d’innocence. « Sacrifié de la BAC Nord » raconte son combat pour recouvrer son honneur perdu.
160 points de vente illicite de drogues !
Bassens, Campagne-Lévêque, la Castellane, le Clos la Rose, Font-Vert, les Oliviers, la Visitation… Les cités des quartiers nord de Marseille sont gangrénées et structurées par le trafic de stupéfiants. Les réseaux y sont très organisés, parfois démantelés, mais toujours remplacés. Le rituel est le même dans chaque cité. À peine les policiers ont-ils montré le bout de leur calandre que le « Arrraaah ! » du « chouffe », le guetteur, retentit de bloc en bloc, d’immeuble en immeuble, de cage d’escalier en cage d’escalier, provoquant la fuite des « charbonneurs » - les revendeurs au détail. Les moins prestes ne sont pas encore menottés que des fourgons de CRS bouclent la zone et que les points d’entrée de la cité sont contrôlés, tandis que des perquisitions sont effectuées sur les points de deal (marché illicite) et dans les étages des barres d’immeubles investies par les trafiquants. Vingt-quatre heures sur vingt-quatre, la présence de ces « marchés » est signalée par des braseros, des fresques artistement exécutées avec les prix et la disponibilité des produits stockés. La seule ville de Marseille compterait près de 160 « plans stups », c’est-à-dire 160 points de vente. Un « plan stup » moyen peut générer de 30 000 à 40 000 euros de revenus par jour et, pour les plus rentables, le double. Selon leurs vacations plus ou moins longues, jusqu’à quinze heures par jour, les « petites mains » du trafic sont quotidiennement rémunérées 100 euros en moyenne.
Des gamins tuent pour les affaires…
Aux premiers jours de son activité de « baqueux » à la division nord, « Les collègues m’ont fait le tableau de l’ampleur du trafic, rapporte Bruno Carrasco, et je n’en ai pas cru mes oreilles : à raison de plus de trente tonnes de shit [haschisch] écoulées chaque année, le chiffre d’affaires avoisinerait les 100 millions d’euros. » « Là, écrit-il plus loin, on trouve des gamins. Des jeunes qui agissent de façon spontanée. Cette "baby connection" accomplit sa besogne criminelle comme elle disputerait un match de foot. Ces gamins-là tuent pour les affaires, pour l’argent, pour un territoire qu’ils ne veulent pas céder, pour un point de vente braqué ou un vol de marchandise. La vie n’a plus la même valeur qu’avant. J’ai croisé des gosses prêts à abattre un adversaire pour une dette de 100 euros. Le prix de la vie. La facilité avec laquelle on peut se procurer des armes fait le reste… Notamment les armes de guerre, qu’on trouve dans les cités à peine moins facilement qu’une barrette de shit. Et en tête de liste, la kalachnikov, quasiment en libre-service. »
Durant la dizaine d’années d’exercice dans les rangs de la BAC Nord, il a participé à quelque mille huit cents interpellations, suivies de mises à disposition devant un officier de police judiciaire. Malgré l’âpreté du travail, plus spécialement dans la lutte contre la drogue, malgré les horaires, les insultes et les menaces, il s’est épanoui dans cette unité, et la rétrospection qu’il en livre dans cet ouvrage est marquée de la plus vive satisfaction et d’une évidente fierté. Devenu en quelques heures, le 5 octobre 2012, un suspect puis un gardé à vue, un voleur puis un ripou, il a le sentiment que pris dans une tourmente qui le dépasse il a été tout bonnement sacrifié. L’information judiciaire n’est pas bouclée, paraît-il. Sans l’avouer à sa mère, Gisèle, institutrice, Bruno Carrasco s’est fait dessiner sur la cuisse un immense phénix (symbole d’une volonté de survie ?) et sur son avant-bras un « le meilleur reste à venir », une sentence catalane en hommage aux origines de Vincent, son père, commerçant à Tlemcen devenu gardien de la paix à Limoges…
- Sacrifié de la BAC Nord, par Bruno Carrasco, avec Sèverine Pardini-Battesti, Presses de la Cité/L’Express, 320 pages, 2015.
Portrait
Paul-Jean Toulet, un écrivain-voyageur à l’ironie douce-amère
« L’histoire littéraire a consacré Paul-Jean Toulet [Pau, 5 juin 1867-Guéthary, 6 septembre 1920] comme figure de proue éphémère de poètes dits "fantaisistes" lesquels, s’ils répugnent à épancher de bons sentiments, revendiquent néanmoins un lyrisme doux-amer en s’émerveillant des beautés fugaces du quotidien. » Dans l’ouvrage collectif « Paul-Jean Toulet, les "prismes" de l’écriture », le jugement esthétique de Jérôme Hennebert, maître de conférences à l’université de Lille, est relayé par Juliette Lormier, professeure agrégée de lettres (lycée Jacques Feyder d’Épinay-sur-Seine), qui remarque en outre que le nom de l’écrivain béarnais figure communément à côté du titre de son recueil poétique le plus célèbre, les « Contrerimes », ensemble de très beaux poèmes de forme singulière, publiés à titre posthume en 1921 par les soins d’Henri Martineau, un des plus zélés propagandistes de Toulet, de Stendhal et de Francis Carco en sa qualité de critique littéraire et d’éditeur.
Un écrivain-voyageur
 « Explorateur et géographe de plein vent », selon la belle formule de David Bédouret (maître de conférences en géographie à Toulouse), il arpente les territoires, observe et décrit les paysages et leurs habitants. Adolescent, il quitte sa région natale pour suivre les traces de ses parents à l’île Maurice (1885-1888). Il multiplie les voyages : pérégrinations dans le Bassin méditerranéen avec un séjour à Alger (1888-1889), visite du sud de la France et de l’Espagne, équipée en Extrême-Orient de 1902 à 1904 avec son ami parisien Curnonsky (alias Maurice Sailland), excursions en Europe où il s’intéresse aux sociétés, sensible aux us et coutumes qu’il capte par les mots et les images. Les images ? Paul-Jean Toulet pratique la photographie comme le ferait tout ethnologue. De l’Orient, l’œuvre de Toulet est féconde, à travers son « Journal », « Les Ombres chinoises » et « Lélie, fumeuse d’opium ». « Explorateur et géographe de plein vent », selon la belle formule de David Bédouret (maître de conférences en géographie à Toulouse), il arpente les territoires, observe et décrit les paysages et leurs habitants. Adolescent, il quitte sa région natale pour suivre les traces de ses parents à l’île Maurice (1885-1888). Il multiplie les voyages : pérégrinations dans le Bassin méditerranéen avec un séjour à Alger (1888-1889), visite du sud de la France et de l’Espagne, équipée en Extrême-Orient de 1902 à 1904 avec son ami parisien Curnonsky (alias Maurice Sailland), excursions en Europe où il s’intéresse aux sociétés, sensible aux us et coutumes qu’il capte par les mots et les images. Les images ? Paul-Jean Toulet pratique la photographie comme le ferait tout ethnologue. De l’Orient, l’œuvre de Toulet est féconde, à travers son « Journal », « Les Ombres chinoises » et « Lélie, fumeuse d’opium ».
Un journaliste caustique
Journaliste et poète, il est à Paris en 1892 où il se lie à Charles Maurras et Toulouse-Lautrec. Collaborateur du magazine culturel La Vie parisienne, il publie, sous son nom ou divers pseudonymes, des chroniques ironiques et raffinées, parfois grinçantes : ainsi règle-t-il des comptes avec le théâtre de Victor Hugo et celui d’Edmond Rostand. Il n’épargne ni George B. Shaw ni Sacha Guitry dans ses critiques tout en plaçant au pinacle Alfred de Musset et « sa prose svelte, agile comme un danseur de corde ». Commentateur éclectique, il évoque aussi bien les Ballets russes de Diaghilev, la Goulue, Jeanne Avril, l’Eden-Théâtre, le Moulin Rouge et les spectacles de music-hall que le ballet de l’Opéra de Paris. Et s’il applaudit au talent de la danseuse Loïe Fuller, il moque la pose de sa consœur Isadora Duncan. Car le chroniqueur sait être particulièrement drôle dans la méchanceté. Les années précédentes, il aimait à livrer à de jeunes revues d’autres chroniques, des poésies, des contes, des études d’histoire, notamment après voir publié « Monsieur du Paur, homme public » (1898). Assez curieusement, plusieurs numéros de La Vie parisienne comprennent différents chapitres de ses futurs romans, tels « Les Tendres Ménages » (1904), « Mon amie Nane » (1905) et « Les Demoiselles La Mortagne » (1923). Malade, il quitta Paris en 1912 et se retira à Guéthary (Pyrénées-Atlantiques) où il s’éteignit huit ans après.
Ironie, tendresse et mélancolie
L’intérêt de P.-J. Toulet pour la musique et les arts de la scène ont retenu l’attention de commentateurs et de littérateurs, parmi lesquels Hélène Laplace-Claverie (professeure de littérature française à l’université de Pau), qui rappelle que l’écrivain béarnais avait envisagé en 1902 avec son ami Claude Debussy l’adaptation de Comme il vous plaira de Shakespeare, sous une forme à la fois dramatique et musicale : Debussy  signerait la musique de scène, Toulet en serait le traducteur-adaptateur. Longtemps rêvée par les deux amis qui s’y attelèrent en 1902 puis en 1917, l’œuvre scénique ne verra jamais le jour. signerait la musique de scène, Toulet en serait le traducteur-adaptateur. Longtemps rêvée par les deux amis qui s’y attelèrent en 1902 puis en 1917, l’œuvre scénique ne verra jamais le jour.
« Baudelaire, c’est sans doute, avec Moréas, considère Jacques Le Gall (maître de conférences en langue et littérature françaises à l’université de Pau), le poète préféré de Toulet. Toulet mettrait sans doute Baudelaire au-dessus de Moréas. » Paul-Jean Toulet lui-même suscitait l’admiration de ses pairs au premier rang desquels Paul Claudel, Francis Jammes, Marcel Schwob et Paul Valéry. L’écrivain et poète sétois prisait l’ironie douce-amère « d’un être à qui la finesse et la poésie furent données en parties égales… ». « Que l’on lise sa poésie, ses romans, sa correspondance, ajoute comme en écho Maxime Colbert de Beaulieu (doctorant à l’université de Pau) : le sourire y semble partout suggéré, on pourrait presque s’amuser à élaborer une typologie du sourire chez Toulet, du sourire niais au sourire fin, du sourire vrai au sourire feint, du doux sourire au sourire mesquin, du sourire triste au joyeux sourire - on sourit comme lui souriait certainement en écrivant ses textes. Cependant, ce n’est jamais dans l’agressivité ni dans l’excès, moins encore dans l’étalage : il s’y trouve une espèce de tendresse difficilement qualifiable et qui ne s’infuse jamais dans l’œuvre sans un peu de mélancolie. »
Paul-Jean Toulet à l’île Maurice © Photo X, droits réservés
- Paul-Jean Toulet, les « prismes » de l’écriture, sous la direction de Sandrine Bédouret-Larraburu, Isabelle Chol et Jérôme Hennebert, Presses de l’université de Pau et des pays de l’Adour, 334 pages, 2021.
Varia : la guerre d’Algérie du soldat Cabu…
« Jean Cabut, devenu Cabu en tant que dessinateur de presse et auteur de bande dessinée, voit le jour le 13 janvier 1938, à Châlons-sur-Marne (aujourd’hui Châlons-en-Champagne), dans une famille catholique de la petite bourgeoisie. Son père, Marcel Cabut (1913-2007), occupe un poste de professeur de forge à l’École nationale supérieure d’arts et métiers. Dès l’âge de 16 ans, Jean Cabut publie ses premiers dessins dans le quotidien régional L’Union. 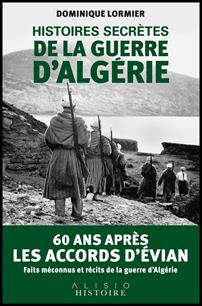 En 1956, il monte à Paris et collabore l’année suivante à l’hebdomadaire Paris Match, avec des dessins racontant la vie des collégiennes et des collégiens. En 1956, il monte à Paris et collabore l’année suivante à l’hebdomadaire Paris Match, avec des dessins racontant la vie des collégiennes et des collégiens.
« La guerre d’Algérie interrompt, en partie, ses débuts de dessinateur dans la presse parisienne. Appelé comme conscrit en mars 1958, il est incorporé durant vingt-sept mois, jusqu’en juin 1960, au 9e régiment de zouaves, basé à Bougie (aujourd’hui Béjaïa), à 180 kilomètres à l’est d’Alger. Simple soldat de 2e classe, il développe un antimilitarisme farouche devant la violence et la cruauté qu’il découvre pendant cette période. […]
« Cabu poursuit ensuite une brillante carrière de dessinateur dans divers journaux satiriques comme Hara-Kiri, Charlie Hebdo, Le Canard enchaîné, créant des personnages comme le Grand Duduche et le Beauf, tout en participant à des émissions télévisées, qu’il illustre en direct. Il est l’auteur de nombreux albums, fréquente des personnalités comme François Cavanna, Georges Bernier, surnommé le professeur Choron, rencontre des dessinateurs de talent comme Gébé, Fred, Wolinski, Reiser et bien d’autres. Il fait la connaissance d’une jeune institutrice de 23 ans, mère de quatre enfants, en poste à Châlons-sur-Marne. Ils ont un garçon ensemble, Emmanuel (le chanteur Mano Solo), né le 24 avril 1963. […]
« Le 7 janvier 2015, Cabu meurt assassiné à Paris lors d’un attentat islamiste contre la rédaction de Charlie Hebdo. »
Extraits de l’ouvrage de Dominique Lormier, « Histoires secrètes de la guerre d’Algérie », éditions Alisio, 208 pages, 2022. (L’historien donne voix aux récits de 23 acteurs de la guerre d’Algérie dont des entretiens exclusifs).
Carnet : rendre attentif les plus distraits
Lorsque je pose le point final à mon manuscrit, je doute de la validité de mon propos, rêvant d’écrire pour le prochain opus « une histoire à rendre attentif les plus distraits », ainsi que le disait l’écrivain américain de langue française Julien Green (1900-1998).
Des vérités dures à entendre
À dix-sept ans, Pierre Lazareff (1907-1972) fait la connaissance de Gaston Leroux (1868-1927) qui l’appelle « Rouletabille numéro 2 » et lui assène deux vérités dures à entendre mais qu’il n’oubliera jamais : « Le journalisme c’est voir, savoir, savoir faire et faire savoir » et « le premier devoir d’un journaliste, c’est d’être lu ».
(Jeudi 7 décembre 2023)
L’intimité ne paie plus
Singulier tout de même de constater que les relations entre femmes et hommes, qui étaient jusqu’alors un sujet confidentiel, sont devenues des problèmes posés sur la place publique, enfin au travers des chaînes de télévision. Un psychologue bordelais vient de publier un quatrième ouvrage qui détaille les ratés sexuels de nos contemporains : l’attachée de presse me prédit un succès égal aux précédents et me propose de rencontrer le psy entre une consultation radiophonique et un plateau de télévision matrimoniale !
De la sentimentalité des dictateurs
Parfois, l’écrivain irlandais Sean O’Faolain (1900-1991) se muait en un satiriste décapant. Il prétendait que tous les idéalistes qui parviennent au pouvoir deviennent rapidement autoritaires et que tout politicien disposait de fortes tendances sentimentalistes. « Même Staline avait une fille, clame-t-il en guise de preuves ; Hitler adorait son chien ; Napoléon sanglotait en lisant des poèmes d’Ossian… »
(Samedi 2 décembre 2023)
Apologues et musique
Les apologues de Jean de La Fontaine révèlent sa passion pour la musique. Avec ses fables, il a fait ce qu’aucun autre poète français n’avait fait avant lui, même pas Clément Marot : il a libéré le mètre, inventé une versification virtuose, paré ses histoires d’une sorte de fluidité musicale.
Merveille des sens
« Contempler, c’est prêter l’oreille », dit joliment la philosophe Barbara Cassin. De son côté, Paul Claudel s’était extasié en clamant : « L’œil écoute ! »
(Mardi 12 décembre 2023)
|
Billet d’humeur
Les 182 ans de « Chez Antoine »
Depuis 1840, un restaurant perpétue la cuisine française au n° 713 de la rue Saint-Louis à La Nouvelle-Orléans, à l’embouchure du Mississippi. Rick Blount, l’actuel propriétaire, représente la cinquième génération de la famille du fondateur, Antoine Alciatore, né en 1822 à Alassio, cité ligure d’Italie. Issus de pêcheurs et d’épiciers de la région de Savone, la famille émigre en France en 1831 : son père exerce le négoce de la laine à Marseille. Adolescent, son fils s’intéresse à l’art culinaire au point de diriger, à 16 ans, la cuisine de l’hôtel de Noailles où son bœuf à la Robespierre (un filet saignant, nappé d’une sauce à base de fond de bœuf, de ris de veau et de foie de volaille) réjouit les papilles du prince de Talleyrand. Cette année-là (1838), il part à New York où le rejoindra Julie Freyss, sa future femme. Mais le couple élira la Louisiane comme destination finale. Après un bref passage aux fourneaux de l’hôtel Saint-Charles, à La Nouvelle-Orléans, il ouvre avec succès une pension de famille avec restaurant dans le Vieux Carré français de la ville. Plusieurs saisons à l’enseigne « Chez Antoine » mais dans des locaux plus spacieux, il promeut sa dinde à la Talleyrand en hommage à l’un de ses illustres clients du Noailles de la cité phocéenne, tandis que ses convives américains découvrent les délices du canapé Saint-Antoine (crabe à la sauce Béchamel agrémenté de vin et servi avec des anchois), du pompano Montgolfier en papillote (poisson du golfe du Mexique), des bécassines sur canapé, de la sole à la Joinville (pochée en sauce au vin, avec des truffes et des crevettes) et des escargots à la bordelaise. En 1899, Jules, le fils d’Antoine, accommode les huîtres en coquille à la Rockfeller et leur sauce au beurre, le plus grand succès de la maison. Directeur de l’établissement de 1934 à 1972, le petit-fils d’Antoine se targue de disposer d’une carte de 1 000 plats différents et de 560 recettes d’œufs ! Parmi elles les œufs Sardou (œufs pochés sur fond d’artichaut avec des anchois et une sauce hollandaise) que Roy a apprêtés en l’honneur du dramaturge français Victorien Sardou lors de sa visite au restaurant. En 1948, Frances Parkinson Keyes (1885-1970) publie un roman policier, « Dîner chez Antoine », dont l’intrigue se déroule partiellement au 713 Saint Louis Street. Selon l’écrivaine, des sommes fabuleuses auraient été offertes à Roy Alciatore pour ouvrir des succursales dans le pays. Celui-ci s’en serait indigné par ces mots : « Mais il ne peut y avoir qu’un seul Antoine ! ». Nombreuses sont les célébrités à s’être attablé à l’Antoine’s restaurant de La Nouvelle Orléans ; les photographies qui tapissent les murs des 14 salles à manger montrent le pape Jean Paul II, la princesse Anne, George Bush, Bill Clinton, Theodore et Franklin Delano Roosevelt, le boxeur George Carpentier, les acteurs Sarah Bernhardt, Tom Cruise, Judy Garland, Angelina Jolie, Buster Keaton, Brad Pitt, Elizabeth Taylor, Bruce Willis, les écrivains Mark Twain et Tennessee Williams, le chanteur Bing Crosby et le gangster Al Capone…
|
Lecture critique
Le bel itinéraire de Marc Jeanson
à la tête de l’Herbier national du muséum
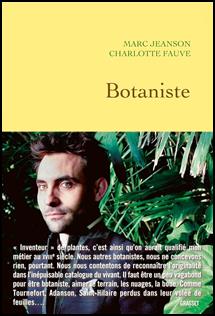 Très tôt, pour Marc Jeanson (Savigny-sur-Ardres, 1981), les dés sont jetés. Rapportant d’un collège champenois à la maison familiale une phalangère rameuse de la famille des anthéricacées, une sorte d’asperge d’intérieur, il l’empote et la place sur une étagère de sa chambre. Très rapidement, à son insu, la plante-araignée développe ses feuilles panachées de vert et d’or vif dans tous les azimuts de la pièce. « Soudain, raconte-t-il, une langue rayonnante léchait mon bureau, semblant boire le soleil pour le reverser sur mon cahier. J’étais impressionné : avec rien, un peu de terre, de lumière et d’eau, cet être irradiait. Dans ma tête, un mystère venait de germer. » Lycéen, l’association humanitaire du bahut l’envoie au Sénégal acheminer de vieux manuels scolaires jusqu’à la frontière de la Mauritanie : l’architecture et la beauté végétales des palmiers-rôniers (Borassus aethiopium) qui jalonnent la route de Dakar à Saint-Louis le marquent durablement de la même façon que les lectures des ouvrages du botaniste Francis Hallé (Seine-Port, 1938) et les recherches du biologiste et botaniste Patrick Blanc (Paris, 1953) découvert dans une émission télévisée ont bouleversé l’adolescent. À l’âge de 22 ans, grâce à Laure, une amie de promotion à l’école d’agronomie, il effectue plusieurs stages à l’Herbier national du muséum parisien : « Il y avait de la poussière partout, un capharnaüm de plantes empilées, mais de grands esprits habitaient les lieux. J’y rencontre des gens de 90 ans qui parlent d’espèces disparues, d’un monde disparu, et moi, j’écoute, fasciné, en pensant au monde de demain. » Une bourse américaine lui permet de travailler cinq ans à l’Herbier de New York afin de préparer sa thèse qui porte, comme de bien entendu, sur les palmiers d’Asie du Sud-Est. Une appréciable liberté et un budget confortable lui permettent d’effectuer des missions au Vietnam, en Chine, en Thaïlande, en Indonésie, en Équateur, à Taïwan et au Japon. Lorsqu’il rentre en France, en 2012, une opportunité s’offre de rejoindre l’équipe de chercheurs de l’Herbier de Montpellier. Mais dans le même temps il apprend qu’un poste similaire est vacant à Paris : il l’obtient ! Circonstance inespérée pour le jeune doctorant qui sera bientôt appelé à diriger l’institution elle-même, vieille de 350 ans et dont les collections uniques documentent avec une rare fiabilité les bouleversements des flores et des paysages de la planète. Prévu pour conserver six millions de spécimens, ledit herbier en contient dix millions, répartis dans des centaines de milliers de liasses, elles-mêmes remisées dans des casiers empilés jusqu’au plafond, à 2,50 mètres de hauteur ! Certes, à l’origine du savoir botanique le plus complexe, il y a la cueillette et ses antiques collecteurs, mais l’Herbier national œuvre aujourd’hui dans des domaines nouveaux comme la recherche de l’ADN, la numérisation et les codes-barres. Pourtant, la conservation, l’utilisation et la transmission de ce savoir ô combien précieux passent encore par la dessiccation des plantes à travers deux feuilles de papier pressées entre deux planches de bois… Assisté par la journaliste Charlotte Fauve, Marc Jeanson décrit dans l’ouvrage « Botaniste » les différentes étapes de sa formation scientifique. Sa fonction à l’Herbier national du muséum d’histoire naturelle l’amène à narrer quelques-unes des expéditions scientifiques des XVIIIe et XIXe siècles qui ont été si profitables aux collections de cette tour de Babel de papier et de plantes qu’est l’Herbier national. Outre Carl von Linné, Antoine-Laurent de Jussieu et Jean-Baptiste de Lamarck, il tient à souligner l’apport décisif de savants de grand format à la connaissance des végétaux comme Michel Adanson (1727-1806), Philibert Commerson (1727-1773), Pierre Magnol (1638-1715), Pierre Poivre (1719-1786) et Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708). Il n'oublie pas de rendre hommage aux scientifiques qui ont tant apporté à l’institution qu’il dirige, en particulier Gérard-Guy Aymonin (1934-2014), Maurice Schmid (1922-2018), Jules-Eugène Vidal (1914-2020) et …la Chèvre, un des érudits de l’Herbier national, surnommé ainsi en raison de son habileté à gravir, pendant quarante ans, les reliefs volcaniques et végétaux de Polynésie, un chercheur dont on ne saura pas le patronyme. D’un bout à l’autre du récit, le botaniste champenois ne tarit pas d’enthousiasme pour les vertus de son métier et les trésors de l’Herbier national, cette mémoire du monde, cette merveilleuse machine à remonter le temps, des milliers de plantes séchées, dont chaque pétale, chaque stipule embaumée témoigne de l’avancée des sciences ou des premiers contacts entre civilisations, pour le meilleur et pour le pire. Très tôt, pour Marc Jeanson (Savigny-sur-Ardres, 1981), les dés sont jetés. Rapportant d’un collège champenois à la maison familiale une phalangère rameuse de la famille des anthéricacées, une sorte d’asperge d’intérieur, il l’empote et la place sur une étagère de sa chambre. Très rapidement, à son insu, la plante-araignée développe ses feuilles panachées de vert et d’or vif dans tous les azimuts de la pièce. « Soudain, raconte-t-il, une langue rayonnante léchait mon bureau, semblant boire le soleil pour le reverser sur mon cahier. J’étais impressionné : avec rien, un peu de terre, de lumière et d’eau, cet être irradiait. Dans ma tête, un mystère venait de germer. » Lycéen, l’association humanitaire du bahut l’envoie au Sénégal acheminer de vieux manuels scolaires jusqu’à la frontière de la Mauritanie : l’architecture et la beauté végétales des palmiers-rôniers (Borassus aethiopium) qui jalonnent la route de Dakar à Saint-Louis le marquent durablement de la même façon que les lectures des ouvrages du botaniste Francis Hallé (Seine-Port, 1938) et les recherches du biologiste et botaniste Patrick Blanc (Paris, 1953) découvert dans une émission télévisée ont bouleversé l’adolescent. À l’âge de 22 ans, grâce à Laure, une amie de promotion à l’école d’agronomie, il effectue plusieurs stages à l’Herbier national du muséum parisien : « Il y avait de la poussière partout, un capharnaüm de plantes empilées, mais de grands esprits habitaient les lieux. J’y rencontre des gens de 90 ans qui parlent d’espèces disparues, d’un monde disparu, et moi, j’écoute, fasciné, en pensant au monde de demain. » Une bourse américaine lui permet de travailler cinq ans à l’Herbier de New York afin de préparer sa thèse qui porte, comme de bien entendu, sur les palmiers d’Asie du Sud-Est. Une appréciable liberté et un budget confortable lui permettent d’effectuer des missions au Vietnam, en Chine, en Thaïlande, en Indonésie, en Équateur, à Taïwan et au Japon. Lorsqu’il rentre en France, en 2012, une opportunité s’offre de rejoindre l’équipe de chercheurs de l’Herbier de Montpellier. Mais dans le même temps il apprend qu’un poste similaire est vacant à Paris : il l’obtient ! Circonstance inespérée pour le jeune doctorant qui sera bientôt appelé à diriger l’institution elle-même, vieille de 350 ans et dont les collections uniques documentent avec une rare fiabilité les bouleversements des flores et des paysages de la planète. Prévu pour conserver six millions de spécimens, ledit herbier en contient dix millions, répartis dans des centaines de milliers de liasses, elles-mêmes remisées dans des casiers empilés jusqu’au plafond, à 2,50 mètres de hauteur ! Certes, à l’origine du savoir botanique le plus complexe, il y a la cueillette et ses antiques collecteurs, mais l’Herbier national œuvre aujourd’hui dans des domaines nouveaux comme la recherche de l’ADN, la numérisation et les codes-barres. Pourtant, la conservation, l’utilisation et la transmission de ce savoir ô combien précieux passent encore par la dessiccation des plantes à travers deux feuilles de papier pressées entre deux planches de bois… Assisté par la journaliste Charlotte Fauve, Marc Jeanson décrit dans l’ouvrage « Botaniste » les différentes étapes de sa formation scientifique. Sa fonction à l’Herbier national du muséum d’histoire naturelle l’amène à narrer quelques-unes des expéditions scientifiques des XVIIIe et XIXe siècles qui ont été si profitables aux collections de cette tour de Babel de papier et de plantes qu’est l’Herbier national. Outre Carl von Linné, Antoine-Laurent de Jussieu et Jean-Baptiste de Lamarck, il tient à souligner l’apport décisif de savants de grand format à la connaissance des végétaux comme Michel Adanson (1727-1806), Philibert Commerson (1727-1773), Pierre Magnol (1638-1715), Pierre Poivre (1719-1786) et Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708). Il n'oublie pas de rendre hommage aux scientifiques qui ont tant apporté à l’institution qu’il dirige, en particulier Gérard-Guy Aymonin (1934-2014), Maurice Schmid (1922-2018), Jules-Eugène Vidal (1914-2020) et …la Chèvre, un des érudits de l’Herbier national, surnommé ainsi en raison de son habileté à gravir, pendant quarante ans, les reliefs volcaniques et végétaux de Polynésie, un chercheur dont on ne saura pas le patronyme. D’un bout à l’autre du récit, le botaniste champenois ne tarit pas d’enthousiasme pour les vertus de son métier et les trésors de l’Herbier national, cette mémoire du monde, cette merveilleuse machine à remonter le temps, des milliers de plantes séchées, dont chaque pétale, chaque stipule embaumée témoigne de l’avancée des sciences ou des premiers contacts entre civilisations, pour le meilleur et pour le pire.
- Botaniste, par Marc Jeanson et Charlotte Fauve, éditions Bernard Grasset, 224 pages, 2019.
Portrait
Wang Keping ou l’exil fécond d’un rebelle
Toute sa vie quasiment, la révolte aura guidé les faits et gestes de Wang Keping. Primitivement scénariste et comédien, le sculpteur est l’un des fondateurs à Beijing, le 27 septembre 1979, du mouvement les Étoiles (Xingxing en mandarin), association d’artistes chinois caractéristique des groupes d’intellectuels qui se constituent après la chute de la « bande des quatre ». Formés en dehors des écoles de beaux-arts, ces artistes prennent une part active à la promotion de styles interdits par la censure étatique, comme les thématiques érotiques, les sujets politiques non officiels et l’art abstrait. Leur action, qui vise à l’obtention d’un lieu d’exposition, se manifeste par un vernissage sur le mur d’enceinte du palais des Beaux-Arts, un sit-in (occupation d’un lieu public assis par terre) de trois jours, et prend fin par une marche vers le centre de Beijing, le 1er octobre 1979, à l’occasion du 30e anniversaire de la République populaire. L’action politique et médiatique du groupe connaît un retentissement international mettant en scène autour de Wang Keping les peintres, graveurs et sculpteurs Bo Yun, Huang Rui, Li Shuang, Ma Desheng, Qu Leilei, Yan Li et Zhong Acheng, bientôt rejoints par Ai Weiwei.
Long Life, première œuvre contestataire
Il naît en 1949 près de Pékin, d’une mère actrice, Liu Yanjin, et d’un père écrivain, Wang Lin, qui a écrit le premier roman chinois dont la narration se déroule lors de la guerre sino-japonaise. Autodidacte, il choisit la discipline picturale qu’il délaisse assez vite au profit de la sculpture, en 1978, 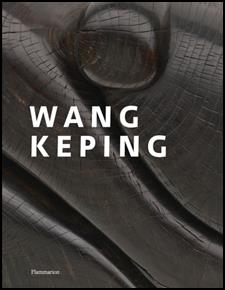 tout à fait par hasard. Cette année-là il a réalisé une sculpture en taillant un barreau de chaise qu’il transforme en un bras dressé tenant dans la main un petit livre rouge : il a nommé l’œuvre Long Life. Farouchement opposé au monde totalitaire qui l’entoure, il ne cesse de manifester un esprit de rébellion (fankang en chinois) au travers d’œuvres le plus souvent condamnant la censure, qu’il intitule Silence, Idole ou Chain. Il espère ardemment quitter son pays natal. Après plusieurs années de tractations diplomatiques au milieu desquelles il se marie (à Pékin, en 1981) avec une Française, Catherine Dézaly, arrivée en Chine en 1975 pour étudier la langue chinoise et enseigner le français à l’université de Pékin, il est autorisé à sortir du territoire en 1984. Il emménage en France en cette même année où naît à Paris sa fille Aline et meurt à Tianjin son père. Ministre français de la Culture, Jack Lang lui attribue un atelier à Aubervilliers en 1985. Cette année-là, il rend visite à son ami Ai Weiwei aux États-Unis, qui lui fait découvrir les grandes métropoles américaines et leurs grands musées. À son retour en France, il écrit un scénario inspiré de sa visite au New Museum de New York (L’Artiste et la Femme œuvre d’art), une pièce qui sera jouée à Hong Kong. En 1995, avec sa famille, il s’installe à Paris et travaille dans un nouvel atelier à Goussainville. tout à fait par hasard. Cette année-là il a réalisé une sculpture en taillant un barreau de chaise qu’il transforme en un bras dressé tenant dans la main un petit livre rouge : il a nommé l’œuvre Long Life. Farouchement opposé au monde totalitaire qui l’entoure, il ne cesse de manifester un esprit de rébellion (fankang en chinois) au travers d’œuvres le plus souvent condamnant la censure, qu’il intitule Silence, Idole ou Chain. Il espère ardemment quitter son pays natal. Après plusieurs années de tractations diplomatiques au milieu desquelles il se marie (à Pékin, en 1981) avec une Française, Catherine Dézaly, arrivée en Chine en 1975 pour étudier la langue chinoise et enseigner le français à l’université de Pékin, il est autorisé à sortir du territoire en 1984. Il emménage en France en cette même année où naît à Paris sa fille Aline et meurt à Tianjin son père. Ministre français de la Culture, Jack Lang lui attribue un atelier à Aubervilliers en 1985. Cette année-là, il rend visite à son ami Ai Weiwei aux États-Unis, qui lui fait découvrir les grandes métropoles américaines et leurs grands musées. À son retour en France, il écrit un scénario inspiré de sa visite au New Museum de New York (L’Artiste et la Femme œuvre d’art), une pièce qui sera jouée à Hong Kong. En 1995, avec sa famille, il s’installe à Paris et travaille dans un nouvel atelier à Goussainville.
Wang a créé son propre système
En 2019, il choisit d’investir un nouvel atelier en Vendée, au sud des Sables-d’Olonne, dans un vaste chantier naval désaffecté, situé à proximité de l’océan Atlantique, qui lui offre de nouvelles possibilités de créations avec ses sept mètres de hauteur sous plafond et des dépendances où il peut stocker des grumes de très grand format. « La fertilité de la matière semble conduire l’artiste à privilégier les formes féminines, les courbes et les arrondis, avance Virginie Perdrisot-Cassan, conservateur du Patrimoine (responsable des sculptures au Musée national Picasso à Paris). Ainsi qu’il le dit lui-même, "pour un sculpteur, il est impossible de ne pas être touché par la forme du corps féminin". Les femmes de bois de Wang Keping, à l’allure hiératique et totémique, se dressent, telles des déesses de la fécondité parées d’une aura primitive. » L’œuvre de Wang Keping comprend un bestiaire, souvent ailé : « Mes oiseaux sont des contes, dit-il, de l’imagination ». Monumentales pour la plupart, les sculptures sont parfois noircies au chalumeau : « J’utilise le chalumeau par petites touches comme un  pinceau », explique l’artiste. En 1988, il s’adresse à la fonderie d’art Susse en Suisse pour réaliser des éditions en bronze de ses sculptures Idole et Silence. En 2010, il installe certains de ses bronzes dans les jardins du musée Zadkine à la faveur d’une exposition intitulée « La Chair des forêts ». « La collaboration avec différentes fonderies, remarque à bon escient Anne-Laure Buffard (galerie Nathalie Obadia), lui permet de cerner la sensibilité propre à chaque fondeur, leurs différences et leurs qualités distinctives. Il apprend peu à peu à en jouer en fonction de l’effet recherché pour chaque sujet édité et affine ainsi sa maîtrise de l’art du bronze qui devient un nouveau lieu privilégié d’expression de son intense quête de perfection. » Si l’on excepte le calcaire et l’acier, le travail sur bois demeure plus que jamais central, utilisant une gamme très étendue d’essences : acacia, acajou, albizia, buis, catalpa, cèdre, cerisier, châtaignier, chêne, cyprès, érable, févier, frêne, hêtre, if, laurier cerise, orme, merisier, platane, pommier, prunier, saule pleureur, séquoia, sipo, sorbier et sycomore. La pertinence de jugement de son ami Ai Weiwei se doit d’être soulignée : « Il se sert de la forme naturelle et originale des matériaux primitifs pour créer une œuvre indéfinissable, où s’exprime son subconscient sous d’apparentes ressemblances, et qui laisse libre cours à une imagination érotique inépuisable. La brutalité de ses œuvres saute aux yeux. Dans le domaine de la sculpture par taille directe, il est peu d’artistes que l’on peut comparer à Wang Keping. Son œuvre est intégrale et autonome. Il a créé son propre système. » pinceau », explique l’artiste. En 1988, il s’adresse à la fonderie d’art Susse en Suisse pour réaliser des éditions en bronze de ses sculptures Idole et Silence. En 2010, il installe certains de ses bronzes dans les jardins du musée Zadkine à la faveur d’une exposition intitulée « La Chair des forêts ». « La collaboration avec différentes fonderies, remarque à bon escient Anne-Laure Buffard (galerie Nathalie Obadia), lui permet de cerner la sensibilité propre à chaque fondeur, leurs différences et leurs qualités distinctives. Il apprend peu à peu à en jouer en fonction de l’effet recherché pour chaque sujet édité et affine ainsi sa maîtrise de l’art du bronze qui devient un nouveau lieu privilégié d’expression de son intense quête de perfection. » Si l’on excepte le calcaire et l’acier, le travail sur bois demeure plus que jamais central, utilisant une gamme très étendue d’essences : acacia, acajou, albizia, buis, catalpa, cèdre, cerisier, châtaignier, chêne, cyprès, érable, févier, frêne, hêtre, if, laurier cerise, orme, merisier, platane, pommier, prunier, saule pleureur, séquoia, sipo, sorbier et sycomore. La pertinence de jugement de son ami Ai Weiwei se doit d’être soulignée : « Il se sert de la forme naturelle et originale des matériaux primitifs pour créer une œuvre indéfinissable, où s’exprime son subconscient sous d’apparentes ressemblances, et qui laisse libre cours à une imagination érotique inépuisable. La brutalité de ses œuvres saute aux yeux. Dans le domaine de la sculpture par taille directe, il est peu d’artistes que l’on peut comparer à Wang Keping. Son œuvre est intégrale et autonome. Il a créé son propre système. »
Wang Keping dans son atelier vendéen © Photo X, droits réservés
- Wang Keping, collectif, éditions Flammarion/Galerie Obadia, 224 pages, 2022.
Varia : le raid du centenaire Latécoère-Aéropostale
« La célèbre phrase de Pierre Georges Latécoère est omniprésente dans cette histoire : « J’ai refait tous les calculs. Ils confirment l’opinion des experts. Notre idée est irréalisable. Il ne nous reste plus qu’une chose à faire, la réaliser ! ».
 « Le côté génial de l’histoire est d’imaginer un raid de près de douze mille kilomètres sur trois continents, en plusieurs parties, de Toulouse jusqu’à Ushuaïa et Santiago du Chili et d’en structurer les moindres détails […] Il s’agit de faire s’envoler 60 avions en respectant les distances de sécurité et en essayant que les derniers n’arrivent pas à l’étape trop tard. […] Nous sommes donc organisés en quatre vagues de 10 à 12 aéronefs, précédées par les avions ouvreurs, les quatre avions de légende, les Broussard, ainsi que l’extraordinaire avion solaire de Raphaël Dinelli. « Le côté génial de l’histoire est d’imaginer un raid de près de douze mille kilomètres sur trois continents, en plusieurs parties, de Toulouse jusqu’à Ushuaïa et Santiago du Chili et d’en structurer les moindres détails […] Il s’agit de faire s’envoler 60 avions en respectant les distances de sécurité et en essayant que les derniers n’arrivent pas à l’étape trop tard. […] Nous sommes donc organisés en quatre vagues de 10 à 12 aéronefs, précédées par les avions ouvreurs, les quatre avions de légende, les Broussard, ainsi que l’extraordinaire avion solaire de Raphaël Dinelli.
« Nous sommes aussi là pour célébrer le centenaire d’une poignée de rêveurs fous qui imaginaient, à la sortie de la grande boucherie de la Première Guerre mondiale, que les avions démobilisés pouvaient aussi servir à relier pacifiquement les hommes en transportant le courrier et les hommes autour du monde. Il faut comprendre qu’après des guerres commerciales incroyables avec les Américains, la "ligne" Latécoère est devenue la compagnie "Air France" que l’on connaît aujourd’hui. Et là, en 2018, juste derrière notre petit DR400 [avion de tourisme monomoteur Robin], s’est glissé un vaisseau du futur : Eraole beaucoup plus maniable que son précurseur solaire Solar impulse qui a fait le tour du monde.
« Un biplan à ailes décalées, recouvert de panneaux solaires, mélange de simplicité ultralégère (avec des tiges en bout d’ailes permettant à l’avion de tenir l’équilibre au sol) et de haute technologie (avec un moteur électrique hybride et une pile à combustible à hydrogène). Le principe est de stocker de l’énergie propre, sans CO2, à l’aide de l’hydrogène pour le décollage puis, en vol, de prendre le relai par l’énergie solaire. Bien sûr, je ne connais pas tous les détails de ce prototype qui est sans doute aussi éloigné de nos futurs avions que ne l’étaient les ébauches des frères Wright par rapport à nos avions actuels. »
Extraits de l’ouvrage de Jean-Louis Gross, médecin de campagne et médecin aéronautique, « Raid Latécoère-Aéropostale - Carnet de route », Les Impliqués éditeur, 114 pages, 2019.
Haut de page
|





