Les Papiers collés
de Claude Darras
Automne 2014
Carnet : Souvenons-nous de Georges Lauris

In memoriam
Dès lors que je lui annonçais ma venue à Marseille, il se faisait une joie de me cuisiner quelque poisson acheté à l’étal d’un supermarché tout proche de la rue Fauchier où il résidait, hôte des services pastoraux du diocèse. Dans l’appartement, indescriptible capharnaüm rétréci par les empilements de documents, d’ouvrages et de manuscrits mêlés aux objets hétéroclites de la vie domestique, Frère Ceslas, de l’ordre des Frères Prêcheurs, plus communément nommés dominicains, me parlait alors de ses travaux éditoriaux et épistolaires du moment. Le rosé de Provence affûtait les saillies de notre bavardage à bâtons rompus. Alternaient évocation du Haut-Languedoc, berceau du poète, essayiste et dramaturge, réminiscences de l’enfance passée à Saint-Martin-de-Londres, à la porte des Cévennes, attachement à la Sainte-Baume où, étudiant, il fréquente l’université théologique du couvent de Saint-Maximin, rappel du compagnonnage affectif avec Paul Claudel et Jean Giono, souvenir de Jean Bourgoint, l’un des « enfants terribles » de Jean Cocteau, découverte émerveillée des peintres Bernard Buffet et Pierre Soulages… Chacune de nos rencontres cadençait une fête de l’amitié, du partage et de l’esprit. Lauréat du prix de poésie Théophile Gauthier de l’Académie française (1991) et de celui des Écrivains croyants (1999), Frère Ceslas/Père Georges Durand plus connu sous son nom de plume Georges Lauris est mort le mardi 4 mars 2014 à Marseille (il était né à Sète le 19 mars 1923). Poète solaire à l’âme romane, il s’inscrivait « dans la tradition des grands voyants et des grands philosophes », assure le doyen Louis Forestier, « ceux qui vont chercher l’essence des choses derrière les apparences : Parménide, Platon, Rimbaud ou Char. Avec force et douceur, au gré d’images qui mêlent le quotidien et le cosmos, la majesté et la familiarité, il créé - c’est nouveau - une sorte de théologie poétique. Et, "du fond de l’abîme", il sait faire remonter vers l’homme souffrant la petite Espérance ».
Avec la disparition de Georges Durand, beaucoup pleurent un ami, un mentor. Dans la peine, je m’efforce de suivre la sentence si lumineuse de Léopold Sédar Senghor, cet autre grand voyant : « Il faut attaquer la mort sur son propre terrain, le terrain de l’existence : exister dans la mémoire des hommes ».
– Lire aussi L’aventure poétique de Georges Lauris (lecture critique) dans les « Papiers collés » du printemps 2012.
Je suis venu vivre tout haut - Autobiographie de ma foi, par Georges Lauris, éditions du Cerf, 208 pages, 2008. (Photo de couverture © Robert Terzian)
J’ai dit…
J’ai dit à la souris : écoute, ne te prends pas pour un moulin à vent.
J’ai dit au crapaud : écoute, ne te prends pas pour Caruso.
J’ai dit à la libellule : écoute, ne te prends pas pour la femme du Préfet.
J’ai dit à la tendresse : dis, écoute, ne m’abandonne jamais.
J’ai dit à ma colère : sois toujours fière. Tu sais que je hais la guerre.
(Jules Mougin, La Grande Halourde, Robert Morel éditeur, 1961)
L’amour et l’orgueil
Il n’y a pas que l’amour. À me relire, je trouve l’orgueil. Il est facile de se critiquer. Dérisoirement. C’est pourquoi il vaut mieux laisser ce plaisir aux autres. Aussi bien, n’est-ce pas à une « critique » que je me livre. Mais à un constat. Il est d’ailleurs curieux de voir à quel point on peut se juger, et à quel point c’est inutile. On n’écrit jamais que ce qu’on est capable d’écrire. Voilà un genre de justice.
(Georges Perros, « Papiers collés » 1, Notes pour une préface, 1960)

Le colosse de Rome
Je ne me lasse pas de contempler le Colisée de Rome peint à l’huile (sur papier) par mon ami Guy Toubon. Commencé par Vespasien et achevé par son fils Domitien, son nom lui vient du Colosse, statue de Néron de plus de 30 mètres de haut, en dieu solaire. « Le Colosse fut enlevé, assure Fernand Braudel (dans "Les Mémoires de la Méditerranée", éditions de Fallois, 1998), mais le nom resta au Colisée, autre colosse. »
© Photo Daniel Cyr Lemaire
Incomplétude
« La véritable beauté des êtres humains et des œuvres d’art gît dans leur incomplétude, assure le peintre Bill Viola (New York, 1951). Cette imperfection, ce caractère inachevé est ce qui donne à la vie son sens. »
(Bill Viola, l’histoire de l’art et le présent du passé, entretien avec l’artiste, revue "Perspective", Institut national d’histoire de l’art, Paris, mars 2008)
De la curiosité
Ne dites pas, je vous prie, que la curiosité est un vilain défaut. Elle reste, au contraire, une des vertus cardinales de tout homme sain de corps et d’esprit. La curiosité, c’est comme la santé ; quand tout va mal, on n’est plus curieux, on ne s’intéresse plus à rien. Être en bonne santé, c’est être curieux ; quand on n’est plus curieux, savez-vous, eh bien, on meurt.
(Samedi 5 juillet 2014)
|
Billet d’humeur
La Madelon se prénommait Madeleine…
Singulier destin des chansonnettes : écrite par Louis Bousquet (Parignargues, 1871-Paris, 1941) sur une musique de marche de Camille Robert, de l’orchestre de l’Élysée, « Quand Madelon » est vouée à demeurer dans les tiroirs des comiques-troupiers après sa création, le 24 avril 1914, sur la scène parisienne du café-concert Eldorado. Son interprète, le chanteur Bach, alias Charles-Joseph Pasquier (1882-1953), est affublé du costume de tourlourou (ancien nom populaire du soldat, du fantassin). En 1916, à la faveur d’une tournée sur le front de la Grande Guerre, Bach récidive mais cette fois la rengaine soulève l’enthousiasme des poilus. Pendant et après le conflit, la « Marseillaise des tranchées » caracole en haut du hit-parade, portée par les voix de Polin, Bérard, Georges Thill, Line Renaud, Maurice Chevalier et Marlène Dietrich - qui la chante à Paris en 1939 lors de la célébration du 14-Juillet. Employé aux chemins de fer puis marchand de cycles à Paris, Louis Bousquet devient maire de Beauchamp, dans le Val d’Oise, avant de se retirer dans son village natal l’année précédant sa disparition. On crédite le parolier gardois de quelque mille deux cents chansons dont de grands « tubes » comme « Les Veines ! » (1908, musique de Vincent Scotto), « Clématite », une polka japonaise ( !) mise en musique par Charles Borel-Clerc et créée par Mayol en 1909, « L’Ami Bidasse » (1913, musique d’Henri Mailfrait) et « La Caissière du Grand Café » (1914, musique de Louis Izoird). Engagé volontaire en 1889 au 3e régiment de zouaves stationné à Batna, en Algérie, c’est là, dans un bar à soldats, qu’il découvre le modèle de sa future Madelon, Madeleine Martin, fille des cafetiers, dont les bidasses frôlent le jupon quand ils ne lui prennent pas la taille ou le menton…
|
Lecture critique
Un conte de notre temps par Béatrice Bourrier
 « Les impressions d’enfance marquent la couleur de l’âme », prétendait Jean Guéhenno. Elles constellent assurément les belles pages du livre, « Le Berger et son étoile », une espèce de conte de notre temps qui sait toucher en nous l’enfant toujours sensible. Les personnages et les paysages que Béatrice Bourrier (née à Montpellier en 1962) découvre et analyse au fil de l’intrigue sont les contemporains d’une Provence solaire et l’observateur attentif en reconnaîtrait à coup sûr leurs semblables, aujourd’hui, entre Rhône et Camargue. « Les impressions d’enfance marquent la couleur de l’âme », prétendait Jean Guéhenno. Elles constellent assurément les belles pages du livre, « Le Berger et son étoile », une espèce de conte de notre temps qui sait toucher en nous l’enfant toujours sensible. Les personnages et les paysages que Béatrice Bourrier (née à Montpellier en 1962) découvre et analyse au fil de l’intrigue sont les contemporains d’une Provence solaire et l’observateur attentif en reconnaîtrait à coup sûr leurs semblables, aujourd’hui, entre Rhône et Camargue.
Berger érudit qui lit L’Astragale d’Albertine Sarrazin sur les chemins de transhumance et commente Les Travaux et les Jours d’Hésiode en décryptant les constellations célestes, Basile narre à la fois sa rencontre, en février 1967, avec la belle italienne Angelina dont il s’éprend en secret, et l’affection toute paternelle qu’il porte à son fils Luca. L’Aphrodite arlésienne et ses deux garçons (Enzo est l’aîné) sont momentanément hébergés par Nelly et son fils Basile au mas des Bessous jusqu’à ce que le chef de famille, Gianni, un Piémontais des Brigades rouges, ne vienne les retrouver dans la plaine de la Crau. La vie n’y est pas simple. Les rencontres sont celles du destin, les sentiments sont rouge vif, les émotions sont des raz-de-marée.  Du compagnonnage entre le pâtre arlésien et le jeune italien, nous ne dirons pas plus, car il ne serait pas charitable d’abattre, ici, toutes les cartes d’un jeu dont les règles sont l’apanage d’un suspense romanesque qu’il convient de sauvegarder.
Entre le drame familial, le thriller psychologique et le récit d’une bouleversante initiation, l’histoire, aussi tendre que cruelle, nous place au carrefour de la poésie, de la géographie et de l’histoire, si je peux me permettre de faire écho à une phrase d’André Breton. À cet égard, l’évocation de l’abbaye de Montmajour, refuge des moines mauristes, le rappel des traditions pastorales, l’illustration de la geste gardiane témoignent d’une fine connaissance du terroir. Si bien que ce roman-là se lit d’un trait avec gourmandise. Il possède la capacité rare de nous alléger l’âme en nous laissant dans le cœur comme un air de printemps triste, n’en déplaise à notre cynisme de convenance…
Du compagnonnage entre le pâtre arlésien et le jeune italien, nous ne dirons pas plus, car il ne serait pas charitable d’abattre, ici, toutes les cartes d’un jeu dont les règles sont l’apanage d’un suspense romanesque qu’il convient de sauvegarder.
Entre le drame familial, le thriller psychologique et le récit d’une bouleversante initiation, l’histoire, aussi tendre que cruelle, nous place au carrefour de la poésie, de la géographie et de l’histoire, si je peux me permettre de faire écho à une phrase d’André Breton. À cet égard, l’évocation de l’abbaye de Montmajour, refuge des moines mauristes, le rappel des traditions pastorales, l’illustration de la geste gardiane témoignent d’une fine connaissance du terroir. Si bien que ce roman-là se lit d’un trait avec gourmandise. Il possède la capacité rare de nous alléger l’âme en nous laissant dans le cœur comme un air de printemps triste, n’en déplaise à notre cynisme de convenance…
- Le Berger et son étoile, par Béatrice Bourrier, éditions Lucien Souny, collection le Chant des pays, 176 pages, 2014.
Portrait
Les deux encriers de Daniel Crozes
 L’abondante bibliographie de Daniel Crozes contredit manifestement Ernest Miller Hemingway qui incitait à se retirer à temps du journalisme parce que, arguait-il, c’est une profession stérilisante pour un écrivain. Alternativement ou continûment romancier et journaliste, l’auteur aveyronnais (né à Camjac en 1958) ne cesse de tremper sa plume dans les deux encriers de sa condition dans le but de raconter l’histoire de son pays natal et de ses habitants. Qu’il explique comment les pains de roquefort sont affinés dans les caves naturelles de la falaise du Combalou, qu’il reprenne le chemin des foires d’Allanche (Cantal) ou de Lacalm (Aveyron) en compagnie des « toucheurs » de bœufs qui lui apprennent à tapoter la culotte d’une aubrac ou à inspecter aplombs et croupes d’une salers, qu’il ravive les souvenirs des couturières et piqueuses des manufactures millavoises, c’est l’expertise du journaliste, savant pédagogue, qui se laisse entendre dans la mise en perspective d’une époque et d’une société, autrement dit de l’histoire et de la géographie. Il puise son savoir aux meilleures sources et il exerce son esprit critique comme une forme supérieure de l’activité intellectuelle. L’abondante bibliographie de Daniel Crozes contredit manifestement Ernest Miller Hemingway qui incitait à se retirer à temps du journalisme parce que, arguait-il, c’est une profession stérilisante pour un écrivain. Alternativement ou continûment romancier et journaliste, l’auteur aveyronnais (né à Camjac en 1958) ne cesse de tremper sa plume dans les deux encriers de sa condition dans le but de raconter l’histoire de son pays natal et de ses habitants. Qu’il explique comment les pains de roquefort sont affinés dans les caves naturelles de la falaise du Combalou, qu’il reprenne le chemin des foires d’Allanche (Cantal) ou de Lacalm (Aveyron) en compagnie des « toucheurs » de bœufs qui lui apprennent à tapoter la culotte d’une aubrac ou à inspecter aplombs et croupes d’une salers, qu’il ravive les souvenirs des couturières et piqueuses des manufactures millavoises, c’est l’expertise du journaliste, savant pédagogue, qui se laisse entendre dans la mise en perspective d’une époque et d’une société, autrement dit de l’histoire et de la géographie. Il puise son savoir aux meilleures sources et il exerce son esprit critique comme une forme supérieure de l’activité intellectuelle.
 On ne lit pas seulement « Éleveurs au temps des champs de foire » et « Dans les fermes et caves du Roquefort » ; on les écoute : c’est l’écho de chants nostalgiques, la mélodie des sources sur les Grands Causses et les estives du Cézallier. On les regarde aussi, ces deux beaux livres, à travers le grain des photographies de Denis Barrau et de Jean Ribière, futurs objets de musée assurément, lieux de mémoire dont la traversée est jalonnée de souvenirs persistants. Dans « Une mère à aimer », ce qui intéresse l’auteur et ravit son lecteur, c’est le roman en tant qu’auscultation du cœur humain. On ne lit pas seulement « Éleveurs au temps des champs de foire » et « Dans les fermes et caves du Roquefort » ; on les écoute : c’est l’écho de chants nostalgiques, la mélodie des sources sur les Grands Causses et les estives du Cézallier. On les regarde aussi, ces deux beaux livres, à travers le grain des photographies de Denis Barrau et de Jean Ribière, futurs objets de musée assurément, lieux de mémoire dont la traversée est jalonnée de souvenirs persistants. Dans « Une mère à aimer », ce qui intéresse l’auteur et ravit son lecteur, c’est le roman en tant qu’auscultation du cœur humain.  De l’orphelinat Notre-Dame, à Rodez, aux Nouveautés Parisiennes, à Millau, en passant par le domaine de Campan bâti dans les monts du Lévézou, Jeanne Ducamp, jeune apprentie brodeuse, tente de percer l’énigme de ses origines. De l’orphelinat Notre-Dame, à Rodez, aux Nouveautés Parisiennes, à Millau, en passant par le domaine de Campan bâti dans les monts du Lévézou, Jeanne Ducamp, jeune apprentie brodeuse, tente de percer l’énigme de ses origines.
Habile historien et fin psychologue, Daniel Crozes procure tous les plaisirs de lecture, qu’il explore l’imaginaire pur ou bien qu’il cherche à cerner le réel avec le plus d’exactitude possible. Ceux qui ont lu Les Chapeaux d’Amélie et Mademoiselle Laguiole le savaient sans doute déjà mais, en découvrant « Une mère à aimer », ils s’apercevront que le romancier est aussi un habile horloger du mystère et qu’à sa façon il est devenu l’un des chroniqueurs privilégiés de la province rouergate au siècle précédent.
Bibliographie de Daniel Crozes
(éditions du Rouergue)
 – Éleveurs au temps des champs de foire, photographies de Denis Barrau, 160 pages, 2013 – Éleveurs au temps des champs de foire, photographies de Denis Barrau, 160 pages, 2013
– Dans les fermes et caves de Roquefort 1950-1960, photographies de Jean Ribière, sur une idée originale d’Hélène Tabès, collection la France des métiers, 48 pages, 2013
– Une mère à aimer, 288 pages, 2013
– Les Chapeaux d’Amélie, 314 pages, 2007
– Mademoiselle Laguiole, 316 pages, 2005.
Varia : la culture du riz en Camargue
« La culture du riz se développera après la guerre. Cultivée dès le XIXe siècle à la suite de l’endiguement de la Camargue et de la salinisation des sols, cette céréale n’était pas cultivée pour elle-même mais "pour rentabiliser les introductions d’eau douce nécessaires à d’autres cultures plus rentables", comme la vigne, implantée au moment où le vignoble français était détruit par le phylloxera (à partir de 1863) [Bernard Picon, 2008].
« Avec la pénurie alimentaire consécutive à la guerre, la culture du riz a bénéficié du Plan Marshall. Elle a intéressé non seulement des familles françaises en provenance du Maroc et d’Algérie, mais aussi de nombreux industriels ou négociants marseillais qui, dès le début de la guerre, avaient investi dans le foncier en Camargue et en Crau. La structure foncière latifundiaire de la Camargue leur offrait la possibilité d’investir dans de grandes propriétés "en une seule opération". L’historien Roger Livet souligne qu’à cette époque la mise en valeur était moins le fait d’agronomes que d’hommes d’affaires soucieux de valoriser un patrimoine nouvellement acquis. Déjà, la discrétion était de mise : à la difficulté d’identifier les frontières de ces premières acquisitions foncières s’ajoutait la quasi-invisibilité des investisseurs.
« Terre de colonisation agraire, la Camargue n’en était pas moins une région où les propriétaires fonciers n’habitaient que très rarement leurs mas. À côté des investisseurs issus de la noblesse arlésienne ou montpelliéraine, voire de la bourgeoisie industrielle marseillaise, on a vu rapidement émerger des investisseurs "étrangers", originaires de Paris ou de Lyon, et qui possédaient les plus grandes propriétés. La gestion technique et managériale de ces exploitations était très souvent confiée à des notables arlésiens. On appelait cela un "investissement danseuse", ce qui évoquait ces propriétés dans lesquelles s’exerçait une certaine activité agricole mais qui servaient avant tout de villégiature.
 « Entre 1960 et 1980, l’activité rizicole en Camargue a connu une période de déclin due à la réorganisation du marché européen du riz, à l’ouverture des frontières et à un manque relatif de compétitivité. Parce que la riziculture s’est révélée vitale à l’équilibre écologique de la région, dont les sols étaient de plus en plus menacés par la salinisation, un plan de relance a été mis en œuvre dès 1981, porté par les professionnels et les pouvoirs publics alors même que la production française du riz représentait un enjeu mineur au regard des volumes échangés sur les marchés internationaux. […] « Entre 1960 et 1980, l’activité rizicole en Camargue a connu une période de déclin due à la réorganisation du marché européen du riz, à l’ouverture des frontières et à un manque relatif de compétitivité. Parce que la riziculture s’est révélée vitale à l’équilibre écologique de la région, dont les sols étaient de plus en plus menacés par la salinisation, un plan de relance a été mis en œuvre dès 1981, porté par les professionnels et les pouvoirs publics alors même que la production française du riz représentait un enjeu mineur au regard des volumes échangés sur les marchés internationaux. […]
« Ce plan de relance a permis à la filière de s’organiser progressivement, de se structurer grâce à la création du Syndicat des riziculteurs de France et du Centre français du riz, et de s’affirmer grâce à l’obtention, en 2000, de l’indication géographique protégée (IGP), faisant du "riz de Camargue" un produit de terroir protégé, à la différence de son concurrent proche : le riz italien. Ce plan a également renforcé le rôle des investisseurs "étrangers", des régisseurs et de la figure du manager.
« Nombre de ces acteurs ont marqué l’histoire agraire de la région au point de la transformer en un "espace-objet", un "espace égaré entre natures". C’est le cas de l’industriel Paul Ricard, qui a acheté le Domaine de Méjanes en 1939 pour en faire une exploitation pilote. C’est également le cas du régisseur de ce domaine, Pierre Guillot, qui a joué un rôle important dans la relance du riz en participant à la création du Syndicat des riziculteurs, dont il est devenu le premier président. Aujourd’hui, le Domaine de Méjanes, regroupant 600 hectares en polyculture et 300 hectares de manade, s’affiche comme un lieu d’expérimentation de pratiques agricoles et touristiques respectueuses du patrimoine et des traditions locales. Citons enfin Luc Hoffman, héritier du groupe pharmaceutique Hoffman-La Roche et grand défenseur de la nature, qui a acheté le Domaine de la Tour de Vallat en 1948 pour en faire une réserve naturelle et une station de recherche biologique. »
Extrait de la revue « Études rurales », n° 190, juillet-décembre 2012, éditions des Hautes études en sciences sociales, 224 pages, « Les exploitations agricoles à l’épreuve de la firme - l’exemple de la Camargue », une étude de Geneviève Nguyen, économiste, et François Purseigle, sociologue, maîtres de conférences à l’Institut national polytechnique de Toulouse.
Carnet : l’automne en musique
Oh ! Que j’aime la définition que donne George Sand de la saison qui commence : « L’automne est un andante mélancolique et gracieux qui prépare admirablement le solennel adagio de l’hiver ».
Épousailles
Après vingt ans de concubinage, le sacristain a épousé sa vieille maîtresse :
– Vous vous êtes décidé alors ! lui lance un paroissien.
– Heu ! répond-il en baissant la voix, que voulez-vous… On commençait à jaser au presbytère !
Cinélittérature
Plus d’un scénariste pourrait lui envier sa manière, cette écriture nerveuse, économe et si démonstrative. « Un roman, s’il n’est pas long, prétend Francis Dannemark (auteur belge francophone né en 1955), c’est peut-être pour qu’il puisse être lu comme on regarde un film : d’une traite. Ce n’est pas un conseil, tout au plus le point de vue d’un écrivain qui aime le cinéma ».
14-Juillet
Après la sonnerie aux morts, le garde-champêtre impose le silence autour du monument aux morts. Le maire du village gardois lit son discours, plein de verve républicaine. Soudain, il trébuche sur un mot, rapproche le papier de ses yeux en le froissant nerveusement. En désespoir de cause, il se tourne vers le secrétaire général de mairie et lui demande :
– Qu’est-ce que vous avez écrit là ?
(Mardi 15 juillet 2014)
Lecture critique
France-Chine 2014
Hwang Chun-Ming nous donne des nouvelles de Taïwan
 Ses nouvelles sont invraisemblables comme la vérité. Hwang Chun-Ming (né à Luodong, Taïwan, en 1935) raconte en discontinu la vie quotidienne de Taïwan dont il distille les épisodes les plus inattendus comme on étale les cartes du tarot. On les mélangerait à nouveau que la carte fatidique sortirait encore : ici, elle porte les caractères si particuliers de l’île natale, ancienne Formose. La multiplicité des curiosités de l’auteur ajoutée aux nombreux métiers qu’il a exercés (instituteur, vendeur d’eaux minérales, opérateur radio dans l’armée, documentariste, entre autres spécialités) expliquent, s’il en est besoin, la richesse baroque de son univers romanesque qui puise au plus intime de la mentalité de la république de Chine et de ses habitants, si conditionnés par l’influence américaine et la société de consommation. Ses nouvelles sont invraisemblables comme la vérité. Hwang Chun-Ming (né à Luodong, Taïwan, en 1935) raconte en discontinu la vie quotidienne de Taïwan dont il distille les épisodes les plus inattendus comme on étale les cartes du tarot. On les mélangerait à nouveau que la carte fatidique sortirait encore : ici, elle porte les caractères si particuliers de l’île natale, ancienne Formose. La multiplicité des curiosités de l’auteur ajoutée aux nombreux métiers qu’il a exercés (instituteur, vendeur d’eaux minérales, opérateur radio dans l’armée, documentariste, entre autres spécialités) expliquent, s’il en est besoin, la richesse baroque de son univers romanesque qui puise au plus intime de la mentalité de la république de Chine et de ses habitants, si conditionnés par l’influence américaine et la société de consommation.
Des quatre nouvelles traduites du chinois par Matthieu Kolatte, j’ai adoré « La Grande Poupée de son fils » (1968) que le cinéaste Hou Hsiao-hsien a adaptée en 1983 pour le grand écran sous le titre « L’Homme-Sandwich ». Pour nourrir sa famille (sa femme A-Tsu et leur fils A-Liong), Khun-Tshiu se transforme en homme-sandwich au service de La Porte du bonheur, un cinéma de la ville. Étrangement accoutré de la tête aux pieds à la manière d’un officier européen du XIXe siècle, il maudit son labeur tout alimentaire qui le ridiculise aux yeux de la population et excite les moqueries des enfants de la rue. La même corrosion, une égale férocité marquent 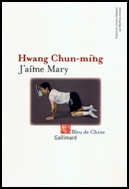 « J’aime Mary » (1977), la nouvelle éponyme du recueil qui met en scène David Chen alias Chen Shun-Te, cadre taïwanais d’une société américaine qui, dans le secret espoir de gravir les échelons de l’entreprise, recueille la chienne de son patron rentré aux États-Unis et ruine l’harmonie de son foyer. Dans « Le Goût des pommes » (1972), fable à l’ironie grinçante, un ouvrier du bâtiment, Chiang Ah-Fa, est renversé et mutilé par l’automobile d’un officier américain, le colonel Grant. Plutôt que la fatalité, la providence de l’accident de la circulation est invoquée par la famille miséreuse de la victime en raison du dédommagement pécuniaire qu’il induit. La morbidité se mêle au burlesque dans « Le Chapeau de Hsiao-Chi » (1975) où deux représentants de commerce pas très futés, Wang Wu-Hsiung et Lin Tsai-Fa, tentent d’écouler une immense batterie de cocotte-minute japonaises sous le regard de Hsiao-Chi, une fillette solitaire et énigmatique dont le père est officier. « J’aime Mary » (1977), la nouvelle éponyme du recueil qui met en scène David Chen alias Chen Shun-Te, cadre taïwanais d’une société américaine qui, dans le secret espoir de gravir les échelons de l’entreprise, recueille la chienne de son patron rentré aux États-Unis et ruine l’harmonie de son foyer. Dans « Le Goût des pommes » (1972), fable à l’ironie grinçante, un ouvrier du bâtiment, Chiang Ah-Fa, est renversé et mutilé par l’automobile d’un officier américain, le colonel Grant. Plutôt que la fatalité, la providence de l’accident de la circulation est invoquée par la famille miséreuse de la victime en raison du dédommagement pécuniaire qu’il induit. La morbidité se mêle au burlesque dans « Le Chapeau de Hsiao-Chi » (1975) où deux représentants de commerce pas très futés, Wang Wu-Hsiung et Lin Tsai-Fa, tentent d’écouler une immense batterie de cocotte-minute japonaises sous le regard de Hsiao-Chi, une fillette solitaire et énigmatique dont le père est officier.
Ce nouvelliste-là est un orfèvre dans l’analyse des sentiments et dans l’exploration de la destinée humaine. Au gré d’une géographie imprécise – ses décors s’inspirent vraisemblablement d’un quartier de Taipei à moins qu’il ne s’agisse de la ville de Yilan, au sud-est de la capitale –, il parvient à faire entrer un monde entier dans les limites d’une narration étroite. Outre les qualités de vivacité et d’exactitude, l’auteur dispose d’un regard acéré qui sait choisir parmi les détails et les images qui importent, instantanés subtils qui caractérisent l’écriture d’un véritable styliste.
– J’aime Mary, par Hwang Chun-Ming, éditions Gallimard, collection Bleu de Chine, 202 pages, 2014.
Portrait
Henri Roque ou l’Homme à cheval
précurseur du tourisme équestre
 Comme les musulmans vont à La Mecque, depuis des siècles, des millions de pèlerins empruntent les chemins de Compostelle à destination de la Galice espagnole afin d’honorer Jacques le Majeur qui y est inhumé. L’histoire prétend que l’apôtre du Christ, après avoir évangélisé la péninsule ibérique, retourna à Jérusalem où il aurait subi le martyr en l’an 44 avant que son corps ne soit rapatrié de Palestine en Espagne. En 1963, Henri Roque (Saint-Rémy-de-Provence, 31 octobre 1920-Eygalières, 10 janvier 1998) et quatre cavaliers quittent les Alpilles, non loin de la ville d’Arles, dans le but d’atteindre la ville sainte de Compostelle. Fils d’un médecin (1877-1952) auquel les Eygaliérois ont dédié une rue, il exploite à Eygalières les terres familiales (les Roque sont de grands propriétaires fonciers) rassemblées autour d’un mas appelé le « Moulin de Marc ». C’est là qu’il aménage une écurie à l’enseigne de L’Homme à cheval, titre d’un roman de Pierre Drieu La Rochelle (1943) qui l’a marqué. Enfant, il constate non sans mélancolie la lente disparition du cheval dans les campagnes au profit de la motorisation. À vingt ans, après des études médiocres (au collège des Jésuites d’Avignon notamment), il nourrit des sympathies pétainistes et entre un temps dans la milice. Catholique fervent, il vénère Charles Maurras et Frédéric Mistral. Après la guerre, il milite pour la préservation du cheval en réalisant, souvent sous les projecteurs des médias, de longues chevauchées visant à promouvoir la randonnée équestre. Comme les musulmans vont à La Mecque, depuis des siècles, des millions de pèlerins empruntent les chemins de Compostelle à destination de la Galice espagnole afin d’honorer Jacques le Majeur qui y est inhumé. L’histoire prétend que l’apôtre du Christ, après avoir évangélisé la péninsule ibérique, retourna à Jérusalem où il aurait subi le martyr en l’an 44 avant que son corps ne soit rapatrié de Palestine en Espagne. En 1963, Henri Roque (Saint-Rémy-de-Provence, 31 octobre 1920-Eygalières, 10 janvier 1998) et quatre cavaliers quittent les Alpilles, non loin de la ville d’Arles, dans le but d’atteindre la ville sainte de Compostelle. Fils d’un médecin (1877-1952) auquel les Eygaliérois ont dédié une rue, il exploite à Eygalières les terres familiales (les Roque sont de grands propriétaires fonciers) rassemblées autour d’un mas appelé le « Moulin de Marc ». C’est là qu’il aménage une écurie à l’enseigne de L’Homme à cheval, titre d’un roman de Pierre Drieu La Rochelle (1943) qui l’a marqué. Enfant, il constate non sans mélancolie la lente disparition du cheval dans les campagnes au profit de la motorisation. À vingt ans, après des études médiocres (au collège des Jésuites d’Avignon notamment), il nourrit des sympathies pétainistes et entre un temps dans la milice. Catholique fervent, il vénère Charles Maurras et Frédéric Mistral. Après la guerre, il milite pour la préservation du cheval en réalisant, souvent sous les projecteurs des médias, de longues chevauchées visant à promouvoir la randonnée équestre.
Avec les encouragements de Marie Mauron
À un grand reporteur de la revue Constellation, Marc-Ambroise Rendu, venu l’interviewer à Eygalières en 1961, il confie le projet de rallier Saint-Jacques de Compostelle à cheval, une idée née d’un raid hippique en Auvergne. Le 15 février de la même année, parti d’Eygalières, seul, à cheval (800 kilomètres en 21 jours !), il débarque un soir de mars au Palais des sports devant le ministre de la Jeunesse, Maurice Herzog, qui préside le 1er congrès du Cheval. « Que voulez-vous ? » demande le vainqueur de l’Annapurna à son interlocuteur resté en selle. « Vous exposer mes idées, Monsieur le Ministre, il faut démocratiser le cheval. » Et le palais des sports, plein à craquer, applaudit le cavalier provençal, à l’unisson du ministre…
L’automne suivant, il prépare la chevauchée compostellane et rend visite à sa voisine Marie Mauron, à Saint-Rémy-de-Provence. L’écrivain et poète, qui a publié Vers Saint-Jacques de Compostelle en 1957, connaît bien le saint lieu et elle encourage vivement le visiteur dans son entreprise. À Eygalières, les préparatifs s’accélèrent auxquels prennent part quatre compagnons qu’Henri Roque a choisis et convaincus de prendre part à l’équipée, à savoir Marc Ambroise-Rendu, le journaliste de Constellation (qui rejoint la rédaction du quotidien Le Monde en 1974), Pierre Barreaud de Lacour, antiquaire parisien (et chercheur de diamants au Venezuela !), Jean-Pierre Bernadac, libraire à Paris (et maréchal-ferrant à l’occasion), et René Frottier, comte de La Coste-Messelière, conservateur aux Archives nationales. Très entouré et escorté le long des chemins de France et d’Espagne, le groupe comptera momentanément un élément de plus avec Christine de Rivoyre, journaliste et écrivain que la direction du magazine féminin Marie Claire charge de « couvrir » l’événement.
Une chevauchée de 1460 kilomètres en 37 jours
Partis d’Eygalières le jeudi 23 mai 1963, jour de l’Ascension, montés sur des chevaux marocains de type barbe, les cinq cavaliers arrivent à Santiago de Compostela le vendredi 28 juin où les acclament des milliers de personnes. Nombre d’entre elles mesurent la portée symbolique de l’événement survenu quelques jours après la disparition (le 3 juin) d’Angelo Roncalli, le pape Jean XXIII. Les cinq français ont repris les chemins des pèlerins d’autrefois coupés depuis une trentaine d’années par la guerre civile, l’isolement du régime franquiste et la Seconde Guerre mondiale. Au XIIe siècle, c’était des Saintes-Maries que partaient les pèlerins pénitents, reconnaissables à la coquille de mer portée en guise d’insigne…
Henri Roque et ses quatre comparses ont relevé le défi de rallier Eygalières à Saint-Jacques-de-Compostelle, parcourant 1460 kilomètres en 37 jours, à raison de huit heures de monte quotidiennes, sans assistance technique et sans changer de cheval. Cavaliers du Poitou, d’Île-de-France, de Foix et de Provence, les cinq hommes sont parvenus au tombeau de Saint-Jacques après bien des péripéties, des tas de difficultés et beaucoup de joies. Dans le chœur de la cathédrale de Compostelle, devant l’évêque, Monseigneur Novoa Fuentes, Henri Roque adresse à leur arrivée une Offrande au saint apôtre : « Comme nos pères, déclare-t-il notamment, nous avons suivi la Voie lactée, le Chemin de saint Jacques, cette route étoilée que vous avez montrée à l’empereur Charlemagne pour venir libérer l’Espagne des Maures. Ce chemin français nous l’avons parcouru depuis notre petit village d’Eygalières en Provence, à travers le Languedoc, les Pyrénées, la Navarre, la Castille, le León, la Galice. Il y a 37 jours que nous chevauchons par monts et par vaux, sous le soleil et sous la pluie, parfois sous la grêle et le tonnerre mais, à présent, nos peines sont oubliées. Nous sommes devant votre tombeau, en communion avec tous les pèlerins des siècles passés. Leur foi et leurs souffrances nous avaient tracé la route. Comme eux, enfin, nous contemplons Compostelle, le champ de l’étoile, la porte du paradis. »
 Au terme d’un patient et minutieux travail d’enquête, Denise Péricard-Méa, médiéviste et universitaire (Paris I Panthéon-Sorbonne), a reconstitué le fameux pèlerinage de 1963, un récit de voyage devenu un journal à plusieurs voix, celles des participants de la chevauchée inaugurale et de quelques témoins. S’il était capital de souligner le rôle de pionnier et de précurseur d’Henri Roque dans la défense et l’illustration du tourisme équestre, discipline caractérisée par la découverte sensible de la nature et la sauvegarde des valeurs agrestes, il importait tout autant de rappeler la valeur patrimoniale des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle que le Conseil de l’Europe a qualifiés de Premier itinéraire culturel européen en 1987. Avant de les déclarer Patrimoine mondial de l’humanité, en 1993 (pour l’Espagne) et en 1998 (pour la France). En outre, cet ouvrage, « L’Homme à cheval sur les chemins de Compostelle 1963 », se lit avec un immense plaisir, à la manière d’un bon polar. Une raison suffisante pour que vous le lisiez cet automne, blotti dans un rocking-chair, sous un plaid écossais, en savourant un whisky pur malt, au coin d’un feu. Au terme d’un patient et minutieux travail d’enquête, Denise Péricard-Méa, médiéviste et universitaire (Paris I Panthéon-Sorbonne), a reconstitué le fameux pèlerinage de 1963, un récit de voyage devenu un journal à plusieurs voix, celles des participants de la chevauchée inaugurale et de quelques témoins. S’il était capital de souligner le rôle de pionnier et de précurseur d’Henri Roque dans la défense et l’illustration du tourisme équestre, discipline caractérisée par la découverte sensible de la nature et la sauvegarde des valeurs agrestes, il importait tout autant de rappeler la valeur patrimoniale des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle que le Conseil de l’Europe a qualifiés de Premier itinéraire culturel européen en 1987. Avant de les déclarer Patrimoine mondial de l’humanité, en 1993 (pour l’Espagne) et en 1998 (pour la France). En outre, cet ouvrage, « L’Homme à cheval sur les chemins de Compostelle 1963 », se lit avec un immense plaisir, à la manière d’un bon polar. Une raison suffisante pour que vous le lisiez cet automne, blotti dans un rocking-chair, sous un plaid écossais, en savourant un whisky pur malt, au coin d’un feu.
Remerciements
Denise Péricard-Méa mérite les compliments les plus vifs pour son excellent ouvrage ainsi que l’éditeur, C’est-à-dire éditions, de Forcalquier. Je remercie plus spécialement Bernard Boudineau, viticulteur et ancien maire de la cité gardoise de Fournès, qui m’a entretenu d’Henri Roque avec une passion communicative. Il est présent dans le récit pour avoir effectué le même périple au côté de l’Homme à cheval, en juillet 1971.
|
– L’Homme à cheval sur les chemins de Compostelle 1963, par Henri Roque, récit établi par Denise Péricard-Méa, docteur en histoire de l’université Paris I-Sorbonne et responsable des recherches à la fondation David Parou Saint-Jacques, avec l’autorisation et le soutien de Vanina Roque-Troisgros, fille d’Andrée et Henri Roque, C’est-à-dire éditions, collection Mille mots chuchotés, 368 pages, 2013.
Varia : les bonnes vertus des « mauvaises herbes »
 Dans son beau livre « Secrets de plantes et fleurs sauvages », Annick Montel-Kowalyszin entend sortir de l’oubli les fleurs sauvages qui ont été des plantes médicinales très appréciées avant d’être injustement méprisées et chassées. « D’abord, observe-t-elle, elles ont inspiré les hommes avec leurs superstitions, leurs croyances et leurs traditions. Ensuite, ces plantes que nous jugeons aujourd’hui comme des "mauvaises herbes" ont rendu de nombreux services à la médecine populaire : les guérisseurs d’antan connaissaient bien leurs vertus. » Dans ce recueil où l’auteure fait parler les plantes et fleurs elles-mêmes, nous avons retenu le texte consacré au Bleuet des champs ou Casse lunettes (Centaurea cyanus, de la famille des Astéracées), symbole de délicatesse et de timidité. Dans son beau livre « Secrets de plantes et fleurs sauvages », Annick Montel-Kowalyszin entend sortir de l’oubli les fleurs sauvages qui ont été des plantes médicinales très appréciées avant d’être injustement méprisées et chassées. « D’abord, observe-t-elle, elles ont inspiré les hommes avec leurs superstitions, leurs croyances et leurs traditions. Ensuite, ces plantes que nous jugeons aujourd’hui comme des "mauvaises herbes" ont rendu de nombreux services à la médecine populaire : les guérisseurs d’antan connaissaient bien leurs vertus. » Dans ce recueil où l’auteure fait parler les plantes et fleurs elles-mêmes, nous avons retenu le texte consacré au Bleuet des champs ou Casse lunettes (Centaurea cyanus, de la famille des Astéracées), symbole de délicatesse et de timidité.
« Dans la mythologie grecque, le centaure Chiron, blessé par Hercule d’une flèche empoisonnée, soigna sa blessure avec le suc d’un bleuet d’où mon nom latin de "centaurea". Mon deuxième nom latin "cyanus" vient de Cyanos, poète grec et chantre de la terre qui, après sa mort, fut métamorphosé par la déesse Flore en bleuet pour que l’humanité se souvienne de lui.
« Je faisais partie avec le coquelicot et la marguerite de la parure capillaire de Déméter, déesse de la terre et des moissons chez les Grecs. Au Moyen-Âge, j’étais une des fleurs associées à la fête de Lammas, le 1er août, célébration de la première moisson de l’année.
« Je suis le symbole commémoratif de l’Armistice du 11 novembre 1918 en rappel aux "bleuets", les soldats aux pantalons bleus de la Première Guerre mondiale. Je suis l’emblème de l’Allemagne et de l’Estonie. Mes fleurs donnent un pigment bleu utilisé comme encre et pour colorer les aquarelles (présentation, mythe et légende).
En décoction, ma fleur est utilisée en bains contre la conjonctivite, les orgelets et l’irritation des paupières d’où mon surnom de "casse lunettes". En décoction et en bain de bouche, ma fleur soigne la gingivite, le muguet et les aphtes. En infusion et en compresses, ma fleur raffermit et tonifie l’épiderme du visage (utilisation médicinale).
« Les pétales délicats de mes fleurs mis dans une salade ou un dessert apportent une saveur légère et douce. Mes fleurs peuvent être broyées avec du sucre pour des pâtisseries (Utilisation culinaire). »
Extrait de l’ouvrage « Secrets de plantes et fleurs sauvages - Recueil pour vos balades à travers la campagne », tome 1, par Annick Montel-Kowalyszin, éditions Édilivre, Classique collection, 95 pages, 2013.
Carnet : Pierre Ryckmans est mort, vive Simon Leys !
In memoriam
 Simon Leys est mort à Canberra, en Australie, le 11 août 2014, à l’âge de 79 ans. De son vrai nom Pierre Ryckmans, il avait choisi ce pseudonyme en référence au nom originel, Simon, de l’apôtre Pierre, et au roman René Leys (1922) de Victor Segalen, l’écrivain des « Stèles » qu’il admirait tout autant que Gilbert K. Chesterton, Joseph Conrad et Henri Michaux. Spécialiste de littérature classique chinoise, l’écrivain et universitaire bruxellois s’était fait connaître en 1971 avec Les Habits neufs du président Mao (éditions Champ libre), chronique virulente dénonçant la Révolution culturelle. À l’époque, l’ouvrage avait suscité une critique défavorable de la majorité des journaux et magazines nationaux et les esprits lucides se comptaient sur les doigts d’une seule main parmi lesquels René Etiemble, Jean-François Revel et René Vienet. Le Monde est allé jusqu’à qualifier son auteur de « colporteur de piètres ragots » et « d’agent de la CIA » ! Le quotidien reviendra sur ses propos en… 1979, encensant le sinologue sous la plume de Nicole Zand… Si l’on excepte sa femme, la Chinoise Hanfang, et leurs deux fils (jumeaux), Simon Leys aura cultivé trois passions dans sa vie, la Chine, la littérature et la mer. Élu en 1990 à l’Académie royale (des sciences, des lettres et des beaux-arts) de Belgique, au fauteuil de Georges Simenon, Simon Leys était surtout un grand styliste de la langue française (il écrivait aussi bien en anglais). Et il faut lire ou relire les essais consacrés à l’écrivain britannique George Orwell (Orwell ou l’horreur de la politique, éd. Hermann, 1984) et à l’intellectuel réformateur chinois Lu Xun (La Mauvaise Herbe de Lu Xun dans les plates-bandes officielles, Union générale d’éditions, 1975), deux personnages dont il partageait l’indépendance d’esprit et le courage politique. Simon Leys est mort à Canberra, en Australie, le 11 août 2014, à l’âge de 79 ans. De son vrai nom Pierre Ryckmans, il avait choisi ce pseudonyme en référence au nom originel, Simon, de l’apôtre Pierre, et au roman René Leys (1922) de Victor Segalen, l’écrivain des « Stèles » qu’il admirait tout autant que Gilbert K. Chesterton, Joseph Conrad et Henri Michaux. Spécialiste de littérature classique chinoise, l’écrivain et universitaire bruxellois s’était fait connaître en 1971 avec Les Habits neufs du président Mao (éditions Champ libre), chronique virulente dénonçant la Révolution culturelle. À l’époque, l’ouvrage avait suscité une critique défavorable de la majorité des journaux et magazines nationaux et les esprits lucides se comptaient sur les doigts d’une seule main parmi lesquels René Etiemble, Jean-François Revel et René Vienet. Le Monde est allé jusqu’à qualifier son auteur de « colporteur de piètres ragots » et « d’agent de la CIA » ! Le quotidien reviendra sur ses propos en… 1979, encensant le sinologue sous la plume de Nicole Zand… Si l’on excepte sa femme, la Chinoise Hanfang, et leurs deux fils (jumeaux), Simon Leys aura cultivé trois passions dans sa vie, la Chine, la littérature et la mer. Élu en 1990 à l’Académie royale (des sciences, des lettres et des beaux-arts) de Belgique, au fauteuil de Georges Simenon, Simon Leys était surtout un grand styliste de la langue française (il écrivait aussi bien en anglais). Et il faut lire ou relire les essais consacrés à l’écrivain britannique George Orwell (Orwell ou l’horreur de la politique, éd. Hermann, 1984) et à l’intellectuel réformateur chinois Lu Xun (La Mauvaise Herbe de Lu Xun dans les plates-bandes officielles, Union générale d’éditions, 1975), deux personnages dont il partageait l’indépendance d’esprit et le courage politique.
(Mercredi 13 août 2014)
Rebelle, impossible métier
La polémique suscitée par la venue en octobre dernier de Marcel Gauchet (Poilley, Manche, 1946) aux 17es Rendez-vous de l’histoire de Blois (le philosophe et historien se proposait d’ouvrir la conférence inaugurale de la manifestation par un débat sur le thème des « Rebelles »), a provoqué la réaction indignée de Régis Debray (né à Paris en 1940) sous la forme d’une tribune dans les colonnes du quotidien Le Monde. Je ne résiste pas au plaisir d’en livrer le passage suivant : « La trouée surréaliste a mis trente ans pour faire l’unanimité chez les étalagistes, sur les Grands Boulevards. C’est le temps qu’il a fallu à l’institution muséale pour phagocyter l’urinoir de Duchamp et transformer l’art brut de Dubuffet en fin du fin d’une collection. L’ex-anarchiste allemand qui horrifiait les bien-pensants de 1968, Cohn-Bendit, est la coqueluche de l’Europe néolibérale que se disputent les médias bien-pensants. Rothschild n’a pas trop tardé à remplacer Sartre à Libération, la BNF rachète à prix d’or les manuscrits de Guy Debord. Dure époque pour les séparatistes : les dominants tout sourire leur ouvrent les bras illico. Le non-conformisme est la clé du succès. Le jeu s’est renversé. »
(Le Monde, « Rebelle, impossible métier », rubrique Débats, dimanche 31 août-lundi 1er septembre 2014)
(Mercredi 3 septembre 2014)
Café du commerce
J’aime écouter au coin du zinc les propos des buveurs. C’est fou comme ils adorent le Café du commerce pour traiter de la politique, de la guerre en Syrie ou de je ne sais quoi : la signification de l’existence, la stupidité des gens qui passent, le championnat de football et le prix du paquet de cigarettes…
(Lundi 8 septembre 2014)
|
Billet d’humeur
Brevets d’invention
180 000, vous rendez-vous compte ! 180 000 brevets ont été déposés en France entre 1791 - année de création du « brevet d’invention » - et 1844 ! Placé sous le tutorat du ministère de l’Économie, du redressement productif et du numérique, l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a mis en ligne (presque) tous les documents afférents à ces brevets. Vous tapez Breguet (Abraham Louis) pour visionner la fiche synthétique relative au chronomètre (inventé en 1798), Fitch (John) pour le bateau à vapeur (1787), Jacquard (Joseph-Marie) pour le métier à tisser (1801), Leclanché (Georges) pour la pile sèche au bioxyde de manganèse (1866), Paul (Nicolas) pour le réverbère (1801), Sax (Antoine Joseph) pour le saxophone (1841). Tous les brevets des XVIIIe et XIXe siècles conservés par l’institut seront mis en ligne d’ici à 2015. Suivront les inventions brevetées au XXe et XXIe siècles. « L’invention, disait Thomas Edison, c’est 1% d’inspiration et 99% de transpiration. » Quant à Jean Racine, il considérait que « Toute invention consiste à faire quelque chose de rien ». N’importe qui peut avoir l’idée d’un avion sans hélice, d’un moteur à eau ou d’une soucoupe volante. Mais quels efforts titanesques impose leur concrétisation !
|
Lecture critique
« Labyrinthes » de Louis-Paul Guigues ou le sens métaphysique
 Rares, très rares, sont les romans susceptibles de procurer une nuit d’insomnie au lecteur, par la puissance d’évocation, la singularité d’invention et la représentation d’un monde (et d’une vie) fantastique(s) qu’ils peuvent révéler. Labyrinthes (1947) de Louis-Paul Guigues (Gênes, Italie, 28 mars 1902-Paris, 14 juillet 1996) est de ceux-là. Allez savoir pourquoi, en refermant le livre de l’éditeur suisse Infolio, ai-je été assailli par les images des sculptures du peintre Gustave Moreau (Paris, 1826-1898) ? Peut-être parce qu’à l’exemple du portraitiste des Salomés, l’écrivain donne chair à ses héroïnes en les modelant avec une sorte de crudité, voire de brutalité, creusant, tordant, exagérant leurs caractères ou les effaçant d’un coup de spatule… d’un trait de plume. Rares, très rares, sont les romans susceptibles de procurer une nuit d’insomnie au lecteur, par la puissance d’évocation, la singularité d’invention et la représentation d’un monde (et d’une vie) fantastique(s) qu’ils peuvent révéler. Labyrinthes (1947) de Louis-Paul Guigues (Gênes, Italie, 28 mars 1902-Paris, 14 juillet 1996) est de ceux-là. Allez savoir pourquoi, en refermant le livre de l’éditeur suisse Infolio, ai-je été assailli par les images des sculptures du peintre Gustave Moreau (Paris, 1826-1898) ? Peut-être parce qu’à l’exemple du portraitiste des Salomés, l’écrivain donne chair à ses héroïnes en les modelant avec une sorte de crudité, voire de brutalité, creusant, tordant, exagérant leurs caractères ou les effaçant d’un coup de spatule… d’un trait de plume.
Dans le château du Parc où il séjourne durant les vacances de Pentecôte, invité par le banquier Van Zeigen, un de ses commanditaires, le narrateur - un peintre de facture académique - s’éprend d’une inconnue qu’il ne connaît que par les traces, fugaces, qu’elle laisse de ses faits et gestes. Les échanges moraux et philosophiques qu’il entretient avec son complice Jean-Louis et le vieux poète Vausard, les relations nouées avec sa confidente Élisabeth, le souvenir de Claudia, un de ses modèles, dont il apprend la mort au fil des pages inclinent à une fable macabre et fantasque qui ourdit sa trame vénéneuse autour de l’obsédante présence de l’absente. L’ambiguïté des situations qui se télescopent au gré de la fantaisie la plus débridée nourrit un formidable suspense, tandis que les images funèbres sont chaque fois tempérées par des songes érotiques et luxurieux. On sort de la lecture de « Labyrinthes » un peu comme l’usager du métropolitain un soir de rentrée de vacances, secoué, froissé, chamboulé, un peu incrédule d’avoir été happé dans une mécanique de grande précision et de ne pas en avoir saisi tous les rouages. Car l’écriture égale la pensée, profuses et souveraines, chez Louis-Paul Guigues. Jean Paulhan ne s’est pas trompé en publiant ce livre-là dès 1947. L’œuvre de cet auteur – qui était aussi peintre et sculpteur – est restreinte mais suffisante à dire le génie métaphorique et l’imagination visionnaire. Elle est remarquable par ce qu’elle révèle, dans une perspective d’animaux empaillés du Muséum, dans la grâce d’une sylphide nue, dans la corruption d’un cadavre, le sens caché : le sens « métaphysique ».
– Labyrinthes, par Louis-Paul Guigues, postface d’Henri Raynal (écrivain et critique d’art), Infolio éditions, collection Maison neuve, 180 pages, 2013.
Portrait
La Patrouille de France
une grande dame de plus de 60 printemps 
Ils paraissent alignés aile contre aile, ces huit oiseaux de guerre, miroitant de tout leur métal ; huit oiseaux effilés comme des épées avec, sur leurs plans, leur fuselage, leurs dérives, une coulée bleu, blanc, rouge. Empennés comme des flèches, ils viennent de quitter l’herbe rase du champ d’aviation de la base aérienne 701 à Salon-de-Provence… Nommés leader (pilote titulaire d’au moins 1 500 heures de vol), intérieur droit, intérieur gauche, charognard, extérieur gauche, extérieur droit, premier solo, second solo, les huit pilotes et leurs Alpha Jet constituent la prestigieuse Patrouille de France (PAF) de l’armée de l’Air qui a célébré en 2013 son 60e anniversaire. Des livres dont une bande dessinée et un film, magnifiquement documentés, ont été réalisés à cette occasion évoquant la fabuleuse épopée de la PAF qui se poursuit de nos jours.
La Patrouille de France est née à… Alger
Le 17 mai 1953, lors d’un meeting aérien à Alger, quatre Republic F-84G « Thunderjet » (avion de fabrication américaine) de la 3e escadre de chasse de Reims, emmenée par le commandant Pierre Delachenal (1919-2011), provoquent l’enthousiasme d’un énorme public par un ballet aérien époustouflant dont les interprètes rivalisent d’audace. Commentateur du jour, le pilote et journaliste Jacques Noetinger annonce au micro : « Mesdames, Messieurs, la Patrouille de France vous salue ! ». Le nom est resté, entériné par l’état-major le 14 septembre suivant. Ainsi est née l’unité prestigieuse qui, en soixante années d’existence, est devenue un symbole puissant de l’armée de l’Air et des ailes françaises. Les historiens de l’aviation assurent que la célèbre PAF est l’héritière de la Patrouille d’Étampes (département de l’Essonne) dont les trois biplans Morane-Saulnier MS 230 la préfiguraient déjà, en 1931. Le 14 mai 2011, elle a d’ailleurs soufflé ses quatre-vingts bougies sur son terrain de l’aérodrome d’Étampes-Mondésir.
En 1954, la Patrouille de l’École de l’air (PEA) - autre appellation usitée - utilise pour ses spectacles aériens quatre Ouragan MD 450, premier avion de chasse à réaction de fabrication française (construit par Dassault Aviation), mis en œuvre par la 2e escadre de chasse basée à Dijon. La PEA rejoint successivement la 12e escadre de Cambrai (1955-1956), la 4e escadre de Bremgarten (Allemagne) en 1956, la 2e escadre de Dijon de 1957 à 1961 et la 7e escadre de Nancy en 1962 et 1963, cela avant de s’installer définitivement, en 1964, à Salon-de-Provence, base d’une des plus prestigieuses écoles de l’air européennes. L’Ouragan MD 450 est remplacé en 1956 par le Mystère IV A (de la même société Dassault Aviation). Dijon « produit » la PEA à quatre avions en 1957, à sept en 1958, puis à neuf au début de 1959. Cette année-là, le capitaine Bernard Capillon, futur chef d’état-major de l’armée de l’Air, conduit douze Mystère IVA dans le ciel africain à la faveur d’un voyage officiel du général de Gaulle. À Salon-de-Provence où l’unité prend, officiellement en 1964, le nom de Patrouille de France (PAF), six, neuf et jusqu’à onze appareils CM-170 Fouga Magister animent dès 1971 le spectacle aérien annuel de la PAF, équipe de présentation de l’armée de l’air au même titre que sa petite sœur, l’équipe de voltige créée en 1968. La célébration du 25e anniversaire de la PAF intervient le 9 juillet 1978 et la dernière présentation sur Fouga Magister est donnée le 16 septembre 1980. L’Alpha Jet équipe la PAF en 1981 : né de la coopération franco-allemande (sociétés Dassault, Breguet et Dornier), cet appareil entame en 2014 sa 33e année d’activité.
|
Quand les deux solos se croisent à 1200 km/h
Fantastiques guerriers ! Lors des galas de présentation (une cinquantaine dans l’année), les Athos (surnom attribué aux pilotes en 1964 d’après l’indicatif radio de la patrouille choisi par le lieutenant Kerguelen en 1957) volent en formation à huit avions de chasse à 2 mètres les uns des autres et à des vitesses oscillant entre 500 et 900 kilomètres à l’heure, durant 25 minutes, et subissant un facteur de charge de - 3 à + 7 G ! Les voltiges les plus acrobatiques, les plus inouïes, se succèdent, tels la « très grande flèche », le « croisillon », le « Rafale », le « Concorde », « Apollo », la « Super balance », le « Dard », le « Cygne », la « Fusée », le « Té », les « Deux poutres », « Ariane », le « losange » ou encore « Alpha ». S’ensuivent des figures toujours plébiscitées, comme la « bombe à huit », le « big bang », le « slalom », le « king twist », la « double volute », le « passage colonne », le célèbre « cœur » et la « shérif » (créée par Philippe Laloix, de la PAF 1993). Toujours spectaculaires, les manœuvres aussi pointues que l’évolution en formation carrée ou en losange, le virage horizontal en miroir, le passage en grande flèche, en diamant ou en canard, sont ponctuées de phases en vol vertical ou « sur le dos » qui s’achèvent parfois sur l’éclatement simultané des huit Alpha Jet en une gigantesque orchidée pyrotechnique et tricolore. Mais ce sont surtout les évitements en tonneau des deux solos qui dispensent les plus gros frissons au spectateur même averti : vertige assuré quand ils se croisent à une vitesse de rapprochement de près de 1200 km/h ! « Pour le show anniversaire de 2013, indique le leader, commandant Raphaël Nal, la PAF a innové avec le 60 géant dessiné avec les fumigènes tricolores ; elle a aussi expérimenté une nouvelle figure à quatre avions appelée "Ziggy" et repris la "Corkscrew", une formation créée par son homologue britannique, les Red Arrows. »
|
Dans les coulisses des meetings
À 8 généralement en meeting, la PAF évolue à 9 quand elle ouvre le défilé aérien militaire du 14-Juillet devant le président de la République. Depuis 1989, elle adopte la formation « big nine » au moment d’imprimer le drapeau tricolore à neuf avions dans le ciel de Paris, à la verticale des Champs-Élysées. Moment d’exception, résultat d’un travail d’équipe extraordinaire, d’une mise en scène bien réglée, d’entraînements inlassables, d’une discipline de l’œil, du pied et de la main parfois en conflit avec les réflexes naturels : la beauté du spectacle laisse dans l’ombre les mécaniciens sans lesquels la PAF ne serait pas ce qu’elle est. Forte de trente-neuf éléments, l’équipe de maintenance est constituée de spécialistes « armement », « avionique », « vecteur », « environnement aéronautique » et de deux officiers mécaniciens. Depuis 1986, elle dispose d’un avion-atelier, le C-160 Transall, pour le suivi des Alpha Jet engagés dans chaque meeting (huit avions et deux en secours). Les mécanos accusent un taux d’activité très élevé, car les pilotes de la PAF totalisent entre 300 et 350 heures de vol par an.
 « Une présentation complète de la PAF s’articule en deux parties d’égale durée, explique le lieutenant-colonel Bruno Bézier, directeur des équipes de présentation de l’armée de l’air. La première partie, conduite à la voix exclusive du leader, s’intitule le "ruban". Elle se caractérise par de belles figures lentes, réalisées en formations serrées de huit appareils. Le second temps fort est appelé "synchronisation". Il correspond à des évolutions plus dynamiques et percutantes effectuées en groupe de deux, quatre ou six avions. » « Une présentation complète de la PAF s’articule en deux parties d’égale durée, explique le lieutenant-colonel Bruno Bézier, directeur des équipes de présentation de l’armée de l’air. La première partie, conduite à la voix exclusive du leader, s’intitule le "ruban". Elle se caractérise par de belles figures lentes, réalisées en formations serrées de huit appareils. Le second temps fort est appelé "synchronisation". Il correspond à des évolutions plus dynamiques et percutantes effectuées en groupe de deux, quatre ou six avions. »
Aux huit pilotes s’ajoute un remplaçant, c’est celui qui possède le plus d’expérience, susceptible de remplacer chaque équipier au pied levé. La PAF se renouvelle chaque année avec trois nouveaux pilotes pour lesquels six mois d’entraînement intensif sont nécessaires, à raison de deux, voire trois vols d’entraînement quotidiens en période hivernale. Dans la perspective de démonstrations au-dessus des étendues maritimes, la Patrouille, chaque année au mois d’avril, s’entraîne à Solenzara, base militaire côtière de la Corse, afin de se familiariser avec le survol maritime qui amène les pilotes à transposer mentalement des repères terrestres vers des secteurs qui en sont totalement dépourvus. La Patrouille de France s’adapte aux conditions météo en proposant trois présentations possibles : « beau temps » lorsque le plafond est supérieur à 4500 pieds (1 800 m), « intermédiaire » avec un plafond compris en 2 500 (830 m) et 4500 pieds et « mauvais temps » si le plafond est compris entre 1 000 pieds (330 m) et 2 500 pieds.
Julien Clerc, premier invité de marque
En 1968, le chanteur Julien Clerc vole à bord d’un des Fouga Magister de la PAF : c’est la première personnalité extérieure à entrer dans l’histoire médiatique de la PAF, une initiative originale visant à braquer le projecteur sur ces chevaliers des temps modernes ainsi que sur les multiples actions caritatives et humanitaires qu’ils soutiennent toute l’année. Au titre d’une fonction ou d’une notoriété particulière, des personnalités publiques sont invitées à parrainer chaque programme annuel de la PAF (spectacles aériens donnés en France et en Europe de mai à octobre). Citons : Alain Delon (1988), Michel Drucker (1990), Jean-Claude Killy (1991), Albert de Monaco (1993), David Douillet (2001), Carla Bruni-Sarkozy (2010) et Thierry Dusautoir (2012). Virginie Guyot, dite « Gini », est la seule femme pilote de chasse à intégrer, en 2000, la PAF : elle en devient le leader en 2010, et c’est à ce titre qu’elle présente ses équipiers à la première dame de France, Carla Bruni-Sarkozy.
En 2013, le grand show du 60e anniversaire est suivi par quelque 120 000 personnes dans le ciel de Salon-de-Provence. La PAF s’y produit en compagnie de six patrouilles européennes : les Frecce Tricolori italiens, la Patrulla Aguila espagnole, la Team Iskra polonaise, les Red Arrows britanniques, les Diables Rouges belges et la Patrouille Suisse.  Le leader de la PAF 2013 est le commandant Raphaël Nal (aujourd’hui lieutenant-colonel) : à la fin de l’année, il passe le relais au commandant Jean-Michel Herpin, leader 2014. L’histoire ou la légende peut continuer.
Le leader de la PAF 2013 est le commandant Raphaël Nal (aujourd’hui lieutenant-colonel) : à la fin de l’année, il passe le relais au commandant Jean-Michel Herpin, leader 2014. L’histoire ou la légende peut continuer.
Spectaculaire photographie : le pilote et photographe Alexandre Paringaux est au premier plan ; derrière lui, huit Alpha Jet de la PAF et le nouvel avion de transport militaire Atlas A 400 M qui surplombe l’ensemble.
Bibliographie
– La Patrouille de France - 60 ans à ciel ouvert, textes du capitaine Yannick Quichaud (officier de communication des équipes de présentation de l’armée de l’air), photographies de Katsuhiko Tokunaga, Rémy Michelin et Alexandre Paringaux, texte du capitaine Yannick Quichaud, avec le concours du colonel Pierre-Alain Antoine et de François Blanc, Zéphyr éditions, 176 pages, 2013 ;
– Patrouille de France - L’épopée, scénario de Franck Coste et Éric Stoffel, dessins de Frédéric Allali, Roland Barthélémy, Thierry Boulanger, JJ. Dzialowski, Éric Godeau, Thierry Martinet, René Mazyn, Yves Plateau, Éric Stoffel et Marcel Uderzo, Idées Plus éditions Passion BD, Plein Vol collection, 74 pages, 2012 ;
– Patrouille de France, un film d’Éric Magnan, raconté par Michel Drucker, coffret 2 DVD, 62 minutes et 180 mn, Airborne Films, 2013 ;
– Double Bang, du Colonel Konstantin Wladimir Rozanoff, suivi de La Patrouille de France, par Marcel Jullian, éditions Presses de la Cité, 312 pages, 1962.
Varia : la raison de peindre de Fan Yang
France-Chine 2014
« Originaire de Nantong (province du Jiangsu), Fan Yang est né en janvier 1955, à Hongkong. Il est entré à l’Institut de recherche d’art et d’artisanat de sa ville natale en 1972. "Apprendre la peinture, l’artisanat folklorique et le découpage du papier, dessiner les esquisses des broderies, imiter les œuvres des maîtres du passé, s’exercer au croquis… Il s’agissait d’exercices très rigoureux", rappelle le peintre.
« En 1978, il est admis à la faculté des beaux-arts de l’Institut normal de Nanjing, dans lequel enseignaient de grands peintres, tels Lu Fengzi (1886-1959), Xu Beihong (1895-1953), Chen Zhifo (1896-1962), Fu Baoshi (1904-1965) et Lu Sibai (1905-1973). Au cours de ces quatre années d’études, Fan Yang a appris le croquis, la calligraphie et la peinture traditionnelle chinoise, mais il s’est initié aussi aux beaux-arts occidentaux.
 Après l’obtention de son diplôme, il demeura dans cette école en qualité de professeur. Quelques années plus tard, il fut nommé directeur de la faculté des beaux-arts relevant de l’Université normale de Nanjing.
Après l’obtention de son diplôme, il demeura dans cette école en qualité de professeur. Quelques années plus tard, il fut nommé directeur de la faculté des beaux-arts relevant de l’Université normale de Nanjing.
« Aujourd’hui, Fan Yang assume plusieurs fonctions : il est à la fois directeur adjoint de l’Académie de peinture traditionnelle qui dépend de l’Académie nationale de peinture et le directeur de l’Académie de peinture et de calligraphie de Nanjing. […] Fort d’une compréhension très personnelle de la peinture traditionnelle au style raffiné et puissant, il s’inspire des peintures de la dynastie des Song (960-1279) et des Yuan (1271-1368), ainsi que des œuvres de Huang Binhong (1865-1955). […] Il a également conçu une série de timbres-poste dont certains représentent le lac Taihu (1995) et les paysages pittoresques de Putuo (1999), émis par la Poste chinoise.
« "Je ne sais rien faire d’autre que peindre, confesse-t-il. Et je continuerai à peindre jusqu’à mon dernier soupir, sans penser à la richesse. Pour moi, chaque œuvre relève un nouveau défi et m’apporte une meilleure compréhension du monde." »
Extraits de l’article de Lu Hang, « Parfum philosophique des peintures de Fan Yang », dans la revue « La Chine au présent », n° 7, juillet 2014.
Carnet : Kafka, Meyrink et Prague
Frantz Kafka, savez-vous, est né à Prague (en 1883), dans la rue des Alchimistes ! En tchèque, son patronyme signifie « choucas », cet oiseau noir au bec jaune voisin de la corneille qui fore son nid au flanc des parois rocheuses. « Il n’est pas de ville au monde à laquelle on aimerait autant tourner le dos quand on y habite, observe Gustav Meyrink (1868-1932) à propos de la cité pragoise, et il n’en est aucune dont l’on ressente aussi fort la nostalgie à peine l’a-t-on quittée ». Écrivain autrichien de langue allemande, il est l’auteur du roman fantastique « Le Golem » (1915) où un tailleur de pierres précieuses du ghetto de Prague, Athanasius Pernath, renoue avec son inquiétant passé au terme d’une obsédante quête initiatique. Inspiré des légendes juives, le Golem est une figurine de glaise modelée par de pieux rabbins qui parvient à s’animer sous les artifices de la kabbale et provoque des catastrophes. L’automate d’argile personnifie les automates humains que crée la société moderne avec ses impitoyables exigences : la fable se rapproche des automates souvent maléfiques de l’écrivain allemand E.T.A. Hoffmann (1776-1822). Kafka reconnaît avoir été fortement influencé par ses deux confrères.
L’enfer de Verdun
Mon grand-père paternel, Charles Louis Darras (1892-1953) avait survécu à l’enfer de Verdun. Il n’en parlait jamais. On ne sait toujours pas combien d’hommes ont péri. Les historiens se partagent sur les chiffres, qui varient parfois du simple au double. Alors 150 000, 300 000, 700 000 ? On connaît mieux le nombre d’obus tombés, de pièces d’artillerie déployées que la quantité de pauvres hères qu’ils ont fauchés…
Cher maître…
Stefan Zweig (1881-1942) a traduit Clérambault et d’autres textes de Romain Rolland (1866-1944). Le prosateur français et son disciple autrichien ont entretenu une amitié de trente ans, en dépit des ruptures engendrées par les guerres et les désaccords politiques. Leur correspondance est édifiante et passionnée (Correspondance 1910-1919 de Stefan Zweig et Romain Rolland, Albin Michel, 640 pages, 2014). Zweig rédigea la biographie de celui qu’il nomma longtemps « cher Maître et ami », jusqu’à ce que Rolland lui écrivit un jour : « Ne m’appelez plus Maître… Tous, apprentis ! ».
(Samedi 13 septembre 2014)
|
Billet d’humeur
La magie de la retraite
Je ris encore à l’évocation d’un vieil ami de Crevoux, dans les Hautes-Alpes, qui se plaisait à m’écouter lui raconter les petites histoires de mon activité journalistique. La rencontre de célébrités, écrivains ou chanteurs de variétés en particulier, le ravissait. Un jour, n’y tenant plus, il me questionna : « Mais à part ce que tu me racontes, qu’est-ce que tu fais comme métier ? »… Un autre soir, comme je lui annonçais mon intention d’interrompre mes cours à l’université d’Aix-Marseille. « Comment, me dit-il stupéfait, tu renoncerais à ta retraite ? » Ce cher montagnard m’en parlait souvent, de la retraite, comme une opération de haute magie qui transforme un maître d’école en rentier.
|
Lecture critique
Alexandre Lafon raconte la camaraderie au front
Centenaire 14-18
 À présent que les derniers « poilus » ont disparu (Lazare Ponticelli, mort en 2008, en était l’ultime survivant), les historiens se retrouvent quasiment seuls en scène pour réécrire la Grande Guerre. Leurs sources ? Les archives militaires et civiles, le contrôle postal (lettres et cartes postales illustrées) et les journaux de tranchées (et carnets de guerre). Disciple de l’historien Rémy Cazals (qui anime le Collectif de recherche international et de débat sur la guerre de 1914-1918), Alexandre Lafon (né à Nancy en 1974) y a largement puisé pour mener à bien l’écriture des quelque cinq cent cinquante pages de « La Camaraderie au front 1914-1918 ». À présent que les derniers « poilus » ont disparu (Lazare Ponticelli, mort en 2008, en était l’ultime survivant), les historiens se retrouvent quasiment seuls en scène pour réécrire la Grande Guerre. Leurs sources ? Les archives militaires et civiles, le contrôle postal (lettres et cartes postales illustrées) et les journaux de tranchées (et carnets de guerre). Disciple de l’historien Rémy Cazals (qui anime le Collectif de recherche international et de débat sur la guerre de 1914-1918), Alexandre Lafon (né à Nancy en 1974) y a largement puisé pour mener à bien l’écriture des quelque cinq cent cinquante pages de « La Camaraderie au front 1914-1918 ».
En analysant la notion de camaraderie sur le front de la Première Guerre mondiale, le chercheur et professeur d’histoire-géographie (docteur en histoire contemporaine de l’université de Toulouse 2-Le Mirail) entend restituer une « mémoire juste » des relations entre les soldats à partir des témoignages des intéressés eux-mêmes. Il en agence la profusion et la diversité selon une narration didactique, non sans avoir passé les récits au filtre de son expertise, de façon à éviter une relation biaisée par les préjugés idéologiques, antimilitaristes ou va-t-en-guerre. Disséqués et commentés, les témoignages émanent des fantassins pour 72 % d’entre eux, agriculteurs, ouvriers ou lettrés, âgés de 18 à 48 ans, parmi lesquels 48 % sont titulaires de diplômes universitaires. Les militaires qui sont en majorité des conscrits se nomment camarades entre eux dans la tranchée et dans la chambrée, durant les repas et les repos, au gré de tous les actes d’une vie anormale. S’il est vrai que la camaraderie n’est convoquée par la hiérarchie et l’état-major que pour montrer le puissant ressort moral de la troupe pleine de cohésion et d’esprit de sacrifice, elle appelle la fraternité, la solidarité et l’égalité chez les combattants qui subissent dès août 1914 l’épreuve du feu, métaphore de la violence de guerre industrialisée, vécue par les acteurs comme une épreuve à la fois personnelle et collective. La présence du mot « camarade » dans les témoignages renvoie à la dimension d’appartenance à l’institution qui fonde le rapprochement des hommes sous l’uniforme bleu horizon. Mais ce ne sont pas, souligne l’auteur, des guerriers au sens de combattants professionnels de la guerre, mais des "civils" faisant comme ils peuvent, seuls ou avec les "camarades". En relation ou non avec la mémoire familiale, des affinités sociales ou de caractères créent des liens plus étroits, plus affectifs parfois, entre les « camarades » du front, confirmant, s’il en était besoin, les différents niveaux de la « camaraderie ».
Au nombre des témoins, le lecteur croise, au fil des pages, les incontournables écrivains Alain-Fournier, Henri Barbusse, Blaise Cendrars, Lucien Destouches (futur Céline), Roland Dorgelès et Maurice Genevoix. Leurs plumes ne suffisent pas, loin s’en faut, à décrire la réalité des pratiques de guerre et la véracité de la vie quotidienne des « poilus ». La perspective s’éclaircit quand Alexandre Lafon donne la parole à l’instituteur Zacharie Baqué, au tonnelier Louis Barthas, à l’employé de banque Octave Bouyssou, au clerc de notaire Romain Darchy, au métreur en bâtiment Gaston Lavy, au musicien-brancardier Maurice Maréchal, au maçon Alphonse Thuillier et au maréchal des logis Albert Viard : chaque camarade combattant apparaît alors en homme ordinaire, ni courageux, ni lâche, mais tâchant de naviguer comme il le peut dans une configuration « surprenante », face à la peur ou à l’éloignement des siens.
- La Camaraderie au front 1914-1918, par Alexandre Lafon, coédition Armand Colin et Ministère de la Défense, 542 pages, 2014.
Portrait
Angelo Rinaldi ou les incertitudes de la mémoire
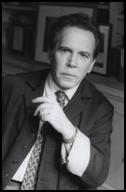 Je viens de relire « Les Roses de Pline » (1987), septième roman d’un homme qui, comme le disait le philosophe roumain Mircéa Eliade (1907-1986), cherche « à être capable de pénétrer le sens caché de ses errances et de les comprendre comme autant de preuves initiatiques qui le ramènent vers le Centre ». Je viens de relire « Les Roses de Pline » (1987), septième roman d’un homme qui, comme le disait le philosophe roumain Mircéa Eliade (1907-1986), cherche « à être capable de pénétrer le sens caché de ses errances et de les comprendre comme autant de preuves initiatiques qui le ramènent vers le Centre ».
Voyager inlassablement dans le temps et dans l’espace à la recherche de soi-même reste le lot d’Angelo Rinaldi (né à Bastia en 1940) dont la sensibilité écorchée condamne les narrateurs de ses récits à la solitude et à une irrémédiable tristesse.
Comme « La Loge du gouverneur » (1969, prix Fénéon), « La Maison des Atlantes » (1971, prix Fémina), « Les Jardins du Consulat » (1985), « Les Roses de Pline » (1990) plonge ses racines dans la société corse et donne de la bourgeoisie insulaire une peinture très incisive. Comme eux encore, il s’articule autour de la relation présent-passé et n’éclaire le présent que par les feux de la mémoire. Mais, ici comme là, il s’agit moins de sacrifier à la nostalgie des souvenirs ou de ressusciter un temps perdu, que de pratiquer l’archéologie de caractères multiples.
Un art subtil du glissement
 Rappelé à son passé, à son enfance corse et à ses débuts parisiens, par le décès d’une adolescente, fille de Marthe Dieudonné, une amie du temps de sa jeunesse à Saint-Germain-des-Prés, et par l’arrivée de Rose, sa gouvernante et tutrice à la mort de ses parents, le narrateur se remémore le quotidien de la Villa des Palmiers où la blancheur des roses de Pline envahit toujours les treillis du parc… Rappelé à son passé, à son enfance corse et à ses débuts parisiens, par le décès d’une adolescente, fille de Marthe Dieudonné, une amie du temps de sa jeunesse à Saint-Germain-des-Prés, et par l’arrivée de Rose, sa gouvernante et tutrice à la mort de ses parents, le narrateur se remémore le quotidien de la Villa des Palmiers où la blancheur des roses de Pline envahit toujours les treillis du parc…
Rose n’a pas revu son protégé depuis vingt ans. Les obsèques de Marie Dieudonné au Père-Lachaise lui donnent, certes, le prétexte de rendre hommage à l’oncle Alexandre, poilu mort pour la France, et de consulter un médecin spécialiste… Mais elles lui permettent aussi de corriger chez le quadragénaire les certitudes d’une mémoire fondée sur un réseau de souvenirs déformés, magnifiés ou noircis, de faits incomplètement rapportés, d’anecdotes surprises en écoutant aux portes.
Tout cela n’est jamais souligné mais suggéré avec un art subtil de l’alternance, du glissement, du dérapage. Dans un mouvement constant qui oscille du présent au passé, qui confronte différentes époques et transforme immédiatement en passé le présent qui s’achève : les images, les situations, les personnages se croisent, s’appellent, s’éclairent ou s’annulent.
Cette syntaxe unique…
Ce mouvement inlassable qui anime les personnages de cet auteur et les extirpe progressivement de leur ombre 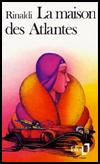 procède d’une écriture singulièrement maîtrisée et dans laquelle le lecteur exigeant reconnaît « cette syntaxe unique, qui dans un roman est pour son personnage la seule forme du destin ». Critique aussi exigeant que féroce, l’académicien (élu en 2001 au fauteuil de José Cabanis) reste un de nos grands stylistes. Entre les incessants jeux de miroirs de l’essayiste et le sens si aigu de l’observation du romancier, on se laisse porter par l’ample souffle lyrique qui anime ses récits, par la beauté des paysages, sombres tempêtes ou lumière radieuse, par l’orchestration musicale des thématiques, par la détresse ou la violence de ses personnages dont il ne se limite pas à analyser les sentiments mais à chercher, aux limites de la conscience, les actions intérieures. procède d’une écriture singulièrement maîtrisée et dans laquelle le lecteur exigeant reconnaît « cette syntaxe unique, qui dans un roman est pour son personnage la seule forme du destin ». Critique aussi exigeant que féroce, l’académicien (élu en 2001 au fauteuil de José Cabanis) reste un de nos grands stylistes. Entre les incessants jeux de miroirs de l’essayiste et le sens si aigu de l’observation du romancier, on se laisse porter par l’ample souffle lyrique qui anime ses récits, par la beauté des paysages, sombres tempêtes ou lumière radieuse, par l’orchestration musicale des thématiques, par la détresse ou la violence de ses personnages dont il ne se limite pas à analyser les sentiments mais à chercher, aux limites de la conscience, les actions intérieures.

Bibliographie
- La Maison des Atlantes, Folio Gallimard, 384 pages, 1973 ;
- La Loge du gouverneur, éditions Denoël, 254 pages, 1981 ;
- Les Jardins du Consulat, Folio Gallimard, 288 pages, 1986 ;
- Les Roses de Pline, Folio Gallimard, 350 pages, 1990 ;
- Tout ce que je sais de Marie, Folio Gallimard, 320 pages, 2004.
Varia : l’espérance de vie va doubler
 « La vague des NBIC est bien plus rapide que prévu. C’est pourquoi elle inquiète. Les nanotechnologies (N), la biologie (B), l’informatique (I) et les sciences cognitives - intelligence artificielle et sciences du cerveau - (C) progressent et convergent. Les résultats obtenus en laboratoires ne sont pas encore très visibles. Nous sommes pourtant à la veille d’avancées sidérantes. Les découvertes dans un domaine servent aux recherches dans un autre. Cette synergie décuple la puissance de la recherche. Tout va très vite. Par exemple, le séquençage de l’ADN (acide désoxyribonucléique) est devenu presque banal. Il coûte 1000 dollars aujourd’hui, alors que la même opération valait trois milliards il y a dix ans ! « La vague des NBIC est bien plus rapide que prévu. C’est pourquoi elle inquiète. Les nanotechnologies (N), la biologie (B), l’informatique (I) et les sciences cognitives - intelligence artificielle et sciences du cerveau - (C) progressent et convergent. Les résultats obtenus en laboratoires ne sont pas encore très visibles. Nous sommes pourtant à la veille d’avancées sidérantes. Les découvertes dans un domaine servent aux recherches dans un autre. Cette synergie décuple la puissance de la recherche. Tout va très vite. Par exemple, le séquençage de l’ADN (acide désoxyribonucléique) est devenu presque banal. Il coûte 1000 dollars aujourd’hui, alors que la même opération valait trois milliards il y a dix ans !
« La perspective, c’est un nouvel allongement de l’espérance de vie. Or, la peur de la mort est sans doute le sentiment le plus partagé au monde. L’espérance de vie a déjà plus que triplé, passant en France de 25 ans en 1750 à plus de 80 ans aujourd’hui. Elle croît désormais de trois mois par an. Il est assez probable qu’au minimum, elle doublera au cours de ce siècle. On assiste donc bien à une révolution du vivant qui va bouleverser nos vies. C’est forcément anxiogène, mais les perspectives de ce qu’on appelle le transhumanisme sont exaltantes. »
Dans un propos de Laurent Alexandre, médecin et chirurgien, spécialiste du décodage du génome, diplômé de Sciences-Po, d’HEC et de l’ENA. Extrait du supplément spécial de Clés Actualités, été 2014, sous le titre « Le Progrès a-t-il un avenir ? ».
|





