 Disparition : Roger Curel a rejoint son étoile
Disparition : Roger Curel a rejoint son étoile
Au matin du samedi 28 mai 2016, Valérie Gros-Rosfelder m’a prévenu que son père venait de rendre son dernier soupir à Vaivre-et-Montoille, en Haute-Saône, à la maison de retraite « Le Doyenné du Lac » où il résidait depuis le début de l’année. Écrivain, journaliste et scénariste, assistant de l’ethnologue Jean Rouch dans les missions africaines « Griaule » et « Niger », soldat des Forces françaises libres, ancien de la 2e Division blindée du général Leclerc, Roger Rosfelder alias Roger Curel, né le mardi 29 mai 1923 à Saïda, en Algérie, était l’auteur de quelque vingt romans et récits. Son deuxième ouvrage, « Le Géant du grand fleuve » (éditions René Julliard, 1956), lui avait valu d’être sélectionné pour le prix Théophraste Renaudot décerné cette année-là à André Perrin pour son récit « Le Père » ; quatre jurés avaient plébiscité le roman de Roger Curel, « un Moby Dick africain », selon ses mots, qui narre les aventures épiques des chasseurs d’hippopotames dans les eaux du fleuve Niger. Il était aussi l’auteur d’un merveilleux guide géographique et littéraire sur Madrid (éditions Rencontre, 1964), d’une chronique magistrale, « Éloge de la colonie - Un usuel de la destruction » (éditions Climats, 1992), et d’un recueil de nouvelles, « Le Maître des bonsaï », que Françoise Mingot-Tauran devait publier cette année à l’enseigne des éditions Wallâda. Ami des écrivains Emmanuel Roblès et Kateb Yacine, du metteur en scène et directeur du théâtre algérien Mohamed Boudia et de l’ethnologue Jean Servier, Roger Rosfelder s’était engagé pour la cause algérienne. Une longue amitié d’une trentaine d’années nous liait et j’avais commencé ces derniers mois la rédaction de sa biographie intitulée « Le Marcheur à l’étoile - La vie de Roger Curel », un ouvrage qui devrait être publié dans le courant de l’année 2017. Dans ces moments douloureux, je pense à Valérie et à son mari Emmanuel ainsi qu’à leurs deux filles, Inès et Elsa, dont le grand-père, Roger Rosfelder, aimait à me louer les progrès scolaires. Non sans émotion, je me souviens de ce qu’il m’écrivait, dans les années quatre-vingt, au tout début de notre long compagnonnage : « Un sanglier du Luberon ! c’est ainsi que je me vois entre chênes et garrigue, solitaire et méditatif. N’oubliez pas, si vous passez dans le coin, la table est mise, le vin chambré, il suffit de me le dire la veille. »
(Mardi 31 mai 2016)
Roger Rosfelder-Curel à Bonnieux le 1er septembre 2015
© Photo Daniel Cyr Lemaire
Vous pouvez lire un portrait de Roger Rosfelder dans mes Papiers collés du Printemps 2012. Ainsi qu’une étude littéraire consacrée à Roger Curel sur le site numérique du magazine Les Carnets d’Eucharis, dirigé et animé par Nathalie Riera, à la date du 28 décembre 2010 : http://lescarnetsdeucharis.hautetfort.com
Dans l’atelier du peintre
J’aime fureter parmi les carnets de dessin de mon ami Guy Toubon (Marseille, 1931). Certains dessins, certaines gouaches du peintre apparaissent définitifs. Certaines feuilles du large carnet à spirale retiennent des esquisses qui, chez lui, sont le contraire de l’à-peu-près. Le temps passant, je me rends compte que ces croquis fondent le terrain même de l’invention et d’un défi perpétuellement relevé. « Ce ne sont que des carnets d’ébauches », minimise-t-il en feuilletant les pages au grain satiné, alors que ces études-là donnent le vertige.
(Jeudi 31 mars 2016)
Un coup de dés
L’écriture de certains ouvrages au long cours ressemble à la quête de la pierre philosophale, en ce sens qu’elle paraît inlassable et sans fin. C’est comme un rêve qui n’est pas du tout fait pour toucher au but, mais qui se prévaut de concrétiser certaines étapes d’un voyage intérieur. Peu d’entre nous ont la capacité d’une telle expérience : édifier une œuvre totale, absolue, inachevable. Un peu à la manière de Stéphane Mallarmé (1842-1898) dont le Coup de dés a matérialisé les blancs typographiques en écriture à part entière, impulsé un mouvement de lecture métamorphosant le vers libre autant que le poème en prose, fécondé une nouvelle partition de mots, une poésie d’un nouveau type. Peut-être aussi à l’exemple de l’écrivain et critique florentin Pietro Citati (né en 1930) dont l’impossible souhait est de lire tous les livres, d’épuiser toutes les bibliothèques et de cueillir leur substance déposée dans une vague mémoire collective, pour les condenser dans un ouvrage unique qui serait le « livre des livres ».
Écriture numérique
Je suis obsédé par les caprices supposés de l’ordinateur. Et je ne cesse de sauvegarder les sauvegardes de mes écrits. À vrai dire, je redoute que les lettres et les mots de mes manuscrits se mélangent entre eux, voire se perdent lorsque, la nuit, je suspends l’activité au clavier de mon ordinateur. Rendez-vous compte quel désappointement ce serait de subir les conséquences d’une amnésie de cette machine automatique de traitement de l’information ! Philippe Sollers l’évoque dans « Les Voyageurs du Temps » : Pas d’ordinateur, tout à la plume et à la machine à écrire préhistorique.
(Mardi 19 avril 2016)
Les saisons de la terre
Les quatre saisons de notre temps ne doivent pas leur existence à l’orbite elliptique de la Terre, mais bien à l’inclinaison (du latin clima, signifiant successivement inclinaison, inclinaison du ciel, région de la terre et au sens actuel « climat ») de l’axe de rotation de notre planète sur elle-même, cela dit comparativement au plan de sa rotation autour du soleil. Depuis que j’ai réappris cette donnée astrophysique, j’ai la tête qui tourne.
Lecture critique
Les avatars et les mythes du péplum
 Si l’on en croit l’historien et critique de cinéma Laurent Aknin (né en 1961), c’est la dernière reine d’Égypte Cléopâtre VII qui inspira en 1897 le premier péplum de l’histoire du cinéma aux Frères Auguste et Louis Lumière (1862/1864-1954/1948). Intitulé Néron essayant des poisons sur des esclaves, ce court-métrage d’une cinquantaine de secondes reprenait en fait l’argument d’Alexandre Cabanel (1823-1889) dans une peinture de 1887, « Cléopâtre essayant des poisons sur des condamnés à mort ». Scénographié par Georges Hatot et filmé par l’opérateur Alexandre Promio, le film valut à la société française de battre sur le poteau sa rivale américaine conduite par Thomas Edison dont la première Passion ne fut projetée que quelques jours plus tard. Les années suivantes, l’École française retient surtout Héliogabale et Thaïs (1911) de Louis Feuillade (1873-1925). Mais c’est en Italie que les premiers chefs-d’œuvre du film antique - et muet - sont réalisés par Luigi Maggi (Les Derniers Jours de Pompéi), Giovanni Pastrone (Cabiria) et Enrico Guazzoni (Quo Vadis ?). Le film de Pastrone est long de 3 360 mètres, soit plus de trois heures de projection, et c’est l’écrivain Gabriele D’Annunzio qui rédige les intertitres ! Les années suivantes, avec l’avènement du parlant, le film antique continue de puiser son inspiration dans les récits historiques, les mythologies grecque et romaine ainsi que la geste biblique : empereurs fous, centurions chevaleresques, chrétiens jetés aux lions, gladiateurs intrépides, femmes fatales, chute de l’Empire romain, arche de Noé, Moïse et les dix commandements, passage de la mer Rouge, construction des Pyramides et cætera. « Synonyme bien souvent de kitsch ou de carton-pâte, le péplum, observe L. Aknin, désigne dorénavant un ensemble de films absolument protéiforme ; il évoque aussi bien les superproductions hollywoodiennes que le cinéma bis le plus invraisemblable. » Dans les années cinquante, l’Américain Cecil B. Demille renouvelle le genre avec Samson et Dalila interprété par Victor Mature et Hedy Lamarr. À l’avènement du cinémascope, Henry Koster marque les esprits avec La Tunique dont la distribution aligne Richard Burton, Jean Simmons, Victor Mature et Jay Robinson. Centré sur la tunique portée par Jésus sur son chemin de croix, ce film médiocre a pourtant l’avantage d’introduire l’expression « film à peplos » forgée par trois cinéphiles dont Bertrand Tavernier. De « film en péplum », l’unique vocable péplum (désignant en latin une tunique romaine) ne tarde pas à qualifier le genre sous tous les méridiens, supplantant le terme « kolossal » utilisé en Italie et l’appellation « film d’épées et de sandales » invoquée par les Américains. À la fin des années 1950, Ben Hur de William Wyler remporte un succès planétaire et rafle douze Oscars à Los Angeles. Certains considèrent que ce film dépasse l’évocation de la Judée à l’aube du christianisme à travers le destin d’un noble juif au temps de Jésus et révèle, idéologie politique oblige, les craintes de l’Amérique de 1959 face au camp soviétique au plus aigu de la guerre froide. Des fortunes très diverses ont marqué à la fois la production de grands réalisateurs, tels Robert Aldrich, Sergio Corbucci, Frederico Fellini, Jerzy Kawalerowicz, Sergio Leone, Anthony Mann, Pier Paolo Pasolini, Nicholas Ray, Roberto Rosselini, Martin Scorsese, Ridley Scott, King Vidor et Franco Zeffirelli, et l’interprétation d’acteurs, parfois inattendue, comme Yul Brynner, Maria Callas, George Clooney, Willem Dafoe, Mylène Demongeot, Kirk Douglas, Lou Ferrigno, Jean Gabin, Richard Gere, Charlton Heston, George Marchal, Anthony Quinn, Steve Reeves, Gordon Scott, Max von Sydow et John Wayne. En 1954, Paul Newman qui faisait ses débuts au cinéma s’est excusé dans un communiqué de presse d’avoir tourné dans le film de Victor Saville Le Calice d’argent où il côtoyait Jack Palance et Pier Angeli ! Le pire et le meilleur constellent l’histoire du péplum qui draine une foison de métamorphoses, d’éclipses et de renaissances tout en épousant l’évolution technique et politique du médium cinématographique. La Dernière Légion de Dino De Laurentiis (2007) et Agora d’Alejandro Amenábar (2009) témoignent de la longévité et de la popularité du genre et de la puissance d’attraction des légendes qu’il entretient, mythes propres aux César, Spartacus, Achille, Œdipe, Hercule, Messaline et autres Maciste.
Si l’on en croit l’historien et critique de cinéma Laurent Aknin (né en 1961), c’est la dernière reine d’Égypte Cléopâtre VII qui inspira en 1897 le premier péplum de l’histoire du cinéma aux Frères Auguste et Louis Lumière (1862/1864-1954/1948). Intitulé Néron essayant des poisons sur des esclaves, ce court-métrage d’une cinquantaine de secondes reprenait en fait l’argument d’Alexandre Cabanel (1823-1889) dans une peinture de 1887, « Cléopâtre essayant des poisons sur des condamnés à mort ». Scénographié par Georges Hatot et filmé par l’opérateur Alexandre Promio, le film valut à la société française de battre sur le poteau sa rivale américaine conduite par Thomas Edison dont la première Passion ne fut projetée que quelques jours plus tard. Les années suivantes, l’École française retient surtout Héliogabale et Thaïs (1911) de Louis Feuillade (1873-1925). Mais c’est en Italie que les premiers chefs-d’œuvre du film antique - et muet - sont réalisés par Luigi Maggi (Les Derniers Jours de Pompéi), Giovanni Pastrone (Cabiria) et Enrico Guazzoni (Quo Vadis ?). Le film de Pastrone est long de 3 360 mètres, soit plus de trois heures de projection, et c’est l’écrivain Gabriele D’Annunzio qui rédige les intertitres ! Les années suivantes, avec l’avènement du parlant, le film antique continue de puiser son inspiration dans les récits historiques, les mythologies grecque et romaine ainsi que la geste biblique : empereurs fous, centurions chevaleresques, chrétiens jetés aux lions, gladiateurs intrépides, femmes fatales, chute de l’Empire romain, arche de Noé, Moïse et les dix commandements, passage de la mer Rouge, construction des Pyramides et cætera. « Synonyme bien souvent de kitsch ou de carton-pâte, le péplum, observe L. Aknin, désigne dorénavant un ensemble de films absolument protéiforme ; il évoque aussi bien les superproductions hollywoodiennes que le cinéma bis le plus invraisemblable. » Dans les années cinquante, l’Américain Cecil B. Demille renouvelle le genre avec Samson et Dalila interprété par Victor Mature et Hedy Lamarr. À l’avènement du cinémascope, Henry Koster marque les esprits avec La Tunique dont la distribution aligne Richard Burton, Jean Simmons, Victor Mature et Jay Robinson. Centré sur la tunique portée par Jésus sur son chemin de croix, ce film médiocre a pourtant l’avantage d’introduire l’expression « film à peplos » forgée par trois cinéphiles dont Bertrand Tavernier. De « film en péplum », l’unique vocable péplum (désignant en latin une tunique romaine) ne tarde pas à qualifier le genre sous tous les méridiens, supplantant le terme « kolossal » utilisé en Italie et l’appellation « film d’épées et de sandales » invoquée par les Américains. À la fin des années 1950, Ben Hur de William Wyler remporte un succès planétaire et rafle douze Oscars à Los Angeles. Certains considèrent que ce film dépasse l’évocation de la Judée à l’aube du christianisme à travers le destin d’un noble juif au temps de Jésus et révèle, idéologie politique oblige, les craintes de l’Amérique de 1959 face au camp soviétique au plus aigu de la guerre froide. Des fortunes très diverses ont marqué à la fois la production de grands réalisateurs, tels Robert Aldrich, Sergio Corbucci, Frederico Fellini, Jerzy Kawalerowicz, Sergio Leone, Anthony Mann, Pier Paolo Pasolini, Nicholas Ray, Roberto Rosselini, Martin Scorsese, Ridley Scott, King Vidor et Franco Zeffirelli, et l’interprétation d’acteurs, parfois inattendue, comme Yul Brynner, Maria Callas, George Clooney, Willem Dafoe, Mylène Demongeot, Kirk Douglas, Lou Ferrigno, Jean Gabin, Richard Gere, Charlton Heston, George Marchal, Anthony Quinn, Steve Reeves, Gordon Scott, Max von Sydow et John Wayne. En 1954, Paul Newman qui faisait ses débuts au cinéma s’est excusé dans un communiqué de presse d’avoir tourné dans le film de Victor Saville Le Calice d’argent où il côtoyait Jack Palance et Pier Angeli ! Le pire et le meilleur constellent l’histoire du péplum qui draine une foison de métamorphoses, d’éclipses et de renaissances tout en épousant l’évolution technique et politique du médium cinématographique. La Dernière Légion de Dino De Laurentiis (2007) et Agora d’Alejandro Amenábar (2009) témoignent de la longévité et de la popularité du genre et de la puissance d’attraction des légendes qu’il entretient, mythes propres aux César, Spartacus, Achille, Œdipe, Hercule, Messaline et autres Maciste.
- Le Péplum, par Laurent Aknin, éditions Armand Colin, 128 pages, 2009.
Portrait
La foudre poétique de René Char
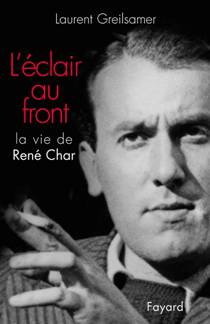 « Comment me vint l’écriture ? Comme un duvet d’oiseau sur ma vitre, en hiver. Aussitôt s’éleva dans l’âtre une bataille de tisons qui n’a pas, encore à présent, pris fin. » Si l’accès de ses poèmes et de ses aphorismes reste difficile, exigeant, mystérieux, leur lecture attentive laisse entrevoir des ouvertures, des épiphanies, dans lesquelles il importe de progresser à pas lents afin de mieux décrypter la foudre poétique qui frappe l’esprit à la vitesse de la lumière. À une amie qui se désespère de buter sur le même vers, il répond : « Mais laissez donc ! Et puis, un jour, vous verrez, cette phrase vous parlera. Georges Mounin (linguiste et universitaire), l’un des ceux qui connaissent le mieux ma poésie, reconnaît que la moitié des poèmes lui restent fermés. » À France Huser (Le Nouvel Observateur), en février 1980, aux Busclats (à l’Isle-sur-la-Sorgue), il confie qu’« un poète commande rarement à son heure d’arrivée. Des phrases, des mots, des thèmes sont donnés et d’autres à peine suggérés. Parfois, c’est la grâce, la part royale, le manuscrit n’est pour ainsi dire pas raturé, et tout le souhaitable s’y trouve. Certaines fois, c’est un tourment à coups de fourche ! ».
« Comment me vint l’écriture ? Comme un duvet d’oiseau sur ma vitre, en hiver. Aussitôt s’éleva dans l’âtre une bataille de tisons qui n’a pas, encore à présent, pris fin. » Si l’accès de ses poèmes et de ses aphorismes reste difficile, exigeant, mystérieux, leur lecture attentive laisse entrevoir des ouvertures, des épiphanies, dans lesquelles il importe de progresser à pas lents afin de mieux décrypter la foudre poétique qui frappe l’esprit à la vitesse de la lumière. À une amie qui se désespère de buter sur le même vers, il répond : « Mais laissez donc ! Et puis, un jour, vous verrez, cette phrase vous parlera. Georges Mounin (linguiste et universitaire), l’un des ceux qui connaissent le mieux ma poésie, reconnaît que la moitié des poèmes lui restent fermés. » À France Huser (Le Nouvel Observateur), en février 1980, aux Busclats (à l’Isle-sur-la-Sorgue), il confie qu’« un poète commande rarement à son heure d’arrivée. Des phrases, des mots, des thèmes sont donnés et d’autres à peine suggérés. Parfois, c’est la grâce, la part royale, le manuscrit n’est pour ainsi dire pas raturé, et tout le souhaitable s’y trouve. Certaines fois, c’est un tourment à coups de fourche ! ».
À le lire ou à le relire, à découvrir les biographies de Laurent Greilsamer (journaliste au Monde) et de Danièle Leclair (maître de conférences à l’université Paris-Descartes), nous comprenons mieux à quel point René-Émile Char (L’Isle-sur-la-Sorgue, 14 juin 1907-Paris, 19 février 1988) fut tout à la fois le compagnon actif des surréalistes et un incorrigible rebelle. L’homme catalyse les contraires, la courtoisie et la rudesse, le jour et la nuit, le bonheur et l’angoisse, la certitude et le doute, la santé et l’épuisement : « Il est tout cela, inextricablement mêlé, argumente L. Greilsamer. Ses textes charrient une violence comprimée, explosive. Une singulière empreinte sadienne court au travers des pages, mais aussi des images secrètes surgies du monde des alchimistes, les pensées enfouies de son arrière-pays mental. Le verbe cingle, les mots sont fouettés. » Terre faite de silex et de pelouses arides, dominée par le mont Ventoux, trouée d’avens maléfiques, plantée d’oliviers torturés, traversée par une Durance torrentueuse et des Sorgues indolentes, sa cité natale a sans conteste forgé l’homme et l’œuvre.
L’influence du marquis de Sade
 Dans la demeure familiale et bourgeoise de son père Émile, patron des Plâtrières du Vaucluse et maire de L’Isle, une propriété baptisée Les Névons, du nom d’un ruisseau paresseux qui coule à ses pieds avant de se jeter dans la Sorgue, le temps de l’enfance conforte la solitude du caganisse (littéralement en provençal, le dernier-né qui chie au nid) en butte à l’agressivité de son frère aîné, Albert (né en 1893), et à l’hostilité de sa mère, Marie-Thérèse Rouget. Ces attitudes sont heureusement compensées par l’affection de ses sœurs Julia, dite Lily (1889), et Émilienne (1900) ainsi que de sa marraine Louise Roze. Notaire chargé en 1813-1814 des intérêts du marquis Donatien de Sade, le chevalier Roze est l’ancêtre de Louise et d’Adèle. Anticonformistes en diable, les deux sœurs Roze soutiendront René Char à ses débuts dans la vie parisienne et lui confieront en 1929 de nombreux ouvrages précieux et des lettres inédites du Divin Marquis qui l’influenceront à jamais. Une tendre complicité le lie à sa grand-mère maternelle, Joséphine Rouget, qui réside aux Névons avec la parentèle. Juste avant de mourir, elle lui donnera quelques louis d’or pour financer son premier recueil de poèmes. Constitué de trente-neuf textes, son titre Les Cloches sur le cœur entend rappeler le tintinnabulement des providentielles piécettes d’or dans la pochette de sa chemise ! Antérieurement, au lycée d’Avignon, le potache ombrageux a jeté son dictionnaire de latin à la tête du professeur qui a osé critiquer en mauvaise part un de ses poèmes ! À dix-neuf ans, il jure à sa mère qu’il n’effectuera aucun travail salarié mais qu’il sera poète. Un court passage à l’École de commerce de Marseille (1925), un stage de commis chez un négociant en fruits et légumes de Cavaillon (1926) et dix-huit mois de service militaire dans l’artillerie à Nîmes (1927-1928) l’ont convaincu de l’évidence de son choix.
Dans la demeure familiale et bourgeoise de son père Émile, patron des Plâtrières du Vaucluse et maire de L’Isle, une propriété baptisée Les Névons, du nom d’un ruisseau paresseux qui coule à ses pieds avant de se jeter dans la Sorgue, le temps de l’enfance conforte la solitude du caganisse (littéralement en provençal, le dernier-né qui chie au nid) en butte à l’agressivité de son frère aîné, Albert (né en 1893), et à l’hostilité de sa mère, Marie-Thérèse Rouget. Ces attitudes sont heureusement compensées par l’affection de ses sœurs Julia, dite Lily (1889), et Émilienne (1900) ainsi que de sa marraine Louise Roze. Notaire chargé en 1813-1814 des intérêts du marquis Donatien de Sade, le chevalier Roze est l’ancêtre de Louise et d’Adèle. Anticonformistes en diable, les deux sœurs Roze soutiendront René Char à ses débuts dans la vie parisienne et lui confieront en 1929 de nombreux ouvrages précieux et des lettres inédites du Divin Marquis qui l’influenceront à jamais. Une tendre complicité le lie à sa grand-mère maternelle, Joséphine Rouget, qui réside aux Névons avec la parentèle. Juste avant de mourir, elle lui donnera quelques louis d’or pour financer son premier recueil de poèmes. Constitué de trente-neuf textes, son titre Les Cloches sur le cœur entend rappeler le tintinnabulement des providentielles piécettes d’or dans la pochette de sa chemise ! Antérieurement, au lycée d’Avignon, le potache ombrageux a jeté son dictionnaire de latin à la tête du professeur qui a osé critiquer en mauvaise part un de ses poèmes ! À dix-neuf ans, il jure à sa mère qu’il n’effectuera aucun travail salarié mais qu’il sera poète. Un court passage à l’École de commerce de Marseille (1925), un stage de commis chez un négociant en fruits et légumes de Cavaillon (1926) et dix-huit mois de service militaire dans l’artillerie à Nîmes (1927-1928) l’ont convaincu de l’évidence de son choix.
Les idéaux des surréalistes
Il adresse un des cent cinquante-trois exemplaires des Cloches sur le cœur, imprimés à Paris en février 1928, à ses nouveaux amis, Louis Aragon, René Crevel, Max Jacob, Pierre Reverdy, André Salmon, Philippe Soupault et Jules Supervielle, dont certains ont déjà publié ses poèmes en revues parce qu’ils lui trouvent des accents éclatants et des intuitions prodigieuses. En 1929, il dédie à son ami écrivain et futur cinéaste André Cayatte son deuxième recueil Arsenal au moment où Paul Éluard entame avec lui une correspondance tout en lui recommandant de rejoindre au plus tôt le cénacle des littérateurs parisiens. Il arrive dans la capitale au moment où le groupe surréaliste traverse une crise plus grave que les précédentes : Robert Desnos, André Masson, Jacques Prévert et Raymond Queneau ont fait sécession, ce qui n’empêche pas le jeune vauclusien de rallier le mouvement. À l’heure de l’apéritif, il rejoint fréquemment au café  Le Cyrano, place Blanche, Louis Aragon, André Breton et Paul Éluard ; et il écrit avec les deux derniers un petit livre collectif Ralentir travaux (1930). Mais ses réticences à l’encontre de l’écriture automatique, de l’embrigadement du groupe et des querelles futiles et mélodramatiques qui divisent périodiquement ses membres l’amènent peu à peu à la rupture. Celle-ci est consommée à l’été 1934 par une lettre qu’il adresse à Benjamin Péret, lorsque José Corti publie Le Marteau sans maître qui reste fortement imprégné des idéaux révolutionnaires des surréalistes.
Le Cyrano, place Blanche, Louis Aragon, André Breton et Paul Éluard ; et il écrit avec les deux derniers un petit livre collectif Ralentir travaux (1930). Mais ses réticences à l’encontre de l’écriture automatique, de l’embrigadement du groupe et des querelles futiles et mélodramatiques qui divisent périodiquement ses membres l’amènent peu à peu à la rupture. Celle-ci est consommée à l’été 1934 par une lettre qu’il adresse à Benjamin Péret, lorsque José Corti publie Le Marteau sans maître qui reste fortement imprégné des idéaux révolutionnaires des surréalistes.
De tout temps, en maintes occasions, il n’aura de cesse de recouvrer sa vraie nature, la posture de repli d’un homme libre de toute servitude. Aux plus intimes, il aime redire en l’explicitant sa croyance en des absolus qui lui ont été dictés très précocement par la pratique d’une vie simple mais rude dans un pays austère et sévère, où l’effort est plus apprécié que la jouissance. Absolus en la beauté, en la Nature, en la poésie. En l’amitié et en l’amour aussi. Saint-John Perse ne disait-il pas de lui : « Il s’était levé : seul et sans maître au chant très sobre du loriot ».
Le silence poétique
Mobilisé en septembre 1939, il est envoyé sur le front d’Alsace où il est nommé brigadier en 1940, année de sa démobilisation dans le Gers. En 1942, il entre dans le silence poétique en s’engageant dans l’Armée secrète pour mieux se battre contre l’envahisseur nazi : le capitaine Alexandre est né. Il poursuit néanmoins pendant cette longue parenthèse la prise de notes. Ce sont des impressions sur le temps de la clandestinité (1943-1944), balisé par la violence et la colère, et des observations sur ses compagnons, magnifiés par le courage et la douleur, matériaux précieux stockés dans un carnet qui sera la matrice de son livre Les Feuillets d’Hypnos publié en 1946 aux éditions Gallimard, dans la collection Espoir dirigée par Albert Camus. L’officier clandestin développe les premiers maquis autour de Céreste, en Haute Provence, à la tête du secteur Durance-Sud avant de diriger, en 1943, toute la Région 2 (recouvrant Basses et Hautes-Alpes, Drôme, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Var et Alpes-Maritimes), un réseau qui rassemble deux mille cent cinquante maquisards. Après la Libération en 1945, il choisit de faire de nouveau entendre sa voix en publiant Seuls demeurent où il revient rétrospectivement sur les années noires de l’Occupation.
Farouche partisan de la justice et de la liberté, l’homme a soutenu les républicains espagnols opposés aux troupes franquistes en 1936 et il a rejoint six ans plus tard les Forces françaises libres comme il prendra parti contre l’installation des missiles nucléaires sur le plateau d’Albion (1965-1967).
Transparents et autres Porteurs d’eau
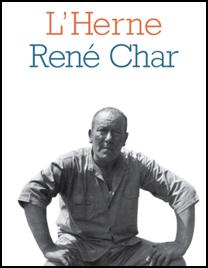 Toute la vie, tout l’œuvre de René Char sont traversés par les « Transparents », ces marginaux sans attaches au nombre desquels il se compte, semi-nomades qui dialoguent dans Les Matinaux (1950). Il ennoblit ces vagabonds de nuit et de jour, ces libertaires anticléricaux, ces « fadas » (habités par les fées) qui transmettent à de rares élus les chants oubliés des ancêtres. Il leur attribue des pseudonymes ou des sobriquets : Toquebiol (« Touche bœuf ! »), Louis Curel de la Sorgue, Odin le Roc, Laurent de Venasque, Mes-Clous, Sang-de-89, l’Armurier (Jean Pancrace Nouguier), l’Orvet et Pénible…. Il se donne celui de Joseph Puissantseigneur comme signataire d’un article de circonstance. Plâtriers ou pêcheurs, brûleurs de ronces ou rempailleurs de chaises, ceux-là forment autour de lui un cercle familial de substitution et, surtout, ils favorisent la parole poétique naissante de leur protégé sur les rives d’une Sorgue dont les eaux herbeuses sont brassées par des dizaines de moulins, ces roues à aubes qui produisent l’énergie nécessaire aux ateliers des soyeux et aux papeteries de Fontaine de Vaucluse. Au gré de ses ouvrages et de sa correspondance, il reconnaît pareillement sa dette envers Baudelaire et ses autres « Porteurs d’eau » essentiels, Blanchot, Camus, Frénaud, Heidegger, Héraclite, Hölderlin, Lély, Michaux, Nietzsche, Rimbaud et Sénac ainsi que Georges de La Tour dont la peinture Le Prisonnier (Job raillé par sa femme) le fascine, sans oublier Claude Lapeyre, professeur de mathématiques et futur maire de Pernes-les-Fontaines, qui l’accompagne durant vingt-cinq ans dans de longues marches entre Ventoux et Alpilles et à qui il dédiera Les Chants de la Balandrane. Aux Transparents et Porteurs d’eau, il adjoint les jeunes poètes qu’il a encouragés, André du Bouchet, Jacques Dupin, Dominique Fourcade (qui dirige le Cahier de l’Herne consacré à son ami), Gil Jouanard et Gustaf Sobin. Il s’attache à exalter l’amour de ses deux épouses, Georgette Goldstein et Marie-Claude de Saint-Seine, et de ses compagnes, Greta Knutson, Yvonne Zervos, Tina Jolas et Anne Reinhold. Des peintres et des sculpteurs ont beaucoup compté pour lui, au point qu’il les a qualifiés « d’Alliés substantiels ». Certains de ses manuscrits ont été enluminés avec superbe par Georges Braque, Victor Brauner, Salvador Dali, Alexandre Galpérine, Alberto Giacometti, Jean et Valentine Hugo, Wifredo Lam, Fernand Léger, Marguerite Leuwers, Henri Matisse, Joan Miró, Pablo Picasso, Nicolas de Staël, Maria Elena Viera da Silva, Jean Villeri et Zao Wou-ki. Braque, Brauner, Staël ont certainement été les alliés les plus intimes du poète. « Dans l’ensemble, cet homme est fait de dynamite dont les explosions seraient hâlées de douceur calme, écrit N. de Staël à propos de René Char. Tous les pontes lui cavalent au froc sans retenue. Braque seul a de la discrétion. » En commentant leur singularité distincte, le poète émet des regrets : « Staël et moi, nous ne sommes pas des yétis ! Mais nous nous rapprochons quelquefois plus près qu’il n’est permis de l’inconnu et de l’empire des étoiles. »
Toute la vie, tout l’œuvre de René Char sont traversés par les « Transparents », ces marginaux sans attaches au nombre desquels il se compte, semi-nomades qui dialoguent dans Les Matinaux (1950). Il ennoblit ces vagabonds de nuit et de jour, ces libertaires anticléricaux, ces « fadas » (habités par les fées) qui transmettent à de rares élus les chants oubliés des ancêtres. Il leur attribue des pseudonymes ou des sobriquets : Toquebiol (« Touche bœuf ! »), Louis Curel de la Sorgue, Odin le Roc, Laurent de Venasque, Mes-Clous, Sang-de-89, l’Armurier (Jean Pancrace Nouguier), l’Orvet et Pénible…. Il se donne celui de Joseph Puissantseigneur comme signataire d’un article de circonstance. Plâtriers ou pêcheurs, brûleurs de ronces ou rempailleurs de chaises, ceux-là forment autour de lui un cercle familial de substitution et, surtout, ils favorisent la parole poétique naissante de leur protégé sur les rives d’une Sorgue dont les eaux herbeuses sont brassées par des dizaines de moulins, ces roues à aubes qui produisent l’énergie nécessaire aux ateliers des soyeux et aux papeteries de Fontaine de Vaucluse. Au gré de ses ouvrages et de sa correspondance, il reconnaît pareillement sa dette envers Baudelaire et ses autres « Porteurs d’eau » essentiels, Blanchot, Camus, Frénaud, Heidegger, Héraclite, Hölderlin, Lély, Michaux, Nietzsche, Rimbaud et Sénac ainsi que Georges de La Tour dont la peinture Le Prisonnier (Job raillé par sa femme) le fascine, sans oublier Claude Lapeyre, professeur de mathématiques et futur maire de Pernes-les-Fontaines, qui l’accompagne durant vingt-cinq ans dans de longues marches entre Ventoux et Alpilles et à qui il dédiera Les Chants de la Balandrane. Aux Transparents et Porteurs d’eau, il adjoint les jeunes poètes qu’il a encouragés, André du Bouchet, Jacques Dupin, Dominique Fourcade (qui dirige le Cahier de l’Herne consacré à son ami), Gil Jouanard et Gustaf Sobin. Il s’attache à exalter l’amour de ses deux épouses, Georgette Goldstein et Marie-Claude de Saint-Seine, et de ses compagnes, Greta Knutson, Yvonne Zervos, Tina Jolas et Anne Reinhold. Des peintres et des sculpteurs ont beaucoup compté pour lui, au point qu’il les a qualifiés « d’Alliés substantiels ». Certains de ses manuscrits ont été enluminés avec superbe par Georges Braque, Victor Brauner, Salvador Dali, Alexandre Galpérine, Alberto Giacometti, Jean et Valentine Hugo, Wifredo Lam, Fernand Léger, Marguerite Leuwers, Henri Matisse, Joan Miró, Pablo Picasso, Nicolas de Staël, Maria Elena Viera da Silva, Jean Villeri et Zao Wou-ki. Braque, Brauner, Staël ont certainement été les alliés les plus intimes du poète. « Dans l’ensemble, cet homme est fait de dynamite dont les explosions seraient hâlées de douceur calme, écrit N. de Staël à propos de René Char. Tous les pontes lui cavalent au froc sans retenue. Braque seul a de la discrétion. » En commentant leur singularité distincte, le poète émet des regrets : « Staël et moi, nous ne sommes pas des yétis ! Mais nous nous rapprochons quelquefois plus près qu’il n’est permis de l’inconnu et de l’empire des étoiles. »
- L’Éclair au front - La vie de René Char, par Laurent Greilsamer, éditions Fayard, 566 pages, 2004 ;
- René Char - Là où brûle la poésie, par Danièle Leclair, Biographie, éditions Aden, collection Le Cercle des poètes disparus dirigée par Robert Bréchon, 640 pages, 2007 ;
- René Char, sous la direction d’Antoine Coron, éditions Bibliothèque nationale de France/Gallimard, à l’occasion d’une exposition « René Char » présentée sur le site François-Mitterrand du 4 mai au 29 juillet 2007, 264 pages, 2007 ;
- René Char, sous la direction de Dominique Fourcade, les Cahiers de l’Herne, 176 pages, 1975.
Varia : un Code de la Déconduite instauré dans l’espace public européen
À l’instar de Max Linder, de René Magritte et de Jacques Tati, le chapeau, Trilby ou Fedora, est devenu l’attribut inséparable du personnage étiré dans une vêture souvent grise qui paraît trop courte. À peine posé sur le haut d’un crâne dégarni, on le remarque d’emblée. Comme on découvre la malice du regard, le précipité de la voix impérieuse et très audible. Devant l’écran de la salle des Lieux publics, le centre national des arts de la rue de la cité phocéenne, les acteurs obtempèrent aux injonctions du metteur en scène Ludovic Nobileau (Marseille, 1968), un vieux jeune homme dont la jeunesse semble inachevée.
 Il n’est pas si fréquent qu’on s’amuse vraiment à la lecture des articles du Code civil annoté par Désiré et Armand Dalloz. C’est pourtant ce que permet une nouvelle initiative du groupe X/tnt (ex théâtre national terroriste) basé à Paris, dirigé et animé par Ludovic Nobileau et Antonia Taddei. Connue pour ses actions de rue, éphémères et iconoclastes (dont la création d’un passage piéton mobile et humain sur la place de l’Arc de Triomphe à Paris), la compagnie a investi en 2015 les amphithéâtres de la faculté aixoise de droit et de science économique (Aix-Marseille université) afin d’explorer, voire de disséquer, la jurisprudence propre à l’usage de l’espace public. Rassemblés en un master « Droit et création artistique » (année académique 2015-2016), des étudiants ont ainsi rejoint les comédiens de X/tnt sur les planches de plusieurs expérimentations civiques et esthétiques visant d’une part à préconiser de nouvelles utilisations de l’espace public, d’autre part à stigmatiser celles qui s’avèrent sinon abusives du moins véritablement hors-la-loi. Dans cette perspective, un Code de la Déconduite a été conçu à destination du réseau européen pour la création artistique en espace public (plus connu sous l’appellation In Situ) et des auto-écoles ont essaimé en Angleterre (Norwich), en Belgique (Bruxelles), en France (Marseille, Paris, Sotteville-les-Rouen) et en Hongrie (Budapest) afin de réinventer l’espace public à partir de la création artistique et théâtrale.
Il n’est pas si fréquent qu’on s’amuse vraiment à la lecture des articles du Code civil annoté par Désiré et Armand Dalloz. C’est pourtant ce que permet une nouvelle initiative du groupe X/tnt (ex théâtre national terroriste) basé à Paris, dirigé et animé par Ludovic Nobileau et Antonia Taddei. Connue pour ses actions de rue, éphémères et iconoclastes (dont la création d’un passage piéton mobile et humain sur la place de l’Arc de Triomphe à Paris), la compagnie a investi en 2015 les amphithéâtres de la faculté aixoise de droit et de science économique (Aix-Marseille université) afin d’explorer, voire de disséquer, la jurisprudence propre à l’usage de l’espace public. Rassemblés en un master « Droit et création artistique » (année académique 2015-2016), des étudiants ont ainsi rejoint les comédiens de X/tnt sur les planches de plusieurs expérimentations civiques et esthétiques visant d’une part à préconiser de nouvelles utilisations de l’espace public, d’autre part à stigmatiser celles qui s’avèrent sinon abusives du moins véritablement hors-la-loi. Dans cette perspective, un Code de la Déconduite a été conçu à destination du réseau européen pour la création artistique en espace public (plus connu sous l’appellation In Situ) et des auto-écoles ont essaimé en Angleterre (Norwich), en Belgique (Bruxelles), en France (Marseille, Paris, Sotteville-les-Rouen) et en Hongrie (Budapest) afin de réinventer l’espace public à partir de la création artistique et théâtrale.
Auréolée du prestige de sa participation en 2015 à la Capitale européenne de la culture de Mons, en Belgique, à travers Mons streetreview.eu (actions et performances accomplies par plus de 900 habitants selon dix kilomètres de rues et filmées par une caméra à 360 degrés), la compagnie a présenté son Code de la Déconduite le vendredi 1er avril 2016 dans les locaux de Lieux publics, le centre national des arts de la rue que Pierre Sauvageot (Paris, 1953) dirige depuis 2001 à Marseille, dans le quartier des Aygalades (15e arrondissement).
En soumettant le droit d’usage quotidien de l’espace public aux deux plateaux de l’équité, comédiens et étudiants démontrent, au-delà du rire et de la provocation, que la balance n’a pu éviter son fléau. La mise en lumière d’actions tournées vers la vidéo-surveillance, la multiplication des ronds-points routiers, le littoral marin, l’accueil des immigrés sans-papiers à Calais en atteste assez crûment. Elle emporte la conviction que les vertus de l’art sont universelles et sans limites, révolutionnaires en un mot, pour traquer les atteintes aux libertés individuelles. Elle laisse présager/espérer des files d’attente de candidats aux comptoirs d’In Situ pour la passation du permis de déconduire.
Ludovic Nobileau sans son légendaire couvre-chef
© Photo Christiane Ardisson
Sites numériques à consulter :
www.streetreview.eu
www.xtnt.org
Carnet : Morand, inconditionnel d’Audiberti
Que diable possédait Jacques Audiberti (1899-1965) pour enflammer tant de cœurs, subjuguer les esprits et « prendre aux tripes » les plus désabusés des lecteurs et spectateurs ? Difficile à dire. L’écrivain Paul Morand (1888-1976) qui maniait peu l’encensoir n’a-t-il pas imaginé cet ex-voto au lendemain de la disparition de l’écrivain et dramaturge : « Perdre Audiberti, c’est comme être privé de café, de tabac, de vin ; le degré d’alcool de son imagination nous était nécessaire ; son lyrisme, c’est le soleil mis en page ; c’est un produit de transformation comme le miel, comme l’huile au goût antique ».
Animaux de compagnie
C’est dingue comme les animaux de compagnie, chiens, chats et perruches en particulier, ont envahi les gondoles des supermarchés à travers les produits de leur alimentation ! Le credo des « Monsieur Propre », si vétilleux sur le bon traitement des caniches à poils courts, mais point trop regardant sur la misère des individus, me provoque chaque fois un haut-le-cœur.
(Mercredi 4 mai 2016)
Lecture critique
L’oiseau noir d’Émilienne Farny
 Les deux ou trois centaines de pages dévolues aux habituelles monographies d’artistes ne sont pas nécessaires à Michel Thévoz (né à Lausanne en 1936) pour raconter l’histoire et analyser l’œuvre de sa compagne, le peintre Émilienne Farny (Neuchâtel, 1938-2014). En quatre-vingts pages, l’historien d’art et philosophe (fondateur et directeur de la Collection de l’art brut au château de Beaulieu, à Lausanne, de 1976 à 2001) établit le portrait intime de l’artiste et détaille les étapes cardinales de son invention. Aux premières incartades du Pop Art et du Nouveau Réalisme (1950-1960), après quatre années d’enseignement à l’École cantonale d’art de Lausanne sous le tutorat du peintre Jacques Berger, Émilienne Farny se met à peindre les éléments de sa proximité urbaine à Paris. Rues, échoppes, enseignes, marchés forains et chantiers sont systématiquement inventoriés sur la toile après avoir été préalablement photographiés. En fait, elle joue les deux média, photo et peinture, l’un contre l’autre pour les confondre, afin de traduire, par l’ironie souvent mais sans la moindre méchanceté, le cadre et le mode de vie de ses contemporains. Pour elle, l’enrichissement du domaine de la beauté qu’elle se prévaut de cultiver – au moyen des pigments du peintre et des rebuts de l’art brut – réside dans les terrains vagues et les campagnes délaissées de la réalité, si bien qu’elle oscille constamment entre les marges et le centre, entre l’être et l’artificiel, entre la figure et le fond.
Les deux ou trois centaines de pages dévolues aux habituelles monographies d’artistes ne sont pas nécessaires à Michel Thévoz (né à Lausanne en 1936) pour raconter l’histoire et analyser l’œuvre de sa compagne, le peintre Émilienne Farny (Neuchâtel, 1938-2014). En quatre-vingts pages, l’historien d’art et philosophe (fondateur et directeur de la Collection de l’art brut au château de Beaulieu, à Lausanne, de 1976 à 2001) établit le portrait intime de l’artiste et détaille les étapes cardinales de son invention. Aux premières incartades du Pop Art et du Nouveau Réalisme (1950-1960), après quatre années d’enseignement à l’École cantonale d’art de Lausanne sous le tutorat du peintre Jacques Berger, Émilienne Farny se met à peindre les éléments de sa proximité urbaine à Paris. Rues, échoppes, enseignes, marchés forains et chantiers sont systématiquement inventoriés sur la toile après avoir été préalablement photographiés. En fait, elle joue les deux média, photo et peinture, l’un contre l’autre pour les confondre, afin de traduire, par l’ironie souvent mais sans la moindre méchanceté, le cadre et le mode de vie de ses contemporains. Pour elle, l’enrichissement du domaine de la beauté qu’elle se prévaut de cultiver – au moyen des pigments du peintre et des rebuts de l’art brut – réside dans les terrains vagues et les campagnes délaissées de la réalité, si bien qu’elle oscille constamment entre les marges et le centre, entre l’être et l’artificiel, entre la figure et le fond.
« Je vis dans ce monde, reconnaît-elle, je peins ce monde - je suis une éponge. Les assemblages sont les vestiges des démolitions du passé pour faire la part belle au béton. Les toiles : la rue, affiches, graffitis, signalisation routière, personnages, etc., ce que je croise chaque jour. Je me laisse aller à cette liberté du regard sans avoir quoi que ce soit à expliquer. »
 « Il n’y pas de solution de continuité, enseigne Michel Thévoz, entre les dessins d’enfant et les séries successives de l’œuvre peint, entre la maison enfantine et celles du "Bonheur suisse", entre les fleurs des champs et les dernières natures mortes, entre le drapeau suisse et la croix récurrente des assemblages, entre les murs historiés et les "Graffitis", entre les premières tentatives alphabétiques et les "block letters" des sprayeurs. Et surtout, il y a, spécifique aux dessins d’Émilienne enfant, un souci de construction plastique et d’ordonnancement des motifs qui préfigure la rigueur architectonique des peintures à venir. »
« Il n’y pas de solution de continuité, enseigne Michel Thévoz, entre les dessins d’enfant et les séries successives de l’œuvre peint, entre la maison enfantine et celles du "Bonheur suisse", entre les fleurs des champs et les dernières natures mortes, entre le drapeau suisse et la croix récurrente des assemblages, entre les murs historiés et les "Graffitis", entre les premières tentatives alphabétiques et les "block letters" des sprayeurs. Et surtout, il y a, spécifique aux dessins d’Émilienne enfant, un souci de construction plastique et d’ordonnancement des motifs qui préfigure la rigueur architectonique des peintures à venir. »
Aux derniers moments du récit, la voix se casse pour conjurer le deuil encore présent et se délivrer d’un remords : « Si j’essaie d’analyser ce que je ressens, il s’agit, plus encore que d’une perte ou d’un manque, d’un sentiment de culpabilité. À tort ou à raison (on ne peut évidemment pas se raisonner dans ces cas-là), j’éprouve le remords de n’avoir pas fait tout ce que j’aurais dû pour la rendre plus heureuse, des voyages, plus de présence, et surtout l’atténuation de la souffrance des derniers mois, la tumeur qu’on aurait dû détecter plus tôt, les médecins auprès desquels j’aurais dû insister… »
Quant au titre de l’ouvrage, il est à rapprocher de Thomas Bernhard (1931-1989). Dans une interview, l’écrivain et dramaturge autrichien prétendait qu’un oiseau noir s’était posé depuis des années sur son épaule droite ; Émilienne s’en était fait l’écho en 1991 dans une chronique littéraire qu’elle assurait épisodiquement dans L’Imbécile de Paris, un mensuel franco-suisse dirigé par Rolf Kesserling et Frédéric Pajak. Vingt ans plus tard, elle confectionnait un oiseau noir en bois peint en songeant au fantasme de Thomas Bernhard. « Parmi les dispositions qu’elle a prises méticuleusement dans les jours qui ont précédé sa mort, relate Michel Thévoz, elle m’a demandé de poser cet oiseau sur son cercueil - mais je n’ai pas pu, j’aurais trop pleuré. »
Émilienne Farny à la fondation Pierre Gianadda à Martigny en 2013
© Photo X, droits réservés
- Émilienne Farny et l’oiseau noir, par Michel Thévoz, art & fiction, éditions d’artistes, 80 pages, 2015.
Portrait
Mircea Eliade, historien du sacré
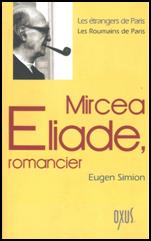 À trop se rapprocher des chemises vertes de la Garde de fer, mouvement fascisant des années trente dont les légionnaires exaltent un antisémitisme virulent dans une Roumanie sensible aux systèmes mussolinien et nazi, il subira longtemps l’opprobre de ses pairs et le discrédit du lectorat. Paradoxalement, à l’époque même où son nationalisme exacerbé est dénoncé (1937-1938), la curiosité intellectuelle de l’immense érudit, poète et savant du sacré est reconnue par le plus grand nombre. Avec une quarantaine d’ouvrages ethnologiques ou historiques, une douzaine de romans, des contes, des nouvelles, un journal, des essais et plusieurs milliers d’articles, l’œuvre de Mircea Eliade (Bucarest, 13 mars 1907-Chicago, 22 avril 1986) apparaît les décennies suivantes comme l’une des plus importantes de son temps, un corpus fondé sur trois orientations stylistiques, le roman existentialiste, la prose fantastique et la narration mythique.
À trop se rapprocher des chemises vertes de la Garde de fer, mouvement fascisant des années trente dont les légionnaires exaltent un antisémitisme virulent dans une Roumanie sensible aux systèmes mussolinien et nazi, il subira longtemps l’opprobre de ses pairs et le discrédit du lectorat. Paradoxalement, à l’époque même où son nationalisme exacerbé est dénoncé (1937-1938), la curiosité intellectuelle de l’immense érudit, poète et savant du sacré est reconnue par le plus grand nombre. Avec une quarantaine d’ouvrages ethnologiques ou historiques, une douzaine de romans, des contes, des nouvelles, un journal, des essais et plusieurs milliers d’articles, l’œuvre de Mircea Eliade (Bucarest, 13 mars 1907-Chicago, 22 avril 1986) apparaît les décennies suivantes comme l’une des plus importantes de son temps, un corpus fondé sur trois orientations stylistiques, le roman existentialiste, la prose fantastique et la narration mythique.
Un enfant sensible, un élève doué
« Son aventure commence à Bucarest (rue Melodiei), nous raconte l’universitaire roumain Eugen Simion (né en 1933), dans la maison d’un officier qui par amour d’un écrivain du XIXe siècle, Ion Heliade Ràdulescu, avait fait changer son nom de "Ieremia" en "Eliade". Il fait ses études secondaires dans un établissement prestigieux de la capitale (le lycée Spiru Haret), sans y briller ; à 13 ans il tient un journal intime, notant ses expériences d’entomologiste ; à 15 ans il se fixe déjà un programme de vie en plusieurs points : écrire chaque jour dix pages de littérature, faire ses exercices au piano, ne pas négliger "la fanfare", etc. »… Interrogé en 1978 sur l'origine de son nom, l'historien des religions aime à préciser qu'Eliade renvoie à hélios, « soleil » en grec.
L’enfant est sensible, l’élève est doué. Il ne s’en tient pas aux grammaires roumaine, française et allemande requises aux examens des lycéens : il apprend de surcroît l’italien, l’anglais, l’hébreu et le persan ! Il n’a pas quatorze ans lorsque son premier article, « L’ennemi du ver à soie », paraît dans le Journal des sciences populaires. Peu après, il public « Comment j’ai découvert la pierre philosophale » (1922), un conte fantastique inspiré du mythique Fulcanelli, parvenu, selon la légende, à la découverte de l’élixir de longue vie. Ses travaux de traducteur en étonnent plus d’un ; ainsi traduit-il en roumain les Souvenirs entomologiques de Jean-Henri Fabre. Et, en guise de récréation intellectuelle, il apprend par cœur un dictionnaire de plantes médicinales ! À dix-sept ans, il entreprend un récit dont il veut préserver la confidentialité, « Le Roman d’un adolescent myope » (édité en 1989). Étudiant dès 1925 à la faculté des lettres et de philosophie de Bucarest, il suit les cours de l’historien Nicolas Iorga et du philosophe Nae Ionescu. Multipliant les collaborations à des revues de lettres et de sciences humaines, il publie ses premières études sur les philosophies orientales et les religions.
La Nuit bengali, prix du meilleur roman
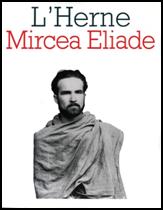 Après avoir séjourné à Rome (en 1927 puis en 1928) pour les besoins d’une thèse sur le poète Marsile Ficin et le philosophe dominicain Giordano Bruno, il souhaite parfaire ses connaissances du tantrisme et de la philosophie indienne et profite d’une bourse d’études du maharadjah de Kassimbazar pour séjourner en Inde. Il y rencontre Surendranath Dasgupta dont l’Histoire de la philosophie indienne l’avait attiré vers l’hindouisme et il s’éprend de sa fille, Maytrei Devi, qui lui inspire un roman, « La Nuit bengali ». Publié en 1933 à Bucarest, l’ouvrage est couronné du Prix du meilleur roman. Mais l’idylle entre les deux jeunes gens n’a pas été appréciée par le maître et le disciple doit rentrer au bercail en 1931, ramenant dans ses bagages une bonne pratique du sanscrit, une connaissance avérée du yoga et les précieux commentaires du philosophe de Calcutta sur les Upanishads (textes sacrés hindous). Sa thèse sur les techniques du yoga et son doctorat en philosophie lui permettent d’accéder au professorat à l’université de Bucarest : ses cours traitent du Problème du mal et de la rédemption dans l’histoire des religions ainsi que de la Dissolution du concept de causalité dans la logique bouddhiste.
Après avoir séjourné à Rome (en 1927 puis en 1928) pour les besoins d’une thèse sur le poète Marsile Ficin et le philosophe dominicain Giordano Bruno, il souhaite parfaire ses connaissances du tantrisme et de la philosophie indienne et profite d’une bourse d’études du maharadjah de Kassimbazar pour séjourner en Inde. Il y rencontre Surendranath Dasgupta dont l’Histoire de la philosophie indienne l’avait attiré vers l’hindouisme et il s’éprend de sa fille, Maytrei Devi, qui lui inspire un roman, « La Nuit bengali ». Publié en 1933 à Bucarest, l’ouvrage est couronné du Prix du meilleur roman. Mais l’idylle entre les deux jeunes gens n’a pas été appréciée par le maître et le disciple doit rentrer au bercail en 1931, ramenant dans ses bagages une bonne pratique du sanscrit, une connaissance avérée du yoga et les précieux commentaires du philosophe de Calcutta sur les Upanishads (textes sacrés hindous). Sa thèse sur les techniques du yoga et son doctorat en philosophie lui permettent d’accéder au professorat à l’université de Bucarest : ses cours traitent du Problème du mal et de la rédemption dans l’histoire des religions ainsi que de la Dissolution du concept de causalité dans la logique bouddhiste.
Sa participation aux activités de la société littéraire Criterion (1933-1934) accroît sa réputation. Il y rencontre le philosophe et écrivain Emil Cioran et le dramaturge Eugène Ionesco qui deviendront ses amis. Tout en préparant une nouvelle thèse sur l’œuvre de l’écrivain moldave roumain Bogdan Hasdeu (1836-1907), il fonde en avril 1939 la revue « Zalmoxis » qui élargit son auditoire au-delà des frontières roumaines.
 Au moment où son pays est pris en tenaille entre l’Allemagne nazie et la Russie de Staline, en avril 1940, il est nommé attaché culturel à l’ambassade de Londres. L’année suivante, il assure la même fonction à Lisbonne où il demeure jusqu’en 1945. Sa première femme, Nina Mares, décède au Portugal en 1944. Aussi choisit-il de s’exiler à Paris en 1945 où il fréquente, entre Butte Montmartre et quartier Latin, Emil Cioran, l’orientaliste Henry Corbin, les époux Ierunca (le poète Virgil Ierunca et l’écrivaine Monica Lovinescu), Eugène Ionesco et Constantin Tacou, un de ses futurs éditeurs. Il acquiert la nationalité française et son ami Georges Dumézil, historien et philologue, le convie à enseigner à l’École pratique des hautes études sur l’histoire des religions (Ve section, 1946-1948) tandis que des revuistes sollicitent ses contributions parmi lesquels Georges Bataille (revue Critique). En janvier 1948, il achève la rédaction du « Traité d’histoire des religions », une somme importante portant sur l’histoire comparée des religions et des mythes et révélant la singularité et la puissance d’un historien atypique.
Au moment où son pays est pris en tenaille entre l’Allemagne nazie et la Russie de Staline, en avril 1940, il est nommé attaché culturel à l’ambassade de Londres. L’année suivante, il assure la même fonction à Lisbonne où il demeure jusqu’en 1945. Sa première femme, Nina Mares, décède au Portugal en 1944. Aussi choisit-il de s’exiler à Paris en 1945 où il fréquente, entre Butte Montmartre et quartier Latin, Emil Cioran, l’orientaliste Henry Corbin, les époux Ierunca (le poète Virgil Ierunca et l’écrivaine Monica Lovinescu), Eugène Ionesco et Constantin Tacou, un de ses futurs éditeurs. Il acquiert la nationalité française et son ami Georges Dumézil, historien et philologue, le convie à enseigner à l’École pratique des hautes études sur l’histoire des religions (Ve section, 1946-1948) tandis que des revuistes sollicitent ses contributions parmi lesquels Georges Bataille (revue Critique). En janvier 1948, il achève la rédaction du « Traité d’histoire des religions », une somme importante portant sur l’histoire comparée des religions et des mythes et révélant la singularité et la puissance d’un historien atypique.
La sphère du sacré
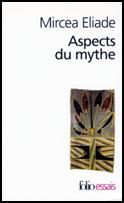 De 1925 à sa mort en 1986, c’est-à-dire durant soixante-et-un ans, il se consacre à ses recherches et à la littérature. Il écrit indifféremment en roumain, en français et en anglais. En 1956, il est invité à donner des conférences à l’université de Chicago qui entend pérenniser son implication pédagogique en lui offrant, l’année suivante, la chaire d’histoire des religions : il l’occupera jusqu’à sa retraite en 1975. La création d’une revue History of religions ainsi que des doctorats honoris causa et des honneurs divers issus de facultés anglo-saxonnes et européennes amplifient la notoriété internationale du personnage. Habitant avec sa seconde femme, Christinel Sotescu, un modeste pavillon non loin du campus de l’université américaine, il écrivait encore les derniers mois de son existence. Attelé à l’écritoire dès une heure de l’après-midi, il ne s’arrêtait qu’à dix heures du soir ! rapportent des proches.
De 1925 à sa mort en 1986, c’est-à-dire durant soixante-et-un ans, il se consacre à ses recherches et à la littérature. Il écrit indifféremment en roumain, en français et en anglais. En 1956, il est invité à donner des conférences à l’université de Chicago qui entend pérenniser son implication pédagogique en lui offrant, l’année suivante, la chaire d’histoire des religions : il l’occupera jusqu’à sa retraite en 1975. La création d’une revue History of religions ainsi que des doctorats honoris causa et des honneurs divers issus de facultés anglo-saxonnes et européennes amplifient la notoriété internationale du personnage. Habitant avec sa seconde femme, Christinel Sotescu, un modeste pavillon non loin du campus de l’université américaine, il écrivait encore les derniers mois de son existence. Attelé à l’écritoire dès une heure de l’après-midi, il ne s’arrêtait qu’à dix heures du soir ! rapportent des proches.
De l’œuvre colossale du penseur, de l’ethnologue et de l’historien, la postérité retiendra Le Mythe de l’éternel retour (1949), Le Chamanisme et les techniques archaïques de l’extase (1951), Images et symboles (1952), Forgerons et Alchimistes (1956), Mythes, rêves et mystères (1957), Le Sacré et le profane (1965), et surtout la monumentale - et inachevée - Histoire des croyances et des idées religieuses, trois tomes publiés chez l’éditeur Payot (1975/1978/1983) qui couvrent une période de l’âge de la pierre jusqu’à l’âge des réformes. Pour Eliade, la sphère du sacré dépasse les limites du religieux, en tout cas, de la religion chrétienne. « Il défend résolument l’idée, observe son biographe Eugen Simion, qu’il y a un autre homme spirituel que celui que définissent Descartes, Kant et en général tous les grands  philosophes européens, l’homme non-européen, plus ancien et dont l’héritage spirituel est plus riche. » Résolument moderniste, l’enseignement eliadesque postule que bien antérieurement aux mystères d’Éleusis, l’homme archaïque affichait déjà des comportements magico-mystiques. Aborigènes d’Australie, Iakoutes du lac Baïkal et nombre de peuples prétendument primitifs savaient eux aussi disserter de la naissance du cosmos et de l’origine de l’homme recourant à la fabrication de mythes à travers les éléments, la forêt, le chamanisme, les rituels, les symboles, les arts, la magie et le fantastique. L’étude comparatiste et inlassable des diverses mythologies, cosmogonies ou même des idéologies lui aura permis de comprendre et d’analyser avec beaucoup de lucidité le fonctionnement du sacré dans ses formes initiatiques et primitives, aussi bien que dans la mentalité de ses contemporains. Œuvre profuse et éclairante dont nous avons hérité.
philosophes européens, l’homme non-européen, plus ancien et dont l’héritage spirituel est plus riche. » Résolument moderniste, l’enseignement eliadesque postule que bien antérieurement aux mystères d’Éleusis, l’homme archaïque affichait déjà des comportements magico-mystiques. Aborigènes d’Australie, Iakoutes du lac Baïkal et nombre de peuples prétendument primitifs savaient eux aussi disserter de la naissance du cosmos et de l’origine de l’homme recourant à la fabrication de mythes à travers les éléments, la forêt, le chamanisme, les rituels, les symboles, les arts, la magie et le fantastique. L’étude comparatiste et inlassable des diverses mythologies, cosmogonies ou même des idéologies lui aura permis de comprendre et d’analyser avec beaucoup de lucidité le fonctionnement du sacré dans ses formes initiatiques et primitives, aussi bien que dans la mentalité de ses contemporains. Œuvre profuse et éclairante dont nous avons hérité.
- Mircea Eliade, romancier, par Eugen Simion, traduit du roumain par Marily Le Nir, éditions Oxus, 320 pages, 2004
- Mircea Eliade, sous la direction de Constantin Tacou, les Cahiers de l’Herne, 406 pages, 1977.
Lectures complémentaires :
- Aspects du mythe, par M. Eliade, Gallimard/Folio, 256 pages, 1988 ;
- La Nostalgie des origines - Méthodologie et histoire des religions, par M. Eliade, Gallimard/Folio, 288 pages, 1991 ;
- Initiation, rites, sociétés secrètes, par M. Eliade, Gallimard/Folio, 288 pages, 1992.
Varia : Poésie visuelle et livres de peintres
« Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, dont la version publiée par Mallarmé en 1897 dans la revue Cosmopolis ne constitue qu’une ébauche provisoire - il faudra attendre 1914 pour en connaître le projet véritable -, consacre de façon décisive l’émergence en Occident d’une littérature désireuse de privilégier la visualité du texte sur sa fidélité à l’oral. Mallarmé, observe Paul Valéry, "avait étudié très soigneusement (même sur les affiches, sur les journaux) l’efficace des distributions de blancs et de noir, l’intensité comparée des types". La seule "nouveauté" que revendique le poète, toutefois, est celle d’"un espacement de la lecture". "Les blancs, en effet, précise-t-il, assument l’importance, frappent d’abord." Sans doute cette innovation visait-elle d’abord à introduire certains effets d’origine plastique dans l’écriture. Mais elle perturbait de ce fait même de manière fondamentale les principes de la création littéraire. Car le poète ne cédait pas seulement "l’initiative aux mots", pour reprendre une de ses formules ; en procédant de la sorte, il déléguait cette initiative à son lecteur, seul décideur, dans l’instant où il les jaugeait, de la valeur de ces blancs abandonnés dans la page comme autant de fragments de pensée muette.
 « Ayant pratiqué lui-même le livre en typographie, Pierre Reverdy prétendit utiliser les blancs de la page pour inventer une forme de poésie lyrique qui serait purement écrite. La seconde version des Ardoises du toit (1945), plus concertée que celle de 1918, montre quelle était sa stratégie : impliquer personnellement le lecteur dans l’évaluation spatiale du texte, l’inciter à décider lui-même du sens sur lequel les "blancs" faisaient silence, et introduire grâce à ces blancs, dans le présent sensible de la lecture, une dimension temporelle et affective qui en multiplie les résonances. Plaçant son œuvre sous le signe de la peinture - l’exclamation du Corrège : "Et moi aussi je suis peintre" sert d’exergue à ses Idéogrammes lyriques, première version des Calligrammes qu’il publie en 1918 -, Guillaume Apollinaire a renoué avec la tradition antique des « vers figurés ». Mais il s’est également inspiré des créations « simultanées » de ses amis futuristes et de leurs revendications en faveur des « mots en liberté », selon l’expression de Marinetti. Durant les deux décennies qui ont suivi, les artistes et les poètes se sont consacrés assidûment à cette libération, tantôt par souci de rompre avec les structures académiques du texte, tantôt afin de créer des styles de lettres mieux adaptés aux exigences de la modernité. »
« Ayant pratiqué lui-même le livre en typographie, Pierre Reverdy prétendit utiliser les blancs de la page pour inventer une forme de poésie lyrique qui serait purement écrite. La seconde version des Ardoises du toit (1945), plus concertée que celle de 1918, montre quelle était sa stratégie : impliquer personnellement le lecteur dans l’évaluation spatiale du texte, l’inciter à décider lui-même du sens sur lequel les "blancs" faisaient silence, et introduire grâce à ces blancs, dans le présent sensible de la lecture, une dimension temporelle et affective qui en multiplie les résonances. Plaçant son œuvre sous le signe de la peinture - l’exclamation du Corrège : "Et moi aussi je suis peintre" sert d’exergue à ses Idéogrammes lyriques, première version des Calligrammes qu’il publie en 1918 -, Guillaume Apollinaire a renoué avec la tradition antique des « vers figurés ». Mais il s’est également inspiré des créations « simultanées » de ses amis futuristes et de leurs revendications en faveur des « mots en liberté », selon l’expression de Marinetti. Durant les deux décennies qui ont suivi, les artistes et les poètes se sont consacrés assidûment à cette libération, tantôt par souci de rompre avec les structures académiques du texte, tantôt afin de créer des styles de lettres mieux adaptés aux exigences de la modernité. »
Extrait de « Poésie visuelle et livres de peintres », un texte d’Anne-Marie Christin issu de l’ouvrage « Histoire de l’écriture - De l’idéogramme au multimédia », éditions Flammarion, 416 pages, 2012, sous la direction d’Anne-Marie Christin, avec la collaboration de 53 auteurs.
Carnet : nouvelles et poésie
Je lis souvent les œuvres de nouvellistes parce que je crois en la parenté de la nouvelle avec la poésie. Les grands maîtres du genre m’ont appris à aimer l’écriture à la pointe sèche où le moindre grain de pathos et de sensiblerie a été éliminé. Je rejoins en cela les lecteurs qui privilégient les textes découvrant la désespérance sans les larmes, le drame sans le dramatique, la joie sans les rires.
Vivant, Denon ?
Je parierais que nombreux sont les visiteurs du palais du Louvre à ignorer qui fut Dominique Vivant Denon (1747-1825) dont l’aile de l’ancienne résidence royale longeant la Seine porte le nom. En dépit de la prédiction de son patronyme, nous avons perdu le souvenir de ce qui le rendit glorieux, de son rôle officiel sous l’Empire. Ses contemporains non plus n’ont pas retenu l’écrivain brillant, le voyageur des Pyramides (1798), le précurseur de la muséologie et le dessinateur du Voyage en Basse et Haute Égypte pendant les campagnes du général Bonaparte (1802). Une de ses nouvelles, Point de lendemain, parut « sous le manteau » en 1777 dans un volume qu’on attribua faussement au poète et dramaturge Claude-Joseph Dorat (1734-1780). La paternité de ce chef-d’œuvre du « second rayon » échappa aussi au fameux baron. Injuste postérité !
(Mercredi 18 mai 2016)
Du carrosse au tgv
Au milieu du XIXe siècle, il faut une quinzaine de jours à un carrosse pour relier Paris à Marseille. Aujourd’hui, le même parcours s’avale en trois heures par des trains à grande vitesse qui n’étonnent plus personne, avec leur vitesse de croisière de 300/320 km/heure. Au Japon, l’an dernier, un train à sustentation magnétique baptisé Maglev a dépassé les 600 km/h : il pourrait rouler à une vitesse de croisière de 500 km/h dès 2017 !
Introspection
Écrire, c’est plonger en soi-même, explique Orhan Pamuk (Istanbul, 1952), c’est traduire en mots ce regard intérieur, passer à l’intérieur de soi, et jouir du bonheur d’explorer patiemment, et obstinément, un monde nouveau. Bien avant l’écrivain turc et prix Nobel de littérature en 2006, Nathalie Sarraute (1900-1999) témoignait de l’intérêt à décrire son for intérieur, une exploration aussi bouleversante et aussi infinie que celle de tous les astres inscrits sur la coupole d’un planétarium.
(Mardi 7 juin 2016)
Lecture critique
« L’Écologiste » à l’école de la nature et de la citoyenneté
 La situation reste paradoxale : science majeure en sa qualité de branche de la biologie, l’écologie connaît d’incessants développements et mutations, ce dont témoignent les publications nombreuses de communautés scientifiques diverses. Pourtant, la discipline n’a pas encore trouvé, semble-t-il, sa place au sein de l’université et de l’enseignement primaire et secondaire. Émanation de la revue anglaise The Ecologist [créée en 1969 par le philosophe Edward Goldsmith (1928-2009)], le magazine L’Écologiste a l’avantage d’introduire le lecteur attentif dans le champ complexe de l’écologie, en présentant et en analysant aussi bien ses aspects classiques que les développements nouveaux qu’elle induit. La lecture trimestrielle de ses pages tend à corriger la confusion entretenue par les excès de la politique et des mouvements associatifs liés plus ou moins légitimement à l’écologie. Aussi n’est-il pas superflu de redire que la science écologique a pour tâche d’étudier le monde vivant à ses différents degrés d’organisation, de l’individu à la biosphère, en passant par les populations, les peuplements, les biocénoses, les écosystèmes et les paysages. Les thématiques abordées par la revue (franco-britannique) animée par Thierry Jaccaud (rédacteur en chef) témoignent de la multitude des domaines concernés par les sciences de l’environnement. Inédits en français ou traduits de l’anglais, les articles et analyses sont guidés par un grand souci de vulgarisation.
La situation reste paradoxale : science majeure en sa qualité de branche de la biologie, l’écologie connaît d’incessants développements et mutations, ce dont témoignent les publications nombreuses de communautés scientifiques diverses. Pourtant, la discipline n’a pas encore trouvé, semble-t-il, sa place au sein de l’université et de l’enseignement primaire et secondaire. Émanation de la revue anglaise The Ecologist [créée en 1969 par le philosophe Edward Goldsmith (1928-2009)], le magazine L’Écologiste a l’avantage d’introduire le lecteur attentif dans le champ complexe de l’écologie, en présentant et en analysant aussi bien ses aspects classiques que les développements nouveaux qu’elle induit. La lecture trimestrielle de ses pages tend à corriger la confusion entretenue par les excès de la politique et des mouvements associatifs liés plus ou moins légitimement à l’écologie. Aussi n’est-il pas superflu de redire que la science écologique a pour tâche d’étudier le monde vivant à ses différents degrés d’organisation, de l’individu à la biosphère, en passant par les populations, les peuplements, les biocénoses, les écosystèmes et les paysages. Les thématiques abordées par la revue (franco-britannique) animée par Thierry Jaccaud (rédacteur en chef) témoignent de la multitude des domaines concernés par les sciences de l’environnement. Inédits en français ou traduits de l’anglais, les articles et analyses sont guidés par un grand souci de vulgarisation.
Centrales nucléaires : le pire est possible
Dans la livraison de juillet-septembre 2007, Stéphane Lhomme, porte-parole du Réseau Sortir du nucléaire, met l’accent sur le danger du risque sismique en France. « Des séismes de magnitude 7 ont déjà eu lieu (celui de la mi-juillet au Japon était de 6,8) et le tremblement de terre dit "de Lambesc" en 1909 a littéralement rasé la Provence. C’est justement dans cette région que se trouve le centre nucléaire de Cadarache qui contient plusieurs installations inadaptées au risque sismique comme le fameux "atelier de plutonium" que l’Autorité de sûreté nucléaire tente de faire fermer depuis des années. Rouvert en 2004 pour recevoir un chargement de plutonium américain (qui a défrayé la chronique), cette installation fonctionne toujours, officiellement pour éliminer les rebuts et autres matières nucléaires qui s’y trouvent encore.
« Le séisme, conclut Stéphane Lhomme, qui peut causer un Tchernobyl français peut se produire dans 500 ans… ou demain matin. Si l’épicentre est très proche d’une centrale, le pire est possible, voire probable. Il est temps que les autorités françaises prennent leurs responsabilités… ou que les citoyens les y contraignent. »
Dans la même livraison, nous apprenons que l’Inde est désormais le seul pays du monde où l’on peut encore voir des tigres en liberté. « Décidément, remarque Armand Farrachi, les symboles nationaux, le tigre en Inde, le pygargue à tête blanche aux États-Unis, le kiwi en Nouvelle-Zélande ou le cèdre au Liban se portent mieux sur les billets de banque que dans la nature. » Au chapitre des plantes sauvages, Thierry Thevenin souligne que la gentiane jaune (Gentiana lutea L.) reste la première plante de cueillette en France, en terme de quantité ramassée : les liquoristes en emploient de grandes quantités en effet pour fabriquer des apéritifs.
À l’école de la nature
 Les cartes ou affiches murales éditées dès 1831 par Émile Deyrolle sollicitent de délicieux souvenirs d’enfance à travers les leçons de choses qu’elles dispensaient en botanique, zoologie, géographie, géologie, physique, chimie, minéralogie, entomologie, etc. À ce titre, la prospection très savante à laquelle se livre Olivier Sigaut dans le domaine de l’éducation de la nature et de la ruralité (L’Écologiste n° 36 de janvier-mars 2012) aiguise les mêmes curiosités. Professeur de sciences sociales et de gestion de l’environnement, celui-ci retrace les étapes et les pédagogues qui balisent l’éducation de la nature de la fin du XVIIIe siècle au XIXe siècle. Il rend justice à Jean Macé dont les actions à la tête de la Ligue de l’enseignement ont favorisé la promotion de la culture et de la science en milieu rural. « Il s’agissait à travers ces dispositifs, remarque-t-il, de développer des pratiques agricoles plus efficaces mais aussi de sortir les populations d’un certain obscurantisme dans lequel les avaient plongés la religion et le non-accès à la formation professionnelle. » Il est juste de la même façon de rappeler la personnalité de Ferdinand Buisson (1841-1932), directeur de l’instruction publique et fondateur de la Ligue des droits de l’Homme. Le futur prix Nobel de la paix a impulsé dans les écoles urbaines une éducation à la nature à travers les classes promenades. Suivront les jardins ouvriers à l’initiative de l’abbé Jules Lemire (1853-1928) et de la Ligue du coin de terre ainsi que les jardins scolaires dont les supports éducatifs recouraient aux excellents manuels du botaniste et écologue Gaston Bonnier (1853-1922). Olivier Sigaut déplore l’effacement de l’éducation populaire à la nature au bénéfice d’une éducation au développement durable, une idéologie très moderne, selon lui, qui a tendance à occulter habilement les conditions politiques de sa construction sociale.
Les cartes ou affiches murales éditées dès 1831 par Émile Deyrolle sollicitent de délicieux souvenirs d’enfance à travers les leçons de choses qu’elles dispensaient en botanique, zoologie, géographie, géologie, physique, chimie, minéralogie, entomologie, etc. À ce titre, la prospection très savante à laquelle se livre Olivier Sigaut dans le domaine de l’éducation de la nature et de la ruralité (L’Écologiste n° 36 de janvier-mars 2012) aiguise les mêmes curiosités. Professeur de sciences sociales et de gestion de l’environnement, celui-ci retrace les étapes et les pédagogues qui balisent l’éducation de la nature de la fin du XVIIIe siècle au XIXe siècle. Il rend justice à Jean Macé dont les actions à la tête de la Ligue de l’enseignement ont favorisé la promotion de la culture et de la science en milieu rural. « Il s’agissait à travers ces dispositifs, remarque-t-il, de développer des pratiques agricoles plus efficaces mais aussi de sortir les populations d’un certain obscurantisme dans lequel les avaient plongés la religion et le non-accès à la formation professionnelle. » Il est juste de la même façon de rappeler la personnalité de Ferdinand Buisson (1841-1932), directeur de l’instruction publique et fondateur de la Ligue des droits de l’Homme. Le futur prix Nobel de la paix a impulsé dans les écoles urbaines une éducation à la nature à travers les classes promenades. Suivront les jardins ouvriers à l’initiative de l’abbé Jules Lemire (1853-1928) et de la Ligue du coin de terre ainsi que les jardins scolaires dont les supports éducatifs recouraient aux excellents manuels du botaniste et écologue Gaston Bonnier (1853-1922). Olivier Sigaut déplore l’effacement de l’éducation populaire à la nature au bénéfice d’une éducation au développement durable, une idéologie très moderne, selon lui, qui a tendance à occulter habilement les conditions politiques de sa construction sociale.
Les dangers de l’industrie minière
Le dossier du n° 46 de janvier-mars 2016 sur l’état de la planète donne l’occasion à Alain Gras, professeur émérite à la Sorbonne, de pointer les menaces engendrées par l’excès de l’extraction des minerais, du sable, des hydrocarbures, du charbon, des terres rares. Selon lui, le développement technologique encourage le pillage de nos sols à un point inimaginable par nos ancêtres d’avant la civilisation thermo-industrielle. « L’exemple de l’autoroute est frappant, argumente-t-il : pour faire rouler plus vite nos véhicules, il est consommé 30 000 tonnes de sable par kilomètre. Dubaï a tellement puisé dans son environnement, avec son projet d’archipel d’îles artificielles, qu’il se trouve aujourd’hui obligé d’importer du sable d’Australie. » « Le cas le plus célèbre, dit-il plus loin dans une excellente analyse, est celui de Nauru, île de phosphate, dont les habitants passèrent en un siècle de membres d’une société tribale, en 1900,
 à celui de riches rentiers dans les années 1970 (au deuxième rang des revenus par habitant après l’Arabie Saoudite), avant de retomber au dessous du seuil de pauvreté (et champions de l’obésité !), une fois l’île dévastée par les compagnies minières américaines et australiennes. »
à celui de riches rentiers dans les années 1970 (au deuxième rang des revenus par habitant après l’Arabie Saoudite), avant de retomber au dessous du seuil de pauvreté (et champions de l’obésité !), une fois l’île dévastée par les compagnies minières américaines et australiennes. »
Parfois, il est utile et édifiant que soit rappelée de quelle façon certaines de nos idéologies ont pris naissance. Silvia Pérez-Vitoria revient ainsi sur le concept de « développement » qui bien qu’advenu à la fin du XVIIIe siècle ne s’est imposé qu’au milieu du XIXe siècle en Europe puis aux États-Unis à travers l’industrialisation. « Mais la notion de développement comme seule forme possible d’évolution des sociétés prend corps le 20 janvier 1949, enseigne l’économiste et sociologue, avec l’apparition de celle de sous-développement. » Ce jour-là, Harry Truman, président des États-Unis, appelle de ses vœux le lancement d’un programme audacieux engageant avancées scientifiques et progrès industriel au service de l’amélioration et de la croissance des régions sous-développées. L’auteure du Manifeste pour un XXIe siècle paysan (dont la contribution est extraite) prévient son lectorat des mirages qu’alimente le « développement », un mot qui n’existe pas dans toutes les langues ; elle le met en garde contre la duperie des concepts qui le sous-tendent à savoir « l’idéologie du progrès, la survalorisation des techniques et l’imaginaire "économiciste" ».
Il reste une lecture très éclairante, très instructive aussi, à l’exemple de la majorité des enquêtes et des analyses d’une revue essentielle à la construction de la citoyenneté.
- L’Écologiste, Forêts, n° 23, juillet-septembre 2007, 66 pages ;
- L’Écologiste, Nature & économie - Sauver les forêts, n° 36, janvier-mars 2012, 66 pages ;
- L’Écologiste, L’état de la planète, n° 46, janvier-mars 2016, 66 pages.
Portrait
Le triomphe de Gustave Eiffel
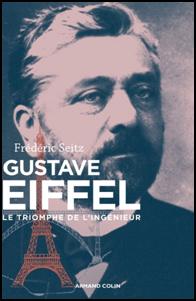 Diplômé de l’École centrale (mais mis en échec à Polytechnique), Gustave Eiffel (Dijon, 15 décembre 1832-Paris, 27 décembre 1923) se destine à la chimie avant d’opter pour la métallurgie qui fera sa gloire et sa fortune. L’ingénieur exploite les qualités des métaux : leur résistance supérieure à celle du bois ou de la pierre, leur élasticité qui permet au fer ou à l’acier de résister à des contraintes de tension et de compression, leur résistance au feu et leur prix très inférieur à celui des matériaux traditionnels. Après avoir réalisé de nombreux ponts et viaducs, il construit la coupole pour le grand équatorial de l’observatoire de Nice puis l’armature de la statue La liberté éclairant le monde qui sera inaugurée à New York le 28 octobre 1886. Pour l’Exposition universelle de 1889, Maurice Koechlin et Émile Nouguier, respectivement chef du bureau d’études et ingénieur de l’entreprise Eiffel, présentent en 1884 le croquis d’un grand pylône métallique formé de poutres en treillis et susceptible de s’élever à plus de trois cents mètres dans le ciel du Champ-de-Mars. Gustave Eiffel manifeste peu d’enthousiasme pour cette tour mais il laisse ses collaborateurs en poursuivre l’étude. Avant la fin de la même année, convaincu de la validité du projet, des prouesses techniques qu’il peut susciter et du bénéfice qu’il peut en tirer, il se préoccupe du brevet d’invention « pour une disposition nouvelle permettant de construire des piles et des pylônes métalliques d’une hauteur de 300 mètres » tout en veillant à y associer les deux techniciens.
Diplômé de l’École centrale (mais mis en échec à Polytechnique), Gustave Eiffel (Dijon, 15 décembre 1832-Paris, 27 décembre 1923) se destine à la chimie avant d’opter pour la métallurgie qui fera sa gloire et sa fortune. L’ingénieur exploite les qualités des métaux : leur résistance supérieure à celle du bois ou de la pierre, leur élasticité qui permet au fer ou à l’acier de résister à des contraintes de tension et de compression, leur résistance au feu et leur prix très inférieur à celui des matériaux traditionnels. Après avoir réalisé de nombreux ponts et viaducs, il construit la coupole pour le grand équatorial de l’observatoire de Nice puis l’armature de la statue La liberté éclairant le monde qui sera inaugurée à New York le 28 octobre 1886. Pour l’Exposition universelle de 1889, Maurice Koechlin et Émile Nouguier, respectivement chef du bureau d’études et ingénieur de l’entreprise Eiffel, présentent en 1884 le croquis d’un grand pylône métallique formé de poutres en treillis et susceptible de s’élever à plus de trois cents mètres dans le ciel du Champ-de-Mars. Gustave Eiffel manifeste peu d’enthousiasme pour cette tour mais il laisse ses collaborateurs en poursuivre l’étude. Avant la fin de la même année, convaincu de la validité du projet, des prouesses techniques qu’il peut susciter et du bénéfice qu’il peut en tirer, il se préoccupe du brevet d’invention « pour une disposition nouvelle permettant de construire des piles et des pylônes métalliques d’une hauteur de 300 mètres » tout en veillant à y associer les deux techniciens.
Une tour en granit concurrente de la tour de fer
En 1886, les instances d’arbitrage ont à choisir entre le pylône de la maison Eiffel et une tour en granit, également de 300 mètres de hauteur, divisée en cinq étages eux-mêmes décorés de colonnes, une tour dessinée par l’architecte Jules Bourdais associé à un ingénieur de Centrale, Amédée Sébillot. La tour de fer l’emporte sur la tour de pierre. Au terme des travaux de fondation de janvier à juin 1887, la tour s’élève à un rythme régulier tandis que les pièces du gigantesque meccano sont assemblées dans l’usine Eiffel de Levallois-Perret. Le premier étage est achevé le 1er avril 1888, le deuxième dès le 14 août et les 1792 marches de l’édifice, inauguré le 31 mars 1889, un mois avant le début de l’Exposition universelle, sont gravies par Gustave Eiffel et les membres du conseil municipal qui plantent le drapeau français au sommet (312 mètres) 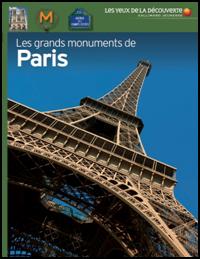 tandis que retentissent vingt-et-un coups de canon.
tandis que retentissent vingt-et-un coups de canon.
Pourtant, dès lors que les plans de la tour sont divulgués en 1886, le projet essuie les plus virulentes critiques. Une campagne de protestation contre « l’inutile et monstrueuse tour Eiffel » reçoit de 1886 à 1887 de célèbres pétitionnaires parmi lesquels les écrivains Alexandre Dumas fils, Guy de Maupassant, Édouard Pailleron, Victorien Sardou et Émile Zola, les poètes François Coppée, Leconte de Lisle et Sully-Prudhomme, les peintres Léon Bonnat, William Bouguereau et Ernest Meissonnier auxquels se joint Charles Gounod. Aux obsèques de Gustave Eiffel, le lundi 31 décembre 1923, en l’église parisienne Saint-Philippe du Roule, sa famille ne tiendra pas rigueur au compositeur de Mireille dont une œuvre est exécutée pendant l’office funèbre à la faveur d’un programme musical intégrant Ludwig van Beethoven, César Franck, Edvard Grieg et Samuel Rousseau.
« La tour Eiffel est l’édifice le plus haut du monde jusqu’en 1929, année de la construction de l’immeuble Chrysler (319 m) à New York, observe Jean-Michel Billioud. Rouge à l’origine, elle est passée au jaune pour l’Exposition universelle de 1900, puis au bronze, utilisé dans trois tons différents depuis 1968. Destiné à être éphémère, ce monument a déjà été visité par deux cent cinquante millions de personnes : c’est le record du monde pour un monument payant. Parmi les 6 à 7 millions de visiteurs accueillis chaque année, 75 % sont étrangers. »
Aujourd’hui, un projet vise à doter la vieille dame de fer de deux étages de plus, mais en sous-sol, sur le modèle du Louvre.
Mémoire et patronyme
Outre la fameuse tour, l’entreprise Eiffel construit plus de 120 ouvrages en moins de vingt-cinq ans dans différents pays : le pont Maria-Pia au Portugal, classé Monument national, le pont ferroviaire d’El-Ourit à Tlemcen (Algérie), le pont Skenderija sur la Miljacka (Yougoslavie), la gare de Budapest-Nyugati (Hongrie), la gare routière de La Paz (Bolivie), la gare Basmane d’Izmir (Turquie), l’église Santa Barbara à Santa Rosalia (Mexique) et la Casa de Fierro (maison de fer préfabriquée) à Iquitos (Pérou). D’autres projets, très ambitieux, ne seront pas concrétisés, tels le métropolitain à Paris, le tunnel-pont sous la Manche et l’observatoire d’astronomie du Mont-Blanc.
 « Au travers de ses réalisations, de ses recherches et de ses écrits, argumente Frédéric Seitz, Gustave Eiffel a énoncé et mis en pratique des principes techniques et scientifiques très innovants et jeté les fondements d’une pensée renouvelée de l’ingénierie. » Le génial inventeur rend compte de ses expérimentations dans des revues de météorologie et d’aérodynamique. Ainsi la tour parisienne lui sert de laboratoire, avec une station météo à son sommet et des équipements pour étudier les mouvements des corps dans l’air. Il établit une soufflerie à Auteuil où il étudie la résistance de corps de formes différentes (roues de train d’atterrissage, flotteurs d’hydravions, fuselages d’avion). Il construit même un avion de chasse à grande vitesse qui pourrait voler à la vitesse de 265 kilomètres/heure, à une altitude comprise entre 4 000 et 8 000 mètres, mais l’aéronef connaît des déboires et un pilote se tue lors des essais, un drame qui hâte l’interruption définitive de l’expérience.
« Au travers de ses réalisations, de ses recherches et de ses écrits, argumente Frédéric Seitz, Gustave Eiffel a énoncé et mis en pratique des principes techniques et scientifiques très innovants et jeté les fondements d’une pensée renouvelée de l’ingénierie. » Le génial inventeur rend compte de ses expérimentations dans des revues de météorologie et d’aérodynamique. Ainsi la tour parisienne lui sert de laboratoire, avec une station météo à son sommet et des équipements pour étudier les mouvements des corps dans l’air. Il établit une soufflerie à Auteuil où il étudie la résistance de corps de formes différentes (roues de train d’atterrissage, flotteurs d’hydravions, fuselages d’avion). Il construit même un avion de chasse à grande vitesse qui pourrait voler à la vitesse de 265 kilomètres/heure, à une altitude comprise entre 4 000 et 8 000 mètres, mais l’aéronef connaît des déboires et un pilote se tue lors des essais, un drame qui hâte l’interruption définitive de l’expérience.
Quatre-vingt douze ans après la mort de Gustave Eiffel, son œuvre et sa pensée n’ont pas été oubliées par ses pairs… et ses descendants. En 1994, ces derniers (quatre-vingt membres environ) ont obtenu, par décret, l’autorisation d’accoler leurs noms de famille respectifs au patronyme de leur prestigieux ancêtre (1). Ils ont également obtenu du puissant groupe Eiffage, qui a intégré en 1992 l’entreprise Eiffel constructions métalliques, de renoncer au patronyme de l’ingénieur de la fameuse tour dans la dénomination sociale d’une de ses filiales selon le souhait exprimé par l’intéressé en 1893.
(1) Massif boisé du Land de Rhénanie-Palatinat, Eifel est à l’origine du nom de l’inventeur de la tour Eiffel. Bourgeois de Marmagen, ville proche de Cologne, les Boenickhausen, ses ancêtres, ont adopté, avec une légère altération, le nom de leur chère province natale, Eifel, lorsqu’ils sont arrivés à Paris au début du XVIIIe siècle.
- Gustave Eiffel - Le triomphe de l’ingénieur, par Frédéric Seitz, éditions Armand Colin, 304 pages, 2014 ;
- Les Grands Monuments de Paris, par Jean-Michel Billioud, Gallimard Jeunesse/Les Yeux de la découverte, 64 pages, 2014 ;
- Gustave Eiffel, le magicien du fer, sous la direction de Caroline Mathieu, éditions Flammarion/Skira, 256 pages, 2009.





