Les Papiers collés
de Claude Darras
Hiver 2016
Carnet : Silence !
On ne fait taire le silence qu’en parlant moins fort que lui.
(Georges Perros, « Papiers collés » 1, Gallimard/l’Imaginaire, 1960-2011)
Fin de soirée
À Digne. Sous les platanes du Boulevard, les commerçants tirent les chaises. Pendant ce temps, comme chaque nuit, le ciel multiplie ses étoiles.
(Jules Mougin, La Grande Halourde, Robert Morel éditeur, 1961)
Credo
Je relis avec un plaisir toujours neuf les essais de la collection Ce que je crois lancée en 1953 à Paris par les éditions Grasset. Les Credo d’Hervé Bazin, Gilbert Cesbron, Jean Delumeau, François Mauriac, Jacqueline de Romilly et Jean Rostand livrent des mines de sagesse et de méditation. Souvent, cependant, l’ambiguïté assaille le lecteur comme elle a certainement étreint l’essayiste. Tant le verbe « croire » est conjugué ici dans sa double et paradoxale acceptation de doute et de certitude. Croire, n’est-ce pas, à la fois, affirmer une conviction et, à défaut de l’infirmer tout à fait, la nuancer quelque peu ? L’anthropologue Emma Aubin-Boltanski affirme que pour être intrinsèquement liées ces définitions demeurent contradictoires, car « le doute est toujours au cœur de la conviction » et « l’affirmation indique d’elle-même qu’elle peut toujours être suspendue ».
(Lundi 26 septembre 2016)
Modes enfantines
On s’étonne qu’en hiver les enfants des pasteurs de l’Afrique subsaharienne façonnent encore dans l’argile recueillie sur le bord des mares des figurines de bétail avec lesquelles ils jouent. Naguère, ceux des Hautes-Alpes fomentaient de semblables récréations avec des petits morceaux de bois taillés. Imitant en cela leurs ascendants dont la pratique experte entrait dans le cadre d’une économie longtemps autarcique : mobilier, outillage agricole et artisanal, éléments de construction, instruments domestiques, contenants de tout acabit, le plus souvent ornés de gravures, de sculptures, parfois aussi de peintures. La multiplicité des usages du bois attestait le goût des montagnards à le travailler, à le transformer.
 Une croisade pour un colchique Une croisade pour un colchique
Depuis plusieurs années, dans le hameau des Laurons, à Martigues, où je réside désormais, un comité d’intérêt de quartier (CIQ) tente de sensibiliser élus et populations à la nécessité de préserver l’unique station française d’un colchique, le mérendère à feuilles filiformes (Merendera filifolia), qui émerge du sol à la floraison durant la première quinzaine d’octobre en produisant de grandes et belles fleurs roses au milieu de feuilles en rosette. Coteau sablonneux et karstique de la garrigue littorale, l’anse de Bonnieu qui abrite cette espèce végétale d’exception est visitée de temps à autre par des botanistes venus s’enquérir de la santé de la plante, sévèrement menacée par une fréquentation non maîtrisée du site (usage dévastateur des engins motorisés notamment) et l’artificialisation croissante de son biotope (ou habitat naturel). Le bureau directeur du CIQ des Laurons déplore la lenteur de la DREAL (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) à déclarer le classement de la station qui devra aboutir à un arrêté préfectoral de protection de biotope (APB). Au moment où nos contemporains sont de plus en plus convaincus de l’urgence vitale de préserver la biodiversité et tous les écosystèmes de la planète, la croisade pour le colchique de Bonnieu leur offre la possibilité d’apporter une contribution responsable et décisive à la survie d’une nature, belle, diverse et émouvante. En septembre 1858, le professeur Alphonse Derbès (1818-1894), conservateur du Muséum d’histoire naturelle de Marseille, avait découvert le beau colchique de Bonnieu. Il travaillait alors sur le développement des oursins ainsi que sur la reproduction des algues et leur structure en Méditerranée. Mais c’est le botaniste et agronome montpelliérain Jacques Cambessèdes (1799-1863) qui a décrit le premier la plante en 1827. Outre la région qui s’appellera plus tard « Côte bleue », le mérendère comptait de très rares stations aux îles Baléares et en Algérie où on la nomme kikout.
Mérendère à feuilles filiformes (Vendredi 7 octobre 2016)
© Photo Daniel Cyr Lemaire
Écoute
Les gens importants ne nous jugent guère que sur notre façon de les écouter.
(Gilbert Cesbron, « Journal sans date », éditions Robert Laffont, 1967)
De la mort de Socrate
Ce n’est pas la ciguë qui a tué Socrate, condamné à mort en 399 av. J.-C., c’est une espèce nord-américaine, certes de la même famille, la cicutaire maculée (Cicuta maculata Linné), une plante bisannuelle ayant l’allure typique des ombellifères.
(Vendredi 7 octobre 2016)
|
Billet
Animalitaire
Curieuse époque ! Singuliers contemporains ! À l’automne 2010, à Paris, tandis que les uns contestent sur les boulevards la réforme des retraites, les autres réclament dans les rues des cages plus spacieuses pour les lapins domestiques ! On ne peut qu’être frappé, entre autres motifs d’étonnement, par la place et le statut, pour le moins paradoxaux, que nous accordons aujourd’hui aux animaux. Tandis que nous livrons les uns - bovins, porcins, volaille - à une exploitation impitoyable et barbare, nous chouchoutons les autres - les animaux de compagnie - presque comme nos propres enfants. Certains d’entre nous militent en faveur des animaux comme d’autres en faveur des humains. C’est ce qui avait amené l’écrivain Ernest Hemingway, en 1932, à forger le néologisme « animalitaire », par analogie avec « humanitaire », pour qualifier la compassion des aficionados à la vue des chevaux utilisés dans les courses de taureaux espagnols.
|
Lecture critique
Léon Blum, inspirateur du Front populaire
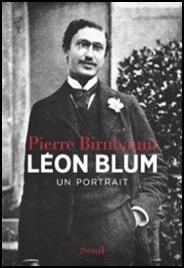 Les leçons de l’histoire sont fécondes mais sans doute ne sont-elles pas apprises comme elles le devraient, ce qui éviterait d’en revivre les pires moments. Raconté et commenté par l’historien et sociologue Pierre Birnbaum (Lourdes, 1940), le parcours intellectuel et sensible de celui qui incarna le Front populaire éveille à l’esprit du lecteur plus d’un écho qui lui fait associer le temps politique que nous vivons (sous le régime de la Ve République) à la période mai 1936-avril 1938 - pendant laquelle la France fut gouvernée par une coalition de partis de gauche (IIIe République) - et à l’après-guerre (1945-1946). L’ultime prise de parole de Léon Blum (Paris, 1872-Jouy-en-Josas, 1950), le 29 août 1946, à la tribune du 38e congrès national du parti socialiste SFIO (section française de l’Internationale ouvrière) où il est mis en minorité, dit assez le désenchantement du tribun. Sachant que le rapport moral défendu par Daniel Mayer, secrétaire général du Parti socialiste, va être repoussé par la majorité des congressistes, il livre ce jour-là à Paris une analyse pertinente et désabusée de la difficulté d’exercer le pouvoir sous la tutelle d’un régime capitaliste : la méditation consonne avec les avatars actuels de la politique du président François Hollande et du gouvernement socialiste conduit par Manuel Valls… Les leçons de l’histoire sont fécondes mais sans doute ne sont-elles pas apprises comme elles le devraient, ce qui éviterait d’en revivre les pires moments. Raconté et commenté par l’historien et sociologue Pierre Birnbaum (Lourdes, 1940), le parcours intellectuel et sensible de celui qui incarna le Front populaire éveille à l’esprit du lecteur plus d’un écho qui lui fait associer le temps politique que nous vivons (sous le régime de la Ve République) à la période mai 1936-avril 1938 - pendant laquelle la France fut gouvernée par une coalition de partis de gauche (IIIe République) - et à l’après-guerre (1945-1946). L’ultime prise de parole de Léon Blum (Paris, 1872-Jouy-en-Josas, 1950), le 29 août 1946, à la tribune du 38e congrès national du parti socialiste SFIO (section française de l’Internationale ouvrière) où il est mis en minorité, dit assez le désenchantement du tribun. Sachant que le rapport moral défendu par Daniel Mayer, secrétaire général du Parti socialiste, va être repoussé par la majorité des congressistes, il livre ce jour-là à Paris une analyse pertinente et désabusée de la difficulté d’exercer le pouvoir sous la tutelle d’un régime capitaliste : la méditation consonne avec les avatars actuels de la politique du président François Hollande et du gouvernement socialiste conduit par Manuel Valls…
Brillant normalien, jaurésien convaincu, captif des Nazis à Buchenwald, propagandiste du projet sioniste jusqu’à la naissance de l’État d’Israël en 1948, Léon Blum excita les passions autant que les haines. Le 6 juin 1936, après avoir commenté le programme de son gouvernement de Front populaire à la Chambre, il fut la cible d’une attaque injurieuse du député et avocat d’extrême-droite Xavier Vallat : « Pour la première fois, harangue le parlementaire, ce vieux pays gallo-romain va être dirigé par un Juif ! ». Quelques mois plus tôt, le président du Conseil des ministres faillit être lynché en pleine rue le jour des obsèques de l’historien maurrassien Jacques Bainville. Pour le leader de l’Action française, Blum restait « le juif à abattre ». Dans le portrait qu’il lui consacre, P. Birnbaum souligne l’antisémitisme virulent qui frappe sa vie durant l’action de ce « juif d’État » qui accède dès 1896 - au temps de l’affaire Dreyfus - au prestigieux Conseil d’État dont il gravit les échelons (auditeur, maître des requêtes puis commissaire du gouvernement) en un peu plus de vingt ans. Admirateur de l’écrivain Stendhal, l’homme alliait aussi la lucidité du critique littéraire (à La Revue blanche) à la pertinence de l’essayiste (Du mariage, 1907). « Blum fait sien le culte de la Révolution française de Stendhal et de ses héros Fabrice del Dongo et Lucien Leuwen, expose l’auteur. […] Stendhal rêvait d’une autre révolution, Blum aura le privilège d’en devenir le maître d’œuvre, le Front populaire, dont il est l’inspirateur, portant un rude coup au pouvoir de la classe dominante en faisant avancer à pas de géant le bonheur individuel et collectif, réalisant ainsi le projet saint-simonien tant espéré par Lucien Leuwen. Et tout comme Stendhal, à la fin de sa vie, Blum se fera gloire de n’avoir jamais rien possédé, rien accumulé […] en dehors de ses livres. »
Portrait pénétrant, empathique mais exempt de toute hagiographie, l’ouvrage ne cache pas les impressions contradictoires que continue de susciter le personnage, « une figure, conclut P. Birnbaum, dont le portrait tout en demi-teintes laisserait planer un doute sur la nature de sa personnalité façonnée par des fidélités multiples vouées pourtant, les unes et les autres, à l’accomplissement de l’histoire nationale ainsi qu’à la réalisation, sous toutes ses formes, de la justice ».
- Léon Blum, un portrait, par Pierre Birnbaum, éditions du Seuil, 272 pages, 2016.
Portrait
La poésie dans tous ses états
 Le génie d’un poète peut se mesurer, à mon sens, à l’emprise qu’il exerce sur des générations successives de lecteurs. Maurice Carême (Wavre, 1899-Anderlecht, 1978) plus que tout autre reste la victime de fluctuations de jugements se manifestant par des engouements soudains et de brusques désaffections. Avec Apollinaire, Aragon, Baudelaire, Du Bellay, Cendrars, Éluard, Hugo, La Fontaine, Lamartine, Mallarmé, Michaux, Nerval, Ponge, Prévert, Rimbaud, Ronsard, Valéry et Verlaine, l’écrivain belge de langue française compte parmi les poètes que les potaches de la communale et de l’enseignement secondaire retiennent et plébiscitent avec constance. Professeur de littérature française à l’université de Nantes, Daniel Briolet (1933-2003) a constaté que « sans l’école, le phénomène poétique demeurerait inconnu de la quasi-totalité des hommes de demain. Il est donc évident, quoi qu’on en ait dit, assure-t-il, que la poésie s’enseigne. Mais selon des modalités absolument spécifiques qui la différencient de tout autre objet d’enseignement » (Dans « Enseigner la poésie ? »). Le génie d’un poète peut se mesurer, à mon sens, à l’emprise qu’il exerce sur des générations successives de lecteurs. Maurice Carême (Wavre, 1899-Anderlecht, 1978) plus que tout autre reste la victime de fluctuations de jugements se manifestant par des engouements soudains et de brusques désaffections. Avec Apollinaire, Aragon, Baudelaire, Du Bellay, Cendrars, Éluard, Hugo, La Fontaine, Lamartine, Mallarmé, Michaux, Nerval, Ponge, Prévert, Rimbaud, Ronsard, Valéry et Verlaine, l’écrivain belge de langue française compte parmi les poètes que les potaches de la communale et de l’enseignement secondaire retiennent et plébiscitent avec constance. Professeur de littérature française à l’université de Nantes, Daniel Briolet (1933-2003) a constaté que « sans l’école, le phénomène poétique demeurerait inconnu de la quasi-totalité des hommes de demain. Il est donc évident, quoi qu’on en ait dit, assure-t-il, que la poésie s’enseigne. Mais selon des modalités absolument spécifiques qui la différencient de tout autre objet d’enseignement » (Dans « Enseigner la poésie ? »).
|
Que dire encore que je n’ai pas dit
Du mal, du bien, même du paradis ?
Il faut avoir la foi du paysan
Ou devenir naïf comme un enfant
Pour croire ici aux clés des philosophes
Qui tous les tirent de la même poche.
|
|
Maurice Carême : « Que dire encore ? » (extrait)
|
Que la poésie soit aujourd’hui comme hier privée de toute audience, c’est une constatation que chacun peut faire, en interrogeant l’homme de la rue, à quelque classe sociale qu’il appartienne. Depuis le XIe siècle, la poésie est un art de culture qui ne s’adresse qu’à des esprits prévenus et suffisamment affinés pour en saisir toutes les subtilités et les moindres nuances. Les mots et les images qui en constituent la pulpe sont à la fois signes et objet, étroitement liés à un corps vivant. Aussi est-il impossible d’y opérer la plus légère substitution sans l’altérer ou la détruire à jamais.
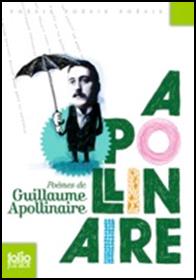 Dans la plaine les baladins Dans la plaine les baladins
S’éloignent au long des jardins
Devant l’huis des auberges grises
Par les villages sans églises
Et les enfants s’en vont devant
Les autres suivent en rêvant
Chaque arbre fruitier se résigne
Quand de très loin ils lui font signe
Ils ont des poids ronds ou carrés
Des tambours des cerceaux dorés
L’ours et le singe animaux sages
Quêtent des sous sur leur passage
|
Guillaume Apollinaire : « Saltimbanques »,
à Louis Dumur, in « Alcools »
|
Gaston Couté, poète-chansonnier libertaire
 Alors que dire de Gaston Couté (Beaugency, 1880-Paris, 1911), artiste des cabarets montmartrois, fils d’un meunier beauceron, poète-chansonnier libertaire, mort à trente ans, en 1911, de faim, d’alcoolisme, de pauvreté ? interroge Alain Vaillant, professeur de littérature française à l’université Paris X-Nanterre, préfaçant la monographie du poète-chansonnier patoisant, « le dernier des poètes maudits ». « Les cabarets lui permettent, pendant quelques années, enseigne la biographe Élisabeth Pillet, maîtresse de conférences à l’université Montpellier II, de développer une œuvre puissamment originale où s’expriment son caractère entier et passionné, sa sensualité et sa sensibilité à vif, ses blessures profondes et son amour pour la vie, sa connaissance intime d’un milieu paysan où il a grandi et qui l’a façonné, son refus radical d’un ordre social porteur de souffrance, de frustration et de mort, son engagement sans réserve au côté de ceux qui luttent pour un autre monde. » « Couté s’inscrit dans une lignée, estime-t-elle ailleurs, qui se poursuit avec des auteurs tels que Prévert, des auteurs-interprètes comme Ferré, Brel ou Brassens, et les nombreux artistes qui leur ont succédé - et dont certains font vivre aujourd’hui la poésie à dire, sous la forme du slam. » (Poésie sociale, le slam est né à Chicago dans les années 1980 sous le président Reagan). L’homme est admiré par Laurent Tailhade, il côtoie Max Jacob, Pierre Mac Orlan et Xavier Privas, son parcours croise ceux de Théodore Botrel, Jean-Baptiste Clément, Gaston Brunschwig, dit Montéhus, et Jehan-Rictus. Félix Mayol interprète « Le Gâs qu’a mal tourné », un des classiques du poète beauceron au même titre que le pathétique « Christ en bois », l’adresse satirique d’« Alcide Piédallu » ou le vibrant plaidoyer des « Gourgandines ». Plus près de nous, entre la fin des années 60 et le début des années 80, la poésie strophique de Couté est redécouverte par un public jeune et diversifié, une voix qui « sonne étonnamment juste et moderne pour la génération de 1968 ». Hugo, Beaumarchais et Vallès sont souvent cités quand il s’agit de souligner la forme classique des poésies coutéennes qui sont chantées à la fin du XXe s. par Marcel Amont, Jacques Douai, René-Louis Lafforgue, Jack Lantier, Bernard Lavilliers, Monique Morelli, Marc Ogeret, Patachou, Édith Piaf, Gérard Pierron, Suzy Solidor et Cora Vaucaire. Alors que dire de Gaston Couté (Beaugency, 1880-Paris, 1911), artiste des cabarets montmartrois, fils d’un meunier beauceron, poète-chansonnier libertaire, mort à trente ans, en 1911, de faim, d’alcoolisme, de pauvreté ? interroge Alain Vaillant, professeur de littérature française à l’université Paris X-Nanterre, préfaçant la monographie du poète-chansonnier patoisant, « le dernier des poètes maudits ». « Les cabarets lui permettent, pendant quelques années, enseigne la biographe Élisabeth Pillet, maîtresse de conférences à l’université Montpellier II, de développer une œuvre puissamment originale où s’expriment son caractère entier et passionné, sa sensualité et sa sensibilité à vif, ses blessures profondes et son amour pour la vie, sa connaissance intime d’un milieu paysan où il a grandi et qui l’a façonné, son refus radical d’un ordre social porteur de souffrance, de frustration et de mort, son engagement sans réserve au côté de ceux qui luttent pour un autre monde. » « Couté s’inscrit dans une lignée, estime-t-elle ailleurs, qui se poursuit avec des auteurs tels que Prévert, des auteurs-interprètes comme Ferré, Brel ou Brassens, et les nombreux artistes qui leur ont succédé - et dont certains font vivre aujourd’hui la poésie à dire, sous la forme du slam. » (Poésie sociale, le slam est né à Chicago dans les années 1980 sous le président Reagan). L’homme est admiré par Laurent Tailhade, il côtoie Max Jacob, Pierre Mac Orlan et Xavier Privas, son parcours croise ceux de Théodore Botrel, Jean-Baptiste Clément, Gaston Brunschwig, dit Montéhus, et Jehan-Rictus. Félix Mayol interprète « Le Gâs qu’a mal tourné », un des classiques du poète beauceron au même titre que le pathétique « Christ en bois », l’adresse satirique d’« Alcide Piédallu » ou le vibrant plaidoyer des « Gourgandines ». Plus près de nous, entre la fin des années 60 et le début des années 80, la poésie strophique de Couté est redécouverte par un public jeune et diversifié, une voix qui « sonne étonnamment juste et moderne pour la génération de 1968 ». Hugo, Beaumarchais et Vallès sont souvent cités quand il s’agit de souligner la forme classique des poésies coutéennes qui sont chantées à la fin du XXe s. par Marcel Amont, Jacques Douai, René-Louis Lafforgue, Jack Lantier, Bernard Lavilliers, Monique Morelli, Marc Ogeret, Patachou, Édith Piaf, Gérard Pierron, Suzy Solidor et Cora Vaucaire.
|
Su’ la grand’ place, y a des baraqu’s et des roulottes,
Des bohémiens qu’ont des brac’lets d’cuiv’ au pougnet,
Et les p’tiots, du fin fond des seigl’s ou des genêts
Accourent avec de grous sous dans leux menottes.
L’assemblée est jolie à plein ; mais c’qu’est l’pus biau,
C’est c’tourniquet là-bas, qu’a des vaissell’s dessus,
Des assiett’s qu’ont des coqs roug’s et verts peints dans l’cul,
Des tass’s pareill’s ! - Et qui prend un numéro ? -
- Ah ! les bell’s tass’s ! Les bells’s assiett’s ! En gangner une…
C’est ça qu’aurait bon genr’ su’ l’dressoir à la mère…
Et, pour prendr’ el’ numério qui gangne… ou qui perd
D’vant l’tourniquet qui [grinc’], les p’tiots lâch’nt leux fortune.
|
|
Gaston Couté : « Le Tournevire aux vaisselles » (extrait)
|
 Les aventures de Cafougnette Les aventures de Cafougnette
Nul ne peut évoquer le folklore des mines du Nord et du Pas-de-Calais en passant sous silence les aventures de Cafougnette, textes rimés en langue picarde que les amuseurs colportaient d’une fosse à l’autre, d’un coron à une autre cité ouvrière. Né de l’imagination du poète-mineur Jules Mousseron (Denain, 1868-1943), Cafougnette est un peu l’équivalent de Marius et Olive dans le Midi. Héros du pays minier. Il apparaît pour la première fois en 1899 dans une chanson, « L’mariache à chabots », puis dans un monologue, « Cafougnette à Paris ». Inconditionnel du père de Cafougnette, le comédien Jacques Bonnaffé (Douai, 1958) a enregistré une trentaine de ses poèmes et/ou chansons à l’enseigne de Gorgone production.
|
Quand l’mineur est d’un certain âge,
Quand i va dév’nir hors d’usage,
In li donne un traval ed’ vieux :
A l’fosse un l’met raccommodeux.
Ch’est li, dins l’min’, qui rabistoque
Chu qui casse et chu qui berloque.
I dot tout connaîtr’ dins c’n’indrot,
Tout, d’puis l’pinpin jusqu’au turot.
Dins l’fosse i dot tout savoir faire,
Tailler dins l’fier, dins l’bos, dins tierre…
D’ tous les accrocs, ch’est li l’médecin…
I guérit tous les accidints !
Souvint i-a pus qué l’cinquantaine,
Et l’in peut apprécier, sans peine,
Qu’i connot à fond sin métier,
D’puis quarante ans qui-est carbonnier.
|
|
Jules Mousseron : L’Raccommodeux (extrait)
|
« Les gens ont peur de la poésie »…
 « La confidentialité est pour la poésie une situation normale, argumente Frank Smith (né en 1968), écrivain et poète, parce qu’elle est l’inverse de la communication et du mot d’ordre. Faites de la poésie ! Écoutez de la poésie ! À mon avis, ces injonctions sont des non-sens. Il y a une exception poétique au sein de l’exception culturelle. » « La confidentialité est pour la poésie une situation normale, argumente Frank Smith (né en 1968), écrivain et poète, parce qu’elle est l’inverse de la communication et du mot d’ordre. Faites de la poésie ! Écoutez de la poésie ! À mon avis, ces injonctions sont des non-sens. Il y a une exception poétique au sein de l’exception culturelle. »
« Je sais bien que les gens ont peur de la poésie, reconnaît de son côté Yvon Le Men (Tréguier, 1953). Les mauvais souvenirs d’école, les analyses critiques souvent absconses ou la sacralisation à outrance du genre : tout cela rebute, effraie, décourage. Beaucoup de lecteurs ne savent plus comment aller simplement vers la poésie. Alors qu’elle est un magnifique chemin de mots. Le poème reste important aux trois carrefours de la vie : quand un enfant naît, quand il se marie, et quand il meurt. »
|
« Quoi ! implorer les Parques inflexibles ?
Non, appelez le cortège des sœurs
qui vole au pré parmi les peupliers !
Vie courte, soit ! mais je la veux unique !
Prenez mes dons à ceux qui n’en ont qu’un
et mes vertus à qui n’en sait user.
Que mon Guillaume de son marteau les forge
au feu lyrique et qui sait tout changer.
Pour lui je veux trente vies mises en une
l’œil qui voit tout, le cœur qui le ressent.
S’il faut qu’il meure je le veux au Parnasse
avec Shakespeare, Cervantes et Byron !
Autour de lui des anges musiciens
le poursuivant de cette mélopée
qui l’entraînait quand il berçait ses vers.
Pour lui sur terre une gloire immortelle
au ciel pour lui extases et chansons
du grand labeur bien juste récompense
dont il avait su refleurir mes dons. »
|
|
Max Jacob : « À la mémoire de Guillaume Apollinaire »
(extrait) in « L’Homme de cristal »
|
 « Nous ne savons pas ce qu’est la Poésie, déclare le poète Pierre-Jean Jouve (1887-1976). Tout poème, s’il est vrai, demeure mystère. Il n’y a ni honte ni malheur, pour l’homme, à reconnaître ses limites, et il n’y a point de diminution pour l’homme, quand il communique avec l’éternel, à ne pas savoir au juste les voies de son accès. La Poésie est une affaire de transcendance toujours relativement voilée. » « Nous ne savons pas ce qu’est la Poésie, déclare le poète Pierre-Jean Jouve (1887-1976). Tout poème, s’il est vrai, demeure mystère. Il n’y a ni honte ni malheur, pour l’homme, à reconnaître ses limites, et il n’y a point de diminution pour l’homme, quand il communique avec l’éternel, à ne pas savoir au juste les voies de son accès. La Poésie est une affaire de transcendance toujours relativement voilée. »
« Il y a tout de même des mystères, dans la vie des hommes, observe l’écrivain et poète Gérard Mourgue (1921-1995). La poésie en est un, la mystique un autre, l’amour un troisième. Tous les ordinateurs du monde, en l’an 4 000 ou 10 000, ne trouveront aucune solution logique à ces énigmes. Elles sont celles des fruits singuliers qui s’appellent génies, saints, amoureux. » « Mais le poète n’est pas seulement celui qui utilise les mots, ajoute-t-il. Il est celui qui crée, au sens grec du mot - avec des notes de musique, des couleurs, des volumes, des architectures - tout ce que l’on veut : des moments de vie par exemple. Un poète est celui qui vit avec cent fois plus d’intensité que ses concitoyens… »
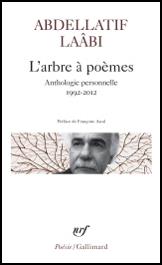
|
Il y a un cannibale qui me lit
C’est un lecteur férocement intelligent
un lecteur de rêve
Il ne laisse passer aucun mot
sans en soupeser le poids de sang
Il soulève même les virgules
pour découvrir les morceaux de choix
Il sait lui que la page vibre
d’une splendide respiration
Ah cet émoi qui rend la proie
alléchante et déjà soumise
Il attend la fatigue
qui descend sur le visage
comme un masque de sacrifice
Il cherche la faille pour bondir
l’adjectif de trop
la répétition qui ne pardonne pas
Il y a un cannibale qui me lit
pour se nourrir
|
|
Abdellatif Laâbi : « Il y a un cannibale qui me lit »
in « L’Étreinte du monde »
|
De nouveaux territoires poétiques
« [Les poètes] veulent enfin, un jour, écrit Apollinaire, machiner la poésie comme on a machiné le monde. Ils veulent être les premiers à fournir un lyrisme tout neuf à ces nouveaux moyens d’expression qui ajoutent à l’art le mouvement et qui sont le phonographe et le cinéma. Ils n’en sont encore qu’à la période des incunables. Mais attendez, les prodiges parleront d’eux-mêmes et l’esprit nouveau qui gonfle de vie l’univers, se manifestera formidablement dans les lettres, dans les arts et dans toutes les choses que l’on connaisse. »
Bien au-delà du peu
la peau et l’épée
lapent
l’eau ailée
du petit pire
Toupie d’une peur idéale
épi à pas de pou
appât
ou pâle pet de pétale
Ghérasim Luca : in « La paupière philosophale »
Aujourd’hui l’amateur se doit d’inventorier ce qui s’invente dans la langue, repérer les nouvelles propositions esthétiques et, si possible, en déterminer les vocabulaires et les enjeux. Soumis à des climats variables, à des intérêts intermittents, des nouveaux territoires poétiques, encore peu balisés, s’ouvrent aux technologies récentes et aux arts contemporains. La confrontation aux démarches plastiques nouvelles qui va de pair avec le détournement des lieux d’exposition est animée par un esprit de laboratoire et une volonté permanente de réinventer, parfois au prix d’une violente défiguration, la forme-poésie.
 « J’appelle poésie ce qui m’élève le cœur, confie le comédien et metteur en scène Éric Ruf (Belfort, 1969), administrateur général de la Comédie-Française, ce qui me rend plus grand, ce qui m’apaise, ce qui est compassionnel, ce qui est excitant… Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je suis scénographe, aussi, je parle de poésie quand je parle de décor ; je parle de poésie quand je parle d’espace. Il y a des espaces que je trouve poétiques. Pourquoi ? Parce qu’ils trimballent un sens qui n’est pas visible. Tout mon métier est d’amener une émotion par un détour technique… Nous avons la chance de traiter un grand répertoire dont les dramaturges, pour ne citer que Claudel, Victor Hugo, Shakespeare ou Racine, sont aussi de grands poètes. » « J’appelle poésie ce qui m’élève le cœur, confie le comédien et metteur en scène Éric Ruf (Belfort, 1969), administrateur général de la Comédie-Française, ce qui me rend plus grand, ce qui m’apaise, ce qui est compassionnel, ce qui est excitant… Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je suis scénographe, aussi, je parle de poésie quand je parle de décor ; je parle de poésie quand je parle d’espace. Il y a des espaces que je trouve poétiques. Pourquoi ? Parce qu’ils trimballent un sens qui n’est pas visible. Tout mon métier est d’amener une émotion par un détour technique… Nous avons la chance de traiter un grand répertoire dont les dramaturges, pour ne citer que Claudel, Victor Hugo, Shakespeare ou Racine, sont aussi de grands poètes. »
- Enseigner la poésie ? sous la direction de Jean-Yves Debreuille, IUFM de l’académie de Lyon et Presses universitaires de Lyon, 174 pages, 1995 ;
- La Fin du Monde, 30 poèmes de Jules Mousseron présentés par Jacques Bonnaffé, Gorgone productions, 2000 ;
- Gaston Couté, le dernier des poètes maudits - Chanson, poésie et anarchisme à la Belle Époque, par Élisabeth Pillet, Presses universitaires de la Méditerranée, 356 pages, 2011 ;
- L’Évangile selon Saint Carême, par Maurice Carême, éditions L’Âge d’homme, 128 pages, 2013 ;
- Apollinaire, poèmes de Guillaume Apollinaire choisis et présentés par Camille Weil, Gallimard Jeunesse, 96 pages, 2013 ;
- La Vérité du poète : Max Jacob, édition établie et présentée par Antonio Rodriguez, éditions de la Table ronde, 240 pages, 2015 ;
- Ne pas détacher le vide du sol, par Ghérasim Luca, nrf Poésie/Gallimard et Télérama (in "Petite bibliothèque de poésie contemporaine"), 48 pages, 2015 ;
- L’Arbre à poèmes, par Abdellatif Laâbi, anthologie personnelle 1992-2012, préface de Françoise Ascal, Poésie Gallimard, 272 pages, 2016.
Retour en 1994
Renaud, mon pote le poète
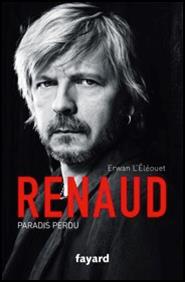 Quand ses lunettes noires glissent le long de son nez, ses yeux soudain dénudés sont très doux. La fatigue de la nuit blanche qui a suivi la victoire de l’Olympique de Marseille à Nîmes mouille le bleu de l’iris et le dilue dans les gris. Il fait un temps d’accordéon-musette au bord de la Sorgue, à la terrasse du restaurant « Lou Nego Chin » (vocable provençal désignant une barque à fond plat). Renaud Séchan y retrouve, à chacun de ses séjours à l’Isle-sur-la-Sorgue, Michel Mélani, Paul Saturnino et Michel Hours, ses maîtres en « parler marseillais » à qui il a rendu hommage dans un disque compact « À la Belle de Mai » en novembre 1994. Quand ses lunettes noires glissent le long de son nez, ses yeux soudain dénudés sont très doux. La fatigue de la nuit blanche qui a suivi la victoire de l’Olympique de Marseille à Nîmes mouille le bleu de l’iris et le dilue dans les gris. Il fait un temps d’accordéon-musette au bord de la Sorgue, à la terrasse du restaurant « Lou Nego Chin » (vocable provençal désignant une barque à fond plat). Renaud Séchan y retrouve, à chacun de ses séjours à l’Isle-sur-la-Sorgue, Michel Mélani, Paul Saturnino et Michel Hours, ses maîtres en « parler marseillais » à qui il a rendu hommage dans un disque compact « À la Belle de Mai » en novembre 1994.
Après avoir patoisé le ch’timi - la langue de sa mère - sur la clé de sol de ses succès, ce Parisien (né le 11 mai 1952) a composé sa première chanson en langage marseillais, contribution de même nature versée au Sud de ses origines paternelles. Si la famille Séchan (« un participe présent sans t », s’étonne-t-il, enjoué) a creusé son berceau dans le granit des Cévennes, l’auteur-compositeur-interprète a souhaité prendre racine en Comtat Venaissin où il a acquis au début des années 1980 la maison familiale de son oncle, le docteur Henri de Fayard, celui que les L’Islois nommaient affectueusement « le médecin des pauvres ». Et puis, il faut savoir que renaud, en argot, signifie protestation, colère, des mots qui collent tout à fait à l’auteur des chansons-poèmes « Société tu m’auras pas », « Mistral gagnant », « Dans mon H.L.M. », « Manhattan-Kaboul » « Laisse Béton » et « Toujours debout ».
En septembre 1994, le chanteur s’était étonné qu’un critique d’art et de littérature (j’appartenais alors à la rédaction du quotidien d’informations générales Le Provençal) souhaitât le rencontrer. Je savais que le réalisateur Claude Berri lui avait collé le virus de l’art contemporain à la faveur du tournage de « Germinal » (Renaud m’a entretenu de Kandinsky, Malevitch et Miro, ses nouveaux maîtres à penser). Et lorsque je lui ai parlé de son père et de sa passion pour la langue française, il a immédiatement convenu d’un rendez-vous en Provence.
Je retranscris des bribes de nos échanges cet automne-là, dans la patrie de René Char, des propos qui prennent un relief particulier vingt ans après.
« À force d’entendre mes copains du "Nego Chin" lancer ces expressions extraordinaires : "Il me casse les alibofi", "Je vais me l’estrasser", "Ce matin, je suis totalement emboucané" ou "Ceux-là, ils vont finir aux barbaresques", j’ai eu envie de m’en approprier le langage, comme les mineurs du film "Germinal" m’y avaient incité dans le patois du Nord. Et Robert Bouvier (1941-1992) a complété mon éducation à travers les pages de son dictionnaire "Le Parler marseillais". C’est d’ailleurs à votre ami (le lexicographe et journaliste était une des plumes du "Provençal") que j’ai dédié mon album et la chanson "À la Belle de Mai", un titre que j’adore d’autant que je suis né en mai et, comme disait Céline : "Je suis né en mai, c’est moi le printemps". » Au cours des longues heures passées à dialoguer au bord de la Sorgue, je lui ai appris que le lexicographe François Caradec avait cité certaines de ses chansons parmi celles de Georges Brassens, Pierre Mac Orlan et Pierre Perret, appelant à une anthologie contemporaine de la chanson argotique qui réunirait les quatre poètes. « Je sais que mes textes sont étudiés dans des universités allemande, américaine, australienne et hollandaise. Mes chansons sont citées dans des bouquins de sociologie et elles ont fait l’objet de plusieurs dizaines de thèses universitaires, telles "Renaud et Aristide Bruant", "L’argot dans la chanson de Renaud" ou "Renaud et le verlan du XVIe siècle". Aussi, quand je croise un de nos ministres, je lui demande : "Alors, plutôt que les Arts et Lettres que j’ai refusés deux fois, et l’ordre du Mérite, jamais vous m’offrez les Palmes académiques ?". Car l’académie, l’enseignement, le savoir, sont pour moi des institutions, des valeurs essentielles. Vous savez, mon père qui a 83 ans a été enseignant toute sa vie. Écrivain et pédagogue. Alors, les Palmes académiques, ça me ferait drôlement plaisir et bien plus que la Légion d’honneur. »
Lecture complémentaire :
Renaud, paradis perdu, par Erwan L’Élouet, éditions Fayard, 224 pages, 2015.
Varia : Le français en liberté
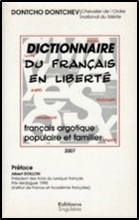 Copain de zinc de l’auteur, Alphonse Boudard (1925-2000) souligne qu’« il ne s’agit pas d’un opuscule, d’une amusette philologique… Non, c’est un fort volume qui fait à peu près le point sur le langage populaire et argotique français à la veille du XXIe siècle. Je suis soufflé. Un Français de Belleville ou de Montparnasse n’aurait pas fait mieux. En tout cas avec autant de sérieux et une sorte d’intuition qui caractérise les véritables amoureux de la langue verte ». Nous relevons des perles dans ce dico. Nous apprenons ainsi qu’un baby-sitter est un garde du corps, une carambolette une fille quelque peu portée sur l’amour physique, une ébonite un téléphone, un escabeau un mauvais livre, un fafiot un bille de banque, une gazeuse une fille séduisante ou une bombe lacrimogène, une Joséphine une mitraillette, un lance-patate un bazooka, une mandoline une volée de coups, un océdar un garçon qui porte les cheveux en brosse, un pâté-rillettes un Français de souche, une rapinade une mauvaise peinture, un roule-ta-bille un clochard, une seccotine une personne ennuyeuse, une visiteuse une lesbienne, une Yvette une femme démodée et un zacharie une squelette. Délibérément laudatif, l’auteur de La Métamorphose des cloportes dit encore que le « Dictionnaire du français en liberté » est tout à fait digne de figurer au côté du Dictionnaire du français non conventionnel de Jacques Cellard et de L’Argot chez les vrais de vrai d’Auguste le Breton : « Chapeau, mon pote Dontcho, interpelle A. Boudard, t’es vraiment un mec de mec digne de figurer dans "la Méthode à Mimile" ». Copain de zinc de l’auteur, Alphonse Boudard (1925-2000) souligne qu’« il ne s’agit pas d’un opuscule, d’une amusette philologique… Non, c’est un fort volume qui fait à peu près le point sur le langage populaire et argotique français à la veille du XXIe siècle. Je suis soufflé. Un Français de Belleville ou de Montparnasse n’aurait pas fait mieux. En tout cas avec autant de sérieux et une sorte d’intuition qui caractérise les véritables amoureux de la langue verte ». Nous relevons des perles dans ce dico. Nous apprenons ainsi qu’un baby-sitter est un garde du corps, une carambolette une fille quelque peu portée sur l’amour physique, une ébonite un téléphone, un escabeau un mauvais livre, un fafiot un bille de banque, une gazeuse une fille séduisante ou une bombe lacrimogène, une Joséphine une mitraillette, un lance-patate un bazooka, une mandoline une volée de coups, un océdar un garçon qui porte les cheveux en brosse, un pâté-rillettes un Français de souche, une rapinade une mauvaise peinture, un roule-ta-bille un clochard, une seccotine une personne ennuyeuse, une visiteuse une lesbienne, une Yvette une femme démodée et un zacharie une squelette. Délibérément laudatif, l’auteur de La Métamorphose des cloportes dit encore que le « Dictionnaire du français en liberté » est tout à fait digne de figurer au côté du Dictionnaire du français non conventionnel de Jacques Cellard et de L’Argot chez les vrais de vrai d’Auguste le Breton : « Chapeau, mon pote Dontcho, interpelle A. Boudard, t’es vraiment un mec de mec digne de figurer dans "la Méthode à Mimile" ».
- Dictionnaire du français en liberté (français argotique, populaire et familier), par Dontcho Dontchev, éditions Singulières, 522 pages, 2007.
Carnet : le plus pur français
Au XVIe siècle, le grammairien anglais - et chapelain de Henri VIII - John Palsgrave (1480-1554) établit que le français le plus pur est parlé sur les bords de la Loire, en Touraine, là où les rois de France aiment aller se reposer ou chasser. Trois siècles plus tard, l’écrivain Alfred de Vigny (1797-1863) qualifie le langage des Tourangeaux « le plus pur français, sans lenteur, sans vitesse, sans accent » : « le berceau de la langue est là, assure-t-il, près du berceau de la monarchie ». De là provient le mythe selon lequel le français de Touraine serait le plus « correct ».
Une découverte de Christophe Colomb
C’est le navigateur génois qui a découvert… l’ananas lors de son deuxième voyage sur les terres de la future Amérique. Très apprécié dans le monde entier, ce fruit exotique a été la première broméliacée cultivée sous serre, dès le XVIIe siècle en Hollande. Plantes à la floraison spectaculaire, les broméliacées qui comprennent près de 3 200 espèces sont actuellement vendues dans les jardineries comme plantes ornementales ; certaines d’entre elles seulement nommées Bromelia, Guzmania, Tillandsia ou Vriesea.
Gloire et mort de Rimbaud
Reliquaire, le premier recueil des poésies d’Arthur Rimbaud, a été mis en librairie à Paris quelques heures avant son décès à Marseille (10 novembre 1891). « La gloire et la mort ont fait là une course de vitesse et sont arrivées ex-aequo », remarque Patrick Kéchichian (Le Monde, 18 janvier 2008).
(Jeudi 14 octobre 2016)
Le temps et la montre
« Les Européens ont des montres, mais les Africains ont le temps… », peut-on entendre souvent à Nouakchott (Mauritanie).
Le Lama et le Castor
Dans le sixième de ses Cahiers de jeunesse (1926-1930), Simone de Beauvoir (1908-1986) raconte comment René Maheu (1905-1975), son ami normalien surnommé le Lama, inventa son surnom. « Vous êtes un castor, lui dit-il un jour de 1929 en rentrant à la Bibliothèque nationale. Les castors vont en bande et ils ont l’esprit constructeur. » Il trouve ainsi argument de la proximité de son patronyme avec beaver, qui signifie « castor » en anglais, et de l’esprit constructeur de la jeune femme qui prépare alors le concours de l’agrégation de philosophie. À l’époque, chacun des membres du clan fermé de Normale sup est affublé d’un surnom à la manière des totems scouts. R. Maheu que Simone de Beauvoir a intégré dans son récit autobiographique des « Mémoires d’une jeune fille rangée » (1958) sous le nom de Jacques Herbaud encourage l’écrivaine à rejoindre un groupe de brillants élèves à la faculté des lettres de l’université de Paris auquel appartient Jean-Paul Sartre. Si René Maheu a échoué au concours de l’agrégation de philosophie, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir sont les premier et deuxième du classement. En accord avec l’analyse de R. Maheu, Sartre reprendra le surnom de « Castor » pour désigner sa compagne. Bientôt professeur de philosophie puis attaché culturel à Londres, René Maheu occupe de hauts postes aux Nations unies et à l’Unesco (dont il sera le directeur général de 1961 à 1974). On sait moins qu’il est l’auteur d’un bel aphorisme : « Une vie ne vaut rien, rien ne vaut une vie », souvent fautivement attribuée à André Malraux.
(Vendredi 15 octobre 2016)
|
Billet d’humeur
Savoureux aptonymes
Les linguistes aiment à rire. Lorsqu’ils en viennent à donner des exemples d’aptonymes - ces patronymes ayant partie liée avec le caractère ou la profession exercée par celui qui le porte - aptonymes puisés dans la vie quotidienne, ils ne résistent pas à l’envie d’énumérer Caroline Aigle, première femme pilote de chasse de l’armée de l’air française, Bertrand Cantat, chanteur, Édith Cresson, ministre de l’Agriculture, Marc Dufumier, agronome, Félix Dujardin, botaniste, Joseph Durocher, géologue, Ian Foote, arbitre de football, Robert Grossetête, philosophe, Gérald Cyprien Lacroix, archevêque catholique de Québec, Thierry Le Luron, humoriste, David Mélé, joueur de rugby, Benjamin Millepied, danseur, Maxime Pinard, viticulteur, Joao Pippi-Sallé, urologue, Pierre Plouffe, champion du monde de ski nautique, François Purseigle, sociologue du monde agricole, Jean-Christophe Robinet, universitaire au laboratoire de Dynamique des fluides, Olivier de Serres, inventeur de l’agronomie, Alain Vadeboncœur, cardiologue, et Marco Velo, cyliste professionnel.
|
Lecture critique
Gabriel Matzneff, le meilleur des guides parisiens
 Je pèse mes mots en affirmant que la lecture d’un florilège des œuvres de Gabriel Matzneff (Neuilly-sur-Seine, 12 août 1936), romans, récits, essais, poèmes et journaux intimes, laisse apparaître fade plus d’une littérature aujourd’hui consacrée par les lecteurs pressés, les jurys des concours et les critiques déclarés. Plus que les textes publiés dans Combat et Le Monde, j’ajouterai à la sélection les Carnets qu’il livrait aux Nouvelles littéraires de 1972 à 1975, chroniques culturelles et politiques où il se livrait à des exercices mémorables d’admiration et de détestation. « Tout ce que nous écrivons est inutile, déplore-t-il, surtout si c’est la vérité. Le monde va devenir chaque jour plus bête, plus laid et plus dur […]. Aussi aurons plus que jamais besoin de nos masques. L’avenir est à la clandestinité. » Le polémiste n’est pas tendre quand il donne des leçons à ses contemporains plus sensibles aux potins et au dénigrement qu’à la beauté et aux choses de l’esprit. Ceux qui ne rabaissent pas le secrétaire des dernières années d’Henry de Montherlant parce qu’il cultive la coquetterie d’aimer les lycéennes de quinze à dix-sept ans, ceux-là adorent le lire pour l’élégance du style, la pertinence de l’argumentation, le faisceau encyclopédique de ses curiosités, l’acuité des flèches qu’il décoche à l’occasion et l’indépendance de pensée. À cet égard, il fait sienne la maxime de Chamfort : « Ne tenir dans la main de personne, être l’homme de son cœur, de ses principes, de ses sentiments, c’est ce que j’ai vu de plus rare ». Je pèse mes mots en affirmant que la lecture d’un florilège des œuvres de Gabriel Matzneff (Neuilly-sur-Seine, 12 août 1936), romans, récits, essais, poèmes et journaux intimes, laisse apparaître fade plus d’une littérature aujourd’hui consacrée par les lecteurs pressés, les jurys des concours et les critiques déclarés. Plus que les textes publiés dans Combat et Le Monde, j’ajouterai à la sélection les Carnets qu’il livrait aux Nouvelles littéraires de 1972 à 1975, chroniques culturelles et politiques où il se livrait à des exercices mémorables d’admiration et de détestation. « Tout ce que nous écrivons est inutile, déplore-t-il, surtout si c’est la vérité. Le monde va devenir chaque jour plus bête, plus laid et plus dur […]. Aussi aurons plus que jamais besoin de nos masques. L’avenir est à la clandestinité. » Le polémiste n’est pas tendre quand il donne des leçons à ses contemporains plus sensibles aux potins et au dénigrement qu’à la beauté et aux choses de l’esprit. Ceux qui ne rabaissent pas le secrétaire des dernières années d’Henry de Montherlant parce qu’il cultive la coquetterie d’aimer les lycéennes de quinze à dix-sept ans, ceux-là adorent le lire pour l’élégance du style, la pertinence de l’argumentation, le faisceau encyclopédique de ses curiosités, l’acuité des flèches qu’il décoche à l’occasion et l’indépendance de pensée. À cet égard, il fait sienne la maxime de Chamfort : « Ne tenir dans la main de personne, être l’homme de son cœur, de ses principes, de ses sentiments, c’est ce que j’ai vu de plus rare ». 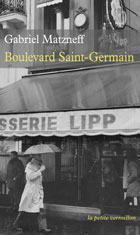 Pour lutter contre le désabusement et se consoler des injustices de son temps, il se réfugie dans la bibliothèque des Anciens, surtout les Romains Cicéron, Horace, Lucrèce et Sénèque, auxquels il associe Baudelaire, Berdiaev, Byron, Casanova, Chestov, Cioran, Dostoïevski, Flaubert, La Rochefoucauld, Montaigne, Nietzsche, Saint-Simon, Schopenhauer, sans oublier sainte Marie l’Égyptienne et l’abbé de Rancé. Certains de ces écrivains et de ces philosophes sont convoqués dans « Boulevard Saint-Germain », un récit qui traverse le Quartier Latin, plus précisément les cinquième, sixième et septième arrondissements de Paris comme le plus inspiré des guides. Mieux que les plus vétilleux des géographes et des sociologues de la capitale, il explore le passé et le présent du berceau de son enfance, « le témoin de ma jeunesse où l’or pâle des pierres, à l’heure où le soleil décline, me murmure qu’il saura aussi être mon tombeau ». L’humour et la tendresse s’inscrivent entre les lignes lorsqu’il rappelle le souvenir de ses compagnons de plume et de table, une confrérie d’écrivains, d’éditeurs et de journalistes que la grande faucheuse n’a pas épargnée : Jean-Louis Bory, Gilles Brochard, Yvan Christ, Paul-Marie Coûteaux, Christian Dedet, Alfred Fabre-Luce, Christian Giudicelli, Frédéric Grendel, Roland Laudenbach, François d’Orcival, Jacques Perret, Jacques de Ricaumont, Dominique de Roux, Pierre-Guillaume de Roux, Philippe de Saint-Robert, Philippe Sénart, Philippe Tesson, Roland Topor, Claude Verdier et Roger Vrigny. Puissant antidote à la vulgarité et à la crétinerie, le bréviaire de cet étrange paroissien de l’Église orthodoxe, fils d’émigré (tout à la fois russe et romain), enseigne un autre usage du tourisme et révèle un Paris plus vrai que nature. Pour lutter contre le désabusement et se consoler des injustices de son temps, il se réfugie dans la bibliothèque des Anciens, surtout les Romains Cicéron, Horace, Lucrèce et Sénèque, auxquels il associe Baudelaire, Berdiaev, Byron, Casanova, Chestov, Cioran, Dostoïevski, Flaubert, La Rochefoucauld, Montaigne, Nietzsche, Saint-Simon, Schopenhauer, sans oublier sainte Marie l’Égyptienne et l’abbé de Rancé. Certains de ces écrivains et de ces philosophes sont convoqués dans « Boulevard Saint-Germain », un récit qui traverse le Quartier Latin, plus précisément les cinquième, sixième et septième arrondissements de Paris comme le plus inspiré des guides. Mieux que les plus vétilleux des géographes et des sociologues de la capitale, il explore le passé et le présent du berceau de son enfance, « le témoin de ma jeunesse où l’or pâle des pierres, à l’heure où le soleil décline, me murmure qu’il saura aussi être mon tombeau ». L’humour et la tendresse s’inscrivent entre les lignes lorsqu’il rappelle le souvenir de ses compagnons de plume et de table, une confrérie d’écrivains, d’éditeurs et de journalistes que la grande faucheuse n’a pas épargnée : Jean-Louis Bory, Gilles Brochard, Yvan Christ, Paul-Marie Coûteaux, Christian Dedet, Alfred Fabre-Luce, Christian Giudicelli, Frédéric Grendel, Roland Laudenbach, François d’Orcival, Jacques Perret, Jacques de Ricaumont, Dominique de Roux, Pierre-Guillaume de Roux, Philippe de Saint-Robert, Philippe Sénart, Philippe Tesson, Roland Topor, Claude Verdier et Roger Vrigny. Puissant antidote à la vulgarité et à la crétinerie, le bréviaire de cet étrange paroissien de l’Église orthodoxe, fils d’émigré (tout à la fois russe et romain), enseigne un autre usage du tourisme et révèle un Paris plus vrai que nature.
Gabriel Matzneff © Ulf Andersen
- Boulevard Saint-Germain, par Gabriel Matzneff, éditions de la Table ronde, 224 pages, 2015.
Lectures complémentaires du même auteur :
- Séraphin, c’est la fin ! Prix Renaudot essai, éditions de la Table ronde, 272 pages, 2013 ;
- Monsieur le comte monte en ballon, éditions Léo Scheer, 72 pages, 2012 ;
- Carnets noirs 2007-2008, éditions Léo Scheer, 512 pages, 2009 ;
- Le Dîner des mousquetaires, éditions de la Table ronde, 416 pages, 1995.
Portrait
Anaïs Nin ou le journal d’une romancière
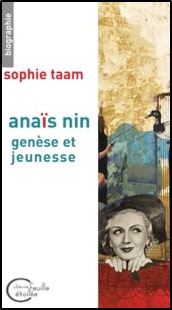 Faut-il ranger sur le même plan son volumineux journal (250 000 pages manuscrites) d’une part, ses romans, nouvelles, poésies et essais d’autre part ? Je le croirais assez en raison de l’imagination et de la fantaisie qui décuplent la force expressive de ses textes issus de l’un et de l’autre encrier. Certes, lorsqu’on lui demandait ce qu’était pour elle la littérature, Anaïs Nin (Neuilly-sur-Seine, 21 février 1903-Los Angeles, 14 janvier 1977) expliquait qu’elle écrivait « pour créer un monde dans lequel elle puisse vivre ». Pourtant, à plusieurs reprises, elle souligna que ses romans n’étaient que « l’affleurement partiel de cette entreprise autrement redoutable et considérable : le Journal ». C’est à onze ans à Barcelone, le 25 juillet 1914 précisément, qu’elle inaugure le premier des innombrables cahiers qui composent cette autobiographie protéiforme (1914-1974). À ce moment-là, son père, Joaquin Nin, pianiste et compositeur cubain, vient d’abandonner sa femme, Rosa Culmell, chanteuse d’ascendance franco-danoise, et leurs trois enfants (Anaïs et ses deux frères, Thorvald et Joaquin). Privée de son chef, la famille embarque pour New York depuis la capitale catalane où elle vivait jusqu’alors chez les parents du déserteur. Écrit entièrement en français, le journal d’enfance s’interrompt le 9 juillet 1920 ; les jours suivants la diariste opte définitivement pour la langue anglaise. « Mon journal connaît ma maîtresse, mes compagnes et mes compagnons de classe, mes amis et ennemis et l’école où je vais, écrit-elle. Il me connaît, il connaît mon âme et mes goûts, mes défauts et mes qualités, mes joies et mes douleurs. » Très tôt, elle se dédouble dans ses confidences en une Miss Nin, personnage public loué pour ses aptitudes épistolaires, et une Miss Linotte, face secrète et cachée d’une personnalité moins avouable. Confession de soi à soi, descente labyrinthique, le journal, expurgé, est partiellement publié en 1966 seulement : vétilleuse et dubitative, elle ne cesse de le revoir et de le corriger. Faut-il ranger sur le même plan son volumineux journal (250 000 pages manuscrites) d’une part, ses romans, nouvelles, poésies et essais d’autre part ? Je le croirais assez en raison de l’imagination et de la fantaisie qui décuplent la force expressive de ses textes issus de l’un et de l’autre encrier. Certes, lorsqu’on lui demandait ce qu’était pour elle la littérature, Anaïs Nin (Neuilly-sur-Seine, 21 février 1903-Los Angeles, 14 janvier 1977) expliquait qu’elle écrivait « pour créer un monde dans lequel elle puisse vivre ». Pourtant, à plusieurs reprises, elle souligna que ses romans n’étaient que « l’affleurement partiel de cette entreprise autrement redoutable et considérable : le Journal ». C’est à onze ans à Barcelone, le 25 juillet 1914 précisément, qu’elle inaugure le premier des innombrables cahiers qui composent cette autobiographie protéiforme (1914-1974). À ce moment-là, son père, Joaquin Nin, pianiste et compositeur cubain, vient d’abandonner sa femme, Rosa Culmell, chanteuse d’ascendance franco-danoise, et leurs trois enfants (Anaïs et ses deux frères, Thorvald et Joaquin). Privée de son chef, la famille embarque pour New York depuis la capitale catalane où elle vivait jusqu’alors chez les parents du déserteur. Écrit entièrement en français, le journal d’enfance s’interrompt le 9 juillet 1920 ; les jours suivants la diariste opte définitivement pour la langue anglaise. « Mon journal connaît ma maîtresse, mes compagnes et mes compagnons de classe, mes amis et ennemis et l’école où je vais, écrit-elle. Il me connaît, il connaît mon âme et mes goûts, mes défauts et mes qualités, mes joies et mes douleurs. » Très tôt, elle se dédouble dans ses confidences en une Miss Nin, personnage public loué pour ses aptitudes épistolaires, et une Miss Linotte, face secrète et cachée d’une personnalité moins avouable. Confession de soi à soi, descente labyrinthique, le journal, expurgé, est partiellement publié en 1966 seulement : vétilleuse et dubitative, elle ne cesse de le revoir et de le corriger.
Échelonnée de 1946 à 1961, la publication d’un cycle de cinq romans réunis sous le titre « Les Cités intérieures » lui permet de se projeter dans la fiction, notamment à travers Djuna, Lillian et Sabina. Des personnages réels se dissimulent à peine derrière elles ; Djuna peut être June Miller (la seconde épouse de l’écrivain Henry Miller) à moins qu’il ne s’agisse de Djuna Barnes (romancière et dramaturge américaine). Certains essais veulent être de véritables exercices d’admiration pour la femme de lettres allemande Lou Andréas-Salomé et l’actrice américaine Romaine Brooks. Proche d’Antonin Artaud et de Lawrence Durrell, elle côtoie à Paris et à New York les artistes Constantin Brancusi, Brassaï et Marcel Duchamp, ainsi que les poètes Robert Duncan, Paul Éluard, James Joyce et James Merrill, les écrivains Waldo Frank, Gore Vidal et Edmund Wilson. Elle se dit impressionnée par le compositeur Edgard Varèse et les littérateurs André Breton, Aldous Huxley et David Herbert Lawrence à qui elle consacrera un essai peu après la mort de l’écrivain britannique, « D. H. Lawrence : une étude non professionnelle » (1932). Quant à ses nouvelles, outre « Un hiver d’artifice » (3 nouvelles, 1945), elle en confine la majeure partie dans « La Cloche de verre », un recueil de 13 nouvelles publié en 1944.
Entre Bruxelles et Arcachon, New York et Paris, entre ses maris Hugo Parker Guiler (banquier) et Rupert Pole (acteur devenu garde forestier puis professeur de sciences) - elle devient bigame avec le second, entre ses amants René Allendy (ami des surréalistes, fondateur de la Société française de psychanalyse), John Erskine (professeur de littérature et romancier), Henry Miller (qu’elle rencontre à Louveciennes en 1931), Isamu Noguchi (sculpteur et designer japonais), Otto Rank (psychanalyste, disciple dissident de Freud) et son père Joaquin Nin (avec qui elle entretint des relations incestueuses enfant et adulte), elle se raconte au travers du journal intime comme de ses récits fictionnels. Si elle expose sa nudité en posant pour des peintres, si elle s’enflamme pour l’exercice de la danse flamenca, elle ne cache pas son penchant pour la psychanalyse, l’émancipation féminine, la monogamie et l’amour unique, et elle réclame de ses vœux un temps et un monde nouveaux où les tabous, les fantasmes et le puritanisme auront disparu. « L’érotisme, soutient-elle, est l’une des bases de la connaissance de soi, aussi indispensable que la poésie. »
« En 1973, remarque Sophie Taam, elle est élue membre de l’Académie américaine des lettres et des arts à New York, joli clin d’œil à la petite fille qui, dans son Journal, signait : Anaïs Nin, membre de l’Académie française. » L’écrivaine américaine meurt d’un cancer en 1977 à Los Angeles. Ses cendres sont dispersées dans les eaux de l’océan Pacifique au-dessus de la baie de Santa Monica : envers et contre tout, elle est parvenue à accomplir le destin qu’elle s’était choisi : celui de catalyser sa propre sa vie en une œuvre intellectuelle.
- Anaïs Nin - Genèse et jeunesse, par Sophie Taam, éditions du Chèvre-feuille étoilée, 160 pages, 2014.
Lectures complémentaires :
- Cités intérieures : Les Miroirs dans le jardin, Les Enfants de l’albatros, Les Chambres du cœur, Une espionne dans la maison de l’amour, La Séduction du minotaure suivie de Collages, par Anaïs Nin, éditions Stock, 1997 et 1998 ;
- Anaïs Nin, par Deirdre Bair, éditions Stock, 664 pages, 1996 ;
- La Maison de l’inceste, par Anaïs Nin, éditions des Femmes, 92 pages, 1979.
Varia : le culte de l’oiseau-soleil et les ministères en Chine
 Le Zuo Zhuan (commentaire de Zuo), le principal commentaire des Annales des Printemps et des Automnes raconte : « …lorsque Shaohao (souverain mythique de l’antiquité chinoise) monta sur le trône, des phénix se réunirent à sa cour. Considérant que c’était de bon augure, Shaohao établit que le phénix serait désormais un dieu pour sa tribu, et l’image de cet oiseau le totem de la tribu. Il nomma son clan "le phénix", et donna aux autres clans d’autres noms d’oiseaux. Le chef du clan Fengniao (Phénix) se chargea ainsi de l’astrologie et du calendrier ; le chef du clan Xuanniao (l’oiseau sombre) de l’armée ; le chef du clan Bozhao (merle noir) s’occupa des deux solstices ; le chef du clan Qingniao (oiseau bleu-vert) fut chargé d’établir le printemps et l’été ; le chef du clan Danniao (oiseau rouge) de fixer l’automne et l’hiver. Le chef du clan Tourterelle fut ministre de l’éducation ; le chef du clan Mandarin chinois, ministre de la guerre ; le chef du clan Coucou, ministre des travaux publics ; le chef du clan Aigle, ministre de la justice ; le chef du clan Faucon, ministre de la trésorerie. Ces ministres forgent l’unité de la population. Cinq clans de faisans, responsables de la gestion du pays, firent en sorte que les unités de mesures soient unifiées et que les échanges commerciaux se fassent de façon juste. Enfin, neuf clans d’oiseaux migrateurs, dirigèrent les activités agricoles en fonction du calendrier, si bien qu’aucun murmure de n’éleva. » Le Zuo Zhuan (commentaire de Zuo), le principal commentaire des Annales des Printemps et des Automnes raconte : « …lorsque Shaohao (souverain mythique de l’antiquité chinoise) monta sur le trône, des phénix se réunirent à sa cour. Considérant que c’était de bon augure, Shaohao établit que le phénix serait désormais un dieu pour sa tribu, et l’image de cet oiseau le totem de la tribu. Il nomma son clan "le phénix", et donna aux autres clans d’autres noms d’oiseaux. Le chef du clan Fengniao (Phénix) se chargea ainsi de l’astrologie et du calendrier ; le chef du clan Xuanniao (l’oiseau sombre) de l’armée ; le chef du clan Bozhao (merle noir) s’occupa des deux solstices ; le chef du clan Qingniao (oiseau bleu-vert) fut chargé d’établir le printemps et l’été ; le chef du clan Danniao (oiseau rouge) de fixer l’automne et l’hiver. Le chef du clan Tourterelle fut ministre de l’éducation ; le chef du clan Mandarin chinois, ministre de la guerre ; le chef du clan Coucou, ministre des travaux publics ; le chef du clan Aigle, ministre de la justice ; le chef du clan Faucon, ministre de la trésorerie. Ces ministres forgent l’unité de la population. Cinq clans de faisans, responsables de la gestion du pays, firent en sorte que les unités de mesures soient unifiées et que les échanges commerciaux se fassent de façon juste. Enfin, neuf clans d’oiseaux migrateurs, dirigèrent les activités agricoles en fonction du calendrier, si bien qu’aucun murmure de n’éleva. »
Extrait de « Le Phénix : l’adoration de l’oiseau-soleil en Chine », un article de Wang Jun, revue Institut Confucius, n° 27, novembre 2014.
Carnet : la révolution de l’immédiateté
Le journal en direct et l’Internet ont apporté un nouveau temps à l’information : l’immédiateté. Le citoyen numérique vit et pense dans l’instant. Le journal en continu et les ordinateurs ont imposé leur rythme effréné à une population nombreuse à l’État lui-même : lors d’une catastrophe, un attentat terroriste ou un fait divers, les dirigeants politiques commentent instantanément l’événement et vont parfois jusqu’à décider de la résolution du problème en direct. Les atteintes à l’environnement commencent à mobiliser la planète et c’est heureux : la révolution numérique impose une prise de conscience de la même amplitude car, là aussi ; les conséquences de cette dangereuse conversion seront incalculables.
(Samedi 5 novembre 2016)
Les paroles s’envolent ?
Verba volent, scripta manent, littéralement, « les paroles s’envolent, les écrits restent » : locution latine, certes, mais ne nous y trompons pas, la sentence est d’origine médiévale.
(Dimanche 4 décembre 2016)
|
Billet d’humeur
Éloge de la lenteur
Dans l’économie comme dans la vie sociale, dans la gestion du quotidien comme dans l’organisation des loisirs, nous vivons la frénésie comme une sorte de punition, parce que nous avons perdu l’usage d’une temporalité naturelle, plus humaine en tout cas. Chaque jour, nous devons « gagner » du temps, c’est-à-dire que nous le « perdons » de plus en plus. La folie et la précipitation de nos faits et gestes ont brisé le partage des heures et des saisons au point de les effacer dans leur durée et leur intégrité originelles. Les technologies contemporaines ont couronné une nouvelle unité de temps, la nanoseconde, qui assujettit désormais les machines les plus sophistiquées à la performance, à la vitesse de l’éclair. A contrario, la vie humaine implique durée et lenteur minimales. Il est grand temps de sortir dans la rue et de revendiquer la lenteur : elle est un droit de l’homme.
|
Lecture critique
Sandrine Krikorian à la table des rois
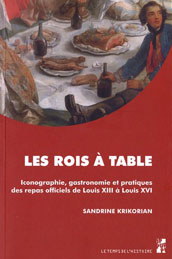 Toute étude universitaire au long cours procède d’une patiente quête pluridisciplinaire. Et pour être le plus complètement circonscrite, l’histoire de l’alimentation et des arts de la table à travers l’iconographie, qui constitue le domaine privilégié de Sandrine Krikorian (Marseille, 1977), imposent d’élargir considérablement l’angle des recherches, bien au-delà en tout cas de l’histoire des mentalités et des comportements. Deux siècles (XVIIe et XVIIIe s.) et le règne de quatre souverains (Louis XIII, Louis XIV, Louis XV et Louis XVI) ont monopolisé l’expertise de l’historienne de l’art qui a puisé à une grande quantité de sources imprimées parmi lesquelles almanachs, cérémonials, dictionnaires et encyclopédies, gazettes, inventaires, livres de cuisine et d’office, récits de voyageurs, traités sur la chasse, les mœurs et les métiers. Les beaux-arts apportent des témoignages tout aussi précieux, notamment les peintures, les dessins, les gravures et les sculptures qui allient souvent leur nature illustrative à une haute valeur documentaire (œuvres de Louis-Marin Bonnet, Alexandre-François Desportes, Christophe Huet, Nicolas Lancret, Carle Van Loo, Jean-Michel Moreau, Pithou le Jeune, Jacques Roëttiers et Jean-François de Troy). Toute étude universitaire au long cours procède d’une patiente quête pluridisciplinaire. Et pour être le plus complètement circonscrite, l’histoire de l’alimentation et des arts de la table à travers l’iconographie, qui constitue le domaine privilégié de Sandrine Krikorian (Marseille, 1977), imposent d’élargir considérablement l’angle des recherches, bien au-delà en tout cas de l’histoire des mentalités et des comportements. Deux siècles (XVIIe et XVIIIe s.) et le règne de quatre souverains (Louis XIII, Louis XIV, Louis XV et Louis XVI) ont monopolisé l’expertise de l’historienne de l’art qui a puisé à une grande quantité de sources imprimées parmi lesquelles almanachs, cérémonials, dictionnaires et encyclopédies, gazettes, inventaires, livres de cuisine et d’office, récits de voyageurs, traités sur la chasse, les mœurs et les métiers. Les beaux-arts apportent des témoignages tout aussi précieux, notamment les peintures, les dessins, les gravures et les sculptures qui allient souvent leur nature illustrative à une haute valeur documentaire (œuvres de Louis-Marin Bonnet, Alexandre-François Desportes, Christophe Huet, Nicolas Lancret, Carle Van Loo, Jean-Michel Moreau, Pithou le Jeune, Jacques Roëttiers et Jean-François de Troy).
Sous Louis XIII, la création culinaire et l’instauration d’une certaine étiquette à la cour marquent la naissance du service « à la française » - ce qui constitue une nette rupture avec le Moyen Âge - et l’affirmation d’une gastronomie qui acquerra au siècle suivant une renommée louée et enviée au-delà des frontières du pays. « Les plus grandes innovations alimentaires datent du XVIIe siècle, soutient l’auteure, avec la pâtisserie ou la consommation nouvelle de boissons que l’on peut qualifier d’exotiques, le café, le thé et le chocolat. » 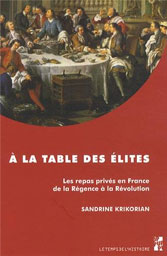 Renvoyés au dessert, les pêches, les figues, les pommes, le raisin ou encore les prunes sont les fruits les plus consommés à la fin du XVIIe s. Écuyer de bouche du duc de Rohan et petit-fils de Sully, Pierre de Lune développe dans son traité, Le Nouveau Cuisinier (1656), la recette d’un potage au melon qui est servi à la table de Louis XIV. Dans la première moitié du même siècle, l’exploitation de la canne à sucre en Martinique et en Guadeloupe ainsi que l’installation de raffineries de sucre sur le continent dote les menus officiels des premiers mets sucrés. Denrée rare et chère, le sucre entre dans la confection des tartes et des tourtes, des confitures et des biscuits, des sorbets et des glaces ; la viande elle-même est apprêtée avec le sucre, une pratique qui sera très vite considérée comme une faute de goût. La fourchette à deux puis à trois dents est utilisée dans le courant du XVIIIe s. : « Elle sert à piquer les aliments avant de les prendre avec les doigts et les mettre à la bouche ». La rigueur du cérémonial des repas publics contraint à une certaine justesse l’emplacement des mets et la place des convives. L’ordonnancement géométrique des plans de table où figurent les premiers menus s’harmonise avec la multiplication et l’innovation de la vaisselle (surtouts, terrines, porcelaines de la manufacture de Sèvres) et du mobilier de table (buffet, dormants et cabaret), vaisselle et mobilier de plus en plus luxueux. Tout aussi raffinée, la décoration des lieux s’apparente souvent à des décors de théâtre : les rois à table offrent un véritable spectacle à l’observateur ! « Les goûts évoluent au fil du temps, estime S. Krikorian, et aux décors de chinoiseries succède un goût pour l’Antiquité qui ne se dément pas jusqu’à la fin du règne de Louis XVI et même au-delà. » Nous apprenons que c’est sous le règne de Louis XIV que l’heure du souper passe de 18 à 22 heures : « Au début du XVIIIe siècle, on déjeunait vers 7 h, on dînait vers 13 h et ou soupait à 22 h, comme sous le règne du Roi-Soleil ». Louis XV aimait cuisiner, nous apprend Béatrix Saule (Tables royales à Versailles 1682-1789), à l’imitation de son oncle le Régent. « Dès 1726, selon l’historienne, conservateur général du patrimoine, il avait fait installer dans les étages de ses petits appartements de Versailles un "laboratoire", petite pièce munie d’un four à pâtisserie et de potagers pour garder au chaud »… Parmi les peintures du Château de l’Isle-Adam que le prince de Conti avait commandées à Michel-Barthélémy Ollivier, deux d’entre elles ont trait à la chasse dont la pratique est très liée à la
Renvoyés au dessert, les pêches, les figues, les pommes, le raisin ou encore les prunes sont les fruits les plus consommés à la fin du XVIIe s. Écuyer de bouche du duc de Rohan et petit-fils de Sully, Pierre de Lune développe dans son traité, Le Nouveau Cuisinier (1656), la recette d’un potage au melon qui est servi à la table de Louis XIV. Dans la première moitié du même siècle, l’exploitation de la canne à sucre en Martinique et en Guadeloupe ainsi que l’installation de raffineries de sucre sur le continent dote les menus officiels des premiers mets sucrés. Denrée rare et chère, le sucre entre dans la confection des tartes et des tourtes, des confitures et des biscuits, des sorbets et des glaces ; la viande elle-même est apprêtée avec le sucre, une pratique qui sera très vite considérée comme une faute de goût. La fourchette à deux puis à trois dents est utilisée dans le courant du XVIIIe s. : « Elle sert à piquer les aliments avant de les prendre avec les doigts et les mettre à la bouche ». La rigueur du cérémonial des repas publics contraint à une certaine justesse l’emplacement des mets et la place des convives. L’ordonnancement géométrique des plans de table où figurent les premiers menus s’harmonise avec la multiplication et l’innovation de la vaisselle (surtouts, terrines, porcelaines de la manufacture de Sèvres) et du mobilier de table (buffet, dormants et cabaret), vaisselle et mobilier de plus en plus luxueux. Tout aussi raffinée, la décoration des lieux s’apparente souvent à des décors de théâtre : les rois à table offrent un véritable spectacle à l’observateur ! « Les goûts évoluent au fil du temps, estime S. Krikorian, et aux décors de chinoiseries succède un goût pour l’Antiquité qui ne se dément pas jusqu’à la fin du règne de Louis XVI et même au-delà. » Nous apprenons que c’est sous le règne de Louis XIV que l’heure du souper passe de 18 à 22 heures : « Au début du XVIIIe siècle, on déjeunait vers 7 h, on dînait vers 13 h et ou soupait à 22 h, comme sous le règne du Roi-Soleil ». Louis XV aimait cuisiner, nous apprend Béatrix Saule (Tables royales à Versailles 1682-1789), à l’imitation de son oncle le Régent. « Dès 1726, selon l’historienne, conservateur général du patrimoine, il avait fait installer dans les étages de ses petits appartements de Versailles un "laboratoire", petite pièce munie d’un four à pâtisserie et de potagers pour garder au chaud »… Parmi les peintures du Château de l’Isle-Adam que le prince de Conti avait commandées à Michel-Barthélémy Ollivier, deux d’entre elles ont trait à la chasse dont la pratique est très liée à la 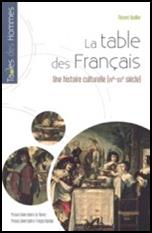 gastronomie de l’époque. Des soupers s’y déroulent à la clochette, c’est-à-dire que les commensaux sonnent les domestiques lorsqu’ils en ont besoin. L’iconographie des repas en plein air se développe au siècle des Lumières, observe S. Krikorian : « Cet intérêt pour la vie champêtre est surtout lié aux haltes de chasse qui vont donner naissance à l’actuel pique-nique, c’est-à-dire une nappe posée à même le sol. » Le repas champêtre, la vie campagnarde et le goût pour la nature des villageois d’alors sont restitués sous une vision idyllique et trompeuse par les peintres Sébastien Bourdon et les frères Le Nain quand François Boucher, Jean-Siméon Chardin et Jean-Baptiste Greuze mettent en scène une élite bourgeoise et aristocratique pareillement idéalisée. gastronomie de l’époque. Des soupers s’y déroulent à la clochette, c’est-à-dire que les commensaux sonnent les domestiques lorsqu’ils en ont besoin. L’iconographie des repas en plein air se développe au siècle des Lumières, observe S. Krikorian : « Cet intérêt pour la vie champêtre est surtout lié aux haltes de chasse qui vont donner naissance à l’actuel pique-nique, c’est-à-dire une nappe posée à même le sol. » Le repas champêtre, la vie campagnarde et le goût pour la nature des villageois d’alors sont restitués sous une vision idyllique et trompeuse par les peintres Sébastien Bourdon et les frères Le Nain quand François Boucher, Jean-Siméon Chardin et Jean-Baptiste Greuze mettent en scène une élite bourgeoise et aristocratique pareillement idéalisée.
Ces deux ouvrages-là montrent au lecteur comment la cour de France s’est érigée en modèle pour les autres cours européennes en matière de gastronomie. Ils expliquent aussi pourquoi la renommée de la cuisine française ne se dément pas aujourd’hui où elle a été classée - suprême récompense - au Patrimoine immatériel de l’Unesco.
- Les Rois à table - Iconographie, gastronomie et pratiques des repas officiels de Louis XIII à Louis XVI, par Sandrine Krikorian, Presses universitaires de Provence, 224 pages, 2011 ;
- À la table des élites - Les repas privés en France de la Régence à la Révolution, par Sandrine Krikorian, Presses universitaires de Provence, 170 pages, 2013.
Lecture complémentaire :
- La Table des Français - Une histoire culturelle (XVe-XIXe siècle), par Florent Quellier, Presses universitaires de Rennes/Presses universitaires François-Rabelais, 280 pages, 2007.
Portrait
Goethe, théoricien des couleurs
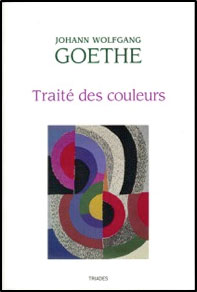 Le voyage en Italie qu’il effectue de septembre 1786 à juin 1788 le bouleverse. Il éprouve un éblouissement presque physique devant l’indicible beauté des paysages méridionaux que son père avait admirés en 1740. Certes, connaître Rome lui paraît nécessaire par fidélité à son ami défunt Johann Joachim Winckelmann (1717-1768), archéologue et historien de l’art allemand qui a donné du sens à leur passion commune de l’Antiquité classique. Mais Johann Wolfgang von Goethe (Francfort-sur-le-Main, 1749-Weimar, 1832) souhaite obtenir davantage de ce pèlerinage italien, quelque remède à l’insatisfaction de plus en plus prégnante dans sa résidence de Weimar. La visite des richesses artistiques de la péninsule - picturales et architecturales - et la fréquentation des peintres (Angelica Kauffmann [1741-1807] et Wilhelm Tischbein [1751-1829]) le comblent et le stimulent. Elles lui permettent, semble-t-il, de mettre un point final à sa tragédie « Egmont » (1788) et de commencer « La Métamorphose des plantes » (1790), un de ses plus chers projets. « Lorsqu’en Italie, Goethe non seulement se trouva devant les couleurs les plus nobles de cet art, raconte le philosophe Rudolf Steiner (1861-1925) qui présente avec brio le "Traité des couleurs" (Zur Farbenlehre, 1810), mais aussi devant les couleurs les plus splendides de la nature, un besoin particulièrement puissant s’éveilla en lui qui le poussa à connaître les lois régissant la couleur. » Il entreprend son étude des couleurs dès son retour d’Italie, au moment où il entend développer son idée de la métamorphose des êtres organiques ; il la poursuit dans les années 1790 et 1791 et ne cessera plus de se préoccuper de chromatisme et d’optique jusqu’au terme de sa vie. Le voyage en Italie qu’il effectue de septembre 1786 à juin 1788 le bouleverse. Il éprouve un éblouissement presque physique devant l’indicible beauté des paysages méridionaux que son père avait admirés en 1740. Certes, connaître Rome lui paraît nécessaire par fidélité à son ami défunt Johann Joachim Winckelmann (1717-1768), archéologue et historien de l’art allemand qui a donné du sens à leur passion commune de l’Antiquité classique. Mais Johann Wolfgang von Goethe (Francfort-sur-le-Main, 1749-Weimar, 1832) souhaite obtenir davantage de ce pèlerinage italien, quelque remède à l’insatisfaction de plus en plus prégnante dans sa résidence de Weimar. La visite des richesses artistiques de la péninsule - picturales et architecturales - et la fréquentation des peintres (Angelica Kauffmann [1741-1807] et Wilhelm Tischbein [1751-1829]) le comblent et le stimulent. Elles lui permettent, semble-t-il, de mettre un point final à sa tragédie « Egmont » (1788) et de commencer « La Métamorphose des plantes » (1790), un de ses plus chers projets. « Lorsqu’en Italie, Goethe non seulement se trouva devant les couleurs les plus nobles de cet art, raconte le philosophe Rudolf Steiner (1861-1925) qui présente avec brio le "Traité des couleurs" (Zur Farbenlehre, 1810), mais aussi devant les couleurs les plus splendides de la nature, un besoin particulièrement puissant s’éveilla en lui qui le poussa à connaître les lois régissant la couleur. » Il entreprend son étude des couleurs dès son retour d’Italie, au moment où il entend développer son idée de la métamorphose des êtres organiques ; il la poursuit dans les années 1790 et 1791 et ne cessera plus de se préoccuper de chromatisme et d’optique jusqu’au terme de sa vie.
Fin observateur de la nature, le poète ne s’est pas seulement intéressé aux couleurs et à la chromatologie, il s’est passionné à l’étude de la géologie, de la minéralogie, de la botanique, de l’archéologie et de la météorologie. Son traité est précédé, dès 1788-1790, de relations et d’essais relatifs à l’optique et au chromatisme, des textes et des expériences dont il entretient son ami l’écrivain Friedrich von Schiller (1759-1805) à travers une volumineuse correspondance (1798-1803). S’il admet au début de ses travaux la théorie des couleurs d’Isaac Newton (1642-1727), il ne la cautionne plus durant la rédaction de son Traité des couleurs. Une controverse s’ensuit opposant les partisans de l’optique newtonienne à l’écrivain allemand. « Nous comparons la théorie des couleurs de Newton, juge, cinglant, Goethe, à une vieille forteresse que son constructeur commença d’édifier avec une juvénile précipitation. »
Au gré de son ouvrage, il classe les couleurs selon trois états : les « couleurs physiologiques » (celles qui sont visibles sans raison extérieure) - le théoricien voit dans les couleurs physiologiques le fondement même du Traité des couleurs, les « couleurs physiques » (celles qui apparaissent dans des milieux incolores) et les « couleurs chimiques » (celles qui sont plus ou moins fixées sur les corps). Une partie intitulée « Vues générales internes » rassemble les considérations générales sur les couleurs ; une autre partie, « Rapports de voisinage », disserte des relations existant entre cette étude des couleurs et  d’autres disciplines comme la philosophie, la physique, les mathématiques, la teinturerie, la physiologie, l’histoire naturelle, l’acoustique et la terminologie ; une dernière partie, « Effet physique-moral de la couleur », traite des effets que la couleur exerce sur l’œil et la sensibilité de l’individu. « En tant qu’élément de l’art, précise Goethe à cet égard, la couleur peut être utilisée et peut collaborer aux fins esthétiques les plus hautes ». Trois essais théoriques parachèvent l’ouvrage : « La médiation de l’objet et du sujet dans la démarche expérimentale » (1792-1823), « Observation et pensée » (1795) et « Expérience vécue et science » (1798). d’autres disciplines comme la philosophie, la physique, les mathématiques, la teinturerie, la physiologie, l’histoire naturelle, l’acoustique et la terminologie ; une dernière partie, « Effet physique-moral de la couleur », traite des effets que la couleur exerce sur l’œil et la sensibilité de l’individu. « En tant qu’élément de l’art, précise Goethe à cet égard, la couleur peut être utilisée et peut collaborer aux fins esthétiques les plus hautes ». Trois essais théoriques parachèvent l’ouvrage : « La médiation de l’objet et du sujet dans la démarche expérimentale » (1792-1823), « Observation et pensée » (1795) et « Expérience vécue et science » (1798).
« La théorie des couleurs de Goethe a joui de l’estime générale des peintres, considère Rudolf Steiner. Elle s’est révélée très féconde dans la pratique. Il lui importait toujours que l’esprit ait finalement un lien quelconque avec la vie : "Il ne suffit pas de savoir, il faut aussi appliquer ; il ne suffit pas de vouloir, il faut aussi faire". »
- Traité des couleurs, par Johann Wolfgang Goethe, avec introduction et notes de Rudolf Steiner, textes choisis et présentés par Paul-Henri Bideau, traduction de Henriette Bideau, éditions Triades, 334 pages, 2011.
Lectures complémentaires :
- Histoire vivante des couleurs – 5 000 ans de peinture racontée par les pigments, par Philip Ball, traduit de l’anglais par Jacques Bonnet, éditions Hazan, 512 pages, 2010 ;
- Couleur, travail et société du Moyen Âge à nos jours, sous la direction de Françoise Bosman et de Rosine Cleyet-Michaud, Somogy éditions d’art/Archives départementales du Nord/Centre des archives du monde du travail, 242 pages, 2004.
|
La couleur à travers le regard du juriste
La couleur du peintre n’est pas celle du physicien, a-t-on coutume de dire : elle n’est pas non plus celle de l’historien ni du juriste, pourrait ajouter Jean-Pierre Scarano, maître de conférences à l’université Lyon-3 et assesseur du doyen de la faculté de Droit. Son ouvrage, « La Couleur et le droit », m’a procuré la plus heureuse surprise. S’appuyant sur l’histoire, la littérature, l’humanisme, la science et l’humour, cet érudit disserte des couleurs à la lumière du droit. Il nous impose du même coup des devoirs de vacances et d’utiles révisions. Ainsi nous apprend-il que la cocarde tricolore a précédé de quelques mois le drapeau bleu-blanc-rouge en juillet 1789 : le blanc était la couleur du roi et de l’armée, le bleu et le rouge celles de la ville de Paris. Un litige oppose la Roumanie et le Tchad, rappelle-t-il, parce qu’ils ont le même drapeau, trois bandes verticales bleu-jaune-rouge : le Tchad a saisi les Nations unies, la Roumanie a interpellé l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. « Contrairement à une idée répandue, l’élaboration d’armoiries, remarque l’auteur, n’était pas réservée à la noblesse. En 1790, plus des deux tiers des armoiries en usage dans le royaume de France étaient celles de bourgeois et d’artisans. » L’héraldique utilisait sept couleurs : argent (blanc), or (jaune), gueule (rouge), sable (noir), azur (bleu), sinople (vert) et pourpre (gris violacé). « Le concile de Latran (1215), lit-on encore, avait imposé aux juifs de se distinguer par le port d’un chapeau jaune et d’une rouelle jaune cousue sur leur vêtement. » La rouelle (de rotella, petite roue) était une pièce ronde de tissu rappelant le sceau de Salomon, de couleur jaune, que les juifs devaient porter du côté gauche, durant le Moyen Âge, en Occident. Parmi les cinq anneaux flottant sur la bannière olympique, trois couleurs ont été choisies en raison des races : noir pour l’Afrique, jaune pour l’Asie, rouge pour l’Amérique. Reste le bleu pour l’Europe (couleur préférée des Européens depuis le XVIIIe s.) et le vert pour l’Océanie. Jean-Pierre Scarano évoque le cas d’un volailler convoqué à la barre d’un tribunal en raison de son logotype formé de bandes diagonales bleu, blanc, rouge, et d’un coq bleu à crête rouge, alors que ses poulets étaient élevés au Brésil ! Sujet autrement dramatique, « des hommes ont porté pendant des siècles la douleur de la négritude, souligne-t-il, à cause de quelques grammes de mélanine qui permettent de distinguer le type négroïde du type européen ». « Sujet de droit à part entière, l’homme ne doit plus être victime de sa couleur, appelle instamment l’universitaire. Le droit et les tribunaux y contribuent en lui accordant la protection juridique nécessaire lui permettant d’accéder à une égalité de traitement. Mise à l’index, la discrimination est aujourd’hui proscrite après avoir été la norme dans les colonies françaises, aux États-Unis, en Afrique du Sud. » À méditer.
- La Couleur et le droit, par Jean-Pierre Scarano, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 122 pages, 2007.
|
Varia : les compagnons du Tour de France, des hommes de Devoir
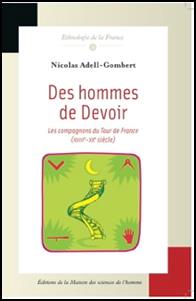 « Combien de jeunes charpentiers, en entrant chez les compagnons, rêvaient en secret d’intégrer à l’issue de leur formation compagnonnique la prestigieuse école d’architecture de Florence, là où "on t’apprend pas à faire des maisons en kit ou ce boulot qu’on fait tous les jours dans les boîtes. Après cette école, tu es responsable pour restaurer des monuments historiques… avec des charpentes à l’ancienne où tu sais pas bien comment les gars se débrouillaient pour les assembler avec les moyens qu’ils avaient" (apprenti charpentier, Fédération). « Combien de jeunes charpentiers, en entrant chez les compagnons, rêvaient en secret d’intégrer à l’issue de leur formation compagnonnique la prestigieuse école d’architecture de Florence, là où "on t’apprend pas à faire des maisons en kit ou ce boulot qu’on fait tous les jours dans les boîtes. Après cette école, tu es responsable pour restaurer des monuments historiques… avec des charpentes à l’ancienne où tu sais pas bien comment les gars se débrouillaient pour les assembler avec les moyens qu’ils avaient" (apprenti charpentier, Fédération).
« Il est vrai que les chefs-d’œuvre, les maximes et extraits de la Règle souvent affichés à l’entrée du siège à l’Association, le règlement interne de la communauté constituent autant d’éléments qui mettent en évidence une volonté de distinction dont on perçoit l’exigence dès le début du XIXe siècle dans les écrits du menuisier Agricol Perdiguier qui se plaignait des conduites de nombre de travailleurs de son époque pour qui "l’estomac est le seigneur, le cerveau est l’esclave". En ce sens, le compagnonnage civilise puisqu’il "excite au travail, à l’étude, à la propreté, à la bienfaisance, à la reconnaissance" (Perdiguier, 1863). Dans le même esprit, l’ouvrier sans prétention, l’homme soumis à son travail, constitue une "catégorie repoussoir" et ce depuis fort longtemps. Mais en quoi cela informe-t-il quant à la réalité des constructions identitaires ? Les jeunes hommes qui quittent l’enseignement professionnel traditionnel pour entrer chez les compagnons cherchent sans nul doute l’excellence. Mais que trouvent-ils ? L’espérance d’un avenir auréolé du prestige du titre de compagnon, mais aussi la nécessité, presque immédiate, de radicaliser son savoir-faire de travailleur manuel. C’est d’abord par sa main que le compagnon se fait. C’est dans le creux de ses aspérités aussi que se lit un savoir-être spécifique. Ainsi se dessine la figure de l’homme de métier. D’un côté, elle s’élabore dans le rejet de la catégorie de ces mauvais ouvriers qui vont au "boulot", en tendant, via la belle ouvrage et les bonnes façons, à constituer une élite artisane, une "chevalerie" du travail, disait-on au XIXe siècle. De l’autre côté, l’ouvrier soumis à l’œuvre, rejeté en bloc comme catégorie, revient de manière éparse au travers d’attitudes, de comportements jugés adéquats, sinon indispensables, à l’identité du travailleur manuel, plus précisément à ces ouvriers du bâtiment qui forment le cœur du compagnonnage. »
Extrait de l’ouvrage « Des hommes de Devoir - Les compagnons du Tour de France (XVIIIe-XXe siècle) », d’Adell-Gombert Nicolas, éditions de la Maison des sciences de l’homme, 276 pages, 2008.
Carnet : la main de l’artisan
« Il y a belle lurette que le fait-main et l’industriel ont fusionné, me lance, délibérément péremptoire, cet administrateur de société. Regardez comme nos machines savent de mieux en mieux imiter la main de l’homme ! ». Certes, mais l’artisan n’a pas disparu pour autant, c’est toujours sa main qui dessine.
Habitudes
Rien n’accélère le temps comme nos petites habitudes.
De l’humanité
Juste pensée de la psychanalyste et écrivaine Marie Balmary : « L’humanité n’est pas héréditaire ».
Nécessité de l’art
L’art n’est pas un luxe qui viendrait après le reste, lorsque le nécessaire est garanti. Défi obstiné, l’art fait partie du nécessaire, au sens premier du vocable. Il doit donc, nécessairement, être enseigné dans les écoles, dès la maternelle.
La leçon de Senghor
Léopold Sédar Senghor lui parle de la négritude, de Césaire. Puis de sa voix jeune, précise et modulée, il lui fait un cours sur la poésie anglaise : « Avez-vous remarqué que les plus grands poètes anglophones sont imprégnés d’ancienne culture celte ?... Ils sont presque tous irlandais, écossais, gallois… Il y a dans cette culture, comme dans la négritude, un élément de passion, d’imagination et de rythme, qui est au cœur même de la poésie. » Quand le poète et académicien raccompagne son hôte sur le perron de la villa, Jean-Claude Trichet, alors président de la Banque centrale européenne (BCE), est ébloui. « Une leçon d’universel », avouera-t-il.
(Jeudi 22 décembre 2016)
|





