Les Papiers collés
de Claude Darras
Printemps 2018
Carnet : elles nous changent…
Il n’y a que l’eau, les femmes et la mort, qui nous prennent dans notre nudité. Nous changent.
(Georges Perros, « Papiers collés » 1, dans « Bretagne », Gallimard/l’Imaginaire, 1960-2011)
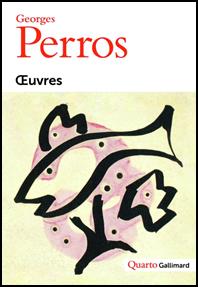 L’intégrale de Georges Perros chez Gallimard L’intégrale de Georges Perros chez Gallimard
L’écrivain est singulier, il écrivait sur des carnets, des cahiers, des bouts de papier, souvent sans indiquer de dates : des pensées brutes, des maximes, des rosseries, des aphorismes. L’homme n’a presque pas publié mais il a abondamment écrit : des carnets, des journaux, des notes, des poèmes, des lettres, des portraits, des critiques, mais jamais de romans ni de textes au long cours. « Aux yeux de Perros, considère l’écrivain et traducteur Thierry Gillybœuf (Lille, 1967) qui préface l’intégrale des œuvres du poète, le livre retire à l’écriture - à la sienne, s’entend - son caractère transitoire ou, plus exactement, fulgurant, en empêchant le mouvement intime qui l’anime. Le texte se fossilise comme un insecte pris au piège de l’ambre. Ce n’est pas tant pour être lu qu’il avoue écrire, que "pour être vécu, un peu". Longtemps, il a considéré que le livre était un obstacle à cette circulation, à ce flux vital. » C’est à Paris, dans le quartier des Batignolles, que Georges Poulot naît le 23 août 1923 : ses ancêtres maternels sont des cultivateurs du Pas-de-Calais tandis que la branche paternelle se manifeste dans l’artisanat jurassien. C’est à Paris qu’il prépare le conservatoire d’art dramatique et devient sociétaire de la Comédie Française où son ami Gérard Philipe le recommande à Jean Vilar, metteur en scène et directeur du TNP (Théâtre national populaire). Il demeure peu de temps sur les tréteaux des deux institutions, comédien dans la première et lecteur dans la seconde. Grâce au poète et critique d’art Alain Jouffroy, Jean Grenier et Jean Paulhan facilitent son embauche en qualité de lecteur à la pige aux éditions de la Nouvelle Revue française (NRF) où il défend les écrits de Roland Barthes, Michel Butor et Nathalie Sarraute bien avant que ceux-ci ne soient officiellement célébrés. Mais il est excédé par la vie parisienne et mondaine au point de s’installer à Douarnenez en 1959 avec Tania et leurs trois enfants, Frédéric, Catherine et Jean-Marie, après avoir sillonné la Bretagne en moto (véhicule que Jeanne Moreau lui aurait offert) à la recherche d’un espace reculé à la pointe du Finistère. Il y accueille ses voisins et les marins-pêcheurs ainsi que ses amis les plus chers, écrivains, poètes, peintres et éditeurs parmi lesquels André Breton, Michel Butor, Leonardo Cremonini, Lorand Gaspar (qui opéra son cancer du larynx), Jean-Marie Gibbal, Xavier Grall, Yves Marion, Gilbert Minazzoli, Gérard Philipe, René Quéré, Jean Roudaut et Henri Thomas. C’est Jean Paulhan qui l’a incité à prendre un nom de plume afin d’éviter toute confusion avec Georges Poulet, critique littéraire belge qui publiait aussi dans la revue NRF : aussi prend-il le nom de Perros, de Pen ar roz, « le bout du chemin » ou « le sommet de la colline » en breton, pseudonyme en totale correspondance avec l’étymologie de Finistère, Pen ar bed, qui signifie « bout du monde ». Admirateur de Joseph Joubert et de Franz Kafka, lecteur obsessionnel de Paul Valéry, « il est, selon T. Gillybœuf, de ces auteurs rares qui, par-delà leur disparition, continuent de nous parler, de convoquer en nous une zone de sensibilité fraternelle ».
- Œuvres, de Georges Perros, sous la direction de Thierry Gillybœuf, éditions Quarto Gallimard, 1600 pages, 2017. L’anthologie contient : Papiers collés (1960/1973/1978), Poèmes bleus (1962), Une vie ordinaire (1967), Échancrures (1977), Huit poèmes (1978).
Mon père…
Mon père était ouvrier d’usine, pointier de son métier. Je ne peux dire s’il était meilleur que les autres hommes de son âge. Avant sa maladie, nous nous déplacions avec lui. Je connus ainsi les Ardennes, l’Anjou et le Nord. Nous devions partir au Havre, quand la mort nous l’enleva. J’ai un peu hérité de son vagabondage. Je n’aime pas rester sur place… Peut-être ça lui permettait, ces départs, d’espérer une autre vie un peu moins pénible, un peu plus humaine.
(Jules Mougin, « Usines », Le Sol Clair, 1940)
L’araignée du brasseur
Avez-vous remarqué, lorsque vous visitez une brasserie des Flandres, que les caves et greniers sont tapissés de toiles d’araignée ? « L’araignée est l’amie du brasseur, assure le Bruxellois Jean Van Roy (Brasserie Cantillon). Elle élimine les insectes nuisibles qui, sans elle, pondraient leurs œufs et diffuseraient des bactéries dans nos bières. »
La chance du bilinguisme
C’est une chance et un bonheur d’être bilingue, estime l’écrivain et traducteur Abdellatif Laâbi (Fès, 1942) : « Les bilingues sont des gens plus ouverts et plus tolérants, dit-il, prompts à s’élever contre les violences identitaires ». « Notre identité marocaine est plurielle, ajoute-t-il. Nous sommes à la fois des Berbères et des Méditerranéens, des urbains et des gens du désert, nous avons une côte atlantique et nous sommes reliés à la France. Toutes ces influences nous constituent. »
La Cité interdite
Classée au patrimoine mondial de l’humanité en 1987 par l’Unesco, celle que l’on dit receler 9 999 pièces et presque autant de passages secrets fascine : 73 hectares, 960 mètres de long pour 750 mètres de large, résidence de 24 empereurs, 1 807 558 objets et plus de 600 ans d’histoire chinoise ! La Cité impériale de Pékin a été réalisée entre 1406 et 1420 à l’initiative de Yongle, alias Zhu Di (1360-1424), troisième empereur des Ming et génial architecte de la ville moderne.
(Mardi 9 janvier 2018)
|
Billet d’humeur
La marinière et le onze de France
Avant 1858, seuls les officiers de la Marine française disposaient d’un uniforme chamarré et clinquant ; les quartiers-maîtres et les matelots s’habillaient de leurs propres effets. Le Second Empire a mis fin à cette anarchie vestimentaire en imposant le tissu rayé qui distinguait depuis le Moyen Âge la vêture des bagnards et des déportés, une façon de stigmatiser davantage ces reclus de la société. L’administration maritime a donné le nom de marinière à ce tricot à raies bleues et blanches qui permettrait, selon elle, de mieux repérer les hommes tombés en mer. À l’origine, le mot désignait les chausses en tricot et la vareuse de serge portées dès le XVIe siècle par les marins eux-mêmes. Toujours en vigueur, la législation stipule que ce maillot de corps à longues manches en jersey de coton doit compter dans le sens horizontal 21 rayures blanches d’une largeur de 20 millimètres et 20 à 21 rayures bleues de 10 mm. La marinière doit épouser le corps pour mettre en valeur l’esthétique musculeuse des matelots et leur éviter de s’accrocher pendant les manœuvres. Pablo Picasso, Gabrielle Chanel, Brigitte Bardot, Madonna et Yves Saint-Laurent ont popularisé à grands frais le pull marin. En 2011, l’équipe de France de football en a même fait sa tenue officielle mais la marinière, très décriée, a fait naufrage en fin de saison, contraignant le sélectionneur Laurent Blanc à la remiser aux vestiaires.
|
Lecture critique
La supplique de Bernard Bertrand pour les arbres de la forêt
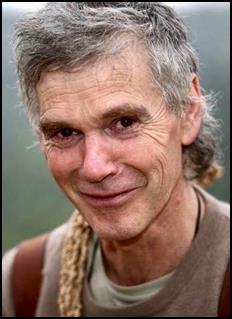 Écrivain-paysan ainsi qu’il se plaît à se qualifier, Bernard Bertrand (Jonzac, 1955) est peut-être davantage un pédagogue qui s’efforce de rendre accessible au plus grand nombre certains aspects de la science écologique. Depuis son berceau familial en Charente maritime où il passait le plus clair de son temps à courir les palisses (les haies en fait), les marais et la côte atlantique, jusqu’au domaine pyrénéen du Terran à Sengouagnet (Haute-Garonne) où il anime aujourd’hui des sessions et des ateliers d’initiation et de formation sur les plantes, les arbres et la forêt, il est devenu un de ces acteurs précieux de la défense et de l’illustration de la biodiversité et plus spécialement du règne végétal. Auteur d’une quarantaine d’ouvrages dont la plupart sont devenus des manuels d’une vulgarisation d’excellent aloi, livres écrits à partir des années 1990 dans une langue simple (mais qui n’interdit pas la rigueur de l’argumentation) et construits selon une démarche pédagogique conçue pour un échantillonnage de lecteurs très élargi, il a commis quatre « Herbiers » qui connaissent un succès de librairie amplement mérité, L’Herbier oublié, L’Herbier érotique, L’Herbier toxique et L’Herbier boisé. Ajoutons que président de l’association des Amis de l’ortie, il continue à défendre la richesse et les vertus des « mauvaises herbes »… Écrivain-paysan ainsi qu’il se plaît à se qualifier, Bernard Bertrand (Jonzac, 1955) est peut-être davantage un pédagogue qui s’efforce de rendre accessible au plus grand nombre certains aspects de la science écologique. Depuis son berceau familial en Charente maritime où il passait le plus clair de son temps à courir les palisses (les haies en fait), les marais et la côte atlantique, jusqu’au domaine pyrénéen du Terran à Sengouagnet (Haute-Garonne) où il anime aujourd’hui des sessions et des ateliers d’initiation et de formation sur les plantes, les arbres et la forêt, il est devenu un de ces acteurs précieux de la défense et de l’illustration de la biodiversité et plus spécialement du règne végétal. Auteur d’une quarantaine d’ouvrages dont la plupart sont devenus des manuels d’une vulgarisation d’excellent aloi, livres écrits à partir des années 1990 dans une langue simple (mais qui n’interdit pas la rigueur de l’argumentation) et construits selon une démarche pédagogique conçue pour un échantillonnage de lecteurs très élargi, il a commis quatre « Herbiers » qui connaissent un succès de librairie amplement mérité, L’Herbier oublié, L’Herbier érotique, L’Herbier toxique et L’Herbier boisé. Ajoutons que président de l’association des Amis de l’ortie, il continue à défendre la richesse et les vertus des « mauvaises herbes »…
Histoires et légendes
« L’Herbier boisé » concerne quatre-vingts arbres, arbustes, arbrisseaux et lianes dont il rapporte les histoires et les légendes tout en détaillant avec beaucoup d’exigence leurs caractères botanique, symbolique, économique ainsi que les usages artisanal, culinaire et phyto-thérapeutique. Ainsi de l’amandier (Prunus amygdalus Batsch), originaire d’Afghanistan et du Turkestan, il déplore que son antique domestication reste une énigme et signale l’inconséquente précocité de la fleur qui apparaît avant la feuille ; je ne savais pas non plus que son huile lubrifie les instruments d’horlogerie. Quant à l’arbousier (Arbutus unedo L.), il est avec l’ours le symbole de la ville de Madrid ; nos contemporains ont appris très tard que l’arbre aux fraises - cousin botanique du fraisier des bois - recelait nombre de vitamines. Notre auteur place le châtaignier (Castanea sativa Muller) parmi ses préférences et le qualifie d’arbre de civilisation ; parmi les métiers liés au châtaignier (tonnelier, vannier, etc.), seul celui de feuillardier était jadis exclusivement associé à l’arbre à pains, une autre de ses appellations ; les feuillards, complète l’auteur, servaient soit à cercler les barriques, soit à préparer claies et clôtures. Le bois du cytise (Laburnum anagyroides Médikus) est privilégié par les facteurs d’arcs. En Sibérie, enseigne B. Bertrand, chaque chaman possède son « mélèze » (Larix decidua Miller), arbre d’initiation auprès duquel il reçoit son éducation ; symbole de renouveau dans les Alpes et en Sibérie, c’est un arbre où se réfugient les entités mystiques qui protègent chaque communauté. Armoire à pharmacie tant sont nombreux ses usages médicinaux, le néflier (Mespilus germanica L.) fournit aux sorciers de Mayenne ses baguettes, coupées uniquement la nuit de la Saint-Jean ! La ronce (Rubus fruticosus L.) protège de si nombreux arbres dans la forêt qu’on la surnomme la mère du chêne ; généreuse, elle se prête à de multiples usages culinaires dont le thé de ronce n’a rien à envier aux thés les plus exotiques. Les pipes en Europe et les calumets de la paix en Amérique sont fabriqués dans le bois du sureau (Sambucus nigra L.) qui est un proche parent du chèvrefeuille. « L’Herbier boisé » nous apprend en outre que le troène (Ligustrum vulgare L.) ne se cantonne pas à dissimuler en guise d’haie impénétrable un pavillon résidentiel de son voisin ; la teinture noire de ses baies sert à colorer chapelets et gants ; de surcroît, les enlumineurs ont font des peintures et des encres.
L’avenir de la forêt relève d’une responsabilité collective
 La lecture de « L’Herbier boisé » conforte l’idée que l’avenir des forêts n’est pas seulement une affaire de choix technique et scientifique. La question ne doit pas être laissée aux seuls experts, laisse à penser Bernard Bertrand : elle relève d’une responsabilité collective. L’auteur se fait aussi l’écho d’une considération importante et encore actuelle, à savoir que les écosystèmes forestiers, répartis sur le dixième de la surface terrestre, restent les premiers producteurs de biomasse de la planète ; ils élaborent 45 % de la production totale de matière organique et les trois quarts de la production organique des terres émergées. « On découvre aujourd’hui seulement, écrit-il dans "L’Herbier boisé", que la vie de la forêt s’appuie sur une biotransformation de la matière organique, et une nutrition biologique des plantes, basée sur la formation de l’humus forestier… Les sols forestiers fonctionnent sur le principe de l’aggradation : la matière organique est transformée, non pas par des bactéries, mais par des champignons, c’est grâce à eux que la biotransformation est possible, sans dépense énergétique, puisqu’au contraire le phénomène entretient son propre approvisionnement en "carburant"… » Une raison suffisante pour protéger et sauvegarder plus que jamais la forêt et ses hôtes, parmi lesquels arbres, arbustes, arbrisseaux et lianes… La lecture de « L’Herbier boisé » conforte l’idée que l’avenir des forêts n’est pas seulement une affaire de choix technique et scientifique. La question ne doit pas être laissée aux seuls experts, laisse à penser Bernard Bertrand : elle relève d’une responsabilité collective. L’auteur se fait aussi l’écho d’une considération importante et encore actuelle, à savoir que les écosystèmes forestiers, répartis sur le dixième de la surface terrestre, restent les premiers producteurs de biomasse de la planète ; ils élaborent 45 % de la production totale de matière organique et les trois quarts de la production organique des terres émergées. « On découvre aujourd’hui seulement, écrit-il dans "L’Herbier boisé", que la vie de la forêt s’appuie sur une biotransformation de la matière organique, et une nutrition biologique des plantes, basée sur la formation de l’humus forestier… Les sols forestiers fonctionnent sur le principe de l’aggradation : la matière organique est transformée, non pas par des bactéries, mais par des champignons, c’est grâce à eux que la biotransformation est possible, sans dépense énergétique, puisqu’au contraire le phénomène entretient son propre approvisionnement en "carburant"… » Une raison suffisante pour protéger et sauvegarder plus que jamais la forêt et ses hôtes, parmi lesquels arbres, arbustes, arbrisseaux et lianes…
Charentais d’origine, Bernard Bertrand vit et travaille aujourd’hui
dans les Pyrénées, près d’Aspet © Photo X, droits réservés
- L’Herbier boisé - Histoires et légendes des arbres et arbustes, par Bernard Bertrand, éditions Plume de carotte, 198/190 pages, 2007/2014 (la première édition, en grand format, est la plus complète).
Portrait
Les vies multiples de Colette
 Le plus extraordinaire personnage de l’œuvre de Colette, c’est Colette elle-même, analyse assez finement l’écrivain et journaliste Maria Le Hardouin. Non pas seulement en raison des récits et des confidences qu’elle nous livre de certains épisodes de sa vie mais plus sûrement à travers les observations, les jugements et les réactions dont la petite paysanne bourguignonne constelle ses écrits qui révèlent les multiples facettes de son être intime. Par la qualité et l’ampleur de l’œuvre qui circonscrit plus de quarante volumes sur une cinquantaine d’années, elle demeure un des écrivains les plus importants de la première moitié du XXe siècle. Robert Brasillach, Truman Capote, Jean Cocteau, André Gide, Rémy de Gourmont, Jacques Laurent, Jean-Marie Gustave Le Clézio, François Mauriac, André Maurois, Marcel Proust, Paul Valéry comptent parmi ses plus fervents propagandistes. Henry de Montherlant la considère comme le plus grand écrivain français naturel : « son style, d’un naturel admirable, écrit-il dans ses "Carnets", et très au-dessus, selon moi, de Gide et de Valéry, est tout le contraire de celui des alambiqués, des laborieux, des pasticheurs… Jamais, sous sa plume, je n’ai surpris une bêtise… Colette est, je crois, la seule personne à propos de qui j’ai parlé de génie. » En 1936, elle intègre l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique. Et le 2 mai 1945, l’unanimité des jurés de l’Académie Goncourt la porte au prestigieux 1er couvert de Jean de La Varende (où lui succéda Jean Giono) : elle en deviendra la présidente en octobre 1949. Nombre de ses œuvres sont adaptées au théâtre (Chéri, La Vagabonde, Gigi) et au cinéma (Divine, Minne l’ingénue libertine, La Naissance du jour) ; l’une d’elles, une féérie-ballet écrite pour sa fille, Colette Renée de Jouvenel dite « Bel-Gazou », sera mise en musique par Maurice Ravel (L’Enfant et les Sortilèges). À partir de 1943, elle souffre d’une arthrite des jambes qui finit par l’immobiliser dans sa chambre, à partir de 1947, jusqu’à son décès le 3 août 1954, rue de Beaujolais (Palais Royal), à Paris : elle est inhumée au Père-Lachaise le 7 août au terme d’obsèques nationales auxquelles l’Église refuse de donner sa bénédiction. Le plus extraordinaire personnage de l’œuvre de Colette, c’est Colette elle-même, analyse assez finement l’écrivain et journaliste Maria Le Hardouin. Non pas seulement en raison des récits et des confidences qu’elle nous livre de certains épisodes de sa vie mais plus sûrement à travers les observations, les jugements et les réactions dont la petite paysanne bourguignonne constelle ses écrits qui révèlent les multiples facettes de son être intime. Par la qualité et l’ampleur de l’œuvre qui circonscrit plus de quarante volumes sur une cinquantaine d’années, elle demeure un des écrivains les plus importants de la première moitié du XXe siècle. Robert Brasillach, Truman Capote, Jean Cocteau, André Gide, Rémy de Gourmont, Jacques Laurent, Jean-Marie Gustave Le Clézio, François Mauriac, André Maurois, Marcel Proust, Paul Valéry comptent parmi ses plus fervents propagandistes. Henry de Montherlant la considère comme le plus grand écrivain français naturel : « son style, d’un naturel admirable, écrit-il dans ses "Carnets", et très au-dessus, selon moi, de Gide et de Valéry, est tout le contraire de celui des alambiqués, des laborieux, des pasticheurs… Jamais, sous sa plume, je n’ai surpris une bêtise… Colette est, je crois, la seule personne à propos de qui j’ai parlé de génie. » En 1936, elle intègre l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique. Et le 2 mai 1945, l’unanimité des jurés de l’Académie Goncourt la porte au prestigieux 1er couvert de Jean de La Varende (où lui succéda Jean Giono) : elle en deviendra la présidente en octobre 1949. Nombre de ses œuvres sont adaptées au théâtre (Chéri, La Vagabonde, Gigi) et au cinéma (Divine, Minne l’ingénue libertine, La Naissance du jour) ; l’une d’elles, une féérie-ballet écrite pour sa fille, Colette Renée de Jouvenel dite « Bel-Gazou », sera mise en musique par Maurice Ravel (L’Enfant et les Sortilèges). À partir de 1943, elle souffre d’une arthrite des jambes qui finit par l’immobiliser dans sa chambre, à partir de 1947, jusqu’à son décès le 3 août 1954, rue de Beaujolais (Palais Royal), à Paris : elle est inhumée au Père-Lachaise le 7 août au terme d’obsèques nationales auxquelles l’Église refuse de donner sa bénédiction.
Indécente et païenne
 Née à Saint-Sauveur-en-Puisaye (Yonne) le 23 janvier 1873, Sidonie-Gabrielle Colette est la fille du capitaine de zouaves Jules Joseph Colette et d’une musicienne Adèle Sidonie Robineau-Duclos née Landoy ; elle est la cadette de Léopold, dit Léo, né le 22 octobre 1866. Ancien saint-cyrien, le père s’est reconverti dans la perception d’impôt à Saint-Sauveur. Une blessure reçue pendant la campagne d’Italie et suivie de l’amputation d’une jambe a mis fin à sa carrière militaire. Colette se marie trois fois. En 1893 avec Henry Gauthier-Villars, alias Willy, son pseudonyme dans le journalisme où il pratique la critique musicale : de quinze ans son aîné, il est le fils d’un éditeur parisien. En 1912 avec Henry de Jouvenel (rédacteur en chef du quotidien Le Matin), alias Sidi : avec sa particule, il lui offre un titre de baronne et un château en Corrèze. Et en 1935 avec Maurice Goudeket : courtier en perles, il est de seize ans le cadet de Colette. La postérité a complaisamment retenu les frasques de l’aventurière qui croque la vie, ses délices et ses perversités, à pleines dents, « une réputation sulfureuse qui accompagne une vie sentimentale compliquée et des écrits audacieux ». Comédienne aux seins nus, son extravagante sensorialité, mystique et sans dieu, lui vaut une collection d’amants et d’amantes. Indécente et dionysiaque, elle choque la bourgeoisie durant l’été 1914 en transformant son chalet de Passy en un gynécée improbable et non-conformiste qui héberge la comédienne Marguerite Moreno, la journaliste Annie de Pène et la danseuse de cabaret Musidora, ses « jumelles, scandaleuses à force d’être libres ». Ses livres sont mis à l’index par le Vatican. Elle collabore sous l’Occupation à l’hebdomadaire Gringoire. Imprévisible, ne fait-elle pas une ascension à bord d’un dirigeable ? Interrogée par le journaliste et romancier Maurice Dekobra sur son éventuelle implication au mouvement féministe, elle va jusqu’à promettre le fouet et le harem aux suffragettes ! Journaliste, elle « couvre » les procès de Landru, de la bande à Bonnot et de Violette Nozière (elle est aussi une critique dramatique et musicale très avisée). Elle monte sur le ring pour apprendre la boxe française. Et c’est sur les conseils d’André Maginot, l’inventeur de la fameuse ligne, qu’elle en vient à vendre des produits de beauté ! Née à Saint-Sauveur-en-Puisaye (Yonne) le 23 janvier 1873, Sidonie-Gabrielle Colette est la fille du capitaine de zouaves Jules Joseph Colette et d’une musicienne Adèle Sidonie Robineau-Duclos née Landoy ; elle est la cadette de Léopold, dit Léo, né le 22 octobre 1866. Ancien saint-cyrien, le père s’est reconverti dans la perception d’impôt à Saint-Sauveur. Une blessure reçue pendant la campagne d’Italie et suivie de l’amputation d’une jambe a mis fin à sa carrière militaire. Colette se marie trois fois. En 1893 avec Henry Gauthier-Villars, alias Willy, son pseudonyme dans le journalisme où il pratique la critique musicale : de quinze ans son aîné, il est le fils d’un éditeur parisien. En 1912 avec Henry de Jouvenel (rédacteur en chef du quotidien Le Matin), alias Sidi : avec sa particule, il lui offre un titre de baronne et un château en Corrèze. Et en 1935 avec Maurice Goudeket : courtier en perles, il est de seize ans le cadet de Colette. La postérité a complaisamment retenu les frasques de l’aventurière qui croque la vie, ses délices et ses perversités, à pleines dents, « une réputation sulfureuse qui accompagne une vie sentimentale compliquée et des écrits audacieux ». Comédienne aux seins nus, son extravagante sensorialité, mystique et sans dieu, lui vaut une collection d’amants et d’amantes. Indécente et dionysiaque, elle choque la bourgeoisie durant l’été 1914 en transformant son chalet de Passy en un gynécée improbable et non-conformiste qui héberge la comédienne Marguerite Moreno, la journaliste Annie de Pène et la danseuse de cabaret Musidora, ses « jumelles, scandaleuses à force d’être libres ». Ses livres sont mis à l’index par le Vatican. Elle collabore sous l’Occupation à l’hebdomadaire Gringoire. Imprévisible, ne fait-elle pas une ascension à bord d’un dirigeable ? Interrogée par le journaliste et romancier Maurice Dekobra sur son éventuelle implication au mouvement féministe, elle va jusqu’à promettre le fouet et le harem aux suffragettes ! Journaliste, elle « couvre » les procès de Landru, de la bande à Bonnot et de Violette Nozière (elle est aussi une critique dramatique et musicale très avisée). Elle monte sur le ring pour apprendre la boxe française. Et c’est sur les conseils d’André Maginot, l’inventeur de la fameuse ligne, qu’elle en vient à vendre des produits de beauté !
De l’influence de Sido et de Willy
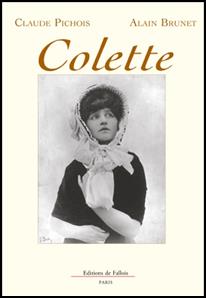 Sa mère Sido et son premier mari Willy ont exercé une influence déterminante sur son œuvre. De Sido lui vient son amour de la nature et des animaux dont les êtres vivants ne cessent de l’émerveiller et d’alimenter de somptueuses évocations qui reflètent, par la texture même de l’écriture, un état d’innocence et une sensualité toute féminine. À Saint-Sauveur, Sido se levait dès potron-minet et, en même temps que le pain et le lait, elle apportait à sa famille les nouvelles des jardins à propos de la germination des semences, la floraison des plantes, la santé des chats. « Elle avait, dit Colette, cette manière étrange de s’arrêter devant une rose et de la relever par le menton pour la regarder en plein visage ». « Aucun écrivain, affirme J.-M.G. Le Clézio - sauf peut-être Faulkner dans "Lumière d’août" - n’a apporté une telle attention à traduire le frémissement, le fourmillement, le pullulement de la vie sous toutes ses formes. » Willy, de son côté, l’a soumise à une sévère discipline du travail d’écriture qui a fait fructifier le don du verbe, la finesse de l’observation, la pertinence de l’analyse psychologique qui distinguent les premiers grands romans parus en feuilleton, de « La Vagabonde » (1910) à « La Fin de Chéri » (1926). Éducation sentimentale détestable, cette première expérience avec un conjoint inconstant et libertin marque plus d’un récit, parfois jusqu’à l’obsession. Dès lors qu’elle inventorie l’univers des passions humaines - lorsque les exigences des sens l’emportent sur le cœur et la sensibilité - le lyrisme musical et la poésie agreste (« Dialogues de bêtes », 1904, « Les Vrilles de la vigne », 1908) laissent place à un style lapidaire, sec, concis, cruel aussi pour décrire d’un esprit amusé, mais souvent d’un œil froid, les vicissitudes de l’amour, le plus souvent en situation d’échec (« Duo », 1934, « Chéri », 1920, « Julie de Carneilhan », 1941). À ses débuts, elle a été le « nègre » de son mari, lui abandonnant la paternité de ses premiers récits, de 1900 à 1905, un volume par an : « Claudine à l’école », « Claudine à Paris », « Claudine en ménage », « Claudine s’en va », « Minne », les Égarements de Minne ». Henry Gauthier-Villars avait institué un atelier de nègres, des jeunes talents pour la plupart qu’il assiégeait de « petits bleus » (pneumatiques) réclamant additions, corrections et refontes de textes qu’il signait sans vergogne de son seul pseudonyme. On a pu dénombrer une cinquantaine de ces teinturiers (autrement dit ceux qui redonnent des couleurs à des manuscrits fastidieux) parmi lesquels Armory (pseud. De L.-C. Dauriac), Paul Barlet, Francis Carco, Curnonsky, Roland Dorgelès, Jean de Tinan, Paul-Jean Toulet, Pierre Veber, jusqu’aux compositeurs Claude Debussy et Émile Vuillermoz ! En 1923, avec « Le Blé en herbe », elle opte définitivement pour son nom de plume, son nom de famille, le « nom du père », après avoir publié sous les pseudonymes de Willy et de Colette Willy. Sa mère Sido et son premier mari Willy ont exercé une influence déterminante sur son œuvre. De Sido lui vient son amour de la nature et des animaux dont les êtres vivants ne cessent de l’émerveiller et d’alimenter de somptueuses évocations qui reflètent, par la texture même de l’écriture, un état d’innocence et une sensualité toute féminine. À Saint-Sauveur, Sido se levait dès potron-minet et, en même temps que le pain et le lait, elle apportait à sa famille les nouvelles des jardins à propos de la germination des semences, la floraison des plantes, la santé des chats. « Elle avait, dit Colette, cette manière étrange de s’arrêter devant une rose et de la relever par le menton pour la regarder en plein visage ». « Aucun écrivain, affirme J.-M.G. Le Clézio - sauf peut-être Faulkner dans "Lumière d’août" - n’a apporté une telle attention à traduire le frémissement, le fourmillement, le pullulement de la vie sous toutes ses formes. » Willy, de son côté, l’a soumise à une sévère discipline du travail d’écriture qui a fait fructifier le don du verbe, la finesse de l’observation, la pertinence de l’analyse psychologique qui distinguent les premiers grands romans parus en feuilleton, de « La Vagabonde » (1910) à « La Fin de Chéri » (1926). Éducation sentimentale détestable, cette première expérience avec un conjoint inconstant et libertin marque plus d’un récit, parfois jusqu’à l’obsession. Dès lors qu’elle inventorie l’univers des passions humaines - lorsque les exigences des sens l’emportent sur le cœur et la sensibilité - le lyrisme musical et la poésie agreste (« Dialogues de bêtes », 1904, « Les Vrilles de la vigne », 1908) laissent place à un style lapidaire, sec, concis, cruel aussi pour décrire d’un esprit amusé, mais souvent d’un œil froid, les vicissitudes de l’amour, le plus souvent en situation d’échec (« Duo », 1934, « Chéri », 1920, « Julie de Carneilhan », 1941). À ses débuts, elle a été le « nègre » de son mari, lui abandonnant la paternité de ses premiers récits, de 1900 à 1905, un volume par an : « Claudine à l’école », « Claudine à Paris », « Claudine en ménage », « Claudine s’en va », « Minne », les Égarements de Minne ». Henry Gauthier-Villars avait institué un atelier de nègres, des jeunes talents pour la plupart qu’il assiégeait de « petits bleus » (pneumatiques) réclamant additions, corrections et refontes de textes qu’il signait sans vergogne de son seul pseudonyme. On a pu dénombrer une cinquantaine de ces teinturiers (autrement dit ceux qui redonnent des couleurs à des manuscrits fastidieux) parmi lesquels Armory (pseud. De L.-C. Dauriac), Paul Barlet, Francis Carco, Curnonsky, Roland Dorgelès, Jean de Tinan, Paul-Jean Toulet, Pierre Veber, jusqu’aux compositeurs Claude Debussy et Émile Vuillermoz ! En 1923, avec « Le Blé en herbe », elle opte définitivement pour son nom de plume, son nom de famille, le « nom du père », après avoir publié sous les pseudonymes de Willy et de Colette Willy.
Colette : c’est le chat qui l’a sans doute le plus inspirée
© Photo Les Amis de Colette, droits réservés
- Colette, par Madeleine Lazard (professeur émérite à l’université Paris III/Sorbonne Nouvelle), Gallimard/Folio biographies, 400 pages, 2008.
Lectures complémentaires :
- Colette, par Maria Le Hardouin, Presses universitaires, 136 pages, 1956 ;
- Colette, par Claude Pichois et Alain Brunet, éditions de Fallois, 606 pages, 1999 ;
- Le Robert des grands écrivains de langue française, sous la direction de Philippe Hamon (université Paris III/Sorbonne Nouvelle) et Denis-Roger-Vasselin (Dictionnaires Le Robert), Dictionnaires Le Robert, 1522 pages, 2000.
Varia : le furet, modèle expérimental pour la grippe aviaire
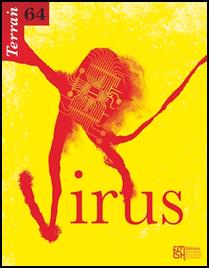 « En septembre 2011, Ron A. M. Fouchier, professeur de microbiologie au centre médical Érasme [de Rotterdam], annonça, lors d’une réunion du groupe de travail européen sur la grippe à Malte, qu’il avait fabriqué un virus de grippe aviaire transmissible par voie aérienne entre mammifères. Le mammifère en question était le furet, qui sert de modèle expérimental pour la grippe car il est, avec l’homme, le seul mammifère à éternuer quand il est infecté. Fouchier avait inséré dans le virus H5N1 trois nucléotides qui avaient été identifiés dans le H1N1 comme favorisant la transmissibilité, puis il avait infecté un furet avec ce mutant. Il avait ensuite prélevé des échantillons nasaux sur ce furet qu’il avait transférés à un autre furet, répétant dix fois la même opération dite de "passaging". Au bout de la dixième génération, le virus H5N1 s’était adapté à l’organisme du mammifère, de telle sorte que deux furets mis dans deux cages adjacentes se transmettaient le virus H5N1 par simple voie aérienne. Fouchier déclara également que ces résultats convergeaient avec ceux qui avaient été obtenus par le biologiste Yoshi Kawaoka, de l’université de Tokyo […] « En septembre 2011, Ron A. M. Fouchier, professeur de microbiologie au centre médical Érasme [de Rotterdam], annonça, lors d’une réunion du groupe de travail européen sur la grippe à Malte, qu’il avait fabriqué un virus de grippe aviaire transmissible par voie aérienne entre mammifères. Le mammifère en question était le furet, qui sert de modèle expérimental pour la grippe car il est, avec l’homme, le seul mammifère à éternuer quand il est infecté. Fouchier avait inséré dans le virus H5N1 trois nucléotides qui avaient été identifiés dans le H1N1 comme favorisant la transmissibilité, puis il avait infecté un furet avec ce mutant. Il avait ensuite prélevé des échantillons nasaux sur ce furet qu’il avait transférés à un autre furet, répétant dix fois la même opération dite de "passaging". Au bout de la dixième génération, le virus H5N1 s’était adapté à l’organisme du mammifère, de telle sorte que deux furets mis dans deux cages adjacentes se transmettaient le virus H5N1 par simple voie aérienne. Fouchier déclara également que ces résultats convergeaient avec ceux qui avaient été obtenus par le biologiste Yoshi Kawaoka, de l’université de Tokyo […]
« Ron Fouchier se présente surtout comme un spécialiste de l’expérimentation animale. Lorsqu’il révéla en septembre 2011 à Malte ses recherches sur le H5N1 mutant, il déclara "J’ai fait quelque chose de très stupide." Cette phrase, qui attira la suspicion des autorités internationales sur la sécurité de ses recherches, résulte d’une confusion avec le néerlandais, où "stupide" se dit par le même mot que "simple". Fouchier voulait seulement préciser qu’il avait utilisé une technique plus simple que Yoshi Kawaoka en faisant passer le virus H5N1 mutant par dix générations du furet, au lieu d’y introduire les gènes du virus H1N1. Fouchier avait conçu des cages dans lesquelles les furets peuvent se transmettre les virus par voie aérienne sans se toucher, et il cherchait des moyens d’adapter ces cages à des cochons ou à des volailles. Il se plaignait de l’élévation des prix des furets de laboratoire, due à un double facteur : les éleveurs de furets (situés notamment en Scandinavie, en Chine et aux États-Unis) les réservent au commerce de la fourrure, et les normes de biosécurité qui permettent de produire des furets séronégatifs (c’est-à-dire n’ayant jamais été en contact avec des pathogènes) sont très exigeantes. »
Extraits de « L’alarme d’Antigone - Les chimères des chasseurs de virus », propos de Frédéric Keck (Musée du quai Branly) issu de la revue « Terrain », dossier « Virus », n° 64, mars 2015, éditions de la Maison des sciences de l’homme, 176 pages.
Carnet : le temps du cinéma et de l’opéra
Un après-midi, après qu’ils eurent regardé La Tosca de Puccini, filmée à Rome en décor réel par Benoît Jacquot, Julien Gracq explique à Régis Debray pourquoi il préfère l’opéra au cinéma. « Les vieux films classiques, dit l’auteur du "Rivage des Syrtes", sont datés comme les automobiles. Les opéras ne le sont pas, protégés du réel par les conventions propres au genre. L’irréalisme du chant et des costumes leur permet de traverser le temps intacts. »
Burn-out ou épuisement ?
Je ne suis pas du tout rétif aux métissages de la langue, lesquels l’enrichissent plus souvent qu’ils ne l’appauvrissent, mais parfois l’emploi de vocables étrangers propage une certaine incompréhension. Ainsi le terme anglo-saxon de burn-out ou burnout, par exemple, qui entend signifier l’épuisement physique et mental d’un individu. Épuisement physique et mental est justement le syntagme propre à qualifier la chute de productivité, la forte irritabilité, l’effroi provoqué par le changement, la perte de contact avec l’environnement familial et professionnel qui affectent l’individu qui en est victime. Chez les anglo-saxons, burn-out désigne, au sens propre, l’arrêt par suite de l’épuisement du combustible et, en électricité, le grillage des circuits ou la décharge progressive ou totale d’une batterie.
(Lundi 22 janvier 2018)
Le silence du désert
Celui qui crie le plus fort dans le désert, c’est le silence, dit un proverbe touareg.
(Mercredi 31 janvier 2018)
Rencontre
À la campagne, on ne rencontre que des familiers ; à la ville, on ne croise que des inconnus - c’est une autre planète.
(Gilbert Cesbron, « Journal sans date », éd. Robert Laffont, 1963/1967/1973)
Bicyclette et télévision
Les frères Goncourt se demandaient déjà si la bicyclette n’allait pas ruiner la vente des livres, comme nous ne cessions, il n’y a pas si longtemps, de déplorer que c’est à cause de la télévision que nos chers enfants n’ont pas encore achevé La Recherche du temps perdu.
(Jeudi 8 février 2018)
|
Billet d'humeur
La truffole du franciscain
Ce n’est pas Christophe Colomb qui a ramené la pomme de terre sur le continent européen mais Pierre Sornas, un franciscain de Tolède. Natif de Bécuse, un hameau de Saint-Alban-d’Ay, dans le Haut-Vivarais, le moine s’était retiré dans son village vers 1540 au terme de sa vie monacale : c’est là que sont plantés pour la première fois les tubercules que le moine a rapportés de la péninsule ibérique dans une des caraques armées par les conquistadors. Si les Incas qui la cultivaient près de 1 000 ans avant Jésus-Christ la nommaient papas, les paysans de la région d’Annonay la désignaient sous le nom de truffole, « petite truffe » en patois local. Le botaniste Henri-Louis Duhamel du Monceau (1700-1782) aurait utilisé le premier en 1762 la métaphore pomme de terre, dans la signification de « fruit de terre ». Quant à Antoine-Augustin Parmentier (1737-1813), agronome et pharmacien aux armées, il aura eu le mérite de dissiper en France, à partir de 1773, les préjugés enracinés contre le féculent jugé « bon qu’à donner aux cochons »… En fait, selon les archéologues, la pomme de terre, alias Solanum tuberosum Linné (de la famille des Solanacées), a été domestiquée, il y a près de huit mille ans - peut-être plus antérieurement encore, par les populations de l’Altiplano, ces hautes plaines andines situées aujourd’hui de part et d’autre de la frontière entre le Pérou et la Bolivie. Une étude génétique a démontré que 99 % de toutes les variétés modernes de pommes de terre proviennent d’une ancêtre patate née dans le centre du Chili. Mais les 1 % restants réfèrent à un ancêtre cultivé dans les Andes, entre l’est du Venezuela et le nord de l’Argentine. 5 000 variétés de pommes de terre ont été répertoriées à la surface du globe
|
Lecture critique
Le parcours atypique d’André Turcat
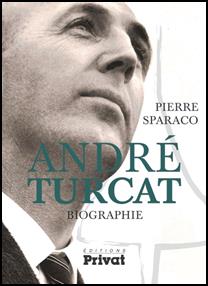 Le lecteur retiendra de la biographie d’André Turcat (Marseille, 23 octobre 1921-Beaurecueil, 4 janvier 2016) par l’écrivain et journaliste Pierre Sparaco (Verviers, 1940-Aix-en-Provence, 2015) le parcours atypique d’un personnage qui se décline à l’exemple d’un inventaire à la Prévert : « La longue énumération de ses activités successives déroute, c’est le moins que l’on puisse dire », observe son biographe et ami. « Turcat, assis sur les bancs de Polytechnique, où il était entré avec un bon rang, imagina en un premier temps qu’il ferait carrière dans les Ponts et Chaussées, raconte P. Sparaco. Mais c’était, expliqua-t-il ensuite "un objectif inaccessible". Et d’ajouter : "De ce fait, l’armée était la seule solution", expliquant qu’il a alors pensé à une arme "technique" et qu’il a choisi l’armée de l’air, lui qui n’avait jamais vu un avion de près ! Plus tard, il fut d’ailleurs malade au cours de son baptême de l’air sur Bloch 210… » Le baptême intervient à l’automne 1942, à Salon-de-Provence ; le Bloch MB-210, un lent et prétendu bombardier, est un bimoteur de 10 tonnes conçu au début des années 1930 que propulse deux moteurs Gnome et Rhône 14N de 910 chevaux ! Cette même année 1942 où il passe son congé d’armistice avec ses camarades Jean Boulet (futur pilote d’essais) et Roger Béteille (ingénieur aéronautique) marque aussi sa rencontre avec Élisabeth Borelli, « une Marseillaise du tonnerre », dira-t-il, qu’il épousera le jour de la capitulation allemande. Son brevet de pilote obtenu en 1947, il multiplie les essais en vol (4 000 heures au total) sur 110 types d’avions dont le Griffon II de Nord-Aviation avec lequel il atteint en 1957 plus de deux fois la vitesse du son et puis le programme franco-britannique Concorde, le supersonique civil à aile delta dont il assume le premier vol le dimanche 2 mars 1969. Le lecteur retiendra de la biographie d’André Turcat (Marseille, 23 octobre 1921-Beaurecueil, 4 janvier 2016) par l’écrivain et journaliste Pierre Sparaco (Verviers, 1940-Aix-en-Provence, 2015) le parcours atypique d’un personnage qui se décline à l’exemple d’un inventaire à la Prévert : « La longue énumération de ses activités successives déroute, c’est le moins que l’on puisse dire », observe son biographe et ami. « Turcat, assis sur les bancs de Polytechnique, où il était entré avec un bon rang, imagina en un premier temps qu’il ferait carrière dans les Ponts et Chaussées, raconte P. Sparaco. Mais c’était, expliqua-t-il ensuite "un objectif inaccessible". Et d’ajouter : "De ce fait, l’armée était la seule solution", expliquant qu’il a alors pensé à une arme "technique" et qu’il a choisi l’armée de l’air, lui qui n’avait jamais vu un avion de près ! Plus tard, il fut d’ailleurs malade au cours de son baptême de l’air sur Bloch 210… » Le baptême intervient à l’automne 1942, à Salon-de-Provence ; le Bloch MB-210, un lent et prétendu bombardier, est un bimoteur de 10 tonnes conçu au début des années 1930 que propulse deux moteurs Gnome et Rhône 14N de 910 chevaux ! Cette même année 1942 où il passe son congé d’armistice avec ses camarades Jean Boulet (futur pilote d’essais) et Roger Béteille (ingénieur aéronautique) marque aussi sa rencontre avec Élisabeth Borelli, « une Marseillaise du tonnerre », dira-t-il, qu’il épousera le jour de la capitulation allemande. Son brevet de pilote obtenu en 1947, il multiplie les essais en vol (4 000 heures au total) sur 110 types d’avions dont le Griffon II de Nord-Aviation avec lequel il atteint en 1957 plus de deux fois la vitesse du son et puis le programme franco-britannique Concorde, le supersonique civil à aile delta dont il assume le premier vol le dimanche 2 mars 1969.
Si sa première passion a été le pilotage, l’histoire de l’art lui a succédé durant les années 1980-1990 avec la soutenance d’une thèse d’État, publiée en 1994 sous le titre « Étienne Jamet, alias Esteban Jamete, sculpteur français de la renaissance en Espagne, condamné par l’Inquisition ». Sa troisième activité s’est trouvée être la théologie où il a été admis au deuxième grade universitaire. Une quatrième passion l’a happé en 2009 quand il décide de se frotter aux techniques journalistiques du reportage. En compagnie de ses amis Pierre Sparaco et Germain Chambost (un autre spécialiste de l’aéronautique civile), il se met en quête de rappeler les hauts faits des ces audacieux pilotes et ingénieurs qui ont permis, durant la décennie 1950-1960, le retour de l’industrie française au devant de la scène mondiale. Entre-temps, il milite pour donner à l’aviation française son académie : l’Académie de l’air et de l’espace est officiellement créée le 21 novembre 1983, date correspondant au 200e anniversaire du premier vol humain, celui de Pilâtre de Rozier en novembre 1783, au château de la Muette (aujourd’hui disparu) à l’ouest de Paris. À la faveur du trentenaire de l’académie, en 2013, célébré dans la salle des Illustres du Capitole de Toulouse, André Turcat rend hommage aux trois premiers et prestigieux membres d’honneur de l’institution : « Henri Fabre (premier vol hydro mondial en mars 1910 sur l’étang de Berre),  Armand Lotti (première traversée aérienne française de l’Atlantique en 1929), tous deux encore en vie en 1983 - date de la création de l’Académie -, et Michel Debré, présent à la cérémonie. "Un ministre visionnaire", dit de lui André Turcat, rappelant qu’il a créé en 1962, avec le général Robert Aubinière, le Centre spatial guyanais de Kourou ». Aux dernières pages de l’ouvrage, Pierre Sparaco évoque la majestueuse propriété du pilote d’essais, à Beaurecueil, enfouie au cœur d’un terrain de 5 hectares, en bordure de la route Paul Cézanne classée par André Malraux : « Si l’épisode mérite d’être conté, c’est en raison du "cahier des charges" soumis à l’architecte Roland Morisse. À savoir la demande pressante de s’inspirer du savoir-faire de Sebastiano Serlio, architecte et sculpteur italien de la Renaissance qui travailla beaucoup à Venise puis en France, notamment à la construction du château de Fontainebleau. Au départ, un beau livre d’époque, remarquablement bien conservé, illustré de nombreux dessins, trouvé dans les trésors d’un bouquiniste parisien qui hésitait à s’en séparer. Puis ce style élégant soumis à Roland Morisse, qui en fit un excellent usage. Mieux, André Turcat décida alors de rendre hommage à Sebastiano Serlio en baptisant sa maison "La Serliane". Un néologisme qui intrigue systématiquement tous les visiteurs qui se rendent à Beaurecueil. Chacun y a de son explication, sans succès, imaginant, par exemple, qu’il s’agit d’une plante provençale rare ou disparue… ». Armand Lotti (première traversée aérienne française de l’Atlantique en 1929), tous deux encore en vie en 1983 - date de la création de l’Académie -, et Michel Debré, présent à la cérémonie. "Un ministre visionnaire", dit de lui André Turcat, rappelant qu’il a créé en 1962, avec le général Robert Aubinière, le Centre spatial guyanais de Kourou ». Aux dernières pages de l’ouvrage, Pierre Sparaco évoque la majestueuse propriété du pilote d’essais, à Beaurecueil, enfouie au cœur d’un terrain de 5 hectares, en bordure de la route Paul Cézanne classée par André Malraux : « Si l’épisode mérite d’être conté, c’est en raison du "cahier des charges" soumis à l’architecte Roland Morisse. À savoir la demande pressante de s’inspirer du savoir-faire de Sebastiano Serlio, architecte et sculpteur italien de la Renaissance qui travailla beaucoup à Venise puis en France, notamment à la construction du château de Fontainebleau. Au départ, un beau livre d’époque, remarquablement bien conservé, illustré de nombreux dessins, trouvé dans les trésors d’un bouquiniste parisien qui hésitait à s’en séparer. Puis ce style élégant soumis à Roland Morisse, qui en fit un excellent usage. Mieux, André Turcat décida alors de rendre hommage à Sebastiano Serlio en baptisant sa maison "La Serliane". Un néologisme qui intrigue systématiquement tous les visiteurs qui se rendent à Beaurecueil. Chacun y a de son explication, sans succès, imaginant, par exemple, qu’il s’agit d’une plante provençale rare ou disparue… ».
Pierre Sparaco avait consacré 50 années au secteur aérien
et écrit une vingtaine d’ouvrages © Photo X, droits réservés
- André Turcat - Biographie, par Pierre Sparaco, éditions Privat, 176 pages, 2015 ;
- André Turcat : l’écriture a succédé à l’épopée du Concorde, portrait de Claude Darras, Papiers collés, printemps 2013.
Portrait
Claudio Magris : les belles leçons d’un humaniste
 Sans la connaître physiquement, j’ai appris à aimer cette ville des migrations et des mélanges, si chahutée par l’histoire, par le truchement de quatre de ses écrivains, Boris Pahor, Umberto Saba, Italo Svevo et Claudio Magris. Mais c’est surtout avec la complicité du dernier que je suis entré dans l’intimité de la ville-frontière de Trieste. Cité portuaire mi-autrichienne et mi-italienne qui lorgne à la fois sur l’Occident et sur l’Orient, elle est un foyer polyglotte où se fondent Arméniens, Croates, Serbes et Slovènes. Germaniste de formation, Claudio Magris (Trieste, 10 avril 1939) n’est pas seulement un romancier et un essayiste, il est aussi un critique et un journaliste de renom. Le Corriere della Sera, quotidien italien publié à Milan (depuis 1876), a célébré en 2017 leur demi-siècle de collaboration. Certains de ses ouvrages rassemblent d’ailleurs des florilèges de ses chroniques dont la lecture témoigne de l’érudition et de l’humanisme d’un observateur aussi sensible qu’attentif. Mais plus encore que l’immense culture du littérateur c’est sa propension à vulgariser qui est avec la curiosité une des vertus cardinales du journaliste. Sans la connaître physiquement, j’ai appris à aimer cette ville des migrations et des mélanges, si chahutée par l’histoire, par le truchement de quatre de ses écrivains, Boris Pahor, Umberto Saba, Italo Svevo et Claudio Magris. Mais c’est surtout avec la complicité du dernier que je suis entré dans l’intimité de la ville-frontière de Trieste. Cité portuaire mi-autrichienne et mi-italienne qui lorgne à la fois sur l’Occident et sur l’Orient, elle est un foyer polyglotte où se fondent Arméniens, Croates, Serbes et Slovènes. Germaniste de formation, Claudio Magris (Trieste, 10 avril 1939) n’est pas seulement un romancier et un essayiste, il est aussi un critique et un journaliste de renom. Le Corriere della Sera, quotidien italien publié à Milan (depuis 1876), a célébré en 2017 leur demi-siècle de collaboration. Certains de ses ouvrages rassemblent d’ailleurs des florilèges de ses chroniques dont la lecture témoigne de l’érudition et de l’humanisme d’un observateur aussi sensible qu’attentif. Mais plus encore que l’immense culture du littérateur c’est sa propension à vulgariser qui est avec la curiosité une des vertus cardinales du journaliste.
Alphabets et livres de lecture
« Un jour, en Chine, raconte l’auteur d’« Alphabets », une étudiante de l’université de Xi’an m’a demandé ce qu’on perd en écrivant. Question difficile, kafkaïenne. Et en lisant ? Borges a dit un jour que d’autres pouvaient, s’ils le voulaient, tirer gloire des livres qu’ils avaient écrits, mais que sa gloire à lui, c’étaient les livres qu’il avait lus. » Au travers de lectures profuses et éclectiques, Claudio Magris excelle à relier dans le temps et la pensée des écrivains et des philosophes aussi dissemblables que Walter Benjamin, Jorge Luis Borges, Hermann Broch, Cervantès, Joseph Conrad, Dante, Fiodor Dostoïevski, William Faulkner, Carlo Emilio Gadda, Hegel, Heinrich Heine, Homère, Ibsen, Franz Kafka, Rudyard Kipling, Karl Kraus, Thomas Mann, Eugenio Montale, Robert Musil, Sophocle, George Steiner, Oscar Wilde, plus une foule d’Italiens (Alberto Cavallari, Pier Jacopo Martello, Vinicio Ongaro, Clemente Rebora, entre autres) qu’on a honte de si mal connaître. Il rapporte que, dans un entretien avec Goethe (1749-1832), « Napoléon, fin critique littéraire qui adorait "Werther" et le connaissait presque par cœur, reprocha au poète d’avoir donné trop de place, dans la première version de son roman, au thème politico-social » ! Il se désole ailleurs que les lecteurs européens ignorent à peu près tout de l’œuvre de Theodor Fontane (1819-1898), ce « Flaubert allemand qui est, dans ses romans, un très sagace analyste et un poète laconique et poignant de la passion amoureuse ». Vantant les qualités de l’écrivain  Gregor von Rezzori (1914-1998) dans « L’épigone précurseur », il observe : « Écrivain autrichien, Rezzori est devenu citoyen roumain à quatre ans, en 1918 ; plus tard "heimatlos" et pas seulement, comme il le disait en plaisantant, parce que ainsi il aurait plus de chances de recevoir le prix Nobel, encore jamais décerné jusqu’ici, dans la rotation des États et des nations, à cette nationalité-là ». Lorsqu’il en vient, dans « Homère digital », à rappeler de quelle façon sa ville natale continue d’alimenter l’imaginaire des écrivains, il livre une subtile définition de l’histoire : « L’Histoire apparaît comme un studio de cinéma dans lequel on démonte pour les mettre dans les réserves des décors, des praticables, des scripts et dans lequel rôdent des acteurs sans masque et sans rôle qui se sont perdus eux-mêmes ». Sa voix se casse au souvenir du psychologue et philosophe Paolo Bozzi (1930-2003) : « Il est juste qu’hier matin, alors que j’étais troublé, presque un peu perdu parce que je venais d’apprendre la mort de Paolo Bozzi, survenue quelques heures auparavant pendant la nuit à Bolzano, quelqu’un m’ait présenté ses condoléances, chose qu’habituellement on réserve à la famille. L’amitié n’est pas un lien moins étroit que la parenté, et elle signifie, tout autant et parfois davantage, une vie partagée, un chemin parcouru ensemble, une expérience commune du monde qui ne peut pas être coupée net sans entraîner une réelle mutilation pour celui qui survit. » Gregor von Rezzori (1914-1998) dans « L’épigone précurseur », il observe : « Écrivain autrichien, Rezzori est devenu citoyen roumain à quatre ans, en 1918 ; plus tard "heimatlos" et pas seulement, comme il le disait en plaisantant, parce que ainsi il aurait plus de chances de recevoir le prix Nobel, encore jamais décerné jusqu’ici, dans la rotation des États et des nations, à cette nationalité-là ». Lorsqu’il en vient, dans « Homère digital », à rappeler de quelle façon sa ville natale continue d’alimenter l’imaginaire des écrivains, il livre une subtile définition de l’histoire : « L’Histoire apparaît comme un studio de cinéma dans lequel on démonte pour les mettre dans les réserves des décors, des praticables, des scripts et dans lequel rôdent des acteurs sans masque et sans rôle qui se sont perdus eux-mêmes ». Sa voix se casse au souvenir du psychologue et philosophe Paolo Bozzi (1930-2003) : « Il est juste qu’hier matin, alors que j’étais troublé, presque un peu perdu parce que je venais d’apprendre la mort de Paolo Bozzi, survenue quelques heures auparavant pendant la nuit à Bolzano, quelqu’un m’ait présenté ses condoléances, chose qu’habituellement on réserve à la famille. L’amitié n’est pas un lien moins étroit que la parenté, et elle signifie, tout autant et parfois davantage, une vie partagée, un chemin parcouru ensemble, une expérience commune du monde qui ne peut pas être coupée net sans entraîner une réelle mutilation pour celui qui survit. »
L’amnésie condamnée à Trieste
 L’écriture, pour Claudio Magris, c’est à la fois une lutte contre l’oubli, un cri de protestation et une tentative de rétablir des vérités. Ces trois raisons consonnent dans l’écriture de « Classé sans suite ». Il s’agit en fait de rappeler aux Triestins faussement amnésiques que l’ancienne rizerie de San Sabba, une usine de décorticage du riz édifiée dans un faubourg de Trieste au XIXe siècle, a bel et bien été, entre 1943 et 1945, un camp de la mort nazi où des juifs, antifascistes, détenus politiques et leurs familles - 5 000 personnes, vieillards et enfants - ont été massacrés puis incinérés dans le seul four crématoire qui se trouvait alors en Italie. La révélation du fait en même temps que sa condamnation sont exprimées par le truchement d’une histoire extraordinaire. En 1945, un Triestin un peu fou et passablement excentrique se lance dans l’assemblage de collections d’objets de guerre qu’il entasse dans les dépendances de la rizerie de San Sabba : chars d’assaut, dragueurs de mine, canons, jeeps, fusils, épées, catapultes, sagaies, arcs, flèches, haches, marmites de campagne, uniformes, films et documentaires, livres et carnets, un désordre d’armes et de véhicules méticuleusement inventoriés et décrits avec l’autorité du chartiste qui constitueront les fonds d’un musée de la L’écriture, pour Claudio Magris, c’est à la fois une lutte contre l’oubli, un cri de protestation et une tentative de rétablir des vérités. Ces trois raisons consonnent dans l’écriture de « Classé sans suite ». Il s’agit en fait de rappeler aux Triestins faussement amnésiques que l’ancienne rizerie de San Sabba, une usine de décorticage du riz édifiée dans un faubourg de Trieste au XIXe siècle, a bel et bien été, entre 1943 et 1945, un camp de la mort nazi où des juifs, antifascistes, détenus politiques et leurs familles - 5 000 personnes, vieillards et enfants - ont été massacrés puis incinérés dans le seul four crématoire qui se trouvait alors en Italie. La révélation du fait en même temps que sa condamnation sont exprimées par le truchement d’une histoire extraordinaire. En 1945, un Triestin un peu fou et passablement excentrique se lance dans l’assemblage de collections d’objets de guerre qu’il entasse dans les dépendances de la rizerie de San Sabba : chars d’assaut, dragueurs de mine, canons, jeeps, fusils, épées, catapultes, sagaies, arcs, flèches, haches, marmites de campagne, uniformes, films et documentaires, livres et carnets, un désordre d’armes et de véhicules méticuleusement inventoriés et décrits avec l’autorité du chartiste qui constitueront les fonds d’un musée de la  Guerre. Le but avoué du conservateur est d’exhiber les instruments destructeurs de la guerre afin de mieux convaincre les visiteurs de la nécessité de construire une paix durable. Le collectionneur ne parvient cependant pas à ses fins : un soir, un incendie détruit une grande partie du futur musée et tue son propriétaire dans le sarcophage où il dormait chaque nuit… La narration du récit de « Classé sans suite » s’ordonne suivant la visite des différentes salles qu’effectue Luisa Kasika Brooks, petite-fille de déportés. Fille d’un aviateur noir américain des troupes d’occupation et d’une Triestine juive épargnée par la Shoah, cette jeune conservatrice a été chargée de restaurer ledit musée de la Guerre. Une tâche que l’on pressent délicate et semée d’embuches, quand on sait qu’une partie des documents rassemblés montre les inscriptions et les graffitis laissés sur les murs des cellules et des latrines de la rizerie dont certains désignent les noms des victimes torturées et assassinées, mais aussi ceux des traîtres, des espions et des collaborateurs des geôliers nazis. Cette histoire-là, l’écrivain en a trouvé l’argument dans la vie bien réelle d’un historien et collectionneur triestin, le professeur Diego de Henriquez, qui a trouvé la mort en 1974, à l’âge de 65 ans, dans un incendie de la rizerie où il envisageait de créer un musée de la Guerre. L’enquête n’a pas permis de confondre les auteurs et leurs commanditaires : elle a été classée sans suite… Attablé avec sa femme Marisa au café San Marco de Trieste, quartier général de sa parentèle, Claudio Magris aime répéter que « toute invention, grande ou modeste, se nourrit de faits qui se sont réellement produits et de personnes qui ont réellement existé : l’invention, la fiction, se nourrit inévitablement, peu ou prou, de cette vérité que Mark Twain trouvait plus bizarre, plus fantastique que toute fiction ». Guerre. Le but avoué du conservateur est d’exhiber les instruments destructeurs de la guerre afin de mieux convaincre les visiteurs de la nécessité de construire une paix durable. Le collectionneur ne parvient cependant pas à ses fins : un soir, un incendie détruit une grande partie du futur musée et tue son propriétaire dans le sarcophage où il dormait chaque nuit… La narration du récit de « Classé sans suite » s’ordonne suivant la visite des différentes salles qu’effectue Luisa Kasika Brooks, petite-fille de déportés. Fille d’un aviateur noir américain des troupes d’occupation et d’une Triestine juive épargnée par la Shoah, cette jeune conservatrice a été chargée de restaurer ledit musée de la Guerre. Une tâche que l’on pressent délicate et semée d’embuches, quand on sait qu’une partie des documents rassemblés montre les inscriptions et les graffitis laissés sur les murs des cellules et des latrines de la rizerie dont certains désignent les noms des victimes torturées et assassinées, mais aussi ceux des traîtres, des espions et des collaborateurs des geôliers nazis. Cette histoire-là, l’écrivain en a trouvé l’argument dans la vie bien réelle d’un historien et collectionneur triestin, le professeur Diego de Henriquez, qui a trouvé la mort en 1974, à l’âge de 65 ans, dans un incendie de la rizerie où il envisageait de créer un musée de la Guerre. L’enquête n’a pas permis de confondre les auteurs et leurs commanditaires : elle a été classée sans suite… Attablé avec sa femme Marisa au café San Marco de Trieste, quartier général de sa parentèle, Claudio Magris aime répéter que « toute invention, grande ou modeste, se nourrit de faits qui se sont réellement produits et de personnes qui ont réellement existé : l’invention, la fiction, se nourrit inévitablement, peu ou prou, de cette vérité que Mark Twain trouvait plus bizarre, plus fantastique que toute fiction ».
Claudio Magris © Photo Catherine Hélie, droits réservés
- Alphabets, éditions Gallimard/L’Arpenteur, 558 pages, 2012 ;
- Classé sans suite, éd. Gallimard/L’Arpenteur, 480 pages, 2017 ;
- Danube, éd. Folio/Gallimard, 576 pages, 1990.
Ouvrages de Claudio Magris, traduits de l’italien par Jean et Marie-Noëlle Pastureau.
Varia : les grandes heures de l’horticulture lyonnaise
 « Pendant longtemps, la botanique recouvre de nombreux enjeux stratégiques dans le bassin lyonnais ; elle est la science dans laquelle puisent un grand nombre de corporations, essentielles au bon développement économique du département du Rhône. La médecine et la pharmacie emploient majoritairement les plantes pour leurs propriétés liées à la santé, l’agriculture recherche celles qui correspondent le mieux à l’élevage des animaux et à l’alimentation des humains. La soierie y trouve les matières textiles et tinctoriales pour la fabrication des étoffes, mais aussi de nombreux motifs ornementaux ; l’ébéniste et le forestier, de nouvelles essences d’arbres […]. « Pendant longtemps, la botanique recouvre de nombreux enjeux stratégiques dans le bassin lyonnais ; elle est la science dans laquelle puisent un grand nombre de corporations, essentielles au bon développement économique du département du Rhône. La médecine et la pharmacie emploient majoritairement les plantes pour leurs propriétés liées à la santé, l’agriculture recherche celles qui correspondent le mieux à l’élevage des animaux et à l’alimentation des humains. La soierie y trouve les matières textiles et tinctoriales pour la fabrication des étoffes, mais aussi de nombreux motifs ornementaux ; l’ébéniste et le forestier, de nouvelles essences d’arbres […].
« L’apogée se situe dans la période qui va de la moitié du XIXe siècle à 1914. Les toutes jeunes sociétés d’agriculture et d’horticulture - où l’on retrouve les plus grands noms de la profession - rivalisent par l’abondance de leurs activités. Si les obtentions végétales sont légion, il ne faut pas pour autant oublier l’immense acquis technique lié à ce contexte. Sait-on par exemple que l’hybridation, véritable révolution de la botanique appliquée, devenue une base de la profession, connut ses premiers développements à Lyon avec Alexis Jordan ? Les horticulteurs lyonnais ont certes légué un héritage fameux de variétés de fruits, de fleurs et de légumes, mais les techniques culturales mises au point localement sont indissociables de ce patrimoine végétal. La plus célèbre, initialement développée dans la région lyonnaise, est la "palmette" inventée par Verrier, aujourd’hui encore largement employée pour conduire les poiriers et les pommiers en espaliers […].
« C’est aussi à Lyon qu’émerge véritablement la pomologie, qui s’attache à l’identification et la classification des variétés de fruits. La Société pomologique de France connaîtra une longue vie. Là aussi, les grands noms sont lyonnais : Burlat, Vercier, Chasset, Mas, Moreau, Luizet, Jaboulay, etc. Les légumes ne sont pas en reste, si l’on en juge par le nombre des obtentions et par l’activité des marchands-grainiers de renom qui se sont installés dans la région, tels Rivoire ou Lille. La fondation du Parc de la Tête d’or, avec son jardin Botanique, son Service des cultures et son Jardin fleuriste, vient couronner le tout […].
« La roue de la fortune cesse de tourner au début du XXe siècle : d’une part la Première Guerre mondiale, en plus des pertes humaines, conduit à l’abandon d’une partie des activités horticoles : les cultures sous serres sont abandonnées et les plus belles collections disparaissent, faute de bras et de moyens. D’autre part, certains horticulteurs suivent le marché des plantes ornementales, qui se déplace vers les villégiatures des clients aisés qui s’installent dans le sud de la France et particulièrement sur la Riviera… Le déclin, inexorable, s’annonce. »
Extrait de « Fleurs, fruits et légumes du bassin lyonnais : un patrimoine culturel et biologique à connaître et à protéger », par Stéphane Crozat, Philippe Marchenay et Laurence Bérard (unité éco-anthropologie et ethnobiologie, CNRS-MNHN, Chaumont, Eyzin-Pinet), texte issu de l’ouvrage « Jardins et médiation des savoirs en ethnobotanique », sous la direction de Pierre Lieutaghi et Danielle Musset, Actes du colloque du musée de Salagon des 27 et 28 septembre 2007, C’est-à-dire éditions, 160 pages, 2008.
Carnet : la croisière en folie
« Les missiles de longue portée qui réduiront peut-être un jour la planète en cendres ont quand même l’avantage d’avoir une appellation rassurante : on les a baptisés "missiles de croisière". » (Jacques Sternberg, Ailleurs et sur la terre, 2011).
De Kipling à Cook
Grand voyageur, l’écrivain Rudyard Kipling (1865-1936) est conseillé dans ses périples par un ami personnel de son père, John Mason Cook. Un demi-siècle plus tôt, le 5 juillet 1841, un de ses ascendants, Thomas Cook (1808-1892), un ancien ébéniste devenu pasteur baptiste, organise le déplacement de ses ouailles de Leicester à Loughborough, dans le centre de l’Angleterre, où se tient un meeting antialcoolique : un parcours d’une dizaine de kilomètres aller et retour qui coûte à chacun des cinq cents voyageurs un shilling ! Le pasteur Cook inaugurait ce jour-là le voyage organisé. Dix ans plus tard, en 1851, la Grande Exposition de Hyde Park donne un véritable essor à ses activités selon une échelle tout autre : cent cinquante mille personnes du Yorkshire et des Midlands sont convoyés à Londres par la nouvelle agence de voyages. En 1855, Thomas Cook entreprend son premier tour d’Europe via Bruxelles, Cologne, Strasbourg et Paris. Et en 1872, c’est le premier tour du monde de l’agence Cook… en 222 jours !
(Mardi 20 février 2018)
De l’industrialisation et l’informatisation
Le philosophe Pierre Musso (né en 1950) considère que l’informatisation aura autant d’impact sur la société et l’économie du XXIe siècle que l’industrialisation en a eu au XIXe siècle.
Une journée de 2 016 heures !
Troisième plus grosse planète du système solaire avec un diamètre de 51 800 kilomètres, l’inclinaison d’Uranus implique qu’à ses pôles, une journée dure 84 jours. Vous imaginez, une journée de 2 016 heures…
Napoléon en boy-scout
Évoquant les erreurs qui surviennent dans le domaine philatélique, Jacques Carelman (1929-2012), peintre et régent du Collège de Pataphysique énumère dans son « Catalogue de timbres-poste introuvables » (1972) : les écailles au lieu de poils sur la queue des castors (un timbre du Canada de 1851), les oreilles à l’envers du paysan autrichien ou l’avion belge immatriculé en Italie. « L’artiste qui a gravé ce timbre australien, écrit-il, manquant peut-être de documentation (c’est loin, l’Australie !), a affublé l’Empereur d’un couvre chef qui serait plus adapté à Baden-Powell présidant un jamboree scout qu’au glorieux vainqueur d’Austerlitz. »
(Lundi 26 février 2018)
|
Billet d’humeur
Nobel : guerre et paix
Né à Stockholm en 1833 et mort à San Remo en 1896, Alfred Nobel est l’inventeur, en 1866, de la poudre-dynamite, « l’huile explosive » ainsi qu’il la nommait. Constitué de nitroglycérine et d’une variété d’argile dite « kieselguhr » (un silicate d’alumine), le mélange explosif s’est révélé bien plus maniable et moins dangereux que la nitroglycérine liquide. Au terme de ses expérimentations, le chimiste suédois, sans grandes ressources personnelles, a reçu le soutien inopiné de Napoléon III qui l’a recommandé aux banquiers bordelais d’origine juive Émile et Isaac Pereire. Les deux frères lui ont consenti une avance de 100 000 francs. Nobel s’est alors partagé entre Stockholm et Paris. Mais il a fini par adopter la France où le célibataire et coureur de jupons s’est définitivement installé en 1873 aménageant un laboratoire dans un hôtel particulier de la capitale au n° 53 de l’avenue Malakoff. Devenu richissime par sa découverte, l’ardent pacifiste voulait croire au pouvoir dissuasif des monstrueux engins qu’il avait enfantés. Dépositaire de trois cent cinquante brevets pour cent cinquante inventions, il a légué par testament une fortune estimée à 33 millions de couronnes suédoises (un capital de quarante millions de francs or) pour la fondation de cinq prix annuels (physique, chimie, médecine et physiologie, littérature et paix) auxquels a été donné son nom. Les mauvaises langues prétendent qu’il aurait écarté les mathématiques afin d’éviter que le prix ne revienne à Gösta Mittag-Leffler (1846-1927), un mathématicien qui lui avait volé le cœur d’une de ses maîtresses, Sophie Hess, fleuriste à Vienne. Les forts en maths se consolent avec la médaille Fields, créée en 1936 à Toronto à l’initiative du professeur John Charles Fields : elle récompense tous les quatre ans de jeunes chercheurs mais elle est beaucoup moins dotée que le Nobel, 15 000 € par lauréat contre 960 000 € pour chaque Nobel.
|
Lecture critique
La valorisation des déchets selon Marie-Ange Le Rochais
 Selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), la production de déchets en France représentait 345 millions de tonnes en 2012, dont 247 millions de tonnes pour le secteur de la construction, 64 millions pour les activités économiques en dehors de la construction, 30 millions pour les ménages (chaque Français a produit 458 kg de déchets ménagers cette année-là) et 4 millions de tonnes pour les collectivités. Précisons toutefois que les déchets agricoles qui sont réutilisés dans l’exploitation font l’objet d’une comptabilisation séparée. En 2014, les tonnages reçus dans les centres de tri de déchets ménagers et assimilés s’élevaient à 10,4 millions de tonnes, dont 6,2 millions de tonnes étaient envoyées en recyclage, c’est-à-dire que 35 % du tonnage étaient refusés dans les centres de tri. Selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), la production de déchets en France représentait 345 millions de tonnes en 2012, dont 247 millions de tonnes pour le secteur de la construction, 64 millions pour les activités économiques en dehors de la construction, 30 millions pour les ménages (chaque Français a produit 458 kg de déchets ménagers cette année-là) et 4 millions de tonnes pour les collectivités. Précisons toutefois que les déchets agricoles qui sont réutilisés dans l’exploitation font l’objet d’une comptabilisation séparée. En 2014, les tonnages reçus dans les centres de tri de déchets ménagers et assimilés s’élevaient à 10,4 millions de tonnes, dont 6,2 millions de tonnes étaient envoyées en recyclage, c’est-à-dire que 35 % du tonnage étaient refusés dans les centres de tri.
La grande crise de l’anthropocène
Dans son livre « Déchets, une mine d’or » qui se prévaut de raconter l’histoire des déchets du Moyen-Âge à nos jours, Marie-Ange Le Rochais (Paris, 1956) rappelle que ce sont les biffins, les chiffonniers, qui récupéraient autrefois tout ce qui était réutilisable. « Il fallut attendre 1883 et Eugène Poubelle pour qu’un tri sérieux soit envisagé, explique-t-elle. Le préfet de la Seine ordonna la distribution des contenants en fer ou en bois doublés de tôle : un pour le papier et les chiffons, un autre pour le verre, un autre pour les coquilles d’huîtres, un autre pour le fer. Cela déclencha un tollé des concierges qui refusaient ce surcroît de travail. En 1884, la réglementation du "Tout à l’égout" stipula que chaque immeuble soit relié au réseau d’égouts. »
Illustré des dessins de l’auteure, l’ouvrage publié par les éditions Des ronds dans l’O se matérialise par quinze chapitres courts aux séquences brèves et incisives qui brossent l’état des lieux d’une planète encombrée par des montagnes de déchets. Cette façon de bâtir chaque chapitre en empilant des messages essentiels, des anecdotes percutantes et des statistiques démonstratives séduit le lecteur qui retient durablement les leçons. L’un de ces enseignements prône qu’il est de la responsabilité collective, autrement dit de la responsabilité de chacun d’entre nous, de sortir de la crise qui affecte les débuts de l’anthropocène, la période géologique actuelle où les activités humaines ont de puissantes répercussions sur les écosystèmes (biosphère) et les transforment - quand elles ne les mutilent pas - à différents niveaux.
Florilège
« L’écologie n’est pas un courant politique ; elle est une exigence éthique, un impératif moral qui presse l’humanité à assumer ses propres responsabilités. » Cardinal Roger Etchegaray (Espelette, 1922).
« 3 000 ans avant J.-C., au Pakistan, une ville, Mohenjo-Daro (dans la vallée de l’Indus, elle est classée au Patrimoine mondial de l’humanité) possédait déjà un système sanitaire et des salles de bains, deux millénaires avant les Romains. […]
« Le 18 mars 2015, Paris était désignée ville la plus polluée au monde devant Shanghai. En l’absence de mesures ambitieuses, l’Union européenne menace la ville-lumière d’un renvoi en justice. "La pollution de l’air est une aberration sanitaire et économique. Elle coûte 101,3 milliards d’euros par an à la France, soit dix fois le trou de la Sécurité sociale." (2015, Commission d’enquête sénatoriale) […]
« L’océan est riche de matériaux rares, de métaux précieux, de pétrole. Comme la forêt, il absorbe un tiers de CO2 et détient une biodiversité inégalable. Des scientifiques ont découvert des bactéries qui réparent leur propre ADN. L’imitation de l’épiderme du requin a permis l’élaboration d’une combinaison de natation "high-tech". Tout comme l’amélioration du glissement dans l’air des avions ! En étudiant l’adhérence des moules à leur rocher, des ingénieurs ont composé un adhésif résistant à l’eau… […]
« Le sable est devenu plus recherché que le pétrole. Il est dragué en mer, ou bien ratissé sur les plages par millions de tonnes pour fabriquer le béton des grandes mégapoles. Son extraction à outrance emporte tout organisme vivant et menace les côtes, engloutissant les maisons proches. […]
« En 1839, le physicien Antoine Becquerel découvre l’effet photovoltaïque qui permet de convertir le rayonnement du soleil en électricité. Aux États-Unis, des panneaux solaires couvrant moins d’un quart des toits suffiraient à la production d’énergie du pays. En cas de nuages, l’énergie est stockée dans des batteries à électrodes en plomb et électrolyses. […]
« Avec 670 canettes, on peut construire un vélo ! […]
« Nous savons que les plantes peuvent capturer le carbone et surtout le confiner dans le sol, que par le monde environ 140 sortes d’algues sont mangées - elles entrent dans la compositions de nombreux cosmétiques et médicaments. Elles servent autant à cicatriser qu’à donner de la consistance aux confiseries et aux yaourts, et aussi à entourer les sushis. […]
« La tourbe assimile les toxiques phosphore, nitrate, cyanure et hydrocarbures. […]
« En hiver, une maison très bien isolée et exposée plein sud peut atteindre 22 degrés sans chauffage ! Déjà, nos ancêtres l’avaient compris en inventant la climatisation naturelle avec les moucharabiehs (panneau de bois ou de métal ouvragé et sculpté occultant les ouvertures en filtrant le soleil et l’air chaud). Des architectes écologues, ingénieurs thermiciens ont trouvé le moyen de ventiler et de chauffer par un système de double flux d’air s’inspirant des termitières.
« Ne doutez jamais qu’un petit groupe de gens réfléchis et engagés puisse changer le monde. En fait, c’est toujours comme cela que ça s’est passé. » Margaret Mead (1901-1978), anthropologue.
- Déchets, une mine d’or, par Marie-Ange Le Rochais, éditions Des ronds dans l’O, 72 pages, 2017.
Portrait
Eduardo Arroyo : « Je suis un romancier raté »
 Lorsqu’il s’installe à Paris en 1958 pour fuir l’Espagne franquiste (son père, pharmacien, était phalangiste), Eduardo Arroyo (né à Madrid le 26 février 1937 sous les bombes) gagne sa vie en faisant des caricatures. La vie des cafés de Montparnasse, le monde de la nuit parisienne à l’atmosphère de film noir, la complicité de boxeurs et de peintres composent l’ordinaire d’un exil dominé par l’exercice de la peinture, une activité commencée en autodidacte à 12 ans (sa première exposition personnelle a lieu en 1961). « À Paris, nous formions un groupe d’artistes venus d’horizons différents, très politisés pour la plupart, raconte-t-il en mai 2010 à Pauline Simons, du "Figaro Magazine", et nous n’avions qu’une idée en tête : combattre l’abstraction. Avec une certaine violence d’ailleurs. C’est de là qu’est née la figuration narrative. » Il devient en 1965 l’un des protagonistes du mouvement qui alliant la représentation du quotidien aux revendications sociales et politiques rassemble des artistes tels que Adami, Aillaud, Erró, Monory et Rancillac. « Je ne crois pas qu’il y ait de message dans mes toiles, explique-t-il en 1980 à Liliane Thorn-Petit, journaliste luxembourgeoise. J’ai peint une obsession de l’exil, donc du souvenir de mon pays, l’impossibilité de l’action, l’angoisse de la distance, la traduction des cultures… On a souvent dit, à tort, que ma peinture était politique. J’étais seulement imprégné d’obsessions : je n’aurais pas pu peindre autre chose. » Lorsqu’il s’installe à Paris en 1958 pour fuir l’Espagne franquiste (son père, pharmacien, était phalangiste), Eduardo Arroyo (né à Madrid le 26 février 1937 sous les bombes) gagne sa vie en faisant des caricatures. La vie des cafés de Montparnasse, le monde de la nuit parisienne à l’atmosphère de film noir, la complicité de boxeurs et de peintres composent l’ordinaire d’un exil dominé par l’exercice de la peinture, une activité commencée en autodidacte à 12 ans (sa première exposition personnelle a lieu en 1961). « À Paris, nous formions un groupe d’artistes venus d’horizons différents, très politisés pour la plupart, raconte-t-il en mai 2010 à Pauline Simons, du "Figaro Magazine", et nous n’avions qu’une idée en tête : combattre l’abstraction. Avec une certaine violence d’ailleurs. C’est de là qu’est née la figuration narrative. » Il devient en 1965 l’un des protagonistes du mouvement qui alliant la représentation du quotidien aux revendications sociales et politiques rassemble des artistes tels que Adami, Aillaud, Erró, Monory et Rancillac. « Je ne crois pas qu’il y ait de message dans mes toiles, explique-t-il en 1980 à Liliane Thorn-Petit, journaliste luxembourgeoise. J’ai peint une obsession de l’exil, donc du souvenir de mon pays, l’impossibilité de l’action, l’angoisse de la distance, la traduction des cultures… On a souvent dit, à tort, que ma peinture était politique. J’étais seulement imprégné d’obsessions : je n’aurais pas pu peindre autre chose. »
Sus au franquisme et à l’art informel !
Son opposition à l’art informel est presque aussi rageuse que ses prises de position contre le franquisme. En cette même année 1965, avec Gilles Aillaud (1928-2005) et Antonio Recalcati (né en 1938), il expose un polyptyque en huit tableaux, "Vivre et laisser mourir ou la fin tragique de Marcel Duchamp". Les trois plasticiens s’y figurent eux-mêmes passant à tabac l’inventeur du ready-made, avant de précipiter son cadavre en bas d’un escalier (évidente allusion au "Nu descendant l’escalier" qui concourut à la célébrité de Duchamp) ! Le trio implique dans l’assassinat pictural Andy Warhol ainsi que Martial Raysse et Pierre Restany. Salvador Dali n’est pas épargné : il le peint en nabot. Ce « Portrait du nain Sebastian de Morra, bouffon de cour né à Figueras dans la première moitié du XXe siècle » (1970) 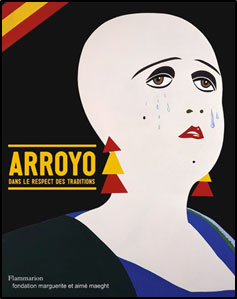 dénonce la docilité du maître de Cadaqués et son intelligence avec le franquisme. Joan Miró est soumis à un régime voisin. « Les Malheurs de la coexistence. La Dernière Rage » détourne une des œuvres majeures du Catalan, La Nature morte au vieux soulier, où la satire mobilise un Khrouchtchev martelant sauvagement de sa chaussure un pupitre des Nations unies à New York, le 15 octobre 1960. Irrévérence suprême : la reine d’Angleterre écope d’un portrait équestre détonnant, « Le Meilleur Cheval du monde » (1965/1975/1976), dont on ne sait lequel des deux individus est désigné… Rembrandt est revisité avec une œuvre monumentale (3,75 m par 7,17 m, huile sur toile, 1975-1976), la « Ronde de nuit aux gourdins », où le peintre explique que le chef-d’œuvre si admiré au Rijksmuseum représente une milice bourgeoise d’autodéfense traquant les voyous dans les ruelles sombres d’Amsterdam... Il est vrai que d’autres personnages bénéficient de ses faveurs et de ses pinceaux : le toréro Manuel Fuentes « Bocanegra » (1837-1889), le peintre suisse Ferdinand Hodler (1853-1918), l’écrivain Angel Ganivet (1862-1898) et Sir Winston Churchill (1874-1965), ancien premier ministre du Royaume-Uni et peintre à ses heures. dénonce la docilité du maître de Cadaqués et son intelligence avec le franquisme. Joan Miró est soumis à un régime voisin. « Les Malheurs de la coexistence. La Dernière Rage » détourne une des œuvres majeures du Catalan, La Nature morte au vieux soulier, où la satire mobilise un Khrouchtchev martelant sauvagement de sa chaussure un pupitre des Nations unies à New York, le 15 octobre 1960. Irrévérence suprême : la reine d’Angleterre écope d’un portrait équestre détonnant, « Le Meilleur Cheval du monde » (1965/1975/1976), dont on ne sait lequel des deux individus est désigné… Rembrandt est revisité avec une œuvre monumentale (3,75 m par 7,17 m, huile sur toile, 1975-1976), la « Ronde de nuit aux gourdins », où le peintre explique que le chef-d’œuvre si admiré au Rijksmuseum représente une milice bourgeoise d’autodéfense traquant les voyous dans les ruelles sombres d’Amsterdam... Il est vrai que d’autres personnages bénéficient de ses faveurs et de ses pinceaux : le toréro Manuel Fuentes « Bocanegra » (1837-1889), le peintre suisse Ferdinand Hodler (1853-1918), l’écrivain Angel Ganivet (1862-1898) et Sir Winston Churchill (1874-1965), ancien premier ministre du Royaume-Uni et peintre à ses heures.
Érudition inouïe, élégance critique et ironie féroce
En 1965, il traduit un paysage bucolique, une maison au bord d’une rivière, de quatre façons différentes, chacune des versions procédant d’une période et d’un mouvement particuliers de l’histoire de la peinture. Le polyptyque s’intitule « Dans le respect des traditions » (huile sur toile, 184 x 192 cm), appellation donnée à la rétrospective du peintre madrilène organisée, d’août à novembre 2017, par la fondation Marguerite et Aimé Maeght à Saint-Paul-de-Vence. Comme tout acte de son auteur, cette œuvre-là porte une érudition inouïe lestée d’une élégance critique et d’une ironie féroce. « Elle dit aussi l’ironie que provoquent certaines œuvres d’art qui, aujourd’hui, oublient leur essence même pour n’offrir que l’industrie ou l’artisanat d’"elles-mêmes", souligne Olivier Kaeppelin (Rio-de-Janeiro, 1949), critique d’art et précédemment directeur de la fondation Maeght. Le contrepied vise aussi "le marketing du nouveau" qui s’époumone dans la proposition permanente de produits promotionnels et communicants, où l’"art" n’est plus qu’une accroche de tête de gondole pour l’investissement ou le négoce. De quel "respect des traditions" s’agit-il ? Non pas de celles qui fondent l’Académie, mais peut-être de celles qui définissent l’art comme pensée, depuis la nuit des temps. »
Deux peintres et un metteur en scène qu’il n’a pas portraiturés ont beaucoup compté pour lui, Francis Picabia (1879-1953) dont il a gardé le goût des tableaux conçus comme des rébus, Paul Rebeyrolle (1926-2005) qui l’a fait entrer à la galerie Maeght et l’a aidé à exposer, et l’Allemand Klaus Michael Grüber (1941-2008), pour lequel il a conçu et réalisé les décors et les costumes de ses spectacles (De la maison des morts, 2005). « Dans mon travail, assure-t-il, les décors de théâtre occupent la même place que la lithographie, la gravure, la sculpture ou la rédaction d’un livre ». Eduardo Arroyo dispose d’ailleurs d’un authentique talent d’écriture. N’est-il pas l’auteur de trois récits, « Panama Al Brown » (1982), « Sardines à l’huile » (1989) et « Deux Balles de tennis » (2017), et de ses propres mémoires, « Minuta por un testamento » (2010) ? « Je suis un romancier raté, répète-t-il à loisir. J’ai voulu commencer une formation littéraire (NDR : études de journalisme à Madrid en 1956 et 1957), et il y a eu substitution de moyens. Ce qui m’intéressait était d’écrire à l’intérieur de cette formidable surface de réflexion qu’est un tableau. J’ai donc eu une attitude d’écrivain. Par contre, je continue d’utiliser des signes, des petits tics symboliques accompagnant mon travail qui, en général, sont un rappel de l’Espagne. »
Eduardo Arroyo dans son atelier © Photo X, droits réservés
- Eduardo Arroyo : dans le respect des traditions, sous la direction d’Olivier Kaeppelin, avec des contributions d’Eduardo Arroyo, Fabienne Di Rocco, Adrien Maeght et Daniel Rondeau, éditions Flammarion, 224 pages, 2017 ;
- Portraits d’artistes, par Liliane Thorn-Petit, RTL édition, 156 pages, 1982.
Lectures complémentaires :
- Nouveau Dictionnaire des artistes contemporains, par Pascale Le Thorel, éditions Larousse, 360 pages, 2010 ;
- Dictionnaire de l’art moderne et contemporain, sous la direction de Gérard Durozoi, notice d’Anton Castro, éditions Hazan, 680 pages, 1993.
Varia : les Samis protègent nature et paysage en Laponie
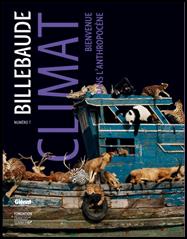 « Les Samis vivent dans le Sápmi, région du nord de l’Europe plus connue sous le nom de Laponie, qui s’étend sur quatre pays : Norvège, Suède, Finlande et Russie. Ils partagent une langue, le sámegiella, une culture et un animal, le renne (Rangifer tarandus tarandus L.), chassé, apprivoisé puis élevé depuis le XVIIe siècle. D’abord chasseurs de rennes sauvages et d’animaux à fourrure, pêcheurs en rivière, pêcheurs le long de la côte de Norvège et même fermiers, c’est aujourd’hui la culture des éleveurs qui a pu se perpétuer le mieux, les autres modes de vie des Samis s’étant trouvés beaucoup plus directement en prise avec la colonisation. La modernisation de la flotte norvégienne, par exemple, a conduit à l’industrialisation de la pêche et à l’assimilation des pêcheurs samis au sein de la population scandinave, même si un mouvement de revitalisation et de politisation est à l’œuvre chez les jeunes Samis côtiers. Beaucoup ont émigré en ville, en particulier dans les capitales Oslo, Stockholm et Helsinki, où ils tiennent une place importante dans les métiers culturels : enseignants, chercheurs, cinéastes, chanteurs et écrivains. […]
« Les Samis vivent dans le Sápmi, région du nord de l’Europe plus connue sous le nom de Laponie, qui s’étend sur quatre pays : Norvège, Suède, Finlande et Russie. Ils partagent une langue, le sámegiella, une culture et un animal, le renne (Rangifer tarandus tarandus L.), chassé, apprivoisé puis élevé depuis le XVIIe siècle. D’abord chasseurs de rennes sauvages et d’animaux à fourrure, pêcheurs en rivière, pêcheurs le long de la côte de Norvège et même fermiers, c’est aujourd’hui la culture des éleveurs qui a pu se perpétuer le mieux, les autres modes de vie des Samis s’étant trouvés beaucoup plus directement en prise avec la colonisation. La modernisation de la flotte norvégienne, par exemple, a conduit à l’industrialisation de la pêche et à l’assimilation des pêcheurs samis au sein de la population scandinave, même si un mouvement de revitalisation et de politisation est à l’œuvre chez les jeunes Samis côtiers. Beaucoup ont émigré en ville, en particulier dans les capitales Oslo, Stockholm et Helsinki, où ils tiennent une place importante dans les métiers culturels : enseignants, chercheurs, cinéastes, chanteurs et écrivains. […]
« Alors qu’en été les rennes se nourrissent sur de riches alpages, et qu’à l’automne ils se régalent de champignons, pendant la plus grande partie de l’année, en hiver et au printemps, ils survivent en mangeant des lichens du genre Cladonia, qui forment des tapis plus ou moins continus au pied des pins sylvestres. Il leur faut creuser la neige pour les atteindre. Les Samis ont développé une véritable science de la neige et de son métamorphisme, nécessaire à la survie de leur troupeau. […]
« Plutôt que chercher à imprimer leur marque, les Samis cherchent plutôt à l’effacer. Il est parfois difficile de retrouver les traces d’un campement quelques dizaines d’années après. Discutant du bien-fondé de la nomination de leur territoire en tant que site du patrimoine mondial de l’Unesco sous le nom de Laponie, une femme samie nous avait demandé avec humour ce que signifiait cette volonté de protection. Les Occidentaux voulaient-ils protéger la nature d’eux-mêmes ? Par exemple de la pollution et de la destruction que leurs barrages et leurs mines avaient perpétrées depuis le début du XXe siècle. Car, nous faisait-elle remarquer, les Samis, quant à eux, avaient su conserver leur paysage pendant des millénaires sans l’altérer. »
Extraits de « Les Samis, sentinelles du réchauffement climatique », par Marie Roué (ethnologue et directrice de recherche au CNRS/Muséum national d’histoire naturelle) et Samuel Roturier (maître de conférences à AgroParisTech), article issu de la revue « Billebaude », n° 7, éditions Glénat/Fondation François Sommer, 96 pages, automne-hiver 2015.
Carnet : le pâtre des berges et le faune
André Gide (1869-1951) et Francis Jammes (1868-1938) s’estimaient beaucoup. Dès le début de leurs échanges épistolaires, les deux amis s’attribuèrent des surnoms ; l’auteur de Paludes est devenu « le pâtre des berges » tandis que le poète béarnais fut appelé « le faune ».
Les secrets des chats
Les enfants savent garder un secret, prétend la romancière Fabienne Juhel (Saint-Brieuc, 1965), « ils sont les plus grands gardiens de secrets du monde. Comme les chats. »
(Jeudi 8 mars 2018)
De l’esprit critique
Ce critique est lu pour sa méchanceté, mais on l’évite dans les dîners en ville de peur de faire les frais de son agressivité. Il ne peut s’empêcher de faire de l’esprit et il aime trop se moquer des gens Et l’on ne guérit pas facilement de l’irrespect lorsqu’on a pris goût à le cultiver.
(Mercredi 14 mars 2018)
|
Billet d’humeur
L’invention de la stéréophonie
Il est loin le temps où le poste de radio en bois précieux trônait, avant la guerre, dans le salon familial. Au début des années 1960, les postes portatifs à lampe ont cédé le pas aux radios miniaturisés. Développée aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, la modulation de fréquence est testée pour la première fois à Paris en 1954 : les amateurs se montrent de plus en plus sensibles à la qualité sonore. Peu après, la stéréophonie, dont les premiers essais de diffusion remontent à 1951, se développe lentement. Méthode de reproduction sonore apte à reconstituer la répartition spatiale des sources d’origine, la stéréo dispense un relief acoustique d’une grande fidélité au moyen de deux canaux (gauche et droit) diffusés par des haut-parleurs ou des écouteurs. « J’ai eu la chance d’assister aux débuts de la stéréo à la radio, se souvient l’ingénieur du son Yann Paranthoën (1935-2005). On avait fait venir dans le studio expérimental Georges Brassens et Achille Zavatta pour tester l’invention. Brassens a chanté, puis il a écouté l’enregistrement et a déclaré : "Pour moi, la stéréo ne change rien". Et il avait raison, la stéréo ne peut rien apporter au chant de Brassens et à sa guitare sèche. Et puis Zavatta est arrivé. Il a empilé des boîtes avec des enfants autour de lui, et il les a fait tomber. Et ça, en stéréo, c’était magnifique ! »
|
Lecture critique
La « saga » provençale de Pierre Sogno
Paul Morand reprochait aux romans d’être envahis trop souvent par la cellulite. Il préférait « le corps maigre et sec du récit court », où l’on se contente de camper les personnages et de filer l’intrigue.
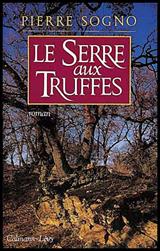 Pierre Sogno (Pierrelatte, 1932-2014) semble avoir retenu la leçon. Poète économe, il ne touche pas, n’émeut pas, et pourtant son roman étonne, captive, par cette méditation scrupuleuse sur une corporation qu’il connaît fort bien (les trufficulteurs ou producteurs de truffes), la célébration pudique du « pays », entre Drôme et Vaucluse, et la quête de l’esprit d’enfance que camoufle un récit bien actuel, presque en forme de reportage, une « saga » provençale qui plonge racines et suspense dans les bois du Serre-aux-truffes, quelque part entre Richerenches et Ventoux. Pierre Sogno (Pierrelatte, 1932-2014) semble avoir retenu la leçon. Poète économe, il ne touche pas, n’émeut pas, et pourtant son roman étonne, captive, par cette méditation scrupuleuse sur une corporation qu’il connaît fort bien (les trufficulteurs ou producteurs de truffes), la célébration pudique du « pays », entre Drôme et Vaucluse, et la quête de l’esprit d’enfance que camoufle un récit bien actuel, presque en forme de reportage, une « saga » provençale qui plonge racines et suspense dans les bois du Serre-aux-truffes, quelque part entre Richerenches et Ventoux.
L’auteur a le goût des mots. Il les hume, les flatte, les lèche avec la gourmandise du prosateur vétilleux. Son histoire, forte comme l’arôme alliacé de la truffe d’hiver, griffe le visage ainsi que le sel de l’océan lors des tempêtes marines.
C’est tout un art que P. Sogno aspire, comme ses personnages, à ne pas perdre, un don que relevait Søren Kierkegaard : être « sérieux comme un enfant qui joue ».
- Le Serre-aux-truffes, par Pierre Sogno, éditions Calmann-Lévy, 240 pages, 1994.
Portrait
Jean Rouch, pionnier du cinéma ethnographique
Ingénieur de l’École des ponts et chaussées en 1937, Jean Rouch (Paris, 31 mai 1917-Birnin N’Konni, Niger, 18 février 2004) est le fils d’un officier de marine qui prit part à la mission Jean-Martin Charcot en Antarctique et dirigea le muséum océanographique de Monaco. À partir de 1941 (il a vingt-quatre ans), Jean Rouch effectue des recherches ethnographiques au Niger et au Sénégal, couronnées en 1951 par une thèse (La religion et la magie songhaï) qu’il soutient avec succès au Musée de l’homme sous la direction de Marcel Griaule (1898-1956). En 1946, il descend pour la première fois le fleuve Niger en pirogue, de la source au golfe de Guinée, et, l’année suivante, il conçoit les premiers reportages documentaires. Ouvert en 1938 à l’initiative du médecin et ethnologue Paul Rivet (1876-1958) dans l’aile Passy du Trocadéro, construite l’année précédente sur la colline de Chaillot pour les besoins de l’Exposition universelle, le Musée de l’homme est l’héritier de l’ancien Musée d’ethnographie, installé en 1880 dans les galeries du premier palais du Trocadéro (1878).
Plus de 140 films produits
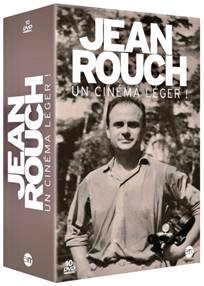 Sans conteste, l’ethnographe cinéaste a renouvelé la technique du film documentaire et donné une salutaire impulsion au cinéma ethnographique. La fondation Jean-Rouch à Paris estime à plus de 140 ses productions filmiques qu’elle n’a pas totalement restaurées. Ce sont des films de durées variables (longs, moyens et courts), des documentaires, des reportages, des fictions, différents fragments et bandes inachevées, une filmographie quelque peu désordonnée qui ressemble beaucoup à son auteur, lequel tournait la plupart du temps en Afrique plusieurs films en même temps, en interrompait certains pour les reprendre parfois plusieurs années après. Certes, il y a les films réalisés à partir de ses enquêtes ethnographiques sur les rituels de possession songhaï ou sonrhaï (peuple du Mali et du Niger), la chasse au lion ou à l’hippopotame, des moyens ou longs métrages (au nombre de soixante-dix) qui comptent parmi les plus caractéristiques de l’œuvre rouchienne : « Les Magiciens de Wanzerbé » (1949), « Cimetières dans la falaise » (1951), « Yenendi, les hommes qui font la pluie » et « Les Gens du mil » (1951), « Bataille sur le grand fleuve » (1952), « Les Maîtres fous » (1955) sur les rites vaudous, « Moi un noir » (1959), prix Louis-Delluc, « La Chasse au lion à l’arc » (1965), lion d’or de la Mostra de Venise, « Petit à petit » (1968) et « Cocorico ! Monsieur Poulet » (1974). D’autres films frôlent l’extravagance et cultivent une certaine légèreté, ceux qu’il réalise avec ses trois complices africains, Damouré Zika, Lam Ibrahim Dia et Tallou Mouzourane : « VW Voyou » (1973), une publicité abracadabrante pour la Coccinelle de la firme de Wolfsburg, « Cousin, Cousine, Pirogue Gondole » (1985-1987) qui fait état de la recherche d’un fétiche dans les canaux vénitiens et « Moi fatigué debout, moi couché » (1996-1997), un conte ésotérique raconté sous un acacia albida abattu par la foudre. Sans conteste, l’ethnographe cinéaste a renouvelé la technique du film documentaire et donné une salutaire impulsion au cinéma ethnographique. La fondation Jean-Rouch à Paris estime à plus de 140 ses productions filmiques qu’elle n’a pas totalement restaurées. Ce sont des films de durées variables (longs, moyens et courts), des documentaires, des reportages, des fictions, différents fragments et bandes inachevées, une filmographie quelque peu désordonnée qui ressemble beaucoup à son auteur, lequel tournait la plupart du temps en Afrique plusieurs films en même temps, en interrompait certains pour les reprendre parfois plusieurs années après. Certes, il y a les films réalisés à partir de ses enquêtes ethnographiques sur les rituels de possession songhaï ou sonrhaï (peuple du Mali et du Niger), la chasse au lion ou à l’hippopotame, des moyens ou longs métrages (au nombre de soixante-dix) qui comptent parmi les plus caractéristiques de l’œuvre rouchienne : « Les Magiciens de Wanzerbé » (1949), « Cimetières dans la falaise » (1951), « Yenendi, les hommes qui font la pluie » et « Les Gens du mil » (1951), « Bataille sur le grand fleuve » (1952), « Les Maîtres fous » (1955) sur les rites vaudous, « Moi un noir » (1959), prix Louis-Delluc, « La Chasse au lion à l’arc » (1965), lion d’or de la Mostra de Venise, « Petit à petit » (1968) et « Cocorico ! Monsieur Poulet » (1974). D’autres films frôlent l’extravagance et cultivent une certaine légèreté, ceux qu’il réalise avec ses trois complices africains, Damouré Zika, Lam Ibrahim Dia et Tallou Mouzourane : « VW Voyou » (1973), une publicité abracadabrante pour la Coccinelle de la firme de Wolfsburg, « Cousin, Cousine, Pirogue Gondole » (1985-1987) qui fait état de la recherche d’un fétiche dans les canaux vénitiens et « Moi fatigué debout, moi couché » (1996-1997), un conte ésotérique raconté sous un acacia albida abattu par la foudre.
Un des pionniers du septième art
Si l’improvisation apparente, la liberté de la mise en scène et la modestie des moyens techniques ont été invoquées pour qualifier, pas toujours en bonne part d’ailleurs, le style Jean Rouch, certains ont déclaré, un peu hâtivement sans doute, qu’il avait influencé la Nouvelle Vague. La réalité est plus subtile. Et le fastueux coffret à la petite trentaine de métrages édité par les éditions Montparnasse  (c’est le sixième coffret consacré à J. Rouch) rend justice à la vérité du personnage et à l’authenticité de son œuvre. Une œuvre protéiforme où l’on retiendra « Babatu, les 3 conseils » (1973-1976) qui est une sorte de reconstitution historique ayant pour cadre les guerres esclavagistes de Babatu, conquérant songhaï du XIXe siècle, « Hommage à Marcel Mauss » (1977) où Germaine Dieterlen parle de la mythologie des Dogon à des auditeurs massés à l’abri d’une des falaises de Bandiagara, « Amadou Hampâté Bâ » (1984) qui rassemble des amis de l’écrivain et ethnologue malien à son domicile d’Abidjan dont Théodore Monod évoquant l’Institut français d’Afrique noire (IFAN) qu’il fonda à Dakar en 1936, et « Ciné-Portrait de Raymond Depardon par Jean Rouch et réciproquement » (1983) qui met en scène la rencontre au jardin des Tuileries des cinéastes Jean Rouch, Raymond Depardon et Philippe Costantini. (c’est le sixième coffret consacré à J. Rouch) rend justice à la vérité du personnage et à l’authenticité de son œuvre. Une œuvre protéiforme où l’on retiendra « Babatu, les 3 conseils » (1973-1976) qui est une sorte de reconstitution historique ayant pour cadre les guerres esclavagistes de Babatu, conquérant songhaï du XIXe siècle, « Hommage à Marcel Mauss » (1977) où Germaine Dieterlen parle de la mythologie des Dogon à des auditeurs massés à l’abri d’une des falaises de Bandiagara, « Amadou Hampâté Bâ » (1984) qui rassemble des amis de l’écrivain et ethnologue malien à son domicile d’Abidjan dont Théodore Monod évoquant l’Institut français d’Afrique noire (IFAN) qu’il fonda à Dakar en 1936, et « Ciné-Portrait de Raymond Depardon par Jean Rouch et réciproquement » (1983) qui met en scène la rencontre au jardin des Tuileries des cinéastes Jean Rouch, Raymond Depardon et Philippe Costantini.
L’apparente légèreté du personnage, son jeu déconcertant d’improvisation et de spontanéité mêlées, sa manière inimitable de rapporter des faits ou de portraiturer des personnages sur le ton de la fable ont pu décontenancer le public ordinairement confronté à un certain académisme dans le genre documentaire. Film à caractères didactique ou/et informatif, le documentaire est rarement soumis aux règles de la dramaturgie à laquelle il s’adonne, une singularité qui ne nuit en aucune façon à l’approche pluridisciplinaire, tout à la fois ethnographique, historique, géographique, linguistique, musicale, économique, sociale et religieuse, l’approche d’un intellectuel que la postérité considérera davantage qu’un théoricien influent et un chercheur inspiré : un savant mémorable.
Jean Rouch en tournage sur les rives du Niger © Photo X, droits réservés
- Jean Rouch : un cinéma léger ! éditions Montparnasse, une édition dirigée par Andrea Paganini et Jean-Emmanuel Papagno sur la proposition de la fondation Jean-Rouch et de l’association du Centenaire Jean Rouch 2017, en partenariat avec le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), 26 films en 10 DVD, 2017.
Lecture complémentaire :
- Découvrir les films de Jean Rouch - Collecte d’archives, inventaire et partage, sous la direction de Béatrice de Pastre (CNC) avec la collaboration de Philippe Costantini (réalisateur), Guillaume Fau (Bibliothèque nationale de France), Françoise Foucault et Laurent Pellé (Comité du film ethnographique), éditions du Centre national du cinéma et de l’image animée, 248 pages, 2010.
Varia : la nouvelle mode chinoise

« L’habillement fait partie intégrante des éléments culturels et sociaux fondamentaux d’une civilisation, intimement lié aux inventions spirituelles et matérielles de l’histoire de l’humanité. On peut parler là d’un héritage esthétique. Bien que de nos jours les vêtements chinois s’inspirent fortement de la mode occidentale, la "nouvelle mode chinoise" a largement reçu les éloges du public au point de devenir une tendance qui influence le monde. Singulière, la "nouvelle mode chinoise" reprend des éléments de la mode traditionnelle tout en y intégrant des éléments et des coupes à la mode occidentale. De fait dans un univers mondialisé, la mode chinoise a bien trouvé sa place dans l’univers "fashion". […]
« La mode vestimentaire d’un peuple permet de mieux comprendre les particularités historiques de toute une culture. Durant des siècles la Chine n’a cessé d’accumuler de multiples caractéristiques et d’éléments iconiques que l’on retrouve sur chaque textile traditionnel. On peut y découvrir des éléments très spécifiques de la mode de l’époque comme le style, les couleurs, les matériaux, les motifs et un raffinement incomparable. Au-delà de l’habillement, de nombreux éléments culturels touchent également la tradition : les parures tricolores splendides des Tang, les encres magnifiques, sa porcelaine simple mais exquise et même ses parcs pavillonnaires, ses rues de village offrent aux stylistes une source d’inspiration sans limites. Les moules simples et sans fioritures, une audace discrète et honnête, une structure rigoureuse, des couleurs inspirantes. La vie agraire originelle, les rides à la surface des étangs, le bouillonnement des tourbillons, ses courbes ou ses formes triangulaires ont servi de base et de modèle à cet art du textile mais aussi à la création des motifs présents sur les vêtements de l’époque. Un tel degré de subtilité et de concision dans les motifs a permis de modeler son caractère sentimental et inspirer la volonté contemporaine afin de retrouver pureté et simplicité originelles.
« L’art contemporain et les limites du stylisme ne sont déjà plus des tendances uniques mais plutôt un développement absorbant toutes les tendances. Les frontières entre ces différents types d’art sont presque inexistantes. Les éléments chinois se mêlent aux autres arts, formant une nouvelle perception et une nouvelle expérience des sensations. La simplicité extrême, le Pop’art, les styles architecturaux, l’avant-gardisme, les hippies, le Japon et l’Afrique, et bien d’autres styles ont aussi influencé les créateurs chinois. Nous vivons dans un même monde, nous tirons tous des éléments de notre environnement, et nous partageons aussi tous les mêmes ressources culturelles. Les éléments chinois n’appartiennent pas seulement à la richesse chinoise. Les différentes cultures mondiales se retrouvent toutes dans la pensée et la confection orientales. Par exemple, le styliste français Pierre Cardin a décidé de mélanger les qipao chinoises à la mode parisienne. Yves Saint-Laurent a aussi créé un nouveau style en s’inspirant de la mode de l’époque des Qing, créant ainsi une collection appelée les "Chinoises". »
Extrait de « La nouvelle mode chinoise se métisse avec le monde entier », de Liu Yang, traduit par Tang Guo, un article issu de la revue « Institut Confucius, n° 36, 80 pages, mai 2016.
In memoriam : le peintre Joseph Alessandri n’est plus
 Né à Tunis le vendredi 16 février 1940, Joseph Alessandri est mort le vendredi 15 décembre 2017 à l’hôpital Saint-Joseph de Marseille. Je l’avais rencontré en juin 1978 chez le galeriste aixois Jean-Pierre Collot qui montrait ses tableaux-reliefs à l’enseigne des Maîtres contemporains, rue de Montigny. À la fin de la décennie 1990, Jean-Louis Ferrier (1926-2002), historien d’art, professeur à l’École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris et docteur en philosophie, avait entrepris la monographie du peintre mais sa mort en avait compromis la réalisation. J’ai eu l’honneur et le plaisir de mener à bonne fin ce projet éditorial à la demande de Philippe Latourelle, président de l’association Présence Van Gogh (musée Estrine à Saint-Rémy-de-Provence). Né à Tunis le vendredi 16 février 1940, Joseph Alessandri est mort le vendredi 15 décembre 2017 à l’hôpital Saint-Joseph de Marseille. Je l’avais rencontré en juin 1978 chez le galeriste aixois Jean-Pierre Collot qui montrait ses tableaux-reliefs à l’enseigne des Maîtres contemporains, rue de Montigny. À la fin de la décennie 1990, Jean-Louis Ferrier (1926-2002), historien d’art, professeur à l’École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris et docteur en philosophie, avait entrepris la monographie du peintre mais sa mort en avait compromis la réalisation. J’ai eu l’honneur et le plaisir de mener à bonne fin ce projet éditorial à la demande de Philippe Latourelle, président de l’association Présence Van Gogh (musée Estrine à Saint-Rémy-de-Provence).
Après une formation dans les Écoles des beaux-arts d’Aix-en-Provence et de Marseille et un apprentissage chez le maître-verrier marseillais Cavalier (1955-1963), il ouvre son atelier en 1963 dans la cité phocéenne où il vit et travaille une douzaine d’années. En 1975, il choisit Eygalières au cœur du massif des Alpilles où il côtoie les plasticiens Gérard Drouillet (1946-2011), Louis Pons (1927) et Mario Prassinos (1916-1985). Son œuvre peint et dessiné est caractérisé par des reliefs à rebut, peintures de cire, bois assemblés, encres de Chine, papiers collés et déchirés, paysages informels, totems et mégalithes.
C’est une œuvre austère, concentrée et tendue sur un questionnement très ancien, vieux comme notre culture méditerranéenne : la déconstruction de la forme et la métamorphose du déchet. En témoigne la multiplication de totems et de reliefs fabriqués à partir d’objets de récupération : bois brûlés, cartons lustrés, cuirs écharnés et tôles embouties.
Chez lui, l’objet de rebut est doté d’une mémoire, riche de tout un passé, porteur d’une somme d’expériences humaines. Transformé, en un second temps, par la scénographie du plasticien et l’alchimie du peintre, il assimile les vertus d’une nouvelle singularité sans perdre ses caractéristiques originelles. Aussi le ramassage des matériaux délaissés n’est-il pas pratiqué à l’aveuglette, il constitue la phase première de la création, soit que l’objet élu s’intègre à un tableau en cours, soit qu’il déclenche la conception d’une œuvre nouvelle. Dans sa démarche, le découvreur retrouve la simplicité des gestes primitifs ; il y puise une formidable capacité d’étonnement et la faculté de renouer avec le monde de l’enfance – partagée entre la Corse et la métropole marseillaise - par des abstractions que clôt le plus souvent le mystère.
« Il importe, pour que le travail soit une réussite, me dit-il en 2002, que le phénomène pictural l’emporte sur l’image. C’est l’objet seul qui te guide dans la réalisation de cet assemblage, de ce collage. C’est ton intelligence qui amènera l’harmonie souhaitée : un ou deux éléments qui jouent avec le reste de la matière étalée et collée sur la toile. Le danger ici serait de multiplier la même création plusieurs fois, d’utiliser lesdits objets plusieurs fois, sous toutes leurs facettes (il ne faut pas trop presser le citron !). En fait, je n’ai de cesse de tourner autour de l’objet afin de circonscrire la prochaine étape de la création, d’imaginer son prochain état dans la toile. À cet égard, je suis resté un braconnier dans l’âme. Très jeune, j’étais déjà un prédateur. Non seulement je plaçais des pièges, mais je les dissimulais, comme je procède en somme avec mes tableaux-reliefs, cherchant, avant toutes choses, à fondre le (ou les) objet (s) dans la masse du tableau. Pour que ça ne se voit pas. Cet exercice de dissimulation est à rapprocher du jeu d’assemblage du maître-verrier.
« J’aime aussi, assez, brouiller les cartes de la création : intégrer dans mon tableau-relief une plaque de fer rouillé voisinant avec la reproduction parfaite sur papier ou carton d’une plaque de fer rouillé. L’or ne m’a jamais fasciné. Les corrosions et accidents de la nature sur les différents éléments ferreux ou boisés sont autrement excitants. »
Joseph Alessandri dans son atelier d’Eygalières en 2002
© Photo Maurice Rovellotti
- Ateliers du Sud - L’Esprit des lieux, par Claude Darras, photographies de Maurice Rovellotti, éditions Edisud, Aix-en-Provence, 160 pages, 2004 ;
- Joseph Alessandri ou la face cachée de l’ombre, par Claude Darras, monographie d’artiste, avec le photographe Jean-Éric Ely, livre couronné du prix Paul Arbaud 2010 de l’Académie des sciences, agriculture, arts et belles lettres d’Aix-en-Provence. Éditions Autres Temps, Marseille, 2009.
|





