Les Papiers collés
de Claude Darras
Automne 2018
Carnet : le sens d’un vers
Demander le sens d’un vers, c’est vouloir en savoir plus long que le poète lui-même. Le sens d’un vers, c’est et ce ne peut être que le vers lui-même. Le poète s’embarrasse, manque « d’esprit » si jamais il croit pouvoir signifier autrement que par la poésie. Et donne des regrets. Comme navre la possession, par une sotte, d’un diamant.
(Georges Perros, « Papiers collés » 1, Gallimard/l’Imaginaire, 1960-2011)
Le Comptable du ciel
Le comptable du ciel
a beau compter et recompter
il lui manque toujours une étoile.
C’est le facteur rural
qui l’a retrouvée
entre la Chaussée d’Antin
et le Revest des Brousses.
Je vous prie d’en aviser
le Préfet de Police.
(Jules Mougin, « Le Comptable du ciel », poèmes, Robert Morel éditeur, 1960)
Information
La mondialisation de l’information permet simultanément d’être au courant de tout et de pouvoir s’en passer.
Mondanités
L’avocat et traducteur Nathan Weinstock (Anvers, 1939) est connu pour ses études savantes du mouvement juif et en qualité de passeur de la culture yiddish ainsi que pour ses engagements antisionistes qu’il a reniés après l’échec des Accords d’Oslo (1993). Il apprécie peu les mondanités et fuit comme la peste les séminaires et les colloques. « C’est mauvais, justifie-t-il, à force, on finit par se sentir important ».
Racisme
Les temps changent : le racisme n’a jamais été aussi prégnant. On verra bientôt qu’à défaut de rester un délit il deviendra une opinion.
(Vendredi 29 juin 2018)
Des autos et des hommes
À l’exemple de certains boulevards, les marques d’automobiles font désormais partie de notre vocabulaire quotidien, au point que nous oublions la plupart du temps qu’elles ont d’abord été des noms portés par des hommes et des femmes en chair et en os, avec femmes, enfants et gouvernantes.
La science et l’État
Gaspard Monge (1746-1818) a trouvé en l’historien François Pairault (Ligré, 1938) le meilleur des biographes. Peu se souviennent de ce mathématicien et géomètre qui devint ministre de la marine après la chute du roi en septembre 1792 et prit part à la fondation du système métrique et du calendrier révolutionnaire. Opposé à la Terreur jacobine, il échappe à l’échafaud. C’est lui qui fonda l’École centrale des travaux publics, qui deviendra l’école Polytechnique. Pour lui, la science doit se mettre au service de l’État.
(Mercredi 18 juillet 2018)
|
Billet d’humeur
L’artiste qui murmure à l’oreille des vaches…
De tout temps, peinture et sculpture ont participé du grand cycle de la nature aux emprunts de laquelle des plasticiens ont ajouté l’animal. Parmi eux Kader Attia, Joseph Beuys, Louise Bourgeois, Maurizio Cattelan, Wim Delvoye, Éric Dietman, Jan Fabre, Damien Hirst, Jannis Kounellis, Annette Messager, Éric Poitevin, Patrick Tosani, Xavier Veilhan et Thierry Boutonnier. Originaire du Tarn où il est né en 1980, à Viviers-lès-Montagne, ce dernier dénonce l’absurdité du système de gestion agricole qui réclame au céréalier et à l’éleveur un savoir-faire non seulement technique mais aussi commercial et financier. Ainsi, à l’occasion d’une série de performances intitulées « Objectif de production » (2005), l’artiste a lu le cours des céréales aux jeunes pousses de blé dans un champ : « J’écoute la tempête qui gronde entre leurs feuilles, raconte-t-il, et je leur demande de bien prendre conscience de la réalité du marché, de sa complexité et de bien grandir ». Ailleurs, dans une étable, il a communiqué les objectifs de production laitière aux… vaches elles-mêmes ! « Je leur présente des graphes, explique-t-il. Ils indiquent la production laitière moyenne d’un individu, la relation de la productivité avec son cycle sexuel et sa reproduction. Ensemble, nous devenons curieux de cette exploitation. »
|
Lecture critique
Valérie Cabanes : restaurer la démocratie
pour sauvegarder notre écosystème
 Discernement et sagesse : Valérie Cabanes (Pont-l’Abbé, 1969) invoque ces deux seules qualités, indispensables selon elle pour protéger, avec les fonctions vitales de la planète Terre, l’avenir de tous les humains ainsi que les arbres, les plantes et les animaux. Dans son livre « Homo natura - En harmonie avec le vivant », la juriste (en droit international, spécialisée dans les droits de l’homme et le droit humanitaire) déplore que nous soyons « incapables de vivre en harmonie avec les rares espaces naturels qui nous entourent tant notre regard sur ceux-ci est possessif et prédateur ». Elle incite à renouer avec les pratiques des peuples premiers qui « semblent avoir acquis cette capacité à se sentir reliés à leurs frères humains mais aussi, plus largement, à tous les êtres vivants et à la Terre qu’ils nomment Mère ». Aussi la sagesse des chefs de certaines sociétés autochtones est-elle louée « parce que le sage, écrit l’auteure, est capable de nous guider vers plus d’équité et d’honnêteté car il a lui-même dépassé les désirs de l’ego, il n’aspire à aucune reconnaissance ». « Comment, en effet, espérer, poursuit-elle, qu’un homme épris de pouvoir puisse nous enseigner des valeurs de solidarité et de bienveillance, comment pourrait-il nous montrer la voie vers plus de fraternité ? N’est-ce pas plutôt le sage qui nous enjoint de nous ouvrir à l’empathie et au partage ? » Discernement et sagesse : Valérie Cabanes (Pont-l’Abbé, 1969) invoque ces deux seules qualités, indispensables selon elle pour protéger, avec les fonctions vitales de la planète Terre, l’avenir de tous les humains ainsi que les arbres, les plantes et les animaux. Dans son livre « Homo natura - En harmonie avec le vivant », la juriste (en droit international, spécialisée dans les droits de l’homme et le droit humanitaire) déplore que nous soyons « incapables de vivre en harmonie avec les rares espaces naturels qui nous entourent tant notre regard sur ceux-ci est possessif et prédateur ». Elle incite à renouer avec les pratiques des peuples premiers qui « semblent avoir acquis cette capacité à se sentir reliés à leurs frères humains mais aussi, plus largement, à tous les êtres vivants et à la Terre qu’ils nomment Mère ». Aussi la sagesse des chefs de certaines sociétés autochtones est-elle louée « parce que le sage, écrit l’auteure, est capable de nous guider vers plus d’équité et d’honnêteté car il a lui-même dépassé les désirs de l’ego, il n’aspire à aucune reconnaissance ». « Comment, en effet, espérer, poursuit-elle, qu’un homme épris de pouvoir puisse nous enseigner des valeurs de solidarité et de bienveillance, comment pourrait-il nous montrer la voie vers plus de fraternité ? N’est-ce pas plutôt le sage qui nous enjoint de nous ouvrir à l’empathie et au partage ? »
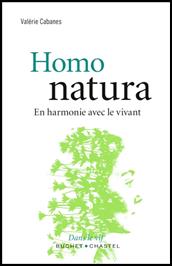 Valérie Cabanes rejoint les lanceurs d’alerte pour lesquels la montée de la violence dans le monde et l’urgence environnementale et climatique enjoignent leurs contemporains d’abandonner les énergies fossiles, de préserver la liberté des semences, d’interdire les organismes génétiquement modifiés (OGM) et de bannir les produits écotoxiques issus de l’industrie pétrochimique, nucléaire, agro-chimique, cosmétique ou pharmaceutique. En 2012, une initiative citoyenne européenne (ICE) a été lancée pour que l’eau soit reconnue comme un bien public et non comme une marchandise. En 2016, le préjudice écologique a été inscrit dans le Code civil. L’année suivante une loi a été adoptée sur le devoir de vigilance des multinationales. Dans une Europe élargie, on parle de plus en plus de la reconnaissance du crime d’écocide et de la protection par les constitutions des communs planétaires, que sont l’eau, l’air et la biodiversité. Beaucoup reste à faire mais nous avons juste à agir. « Le droit de tout être humain à la vie est dénué de sens, estime l’essayiste, si les écosystèmes qui subviennent à ses besoins n’ont pas le droit légal d’exister. La reconnaissance de ces droits permettrait de redéfinir la notion d’égalité entre les hommes au nom de leurs besoins biologiques essentiels et donc de garantir à tous l’accès aux ressources vitales. Il s’agirait aussi d’inscrire enfin dans la loi les devoirs de l’humanité vis-à-vis des générations à venir et de l’écosystème planétaire. » Pour relever ce formidable défi, il nous faut - nous tous et chacun d’entre nous - accomplir une révolution intérieure, une démarche qui impose de réduire l’arsenal de nos armes économiques, réviser notre rapport à la propriété, limiter la souveraineté des États, autrement dit restaurer la démocratie.
Valérie Cabanes rejoint les lanceurs d’alerte pour lesquels la montée de la violence dans le monde et l’urgence environnementale et climatique enjoignent leurs contemporains d’abandonner les énergies fossiles, de préserver la liberté des semences, d’interdire les organismes génétiquement modifiés (OGM) et de bannir les produits écotoxiques issus de l’industrie pétrochimique, nucléaire, agro-chimique, cosmétique ou pharmaceutique. En 2012, une initiative citoyenne européenne (ICE) a été lancée pour que l’eau soit reconnue comme un bien public et non comme une marchandise. En 2016, le préjudice écologique a été inscrit dans le Code civil. L’année suivante une loi a été adoptée sur le devoir de vigilance des multinationales. Dans une Europe élargie, on parle de plus en plus de la reconnaissance du crime d’écocide et de la protection par les constitutions des communs planétaires, que sont l’eau, l’air et la biodiversité. Beaucoup reste à faire mais nous avons juste à agir. « Le droit de tout être humain à la vie est dénué de sens, estime l’essayiste, si les écosystèmes qui subviennent à ses besoins n’ont pas le droit légal d’exister. La reconnaissance de ces droits permettrait de redéfinir la notion d’égalité entre les hommes au nom de leurs besoins biologiques essentiels et donc de garantir à tous l’accès aux ressources vitales. Il s’agirait aussi d’inscrire enfin dans la loi les devoirs de l’humanité vis-à-vis des générations à venir et de l’écosystème planétaire. » Pour relever ce formidable défi, il nous faut - nous tous et chacun d’entre nous - accomplir une révolution intérieure, une démarche qui impose de réduire l’arsenal de nos armes économiques, réviser notre rapport à la propriété, limiter la souveraineté des États, autrement dit restaurer la démocratie.
Valérie Cabanes © Photo Jérôme Panconi, droits réservés
- Homo natura - En harmonie avec le vivant, par Valérie Cabanes, préface du sociologue et philosophe Edgar Morin, éditions Buchet-Chastel, collection Dans le vif, 126 pages, 2017.
Portrait
La littérature fraternelle d’Henri Calet
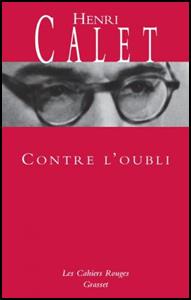 Les chemins de la critique sont pavés de malentendus. Comment expliquer la charge violente du romancier Paul Nizan (1905-1940) qui le qualifiait tel « un homme profondément réactionnaire, comme tous les hommes sans espoir » ? La meilleure veine populiste caractérise l’œuvre de Raymond Théodore Barthelmess, alias Henri Calet (Paris, 3 mars 1904-Vence, 14 juillet 1956), une vingtaine d’ouvrages, romans, récits, nouvelles, chroniques ou notes où il livre sa passion des lieux pittoresques et sans panache de la capitale, où il prête sa plume aux petites gens des quartiers, attentif ici aux tragédies quotidiennes de Belleville, tendre là envers les mômes du quartier de la Monnaie. « Je connais cette ville par cœur, aimait-il répéter ; je pourrais la démonter pierre à pierre et la reconstruire ailleurs. […] Je l’aime. Elle est à ma taille, elle me botte parfaitement. Entre nous, maintenant, c’est à la vie à la mort (la vie pour elle, la mort pour moi). » Au musée des Travaux publics, avenue d’Iéna, un gardien actionne un merveilleux train électrique en miniature : « Nous n’avions jamais possédé un tel jouet, observe-t-il au gré d’une chronique ("De ma lucarne"). Il me venait des culottes courtes qui, d’ailleurs, me vont encore très bien. » « Je ne sais pas ce qui m’arrive, confesse-t-il dans "Peau d’ours" : je me sens de plus en plus empêché de m’exprimer à haute voix, et surtout publiquement. Le français me devient tout à coup comme étranger, je m’embarrasse dans ma langue, mes propos tournent au bredouillage et retournent à l’inexprimé… c’est curieux. Bref, je ne suis certainement pas doué pour la parole. C’est peut-être pourquoi je me suis mis à écrire. » Les chemins de la critique sont pavés de malentendus. Comment expliquer la charge violente du romancier Paul Nizan (1905-1940) qui le qualifiait tel « un homme profondément réactionnaire, comme tous les hommes sans espoir » ? La meilleure veine populiste caractérise l’œuvre de Raymond Théodore Barthelmess, alias Henri Calet (Paris, 3 mars 1904-Vence, 14 juillet 1956), une vingtaine d’ouvrages, romans, récits, nouvelles, chroniques ou notes où il livre sa passion des lieux pittoresques et sans panache de la capitale, où il prête sa plume aux petites gens des quartiers, attentif ici aux tragédies quotidiennes de Belleville, tendre là envers les mômes du quartier de la Monnaie. « Je connais cette ville par cœur, aimait-il répéter ; je pourrais la démonter pierre à pierre et la reconstruire ailleurs. […] Je l’aime. Elle est à ma taille, elle me botte parfaitement. Entre nous, maintenant, c’est à la vie à la mort (la vie pour elle, la mort pour moi). » Au musée des Travaux publics, avenue d’Iéna, un gardien actionne un merveilleux train électrique en miniature : « Nous n’avions jamais possédé un tel jouet, observe-t-il au gré d’une chronique ("De ma lucarne"). Il me venait des culottes courtes qui, d’ailleurs, me vont encore très bien. » « Je ne sais pas ce qui m’arrive, confesse-t-il dans "Peau d’ours" : je me sens de plus en plus empêché de m’exprimer à haute voix, et surtout publiquement. Le français me devient tout à coup comme étranger, je m’embarrasse dans ma langue, mes propos tournent au bredouillage et retournent à l’inexprimé… c’est curieux. Bref, je ne suis certainement pas doué pour la parole. C’est peut-être pourquoi je me suis mis à écrire. »
 La plupart de ses écrits constituent autant d’études de mœurs où il se met lui-même en scène. Une espèce de désenchantement - une amère mélancolie parfois - habite les personnages simples qui déambulent sur les planches d’un théâtre bruissant de cris et de pleurs, de faiblesses et de trahisons. La plus extrême pudeur est convoquée lorsqu’il s’agit d’exposer les vicissitudes de la vie des plus humbles. Une cruauté acide dévisage le bourgeois prétentieux et le nanti aux penchants égoïstes. Heureusement, l’humour et le cocasse sauvent la face. Et tout cela est superbement écrit et décrit au gré d’une épure stylistique qui mêle les traits d’ironie à des envolées lyriques dignes des plus grands prosateurs. « Du début des années trente jusqu’au milieu des années cinquante, considère l’universitaire Michel P. Schmitt, son œuvre s’est élaborée sur fond de vocifération, d’imposture et d’oppression générales. Il fut le contemporain du bourrage de crâne de deux guerres mondiales, des appels au meurtre fascistes et des procès staliniens, La plupart de ses écrits constituent autant d’études de mœurs où il se met lui-même en scène. Une espèce de désenchantement - une amère mélancolie parfois - habite les personnages simples qui déambulent sur les planches d’un théâtre bruissant de cris et de pleurs, de faiblesses et de trahisons. La plus extrême pudeur est convoquée lorsqu’il s’agit d’exposer les vicissitudes de la vie des plus humbles. Une cruauté acide dévisage le bourgeois prétentieux et le nanti aux penchants égoïstes. Heureusement, l’humour et le cocasse sauvent la face. Et tout cela est superbement écrit et décrit au gré d’une épure stylistique qui mêle les traits d’ironie à des envolées lyriques dignes des plus grands prosateurs. « Du début des années trente jusqu’au milieu des années cinquante, considère l’universitaire Michel P. Schmitt, son œuvre s’est élaborée sur fond de vocifération, d’imposture et d’oppression générales. Il fut le contemporain du bourrage de crâne de deux guerres mondiales, des appels au meurtre fascistes et des procès staliniens, 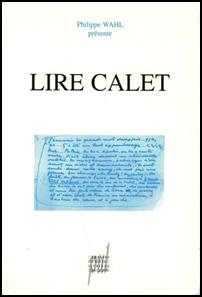 des dissertations pesantes d’un humanisme vieillissant, en même temps que des manifestes littéraires et artistiques bruyants ou des mises en scène matamoresques de la littérature engagée. Calet, "opposé à l’esclandre", émet une voix juste qui témoigne contre l’écrasement des individus sous une histoire qu’on leur impose et les mots de la propagande. » des dissertations pesantes d’un humanisme vieillissant, en même temps que des manifestes littéraires et artistiques bruyants ou des mises en scène matamoresques de la littérature engagée. Calet, "opposé à l’esclandre", émet une voix juste qui témoigne contre l’écrasement des individus sous une histoire qu’on leur impose et les mots de la propagande. »
Né le 3 mars 1904, d’un père parisien et d’une mère flamande, Henri Calet vécut son adolescence dans la Belgique occupée. Affecté durant la Seconde Guerre mondiale à une compagnie de tirailleurs, il est fait prisonnier et s’évade en 1940 au terme d’une captivité de sept mois. Le couple formé avec sa femme Marthe Klein, d’origine juive hongroise, se cacha de la Schutzstaffel (SS, escadron de protection allemand) à Andancette, dans la Drôme, où l’écrivain dirigea une usine de céramique, Andancette dont il narre, dans des textes publiés après la Libération, les actesd’héroïsme et de lâcheté accomplis dans les rangs de la résistance. Il ne publia pratiquement aucun livre durant cette sombre période d’autant qu’il était révulsé par la conduite de certains éditeurs et revuistes proches de l’occupant nazi (à l’instar de La Nouvelle Revue française (Nrf) de Pierre Drieu la Rochelle [1893-1945]). Chemin faisant, l’acuité de ses observations, les incessantes déambulations  du « piéton sentimental » ainsi que la multiplicité des emplois qu’il a tenus dans sa vie ont alimenté une « littérature fraternelle », selon la formule d’Antoine Blondin (1922-1991). Songez qu’il a été tour à tour clerc d’huissier, garçon coiffeur, coursier, statisticien, directeur d’usine, journaliste. « Je trouvais dans ses ouvrages, confie Louis Nucéra (1928-2000), l’empreinte des êtres qui ont appris la vie dans la vie, et non dans des bibliothèques, des êtres qui, jusqu’au bout, n’oublieront jamais leur enfance miséreuse, les fins de mois qui durent quinze jours, le visage harassé de leur mère. » « En juillet 1956, la veille (ou l’avant-veille) de sa mort, rappelle encore le "Cycliste de Montmartre", Henri Calet avait écrit sur son agenda : "C’est sur la peau de mon cœur que l’on trouverait des rides. Il faut se quitter déjà ?" "Ne me secouez pas, je suis plein de larmes." Ce furent ses derniers mots. » du « piéton sentimental » ainsi que la multiplicité des emplois qu’il a tenus dans sa vie ont alimenté une « littérature fraternelle », selon la formule d’Antoine Blondin (1922-1991). Songez qu’il a été tour à tour clerc d’huissier, garçon coiffeur, coursier, statisticien, directeur d’usine, journaliste. « Je trouvais dans ses ouvrages, confie Louis Nucéra (1928-2000), l’empreinte des êtres qui ont appris la vie dans la vie, et non dans des bibliothèques, des êtres qui, jusqu’au bout, n’oublieront jamais leur enfance miséreuse, les fins de mois qui durent quinze jours, le visage harassé de leur mère. » « En juillet 1956, la veille (ou l’avant-veille) de sa mort, rappelle encore le "Cycliste de Montmartre", Henri Calet avait écrit sur son agenda : "C’est sur la peau de mon cœur que l’on trouverait des rides. Il faut se quitter déjà ?" "Ne me secouez pas, je suis plein de larmes." Ce furent ses derniers mots. »
Les œuvres d’Henri Calet :
- Fièvres des polders, éditions Gallimard, collection L’imaginaire, 200 pages, 1939/2017 ;
- Le Bouquet, éd. Gallimard, coll. L’imaginaire, 308 pages, 1945/2001 ;
- Le tout sur le tout, éd. Gallimard, coll. L’imaginaire, 280 pages, 1948/1980 ;
- Monsieur Paul, éd. Gallimard, coll. L’imaginaire, 304 pages, 1950/1996 ;
- Contre l’oubli, reportages et chroniques parus dans la presse entre 1944 et 1948), éditions Grasset, Les Cahiers rouges, 1956/2010 ;
- Peau d’ours, notes pour un roman, éd. Gallimard, coll. L’imaginaire, 168 pages, 1958/1985 ;
- Acteur et témoin, éditions Mercure de France, collection Bleue, 240 pages, 1959/2006 ;
- De ma lucarne, chroniques, textes établis avec préface et notices par Michel P. Schmitt, éd. Gallimard, coll. L’imaginaire, 378 pages, 2000/2014.
Lecture complémentaire :
- Lire Calet, présenté par Philippe Wahl, Presses universitaires de Lyon, 318 pages, 1999.
Varia : Lettres à Louise d’Honoré de Balzac
« Lettre à "Louise" (dont l’identité reste mystérieuse) à la date du 22 août 1836
« […] J’ai perdu l’être que j’aimais le plus au monde [il s’agit de Madame de Berny], et suis dans un tel conflit d’intérêts à débattre, que je ne puis, pour aujourd’hui vous écrire que ce petit mot, car moi, aussi, j’arrive et vous écris hors de chez moi, dans une auberge où je suis arrêté en revenant d’un second voyage - j’espère que vous m’écrirez plus en détail ; et moi, dans quelques jours, j’espère être plus calme et plus assis et pouvoir vous dire plus de choses - aujourd’hui, je ne puis que vous laisser deviner tout ce qu’un cœur souffrant demande à un cœur aimant.
« Lettre à "Louise" de Paris, vers le 28 août 1836
« La personne que j’ai perdue était plus qu’une mère, plus qu’une amie, plus que toute créature peut être pour une autre, elle ne s’explique que par la divinité - Elle m’avait soutenu de parole, 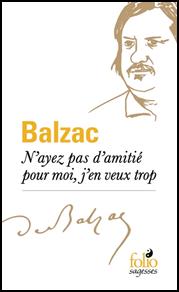 d’actions, de dévouement, pendant les grands orages. Si je vis, c’est par elle ; elle était tout pour moi ; quoique, depuis deux ans, la maladie, le temps, nous eût séparés, nous étions visibles à distance, l’un pour l’autre ; elle réagissait sur moi, elle était un soleil moral. Mme de M[ortsauf] du Lys, est une pâle expression des moindres qualités de cette personne ; il y a un lointain reflet d’elle, car j’ai horreur de prostituer mes propres émotions au public, et jamais rien de ce qui m’arrive ne sera connu - Eh bien, au milieu des nouveaux revers qui m’accablent, le mort de cette femme est venue - […]. » d’actions, de dévouement, pendant les grands orages. Si je vis, c’est par elle ; elle était tout pour moi ; quoique, depuis deux ans, la maladie, le temps, nous eût séparés, nous étions visibles à distance, l’un pour l’autre ; elle réagissait sur moi, elle était un soleil moral. Mme de M[ortsauf] du Lys, est une pâle expression des moindres qualités de cette personne ; il y a un lointain reflet d’elle, car j’ai horreur de prostituer mes propres émotions au public, et jamais rien de ce qui m’arrive ne sera connu - Eh bien, au milieu des nouveaux revers qui m’accablent, le mort de cette femme est venue - […]. »
- N’ayez pas d’amitié pour moi, j’en veux trop, par Honoré de Balzac, édition de Roger Pierrot et Hervé Yon, Lettres extraites de Correspondance, II (Bibliothèque de la Pléiade), éditions Gallimard, collection Folio Sagesses, 96 pages, 2018.
Carnet : mythologie chinoise
Fabuleuse mythologie chinoise ! Je viens d’apprendre que le chien céleste est un animal mythique capable de manger la lune. C’est pourquoi les Chinois l’ont tenu pour responsable des éclipses… Quant à la Reine-mère d’Occident, elle a quitté les nuées mythiques pour rallier les divinités taoïstes. À l’ouest de la Chine, dans la clandestinité des monts Kunlun, elle fabrique des drogues d’immortalité, grâce à une espèce de pêche d’une grande rareté et aux herbes médicinales poussant dans son domaine…
Concessions
À force de faire des concessions, on finit par en avoir une à perpétuité.
(Jacques Sternberg, « Contes glacés », 1974)
Le bonheur d’être triste
La mélancolie a toujours été considérée tantôt comme une source de création tantôt comme un anéantissement de la pensée. Ce « bonheur d’être triste » a été analysé avec brio par le psychanalyste lyonnais Pierre Fédida (1934-2002) dans « Les Bienfaits de la dépression - Éloge de la psychothérapie » au travers des nombreuses et différentes approches de cet état psychique auquel on a donné le nom fourre-tout de « dépression ». Le vocable apparaît à la fin du XIXe siècle issu de la psychologie de Pierre Janet (1859-1947) auquel on doit également le mot de « subconscient ». Le philosophe et psychologue a tenu à distinguer le subconscient, notion clinique, de l’inconscient, notion philosophique. Il a forgé le terme de « subconscient » vers 1909 pour résumer les traits singuliers que présentaient certains troubles de la personnalité dans une névrose particulière, l’hystérie.
(Jeudi 26 juillet 2018)
Borges et la Montagne magique
L’Argentin Juan José Saer (1937-2005) raconte qu’il avait parlé à son collègue et compatriote Jorge Luis Borges (1899-1986) de « La Montagne magique » (1924) de l’écrivain allemand Thomas Mann (1875-1955), lui disant combien il aimait ce livre. Borges lui répondit : « Moi, je n’ai jamais pu l’escalader ! ».
(Lundi 13 août 2018)
Mémoire
Je ne savais pas tout, loin de là, sur mes parents ou leur propre vie. Ces faits-là sont ce que nous apprenons en dernier sur notre famille. Le temps qu’on vous les rapporte ou que vous les appreniez, vous n’êtes déjà plus des enfants.
(Mardi 28 août 2018)
Maldonne
Depuis mes 17 ans, j’aime me plonger dans la prose d’André Gide (1869-1951). Je relis de temps à autre son Journal (1889-1949), véritable anthologie. En relisant « André Gide et la crise de la pensée moderne » (1943) de l’écrivain allemand Klaus Mann (1906-1949), je me rends compte qu’on s’est obstiné longtemps à attribuer l’expression « Gide, le contemporain capital » alors qu’elle est d’André Rouveyre, un écrivain qui se doublait d’un infaillible caricaturiste.
(Samedi 1er septembre 2018)
|
Billet d’humeur
La marque au lion
Le lion de Peugeot n’a rien à voir avec le Lion de Belfort, conçu et réalisé après la guerre franco-prussienne de 1870 par le sculpteur Auguste Bartholdi (1834-1904), l’auteur de la Statue de la Liberté. Son apparition sur les productions de l’industriel sochalien est bien antérieure. Jules et Émile Peugeot sollicitent en 1847 un orfèvre et graveur de Montbéliard, Justin Blazer, afin qu’il leur dégotte ce qu’on appellerait aujourd’hui un logotype propre à identifier leur marque, plus spécialement sur les lames de scies. Nul doute que l’orfèvre a songé à l’animal présent sur les armoiries de la Franche-Comté. De surcroît, le lion est connu pour sa force : il incarne tout naturellement les qualités des lames Peugeot, résistance des dents, souplesse de la lame et rapidité de la coupe. Le mammifère léonin est représenté de profil, regardant à gauche, droit sur ses pattes posées sur une flèche qui symbolise l’outil Peugeot. La marque au lion est déposée le 20 novembre 1858 au Conservatoire des arts et métiers. Avant qu’il ne subisse de multiples avatars, le corps du fauve apparaît aux dernières années du XIXe siècle entièrement composé d’outils, ce qui laisse penser aux individus portraiturés par le peintre milanais Giuseppe Arcimboldo (1526-1593) selon une marqueterie de fruits, de légumes et de fleurs, un assemblage original en diable.
|
Lecture critique
Joël Schmidt, une littérature romanesque et gothique
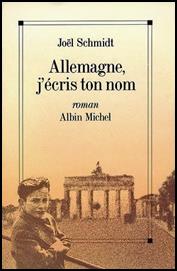 Parce que l’histoire ne suffisait plus à apaiser les fringales sensuelles de sa mémoire, Joël Schmidt (Paris, 1937) a recouru à l’imaginaire qui ensemence les cinq romans réunis sous le titre générique « Les Larmes de l’adolescence ». Parce que l’histoire ne suffisait plus à apaiser les fringales sensuelles de sa mémoire, Joël Schmidt (Paris, 1937) a recouru à l’imaginaire qui ensemence les cinq romans réunis sous le titre générique « Les Larmes de l’adolescence ».
On retrouve dans « Allemagne, j’écris ton nom », portés à leur paroxysme, tous les ingrédients d’une littérature romanesque et gothique dont le pouvoir, les caprices et les séductions tiennent à la répétition d’un rituel éprouvé.
Dans « Le Fleuve des morts » (1975), l’écrivain identifiait ses héros aux personnages historiques d’une tragédie vécue au XIXe siècle dans le château de Loustal en Périgord. Au siècle suivant, le fils d’un résistant mort en déportation s’est épris de la fille du bourreau SS responsable de l’arrestation de son père. Ensemble ils projettent de remonter le fleuve des morts pour y laver l’outrage d’une culpabilité qui a empoisonné leur enfance.
Dans « Allemagne, j’écris ton nom », Frédéric, le narrateur, élevé dans le culte du souvenir, est fasciné par la puissance du IIIe Reich que les hôtes de ses parents incarnent et perpétuent après la guerre dans les salons du même château de Loustal. Laura, la fille d’un haut dignitaire nazi, partage les rêves fous de l’adolescent. Comme lui, elle croit au rétablissement de l’Allemagne, cette « Germanie dont la cuirasse englobait sur la gravure des timbres les deux seins nourriciers, apparents, attirants sous l’airain ». Étudiant d’histoire à la Sorbonne, Frédéric découvre en Laura, quelques années plus tard à Berlin, une interprète de la tétralogie wagnérienne. Mais tandis que l’écroulement des dieux antiques est, dans Le Crépuscule des dieux, ressenti douloureusement, dans « Allemagne, j’écris ton nom » la chute du mur de Berlin est accueillie comme un dénouement naturel et heureux…
Le livre compose une nouvelle variation sur une Allemagne mythique où la nostalgie affleure constamment, comme les paillettes de mica dans certains granites. Répétition, disais-je ? Joël Schmidt a le défaut des gens de la campagne, il cultive souvent le même champ.
- Allemagne, j’écris ton nom, par Joël Schmidt, éditions Albin Michel, 224 pages, 2014.
Portrait
François Walter raconte l’histoire de la Suisse
 Les chapitres courts et nerveux qui composent « Une histoire de la Suisse » ne sont en rien les flashes annoncés dans l’introduction de l’ouvrage de François Walter (né en 1950). Le vocable médiatique sied mal à la forme et au fond du propos, lequel réussit la gageure de dire et d’expliquer avec autant d’érudition que de clarté les étapes et les péripéties de la construction de ce pays si proche et si méconnu. Les chapitres courts et nerveux qui composent « Une histoire de la Suisse » ne sont en rien les flashes annoncés dans l’introduction de l’ouvrage de François Walter (né en 1950). Le vocable médiatique sied mal à la forme et au fond du propos, lequel réussit la gageure de dire et d’expliquer avec autant d’érudition que de clarté les étapes et les péripéties de la construction de ce pays si proche et si méconnu.
Scandée selon cinq parties chronologiques, l’édification de la communauté helvète est prise en compte à partir d’août 1291 au moment où les trois cantons forestiers d’Uri, Schwytz et Unterwald se lient en un pacte perpétuel, dit « Pacte de 1291 », dont le parchemin, retrouvé dans les archives en 1758, marquerait l’origine même de la Confédération. Durant cette période qui court du XIIIe au XVIe siècles (L’invention d’une Confédération), les réformes religieuses fondent des bastions confessionnels distincts et antagonistes. Outre une deuxième partie (1600-1750) dévolue à l’Ancien Régime et à L’âge classique, Le temps des révolutions (1750-1830) permet à l’historien et professeur (honoraire) à l’université de Genève de souligner l’importance de l’année 1798 à la faveur de laquelle s’installe, momentanément, en Suisse, un État centralisé et structuré sur le modèle français. C’est en 1848 que naît l’État fédératif (La création de la Suisse moderne, 1830-1930) : « Cet événement constitue probablement la date la plus importante de son histoire, considère l’auteur. Parallèlement, le pays s’est construit en tant que Nation, à l’instar des autres États européens ». « Mais, surtout, ajoute-t-il, la société dans son ensemble a été transformée par l’essor économique. […] Sans avoir d’empire colonial, la Confédération participe activement à la mondialisation. […] Par la fiabilité de ses services bancaires, elle devient dès avant 1914 une place financière d’importance planétaire. » Il est d’ailleurs beaucoup question, dans la dernière partie de l’ouvrage (Certitudes et incertitudes du temps présent, de 1930 à nos jours), d’évoquer les aspects économiques, linguistiques, culturels, sociaux et environnementaux de la vie et de l’activité des citoyens suisses. Le pays se donne un nouveau canton de langue française, le Jura, en 1979 (le 23e canton de la Confédération) ; il se dote d’une nouvelle constitution en 1999 et devient membre de l’Organisation des Nations unies en 2002.
Au fil de l’histoire, le lecteur retiendra l’évocation de faits mémorables. Par exemple, lorsque l’auteur rapporte le récit des chroniqueurs des XVe et XVIe s. qui valident la thèse de la révolte des Suisses 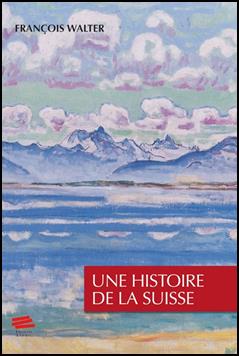 contre les Habsbourg dans le courant du XIVe s. et lui rattachent des épisodes héroïques dont celui de Guillaume Tell, le tyrannicide. « Selon la tradition, le 18 novembre 1307, narre F. Walter, le héros a tué le bailli Gessler, après avoir relevé le défi de transpercer une pomme posée sur la tête de son propre fils, le fameux tir à l’arbalète. Si le nom de Tell ne figure pas dans les sources, le patronyme de Gessler existe réellement, désignant une famille de ministériaux au service de l’Autriche. Il semblerait que les chroniqueurs du XVe siècle l’aient choisi comme nom générique pour désigner un administrateur tyrannique. » À travers le personnage du « mercenaire » ou « soldat capitulé », d’autre part, la vocation historique et guerrière de la Confédération est clairement explicitée : « À la fin du XVe siècle, auréolée de ses succès dans les guerres de Bourgogne puis des razzias de la guerre de Souabe, la Confédération est incontestablement une société guerrière. Les jeunes sont fascinés par la gloire militaire et par l’enrichissement potentiellement rapide que celle-ci peut apporter ». Enfin, la légitimation progressive de la neutralité, du XVIIIe au XXe s., est soulignée : « La couverture militaire des frontières a toujours été un élément important de la politique de sécurité. L’objectif [au XVIIIe s.] est de s’assurer un glacis politique de régions sécurisées tout autour du territoire des XIII Cantons. Au lieu d’édifier sur leurs marges de coûteux ouvrages fortifiés, les républiques suisses ont sans cesse tenté d’obtenir des accords internationaux de neutralisation ». Avant la Première Guerre mondiale, « la neutralité est perçue comme une garantie de sécurité mais en même temps aussi comme une exigence, celle d’être capable de défendre le territoire. [..] une neutralité active [parce qu’elle] se concrétise encore par une disponibilité aux initiatives de paix ». contre les Habsbourg dans le courant du XIVe s. et lui rattachent des épisodes héroïques dont celui de Guillaume Tell, le tyrannicide. « Selon la tradition, le 18 novembre 1307, narre F. Walter, le héros a tué le bailli Gessler, après avoir relevé le défi de transpercer une pomme posée sur la tête de son propre fils, le fameux tir à l’arbalète. Si le nom de Tell ne figure pas dans les sources, le patronyme de Gessler existe réellement, désignant une famille de ministériaux au service de l’Autriche. Il semblerait que les chroniqueurs du XVe siècle l’aient choisi comme nom générique pour désigner un administrateur tyrannique. » À travers le personnage du « mercenaire » ou « soldat capitulé », d’autre part, la vocation historique et guerrière de la Confédération est clairement explicitée : « À la fin du XVe siècle, auréolée de ses succès dans les guerres de Bourgogne puis des razzias de la guerre de Souabe, la Confédération est incontestablement une société guerrière. Les jeunes sont fascinés par la gloire militaire et par l’enrichissement potentiellement rapide que celle-ci peut apporter ». Enfin, la légitimation progressive de la neutralité, du XVIIIe au XXe s., est soulignée : « La couverture militaire des frontières a toujours été un élément important de la politique de sécurité. L’objectif [au XVIIIe s.] est de s’assurer un glacis politique de régions sécurisées tout autour du territoire des XIII Cantons. Au lieu d’édifier sur leurs marges de coûteux ouvrages fortifiés, les républiques suisses ont sans cesse tenté d’obtenir des accords internationaux de neutralisation ». Avant la Première Guerre mondiale, « la neutralité est perçue comme une garantie de sécurité mais en même temps aussi comme une exigence, celle d’être capable de défendre le territoire. [..] une neutralité active [parce qu’elle] se concrétise encore par une disponibilité aux initiatives de paix ».
Voici un grand livre d’histoire, savant et passionné, qui diffère par bien de ses caractéristiques et de ses qualités des modèles du genre.
François Walter a été professeur d’histoire moderne et contemporaine
à l’université de Genève © Photo X, droits réservés
- Une histoire de la Suisse, par François Walter, éditions Alphil - Presses universitaires suisses, 548 pages, 2016.
Varia : de la cure psychanalytique
 « L’aménagement du dispositif psychanalytique, dans sa forme dite classique et bien connue, place l’analyste dans un fauteuil, derrière le patient lui-même allongé sur un lit de repos ou un divan. Une telle configuration repose sur une asymétrie : d’un côté, le patient s’offre à la fois à l’oreille et au regard de l’analyste qui, de l’autre, n’est présent pour lui que par ses paroles. La règle d’association libre incite le patient à "tout dire" afin de permettre à l’analyste de reconstruire, à travers l’interprétation de ses rêves ou de ses fantasmes, l’articulation de son histoire, dans laquelle la sexualité infantile est censée jouer un rôle capital. « L’aménagement du dispositif psychanalytique, dans sa forme dite classique et bien connue, place l’analyste dans un fauteuil, derrière le patient lui-même allongé sur un lit de repos ou un divan. Une telle configuration repose sur une asymétrie : d’un côté, le patient s’offre à la fois à l’oreille et au regard de l’analyste qui, de l’autre, n’est présent pour lui que par ses paroles. La règle d’association libre incite le patient à "tout dire" afin de permettre à l’analyste de reconstruire, à travers l’interprétation de ses rêves ou de ses fantasmes, l’articulation de son histoire, dans laquelle la sexualité infantile est censée jouer un rôle capital.
« La cure psychanalytique se présente donc comme une sorte de conversation, mais bien particulière, car celle-ci s’établit, selon une célèbre formule freudienne, non pas entre deux personnes, mais plutôt entre deux inconscients. De là une vision assez désincarnée et impersonnelle du rapport entre le médecin-analyste et le patient : le médecin "doit tourner son inconscient, tel un organe récepteur, vers ce que lui transmet l’inconscient du patient. Il doit s’adapter à l’analyste comme un combiné" à un cornet amplificateur. "Tout comme le combiné reconvertit en ondes sonores les oscillations électriques émises initialement par ces mêmes ondes sur une ligne téléphonique, de même l’inconscient du médecin est capable, d’après les dérivés d’inconscient qui lui sont communiqués, de reconstruire l’inconscient qui a déterminé les associations libres du patient" (Freud, 1912). Dans la description de sa technique, Freud semble se désintéresser de la présence des corps réels, qui sont plus ou moins immobilisés par les règles de conduite distribuant les places au sein du dispositif : pourvu que "ça" parle. »
Extrait de « La science orgasmique de Wilhelm Reich* - Du divan à la boîte à orgone », par Andreas Mayer (Centre Alexandre Koyré, Histoire des sciences et des techniques/CNRS/EHESS), un propos issu de la revue « Terrain » n° 67, dossier « jouir ? », printemps 2017, Maison archéologie et technologie (MAE) de l’université de Nanterre, 224 pages.
* Le psychanalyste et médecin Wilhelm Reich, reconnu comme pionnier pour ses premiers travaux thérapeutiques et sexologiques sur l’orgasme, mais finalement condamné pour sa prétendue découverte d’une nouvelle énergie vitale, « l’orgone », est l’une des figures à la fois marquantes et dérangeantes de l’histoire des recherches sur la sexualité.
Carnet : le regard du marin
Où qu’il aille, l’écrivain Hervé Hamon (Saint-Brieuc, 1946) se situe toujours par rapport à la mer. Les marées, les embruns, la broderie des rivages ont laissé leur empreinte dans sa manière d’écrire et dans sa façon d’aborder ses contemporains. « Nous autres, gens de la lune, des coefficients, des équinoxes, dit-il, savons que la mer dessine la terre et non l’inverse. » Quelque part, la mer a modelé son écriture.
Mise en garde
Le même Hervé Hamon se plaît à raconter que lorsque l’écrivain « Louis Guilloux [Saint-Brieuc, 1899-1980] venait boire un verre ou dîner à la maison, mon père mettait ma mère en garde : "Attention à ce que tu dis. N’oublie pas qu’il prend des notes en rentrant…". »
(Lundi 3 septembre 2018)
L’écorce et le livre
Joli mot du lexicographe Alain Rey (Pont-du-Château, 1928) : « Le livre est bien une écorce, mais elle couvre les cercles concentriques du temps de la lecture, et conduisent au cœur. »
Mondialisation et civilisation
« La mondialisation et la civilisation ne cheminent pas ensemble, prétend l’ethnologue et sociologue Georges Balandier (1920-2016), liées par un rapport nécessaire qui les rendrait indissociables ; au contraire, la première ne cesse d’accélérer son allure et de distancer la seconde. »
Une drôle de bonne femme
Paul Gauguin (1848-1903) n’a certainement pas connu son illustre aïeule pour qu’il en brosse dans ses Mémoires un portrait assez terne et flou, entre la vérité et la fable. « Ma grand-mère était une drôle de bonne femme, racontait le peintre. Elle se nommait Flora Tristan. Proudhon disait qu’elle avait du génie. N’en sachant rien, je me fie à Proudhon. Elle inventa un tas d’histoires socialistes, entre autres l’Union ouvrière. Les ouvriers reconnaissants lui firent dans le cimetière de Bordeaux un monument. Il est probable qu’elle ne sut pas faire la cuisine. Un bas bleu socialiste, anarchiste. »
(Jeudi 6 septembre 2018)
Goethe et le français
« Le romancier et poète Goethe n’a jamais résidé en France, précise l’écrivain Michel Tournier (1924-2016). François de Théas, comte de Thoranc, qui lui a appris le français devait parler français avec l’accent du Midi, et c’est donc ainsi que Goethe devait le parler lui-même. Comme c’était également le cas de Napoléon, leurs fameux entretiens des 2, 6 et 10 octobre 1808 à Erfurt et à Weimar devaient sonner comme un pièce de Pagnol. »
(Mercredi 12 septembre 2018)
|
Billet d’humeur
La légende de la bête à bon Dieu
À Marseille (au CNRS) et à Montpellier (à l’INRA), les généticiens planchent sur la parure de la coccinelle, ce coléoptère capable d’ingurgiter chaque jour entre 120 et 150 pucerons, à la satisfaction des jardiniers dont la lutte contre les ravageurs de jeunes pousses se trouve ainsi grandement facilitée. Les chercheurs ont découvert qu’un gène nommé « pannier », découvert chez la drosophile, était responsable de la production de motifs (points, lignes, taches et carrés) sur les élytres (ailes antérieures) de la bête à bon Dieu. Le gène agit sur différentes populations de cellules de l’élytre et y active d’autres gènes, responsables de la formation des fameux points (chez les coccinelles rouges) ou du fond (chez les noires). Le surnom de « bête à bon Dieu » a été attribué à la coccinelle consécutivement à une histoire survenue au début du XIe siècle, au temps de la dynastie capétienne. Un jour d’exécution publique, une coccinelle se posa sur le cou d’un condamné à mort qui clamait son innocence la tête sur le billot. Le bourreau chassa vainement à plusieurs reprises l’insecte qui revenait se poser à la même place. Le souverain, Robert II (972-1031), dit « le Pieux », interpréta le vol de l’insecte semblable à une intervention divine et il gracia le condamné. Peu de temps après, le vrai coupable fut arrêté : la bête à bon Dieu s’est nourrie de cette légende.
|
Lecture critique
Les curriculum vitae d’Albert Schweitzer
 Peut-on raconter une existence ? Les êtres n’ont pas un curriculum vitae, mais plusieurs, aussi vrais les uns que les autres. Et l’affaire se complique lorsqu’il s’agit d’un homme comme Albert Schweitzer (1875-1965). Car son œuvre philosophique, sa quête mystique, sa pratique de l’humanitaire et sa contribution à la musicologie rejaillissent sur sa vie, la colorent ou l’éclairent jusqu’à lui donner les traits (ou les attraits) d’une mythologie. Peut-on raconter une existence ? Les êtres n’ont pas un curriculum vitae, mais plusieurs, aussi vrais les uns que les autres. Et l’affaire se complique lorsqu’il s’agit d’un homme comme Albert Schweitzer (1875-1965). Car son œuvre philosophique, sa quête mystique, sa pratique de l’humanitaire et sa contribution à la musicologie rejaillissent sur sa vie, la colorent ou l’éclairent jusqu’à lui donner les traits (ou les attraits) d’une mythologie.
Rien de tel dans l’ouvrage du psychologue et luthérien Pierre Lassus (né en 1945) qui convainc ses lecteurs qu’il y a plus de grandeur dans l’historique que dans le mythique. Rien de tel non plus chez Jean-Paul Sorg, un autre exégète du « bon docteur de Lambaréné », dont la recension de la correspondance et de textes inédits exclut les mythes réducteurs et simplificateurs. Sans rapetisser le personnage, les travaux conjugués des deux auteurs le ramènent à la dimension humaine en même temps qu’ils retrouvent une boussole d’une précision rarement atteinte pour indiquer le nord d’une connaissance amplifiée et fondée sur son œuvre éthique.
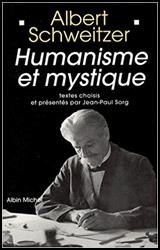 « L’éthique, professait le pasteur et médecin, c’est la reconnaissance de notre responsabilité, élargie à l’infini, envers tout ce qui vit. » Précepte de l’humanitaire, des médecins sans frontières et de l’écologie, le « respect de la vie » animera sa vie durant tous les faits et gestes du prix Nobel de la Paix (1952) qui fut du reste viscéralement opposé à la peine de mort et aux essais atomiques. « L’éthique, professait le pasteur et médecin, c’est la reconnaissance de notre responsabilité, élargie à l’infini, envers tout ce qui vit. » Précepte de l’humanitaire, des médecins sans frontières et de l’écologie, le « respect de la vie » animera sa vie durant tous les faits et gestes du prix Nobel de la Paix (1952) qui fut du reste viscéralement opposé à la peine de mort et aux essais atomiques.
À cet égard, soutient Jean-Paul Sorg, il pourrait être reconnu avec Emmanuel Levinas comme un des grands penseurs de l’éthique au XXe siècle. L’admiration est un brevet de ressemblance et celle qu’Albert Schweitzer porta à Levinas comme à Tolstoï, Goethe et Bach ne se démentit pas.
À une époque où l’humanité hésite encore à sortir de la préhistoire, il est réconfortant que de tels éclaireurs nous précèdent pour triompher des apologies creuses du silence et des jugements d’une postérité défaillante.
- Albert Schweitzer, 1875-1965, par Pierre Lassus, éditions Albin Michel, 424 pages, 1995 ;
- Albert Schweitzer - Humanisme et mystique, textes choisis et présentés par Jean-Paul Sorg, éditions Albin Michel, 531 pages, 1995.
Portrait
Les hommes de brique aux Milles
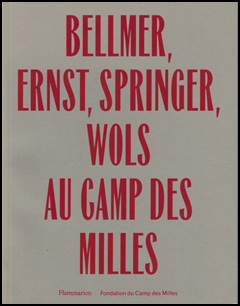 Graveur, dessinateur et peintre, Ferdinand Springer (1907-1998) raconte : « Aux premiers jours de novembre 1939 […] nous sommes arrivés aux Milles. Nous soulevions, en marchant, un énorme nuage de poussière - la poussière des briques, de la terre, de la paille - et ma première vision en entrant dans ce camp a été, à travers cette espèce de brouillard, un peu à l’écart comme une apparition irréelle, le visage de Max Ernst. […] Comme lui et beaucoup d’autres, j’allais devenir un homme de brique. » « Évoquant le caractère "sui generis" de l’endroit, Max Ernst a des phrases qui seront souvent citées : "Partout il y avait des débris de briques et de la poussière de brique, même dans le peu qu’on nous donnait à manger. Cette poussière rouge pénétrait jusque dans les pores de la peau. On avait l’impression d’être destinés à devenir débris de briques." »… L’écrivain et critique d’art Alain Paire rapporte ces propos dans l’ouvrage « Hans Bellmer, Max Ernst, Ferdinand Springer et Wols au camp des Milles » édité en 2013 à l’occasion d’une exposition éponyme dont Juliette Laffon, historienne d’art, ancien conservateur du musée Bourdelle, assurait avec son concours le commissariat. En 1939 et 1940, F. Springer est enfermé dans ce camp d’internement de la Seconde Guerre mondiale ainsi que ses collègues Hans Bellmer (1902-1975), Max Ernst (1891-1976) et Alfred Otto Wolfgang Schulze, alias Wols (1913-1951). Graveur, dessinateur et peintre, Ferdinand Springer (1907-1998) raconte : « Aux premiers jours de novembre 1939 […] nous sommes arrivés aux Milles. Nous soulevions, en marchant, un énorme nuage de poussière - la poussière des briques, de la terre, de la paille - et ma première vision en entrant dans ce camp a été, à travers cette espèce de brouillard, un peu à l’écart comme une apparition irréelle, le visage de Max Ernst. […] Comme lui et beaucoup d’autres, j’allais devenir un homme de brique. » « Évoquant le caractère "sui generis" de l’endroit, Max Ernst a des phrases qui seront souvent citées : "Partout il y avait des débris de briques et de la poussière de brique, même dans le peu qu’on nous donnait à manger. Cette poussière rouge pénétrait jusque dans les pores de la peau. On avait l’impression d’être destinés à devenir débris de briques." »… L’écrivain et critique d’art Alain Paire rapporte ces propos dans l’ouvrage « Hans Bellmer, Max Ernst, Ferdinand Springer et Wols au camp des Milles » édité en 2013 à l’occasion d’une exposition éponyme dont Juliette Laffon, historienne d’art, ancien conservateur du musée Bourdelle, assurait avec son concours le commissariat. En 1939 et 1940, F. Springer est enfermé dans ce camp d’internement de la Seconde Guerre mondiale ainsi que ses collègues Hans Bellmer (1902-1975), Max Ernst (1891-1976) et Alfred Otto Wolfgang Schulze, alias Wols (1913-1951).
Les créations singulières du quatuor
« Dans la tuilerie des Milles, évoque A. Paire, ces quatre artistes élaborent furtivement des niches et des intervalles pour leurs créations. Dans une telle situation, les prescriptions du marché de l’art sont presque inopérantes : quelque chose d’intérieur et d’inconditionné peut se risquer soudainement, ce sera le cas dans les dessins gouachés de Wols exécutés aux Milles. Une relative tolérance des responsables de l’encadrement militaire du camp favorise les tentatives de nos personnages. […] Au camp, le registre d’expression de Max Ernst reste mineur : pas d’huile sur toile, ses formats sont réduits. […] Dans son catalogue raisonné, six œuvres sont répertoriées comme provenant des Milles : principalement le couple de silhouettes fantomatiques des Apatrides, ironiquement figurés avec des limes pourvues de regards et de grandes pattes d’oiseaux. […] Hans Bellmer se prête au jeu de la commande, exécute des dessins irréprochables, des grisailles de facture classique, le portrait de Charles Goruchon [le commandant du camp] et celui du capitaine Poinas et de sa fille. […] Quand il aperçoit Springer dessinant aigûment ses manières d’allégories, les silhouettes musclées et apolliniennes de ses "Coupeurs de bois", 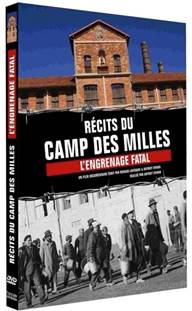 ou bien "La Douche des Milles", Bellmer est sincèrement scandalisé par ce qu’il considère comme un véritable déni de réalité : "Vous faites ça d’après les crétins qui se promènent là dans la cour ? Vous dessinez ces beaux dieux grecs d’après ces crétins ?" » […] Wols créait ses aquarelles principalement pendant la nuit, "près d’un feu à charbons" ou bien "à la lueur d’une chandelle" […] Il capte et traduit quelque chose d’hilarant, des états voisins de l’hallucination. Ce qu’il fait surgir avec les tracés soudains de sa plume est burlesque, ludique, inattendu ou bien terrifiant. Parce que l’humour et la perception du tragi-comique de l’existence faisaient partie de ses ressources premières, Wols semble avoir éprouvé en face du grand cirque et des mauvaises farces de la détention un bien étrange mélange de frayeur et de jubilation. »… ou bien "La Douche des Milles", Bellmer est sincèrement scandalisé par ce qu’il considère comme un véritable déni de réalité : "Vous faites ça d’après les crétins qui se promènent là dans la cour ? Vous dessinez ces beaux dieux grecs d’après ces crétins ?" » […] Wols créait ses aquarelles principalement pendant la nuit, "près d’un feu à charbons" ou bien "à la lueur d’une chandelle" […] Il capte et traduit quelque chose d’hilarant, des états voisins de l’hallucination. Ce qu’il fait surgir avec les tracés soudains de sa plume est burlesque, ludique, inattendu ou bien terrifiant. Parce que l’humour et la perception du tragi-comique de l’existence faisaient partie de ses ressources premières, Wols semble avoir éprouvé en face du grand cirque et des mauvaises farces de la détention un bien étrange mélange de frayeur et de jubilation. »…
En dépit de la solitude, de l’exil, de la xénophobie, de l’angoisse et de la dureté des conditions de vie, les fours voûtés qui avaient permis de cuire briques et tuiles à haute température ainsi que les dépendances de l’usine se transforment en salon littéraire, en théâtre, en salle de concerts de fortune : « Des champions de football décident d’entraîner les plus jeunes ainsi que des gamins du village. Des cours, des conférences et des cérémonies religieuses s’organisent, une chorale et un orchestre se forment, des parodies d’opéra et des sketchs s’esquissent ».
Une histoire largement méconnue
L’histoire du camp des Milles demeure largement méconnue du grand public. Dans ce village tout proche d’Aix-en-Provence transitèrent, entre septembre 1939 et septembre 1942, dans des conditions rudes et précaires, 10 000 étrangers et antifascistes de 38 nationalités dont 2 000 hommes, femmes et enfants d’origine juive furent déportés. Ancienne briqueterie en cessation d’activité, le lieu reste le seul grand camp français d’internement et de déportation intact et accessible au public. Le 12 septembre 2012, le premier ministre Jean-Marc Ayrault inaugurait le site-mémorial que gère aujourd’hui une fondation présidée par Alain Chouraqui (Casablanca, 1949). Directeur de recherches émérite au  CNRS (en droit, sociologie et science politique), il est le fils d’un des initiateurs de l’entreprise qui mit près de trente ans à aboutir, Sidney Chouraqui (Sidi Bel Abbes, 1914-Aix-en-Provence, 2018). C’est cet ancien résistant et avocat qui s’éleva avec véhémence contre la destruction programmée de la salle des peintures de l’ancien camp (le réfectoire des gardiens). Classé monument historique, le lieu a été fort heureusement sanctuarisé et il est aujourd’hui un centre de pédagogie humaniste voué à lutter contre le racisme, la xénophobie et l’antisémitisme. CNRS (en droit, sociologie et science politique), il est le fils d’un des initiateurs de l’entreprise qui mit près de trente ans à aboutir, Sidney Chouraqui (Sidi Bel Abbes, 1914-Aix-en-Provence, 2018). C’est cet ancien résistant et avocat qui s’éleva avec véhémence contre la destruction programmée de la salle des peintures de l’ancien camp (le réfectoire des gardiens). Classé monument historique, le lieu a été fort heureusement sanctuarisé et il est aujourd’hui un centre de pédagogie humaniste voué à lutter contre le racisme, la xénophobie et l’antisémitisme.
Trois phases ont distingué l’activité du camp des Milles. À l’entrée en guerre, en 1939, les autorités françaises décident d’interner les ressortissants allemands, autrichiens, hongrois, polonais, russes et tchèques dont la majorité a fui le régime nazi et cherché asile en France. Dans la briqueterie transformée à la hâte en camp « pour ressortissants ennemis » - un camp qui relève de l’administration de l’Intérieur (intendance de police de Marseille) - arrivent un grand nombre d’artistes et d’intellectuels, tels les poètes et écrivains Lion Feuchtwanger, Walter Hasenclever, Franz Hessel, Alfred Kantorowicz, Golo Mann, le chef d’orchestre Adolf Siebert, l’architecte Konrad Wachsmann, 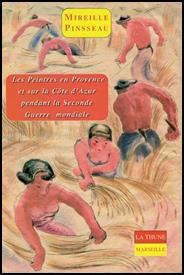 les prix Nobel de médecine Otto Meyerhof et Thadeus Reichstein, les peintres Hans Bellmer, Max Ernst, Adolphe Fleischmann, Henri Gowa, Robert Liebknecht, Max Lingner, Peter Lipmann-Wulf (sculpteur), Léo Marchutz et Wols, au point qu’il sera baptisé un temps « le Montmartre des Milles ». Après l’armistice de juin 1940 et jusqu’en juillet 1942, il devient le camp de transit de tous les indésirables de la Zone sud en instance d’émigration outre-mer : l’État français de Pétain y transfère des antifascistes, des internés des camps du Sud-Ouest, d’anciens membres des Brigades internationales d’Espagne, et des Juifs ayant fui les persécutions. Cela avant que le lieu ne se transforme en camp de déportation des juifs d’août à septembre 1942, avant même l’occupation allemande de la zone Sud qui intervient le 11 novembre 1942 ! les prix Nobel de médecine Otto Meyerhof et Thadeus Reichstein, les peintres Hans Bellmer, Max Ernst, Adolphe Fleischmann, Henri Gowa, Robert Liebknecht, Max Lingner, Peter Lipmann-Wulf (sculpteur), Léo Marchutz et Wols, au point qu’il sera baptisé un temps « le Montmartre des Milles ». Après l’armistice de juin 1940 et jusqu’en juillet 1942, il devient le camp de transit de tous les indésirables de la Zone sud en instance d’émigration outre-mer : l’État français de Pétain y transfère des antifascistes, des internés des camps du Sud-Ouest, d’anciens membres des Brigades internationales d’Espagne, et des Juifs ayant fui les persécutions. Cela avant que le lieu ne se transforme en camp de déportation des juifs d’août à septembre 1942, avant même l’occupation allemande de la zone Sud qui intervient le 11 novembre 1942 !
• Site mémorial du camp des Milles, 40, chemin de la Badesse, 13290 Aix-en-Provence (Les Milles). Ouvert tous les jours de 10 à 18 heures. Téléphone : 04 42 39 17 11.
Un timbre poste a été dessiné et gravé en 2012
par Claude Andréotto (1949-2017) © Photo X, droits réservés
- Hans Bellmer, Max Ernst, Ferdinand Springer et Wols au camp des Milles, avec les contributions de Bernadette Caille, Juliette Laffon et Alain Paire, éditions Flammarion et fondation du Camp des Milles - Mémoire et éducation, 128 pages, 2013 ;
- Récits du camp des Milles, l’engrenage fatal, film réalisé par Renaud Lavergne et Antony Fayada, France Télévisions, 54 minutes, 2015.
Lecture complémentaire :
- Les Peintres en Provence et sur la Côte d’Azur pendant la Seconde Guerre mondiale, par Mireille Pinsseau, éditions La Thune, 248 pages, 2004.
Varia : le lapin et le lièvre
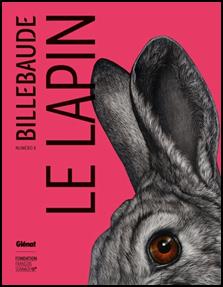 « Contrairement au lapin, le lièvre ne creuse pas de terrier. Il occupe un domaine vital de 200 à 300 hectares. Sur cette surface, qui comprend des itinéraires de fuite, seuls 10 à 15 ha sont régulièrement fréquentés. Adulte, l’animal adopte des mœurs essentiellement nocturnes ou crépusculaires. S’il cohabite volontiers avec quelques congénères sur ses aires de gagnage, il rejoint dès l’aube, isolément, une petite excavation sommairement aménagée au sol nommée gîte. Plusieurs gîtes sont aménagés sur un même territoire selon la saison, les conditions météo du moment et l’évolution du couvert végétal. L’animal étant très casanier, les emplacements de ces refuges ainsi que les itinéraires de fuite sont immuables, et semblent transmis de génération en génération. […] « Bossu, bouquin, oreillard, financier, capucin… tous ces sobriquets illustrent bien l’intérêt que nous portons au lièvre. Lieuvre ou yeuve des grandes plaines du Nord, lèbre des Alpilles "qui hante de façon lancinante les rêves du chasseur méridional", disait le docteur Oberthur, le trophée est si convoité que le rater prend la dimension d’une tragédie antique. Mais d’où diable vient cette fascination ? Outre l’intérêt de sa chasse, notamment aux chiens courants, sa corpulence compte sans doute pour beaucoup dans les convoitises qu’il suscite : le lièvre est le gros morceau qui couronne dignement l’ouverture. Il est le "plus grand de nos petits gibiers", une pièce auréolée de prestige, fleuron des chasses communales. […] « Contrairement au lapin, le lièvre ne creuse pas de terrier. Il occupe un domaine vital de 200 à 300 hectares. Sur cette surface, qui comprend des itinéraires de fuite, seuls 10 à 15 ha sont régulièrement fréquentés. Adulte, l’animal adopte des mœurs essentiellement nocturnes ou crépusculaires. S’il cohabite volontiers avec quelques congénères sur ses aires de gagnage, il rejoint dès l’aube, isolément, une petite excavation sommairement aménagée au sol nommée gîte. Plusieurs gîtes sont aménagés sur un même territoire selon la saison, les conditions météo du moment et l’évolution du couvert végétal. L’animal étant très casanier, les emplacements de ces refuges ainsi que les itinéraires de fuite sont immuables, et semblent transmis de génération en génération. […] « Bossu, bouquin, oreillard, financier, capucin… tous ces sobriquets illustrent bien l’intérêt que nous portons au lièvre. Lieuvre ou yeuve des grandes plaines du Nord, lèbre des Alpilles "qui hante de façon lancinante les rêves du chasseur méridional", disait le docteur Oberthur, le trophée est si convoité que le rater prend la dimension d’une tragédie antique. Mais d’où diable vient cette fascination ? Outre l’intérêt de sa chasse, notamment aux chiens courants, sa corpulence compte sans doute pour beaucoup dans les convoitises qu’il suscite : le lièvre est le gros morceau qui couronne dignement l’ouverture. Il est le "plus grand de nos petits gibiers", une pièce auréolée de prestige, fleuron des chasses communales. […]
« Quant au lapin, il est chassé et consommé depuis la préhistoire. Au tout début de notre ère, aux Baléares, la population locale exigea l’intervention des légions de l’empereur Auguste pour la débarrasser de lapins surabondants devenus un véritable fléau. C’est à cette occasion que furent utilisés pour la première fois les furets, importés de Libye !
« Aujourd’hui, là où il est encore présent, le lapin est toujours chassé devant soi, avec de petits chiens broussailleurs. Mais les vrais passionnés ne se fient pas aux hasard de la billebaude : c’est aux chiens courant qu’ils chassent Jeannot. Dans les régions méridionales comme dans les pays bocagers, notamment en Bretagne, cette chasse de tradition jadis très populaire est encore profondément ancrée dans les habitudes locales. Elle sublime un gibier non avare de ses ruses, le tir ne venant que conclure une quête bien menée. Beagles, bassets fauves de Bretagne, bassets griffons vendéens, bassets artésiens normands ou petits bleus de Gascogne sont les races sélectionnées pour chasser le lapin dont les réflexes étaient jugés dans les années 1950 par l’écrivain Alfred Delacour "mieux ordonnés que ceux du lièvre, la manière d’agir plus réfléchie, les attitudes plus mesurées, les mouvements moins impulsifs". Quand ils se trouvent en terrain découvert, les lapins disposent des guetteurs qui surveillent les alentours. Le degré de vigilance est alors défini par des mouvements particuliers, très caractéristiques : les oreilles, habituellement couchées, se dressent l’une après l’autre, ainsi que la queue. Quand il pressent un danger, qu’il détecte une forme inhabituelle ou un bruit suspect, le lapin cesse soudain de brouter et observe les environs. Alerté, il s’assied parfois sur son train arrière, corps dressé, pattes antérieures pendantes : on dit qu’il fait "le petit homme". Toute la colonie se prépare à décamper, attendant le signal d’alerte donné par le guetteur qui frappe le sol de ses pattes postérieures en émettant un tambourinement sonore ». […]
La revue « Billebaude » nous apprend également que « selon le Dictionnaire historique des argots français de Gaston Esnault (1965), "poser un lapin" signifie quitter une maison close sans payer ». […]
« Celui qui accède à la postérité pour sa "Guerre des boutons", lit-on par ailleurs, n’était pas que le romancier de la jeunesse. Louis Pergaud [1882-1915] a en effet beaucoup écrit sur les animaux : son premier recueil de nouvelles, "De Goupil à Margot", dont le personnage principal est toujours un animal, lui vaudra même le prix Goncourt. Dans "La Conspiration du Murger", issue de ce recueil publié en 1910, le lièvre roux Roussard règne en maître sur la Combe aux Mûres, mais il est chassé par une bande de lapins qui le châtrent… Et dans "La Vie des bêtes", œuvre posthume parue en 1923, c’est à nouveau Roussard le lièvre qu’il met en scène, mais un Roussard roublard qui se joue du chasseur et de son chien avec malice, dans un de ces contes attachants sur les bêtes qui vivent près de nous, dans les forêts et les prairies. »
Extraits de « Lapin Lièvre », un reportage de Pascal Durantel, journaliste spécialiste de nature, cynégétique et halieutique, et des informations diverses issus du dossier « Lapin » de la revue « Billebaude » n° 8, printemps-été 2016, éditions Glénat et Fondation François Sommer pour la chasse et la nature, 96 pages.
|





