Les Papiers collés
de Claude Darras
Été 2021
Carnet : Cinq, six notes de musique…
Y a quelques notes de musique, certaines notes cinq, six, qui pèsent, qui pèsent, cinq, six notes, qui secouent un homme, cinq, six notes, une, deux, trois phrases qui changent un homme, chair, humeur, cœur, et le dedans de la tête ! Jeudi 24 septembre 1998.
(Jules Mougin, « 1912 : toutes les boîtes aux lettres sont peintes en bleu ciel », Travers 53, Philippe Marchal éditeur, 1999)
Nos meilleurs amis…
Si on savait ce que pensent et disent de nous nos meilleurs amis, nous serions horrifiés. Impression d’être trahis, dupés, rage sourde d’avoir trop livré de soi-même pour en arriver à ces misères. Mais ne le sait-on pas, par nous quant à eux ?
(Georges Perros, « Papiers collés », 1960, Œuvres, Quarto Gallimard, 2017)
De l’instinct de propriété
Entre 1980 et 2010, les naturalistes ont observé 310 espèces d’oiseaux sur les rives de l’étang de Berre, précise un des ornithologistes chargés de l’inventaire en préambule d’une réunion tenue début mars à Marignane. Un d’entre eux intervient, irrité pour deux raisons, d’abord parce que la réunion a débuté sans lui, ensuite parce que le volatile dont on évoque les mœurs est la foulque macroule dite en Provence macreuse noire (Fulica atra Linné) et qu’il se considère un peu comme propriétaire du sujet…
Révolutions
Pour accomplir, sur son orbite, un tour complet du Soleil, Mercure met 88 jours, Vénus 224, alors que Mars a besoin de près de 2 ans, Jupiter prend environ 12 ans pour faire son tour, Saturne presque 29 ans et demi, Uranus 84 ans, Neptune 165 ans et Pluton 248 ans.
(Vendredi 26 mars 2021)
Cimaises
La métaphysique selon Franck Villa
 Dans la trajectoire de Franck Villa (Nîmes, 1958), tout événement appelle sa conséquence. Aucune étape de son itinéraire n’a plus d’importance qu’une autre. La première, pourtant, se révèle fondatrice : âgé de 8 ou 10 ans, il crayonne inlassablement sur n’importe quelle bribe de papier qui lui tombe sous la main. Il dessine des personnages de bandes dessinées, croque les héros de la mythologie, copie les combattants de la deuxième guerre mondiale, profile les gens de son quotidien, esquisse les phénomènes météorologiques ainsi que les paysages qu’il scrute déjà avec boulimie et gourmandise. Dans la trajectoire de Franck Villa (Nîmes, 1958), tout événement appelle sa conséquence. Aucune étape de son itinéraire n’a plus d’importance qu’une autre. La première, pourtant, se révèle fondatrice : âgé de 8 ou 10 ans, il crayonne inlassablement sur n’importe quelle bribe de papier qui lui tombe sous la main. Il dessine des personnages de bandes dessinées, croque les héros de la mythologie, copie les combattants de la deuxième guerre mondiale, profile les gens de son quotidien, esquisse les phénomènes météorologiques ainsi que les paysages qu’il scrute déjà avec boulimie et gourmandise.
 À trente ans, sans délaisser la mine de plomb, et accessoirement les crayons de couleur, il se donne au chromatisme de la peinture à l’huile où l’on repère les personnages et les lieux figurés naguère au crayon graphite.
Fonctionnaire de police à Lyon, il poursuit alors ses gammes au musée des Moulages où un cycle d’enseignement étaie ses aptitudes naturelles et conforte sa maîtrise des techniques académiques. Moins de deux décennies plus tard, en 2005, il sent la nécessité de claquer la porte du passé pour aller plus loin. La rupture accouche d’une métamorphose : il peint enfin ce qu’il est, un observateur sagace du temps qui passe, de ses contemporains, des choses de la vie. Il comprend mieux sans doute pourquoi Salvador Dali, Giorgio De Chirico et Kasimir Malevitch l’ont tant bouleversé.
À trente ans, sans délaisser la mine de plomb, et accessoirement les crayons de couleur, il se donne au chromatisme de la peinture à l’huile où l’on repère les personnages et les lieux figurés naguère au crayon graphite.
Fonctionnaire de police à Lyon, il poursuit alors ses gammes au musée des Moulages où un cycle d’enseignement étaie ses aptitudes naturelles et conforte sa maîtrise des techniques académiques. Moins de deux décennies plus tard, en 2005, il sent la nécessité de claquer la porte du passé pour aller plus loin. La rupture accouche d’une métamorphose : il peint enfin ce qu’il est, un observateur sagace du temps qui passe, de ses contemporains, des choses de la vie. Il comprend mieux sans doute pourquoi Salvador Dali, Giorgio De Chirico et Kasimir Malevitch l’ont tant bouleversé.
 Tantôt énigmatique, un tantinet joueur, parfois grave, le peintre construit à la brosse sur la toile de lin des constellations de formes et de volumes qui réfèrent à la quête du sens, aux fins de l’existence, au Dieu, au monde, au moi, à la liberté, à l’immortalité, somme toute à la métaphysique.
Dans « Révolte » (huile sur toile, 73 x 92 cm, 2013), un groupe d’individus - cerclé de rouge - clame sa différence, son humanité au milieu d’un quartier urbain, quadrangulaire et tranchant, nanti de perspectives outrées et d’ombres menaçantes. Toutes les couleurs de la palette sont expulsées de « La Tête du peintre » (h/t, 81 x 65 cm, 2021) à l’exception d’une seule, le noir de l’infinitude cosmique. La fluidité poétique des « Pierres dans la rivière » (h/t, 92 x 65 cm, 2018) témoigne de l’obsession latente de l’artiste à transcrire la nature dont il reste si épris.
Tantôt énigmatique, un tantinet joueur, parfois grave, le peintre construit à la brosse sur la toile de lin des constellations de formes et de volumes qui réfèrent à la quête du sens, aux fins de l’existence, au Dieu, au monde, au moi, à la liberté, à l’immortalité, somme toute à la métaphysique.
Dans « Révolte » (huile sur toile, 73 x 92 cm, 2013), un groupe d’individus - cerclé de rouge - clame sa différence, son humanité au milieu d’un quartier urbain, quadrangulaire et tranchant, nanti de perspectives outrées et d’ombres menaçantes. Toutes les couleurs de la palette sont expulsées de « La Tête du peintre » (h/t, 81 x 65 cm, 2021) à l’exception d’une seule, le noir de l’infinitude cosmique. La fluidité poétique des « Pierres dans la rivière » (h/t, 92 x 65 cm, 2018) témoigne de l’obsession latente de l’artiste à transcrire la nature dont il reste si épris.
Aumône
L’aumône consiste à distribuer des clous à des gens qui n’ont pas de semelles.
(Léonce Bourliaguet, De sel et de poivre, éditions Magnard, 1963
Rire ou pleurer ?
Nombreux clients dans le café du Commerce. Conversations bruyantes, tournées répétées, plaisanteries grasses… Le bistrotier est de plus en plus maigre et complètement fou, un fou gai, qui n’en finit pas de pleurer à force de rire.
(Lundi 29 mars 2021)
|
Billet d’humeur
Un puissant agent de blanchiment
L’eau de Javel demeure l’un des désinfectants les plus actifs deux cent trente ans après avoir été découverte. Elle nous est tellement familière qu’on en a oublié ses vertus, inondés que nous sommes sous les slogans racoleurs d’une publicité qui vante les mérites comparés du désinfectant sans éponge ou du détergent de madame Propre. Cette eau de Javel trouve son origine dans le blanchiment des toiles et des fils. Sur les bords des rivières, les lavandières savent comment blanchir des textiles après une série d’opérations de lessivage. La rusticité du procédé aiguise la curiosité du chimiste Claude-Louis Berthollet (Talloires, 1748-Arcueil, 1822) qui démontre que l’effet blanchissant est dû à l’oxygène de l’air. En 1789, alors à la direction des teintures de l’Académie des sciences, il parvient à reproduire artificiellement le phénomène en utilisant à la fois de l’eau de chlore et de la potasse. L’élément chimique du chlore a été obtenu en 1774 par le chimiste suédois Carl Scheele (1742-1786) sous l’action de l’acide chlorhydrique sur le bioxyde de manganèse. Le comte Berthollet conduit ses expérimentations dans une manufacture de produits chimiques appartenant à des proches du comte d’Artois, le frère du roi Louis XVI. L’établissement industriel se situe dans le village de Javel (aujourd’hui quartier du 15e arrondissement de Paris), à proximité d’un moulin et d’une guinguette, d’où le nom donné à l’agent de blanchiment. Très vite, les scientifiques prennent conscience des vertus désinfectantes de l’eau de Javel. Profitant de l’existence sur le marché du carbonate de sodium, moins onéreux que la potasse, un pharmacien pyrénéen, Antoine Labarraque (1777-1850), met au point l’hypochlorite de sodium, autrement dit l’eau de Javel que nous utilisons aujourd’hui. In vitro, avec une dilution au 1/100e d’eau de Javel, toutes les bactéries sont détruites en trente secondes : staphylocoques, vibrions cholériques, salmonelles ou virus responsables d’infections poliomyélitiques ne lui résistent pas. Nos contemporains l’ont bien compris puisqu’ils achètent chaque année en France 130 millions de litres de javel, conditionnés en berlingots et en bouteilles de matière plastique.
|
Lecture critique
Revue Belvédère : un point de vue remarquable
 Depuis douze années, la revue trimestrielle « Belvédère » offre à ses lecteurs un point de vue remarquable pour découvrir l’œuvre profus d’un poète et romancier italien d’exception. Dramaturge, critique d’art et de littérature de surcroît, né à Messine (Sicile) en 1937, Andrea Genovese étonne et intimide ses pairs par l’étendue de ses curiosités, la pertinence de ses avis et l’élégance de son écriture. Sachant qu’unique animateur et rédacteur de ladite revue (avec cependant le concours de Vanessa De Pizzol), il s’exprime aussi bien en italien, en français qu’en dialecte sicilien. Dans la toute dernière livraison, le revuiste nous livre « Vocations pastorales », une nouvelle rafraîchissante, gentiment coquine et gouvernée par les astres : dans une auberge de jeunesse, le narrateur rencontre Monique qui lui propose de randonner au travers du massif alpestre jusqu’à une bergerie tenue par Jean-Paul et sa compagne Alexia… N’en disons pas davantage afin de ne pas déflorer le caractère inédit du texte qui est un bijou de nouvelliste ! Au nombre des notes de lecture, l’évocation du philosophe et poète roumain Lucian Blaga (1895-1961) répare l’injustice d’une méconnaissance dans laquelle est tenue en France ce Transylvain inspiré, littérateur aussi considérable que son compatriote plus connu, Emil Cioran. Le même souci guide Andrea Genovese dans la passerelle tendue à Hrvoje Pejaković (1960-1996), poète, essayiste et critique croate, dont les confidences intimes entretenues avec le lecteur n’excluent pas les intermittences brûlantes d’un verbe à très haute tension. L’initiation à ces deux grandes voix de la poésie doivent beaucoup - on ne le dit pas assez - aux passeurs au long cours que sont les traducteurs Jean Poncet et Brankica Radić. Depuis douze années, la revue trimestrielle « Belvédère » offre à ses lecteurs un point de vue remarquable pour découvrir l’œuvre profus d’un poète et romancier italien d’exception. Dramaturge, critique d’art et de littérature de surcroît, né à Messine (Sicile) en 1937, Andrea Genovese étonne et intimide ses pairs par l’étendue de ses curiosités, la pertinence de ses avis et l’élégance de son écriture. Sachant qu’unique animateur et rédacteur de ladite revue (avec cependant le concours de Vanessa De Pizzol), il s’exprime aussi bien en italien, en français qu’en dialecte sicilien. Dans la toute dernière livraison, le revuiste nous livre « Vocations pastorales », une nouvelle rafraîchissante, gentiment coquine et gouvernée par les astres : dans une auberge de jeunesse, le narrateur rencontre Monique qui lui propose de randonner au travers du massif alpestre jusqu’à une bergerie tenue par Jean-Paul et sa compagne Alexia… N’en disons pas davantage afin de ne pas déflorer le caractère inédit du texte qui est un bijou de nouvelliste ! Au nombre des notes de lecture, l’évocation du philosophe et poète roumain Lucian Blaga (1895-1961) répare l’injustice d’une méconnaissance dans laquelle est tenue en France ce Transylvain inspiré, littérateur aussi considérable que son compatriote plus connu, Emil Cioran. Le même souci guide Andrea Genovese dans la passerelle tendue à Hrvoje Pejaković (1960-1996), poète, essayiste et critique croate, dont les confidences intimes entretenues avec le lecteur n’excluent pas les intermittences brûlantes d’un verbe à très haute tension. L’initiation à ces deux grandes voix de la poésie doivent beaucoup - on ne le dit pas assez - aux passeurs au long cours que sont les traducteurs Jean Poncet et Brankica Radić.
- Belvédère, par Andrea Genovese et Vanessa De Pizzol, n° 60, janvier-mars 2021, 24 pages, revue éditée par l’association La Déesse Astarté.
Portrait
De l’engagement de J. M. G. Le Clézio
 « Écrire est un besoin… C’est à l’intérieur de vous-même. Ça a besoin de sortir, et de sortir sous cette forme. Si vous modifiez la structure de ce que vous faites, il me semble qu’alors vous n’aurez plus envie de continuer. Écrire n’est pas facile. Écrire est un art, qui demande beaucoup d’entraînement ; je veux dire, qui exige davantage que de connaître le dictionnaire de la langue française et la syntaxe de cette langue. Il faut avoir lu des auteurs, les avoir digérés, avoir éprouvé le besoin de faire mieux qu’eux. » Si les motivations de l’écriture qu’il livre à Gérard de Cortanze (Paris, 1948) en février 1998 sont communes à bien d’autres écrivains, il importe de souligner chez Jean-Marie Gustave Le Clézio (Nice, 13 avril 1940) le souci d’une perpétuelle recherche, celle de retrouver les mythologies, la langue, l’identité, la terre même des populations avec lesquelles la civilisation régnante a rompu. Qu’il s’agisse du Nouveau Mexique, du Panamá, du Nigéria, de la Corée, du Maroc, de l’archipel du Vanuatu, de la Chine, des îles Rodrigues et Maurice où plongent ses racines, il cherche à sauver de l’oubli par l’écriture ses semblables fraternels, leur patrimoine et leurs âmes menacés d’extinction. « Écrire est un besoin… C’est à l’intérieur de vous-même. Ça a besoin de sortir, et de sortir sous cette forme. Si vous modifiez la structure de ce que vous faites, il me semble qu’alors vous n’aurez plus envie de continuer. Écrire n’est pas facile. Écrire est un art, qui demande beaucoup d’entraînement ; je veux dire, qui exige davantage que de connaître le dictionnaire de la langue française et la syntaxe de cette langue. Il faut avoir lu des auteurs, les avoir digérés, avoir éprouvé le besoin de faire mieux qu’eux. » Si les motivations de l’écriture qu’il livre à Gérard de Cortanze (Paris, 1948) en février 1998 sont communes à bien d’autres écrivains, il importe de souligner chez Jean-Marie Gustave Le Clézio (Nice, 13 avril 1940) le souci d’une perpétuelle recherche, celle de retrouver les mythologies, la langue, l’identité, la terre même des populations avec lesquelles la civilisation régnante a rompu. Qu’il s’agisse du Nouveau Mexique, du Panamá, du Nigéria, de la Corée, du Maroc, de l’archipel du Vanuatu, de la Chine, des îles Rodrigues et Maurice où plongent ses racines, il cherche à sauver de l’oubli par l’écriture ses semblables fraternels, leur patrimoine et leurs âmes menacés d’extinction.
Le désert des hommes bleus
En 1963, le jeune niçois qui lit et écrit (un peu) depuis l’âge de 7 ans rêve de remporter le prix Formentor, créé à Majorque par le poète et éditeur espagnol Carlos Barral à l’hôtel Formentor. Il envoie, par la poste, aux éditions Gallimard et à l’attention de Georges Lambrichs, directeur de la collection Le Chemin, le manuscrit du roman « Le Procès-verbal » qu’il a rédigé durant l’été caniculaire sous l’influence de J. D. Salinger, l’auteur américain de L’Attrape-cœurs. Une notule l’accompagne : « "Le Procès-verbal" raconte l’histoire d’un homme qui ne savait pas trop s’il sortait de l’armée ou de l’asile psychiatrique ». Lu et publié par G. Lambrichs, l’ouvrage ne remporte pas ledit prix Formentor (qui est attribué à l’écrivain allemand Uwe Johnson) mais il manque de peu le prix Goncourt et reçoit le Renaudot. La notoriété et la rencontre d’Henri Michaux ne l’empêchent pas de prolonger sa passion coutumière des voyages. Il frotte sa curiosité aux Indiens Emberá du Panamá et à leurs cousins germains, les Waunanas ; il se passionne pour la civilisation préhispanique au point de résider de longues années au Mexique dans les régions rurales du Yucatán et du Michoacán ; il découvre dans le Sud marocain au côté de sa femme Jemia Jean le désert des hommes bleus « attiré par ce que les autres en avaient dit. Un peu comme quelqu’un qui écrit, guidé vers le désert par les légendes et les paroles. Ou comme Monod, le scientifique, ou comme certains ethnographes, ou comme Leiris, qui ont pu être attirés par le désert par ce qu’ils en attendaient d’humain, parce qu’ils savaient qu’ils allaient rencontrer des gens et qu’ils sentaient que cela allait les transformer ».
L’enfant des landes bretonnes
 Prix Nobel de la littérature en octobre 2008, J. M. G. Le Clézio est considéré par le jury de l’académie suédoise comme l’« explorateur d’une humanité au-delà et en dessous de la civilisation régnante ». Cette distinction internationale décuple son audience et lui permet d’atteindre aussi le monde des puissants, explique la romancière et critique littéraire Aliette Armel (Neuilly-sur-Seine, 1951) dans son ouvrage « Le Clézio, l’homme du secret » : « Il envisageait ces festivités comme une caisse de résonance pour son combat en faveur de l’interculturalité et de la prise en compte, à égalité, de toutes les voix, de tous les peuples et de toutes les langues ». Prix Nobel de la littérature en octobre 2008, J. M. G. Le Clézio est considéré par le jury de l’académie suédoise comme l’« explorateur d’une humanité au-delà et en dessous de la civilisation régnante ». Cette distinction internationale décuple son audience et lui permet d’atteindre aussi le monde des puissants, explique la romancière et critique littéraire Aliette Armel (Neuilly-sur-Seine, 1951) dans son ouvrage « Le Clézio, l’homme du secret » : « Il envisageait ces festivités comme une caisse de résonance pour son combat en faveur de l’interculturalité et de la prise en compte, à égalité, de toutes les voix, de tous les peuples et de toutes les langues ».
La même année, il prend publiquement position pour la protection des peuples menacés de disparition avec leur culture et leurs terres sacrées comme les Innus du Canada. Il renouvellera son engagement pour les Chagossiens d’un archipel de l’océan Indien, en 2009, les Huichols de la Sierra Madre, au Mexique, en 2012, et les Indiens Kuna  de l’archipel des San Blas, au Panamá, de la même façon qu’il avait dénoncé la prostitution enfantine en Thaïlande en 1967 et milité en faveur des baleines grises et contre les essais nucléaires en 1995. Auteur d’une cinquantaine d’ouvrages, romans, récits, contes et essais, il dit aussi raconter l’histoire de sa parentèle de fermiers bretons dont l’acte de naissance se situe à la fin du XVIIIe siècle, lorsque son aïeul François Alexis quitta la Bretagne pour tenter sa chance sur l’île de France, devenue plus tard l’île Maurice, là où l’écrivain a grandi et d’où sont originaires ses deux parents (père médecin mauricien - donc britannique à l’époque - et mère française). Selon sa biographe Aliette Armel, « ses séjours avaient confirmé dans la voie du silence et du secret l’enfant des landes bretonnes, héritier des non-dits familiaux enfouis à "Eurêka", la propriété de l’île Maurice ». de l’archipel des San Blas, au Panamá, de la même façon qu’il avait dénoncé la prostitution enfantine en Thaïlande en 1967 et milité en faveur des baleines grises et contre les essais nucléaires en 1995. Auteur d’une cinquantaine d’ouvrages, romans, récits, contes et essais, il dit aussi raconter l’histoire de sa parentèle de fermiers bretons dont l’acte de naissance se situe à la fin du XVIIIe siècle, lorsque son aïeul François Alexis quitta la Bretagne pour tenter sa chance sur l’île de France, devenue plus tard l’île Maurice, là où l’écrivain a grandi et d’où sont originaires ses deux parents (père médecin mauricien - donc britannique à l’époque - et mère française). Selon sa biographe Aliette Armel, « ses séjours avaient confirmé dans la voie du silence et du secret l’enfant des landes bretonnes, héritier des non-dits familiaux enfouis à "Eurêka", la propriété de l’île Maurice ».
- Le Clézio, l’homme du secret, par Aliette Armel, Le Passeur éditeur, 160 pages, 2019 ;
- Ritournelle de la faim, par J.M.G. Le Clézio, Gallimard Nrf, 224 pages, 2008 ;
- Quinze causeries en Chine - Aventure poétique et échanges littéraires, par J.M.G. Le Clézio, avant-propos et recueil des textes par Xu Jun, Gallimard Nrf, 208 pages, 2019 ;
- J.M.G. Le Clézio, croyances et mythologies, dans Le Magazine littéraire, n° 362, février 1998, « Une littérature de l’envahissement », propos recueillis par Gérard de Cortanze.
Varia : Gérard Titus-Carmel et l’informulable musique des sphères
 Peintre, dessinateur et graveur, Gérard Titus-Carmel (Paris, 1942) est aussi un littérateur sensible et nourri de multiples curiosités. Dans un entretien avec la critique d’art Évelyne Artaud qui suggère que l’approche et la pratique de son travail ne sont pas très éloignées d’un art guerrier ou martial, il répond en ces termes : Peintre, dessinateur et graveur, Gérard Titus-Carmel (Paris, 1942) est aussi un littérateur sensible et nourri de multiples curiosités. Dans un entretien avec la critique d’art Évelyne Artaud qui suggère que l’approche et la pratique de son travail ne sont pas très éloignées d’un art guerrier ou martial, il répond en ces termes :
« Martial, je ne sais pas. Mais il y a peut-être du samurai en moi si l’on entend par ce mot, au moins ici, en Occident - mais sans évoquer, bien sûr, je ne sais quel code d’honneur -, une certaine discipline, l’intérêt, dans le travail, de la construction, de la résolution des contraires, de tout ce qui nous fait espérer ce point d’équilibre qui fait centre en nous, ce que j’ai pu nommer un "travail de beauté" dans mon livre, Le Huitième pli. La beauté, oui… Mais qui, décidément, toujours nous échappe… Pourtant, il doit bien y avoir dans l’art, tel que nous l’envisageons, cet accord secret qui fait que tout n’est pas perdu, qu’il y a quelque part un lieu de perfection et d’évidence vers lequel tout aspire et demeure tendu, comme vers un horizon, toujours à dépasser, mais jamais atteint. Et voilà qu’on retourne à notre âpre cheminement de tout à l’heure, à cette progression qui n’est pas une promenade de santé, mais plutôt une épuisante expédition vers ces rivages où les contraires cesseront enfin d’être perçus contradictoirement. Un rêve… Mais nous savons, n’est-ce pas, qu’il n’y a pas d’autre destination ni de but à nos belles pérégrinations que ce leurre ; qu’elles sont justement belles en cela qu’elles ne mènent à nul autre lieu que du bon côté de la vitre d’où nous pouvons admirer le dehors inaccessible. Avec, comme seul compagnon d’armes, notre soupçon de vivre dans cette distance permanente qui nous tient si loin de l’horizon…
« Tu parlais d’art guerrier, dans ta question. Eh bien, je peux te le confirmer : d’embus en retombes, une guerre perdure, en effet, là où l’on bâtit contre cette mémoire qui innerve par-dessous l’œuvre en devenir et la taie qu’elle dépose, ce flou, pour tout dire, c’est le out of focus définitif qui nous tient détachés à jamais de la netteté du monde.
« C’est pour cette raison qu’on peint, qu’on grave et dessine. Qu’on organise l’informulable musique des sphères, qu’on rebâtit le monde avec les mots. Ce qui nous permet de vivre dans l’orgueil de notre fiction. Et, en ce qui me concerne, quand le travail de la journée sèche sur le mur et que le dernier mot clôt la page… »
Extrait de l’entretien intitulé « Ramures & Retombes » (2017) dans l’ouvrage « Écrits de chambre et d’écho », par G. Titus-Carmel, préface de Thomas Augais (maître de conférences à l’université Paris-Sorbonne), L’Atelier contemporain, 646 pages, 2019.
Carnet : alouettes et Saint-Esprit
Faire le Saint-Esprit, cela signifie que l’alouette, les ailes étendues immobiles, plane lentement au-dessus du miroir d’un lac.
Le festin des philosophes
Le « symposium » des savants d’aujourd’hui, philosophes et scientifiques, ne désignait-il pas initialement un banquet voué aux libations ?
(Mardi 20 avril 2021)
|
Billet d’humeur
À l’écoute du criquet des mers
Moins mélodieux que le chant des sirènes, les cris de la langouste rouge (Palinurus elephas, Fabricius, 1787) interpellent les scientifiques qui se sont rendus compte que cette victime emblématique de la surpêche occupait le peloton de tête parmi les araignées de mer, oursins, homards, coquilles Saint-Jacques et autres braillards sous-marins. Dans la baie de Sainte-Anne-du-Portzic, près de Brest, des chercheurs bretons ont installé au printemps 2020 une série d’hydrophones afin d’en savoir davantage sur les sons émis par le crustacé. Les vieux pêcheurs du Finistère surnommaient déjà la langouste commune qu’ils pêchaient en mer d’Iroise de « criquet des mers ». Capturée, la langouste frotte souvent ses deux antennes, à la manière de ses homologues terrestres, cousins arthropodes éloignés. L’émission de ces crissements d’antennes a pour but de faire fuir leurs prédateurs, poulpes ou poissons. Comme on pouvait s’y attendre, les sons les plus élevés sont émis par les plus gros individus. Certains d’entre eux peuvent atteindre une intensité considérable : jusqu’à 167 décibels (dB), ce qui classe la langouste commune ou rouge la deuxième espèce de crustacé la plus bruyante, immédiatement après la crevette pistolet (Alpheus dentipes, Guérin, 1832). Spécialistes des paysages sonores sous-marins, des bio-acousticiens ont remarqué que leurs équipements d’écoute et d’enregistrement étaient capables de détecter les sons ou les râpes des langoustes rouges à 100 mètres de distance. Nombre de questions n’ont cependant pas encore trouvé leurs réponses quant à la fréquence de la production sonore, à son utilité, à sa portée et à sa destination (communication et/ou alerte).
|
Lecture critique
Le souffle épique de Pierre Peuchmaurd
 Le chapelet d’émotions que suscitent la lecture et la relecture obligée d’un poème de Pierre Peuchmaurd (Paris, 1948-Brive-la-Gaillarde, 2009) est livré par étapes successives et bien défendues. L’homme reste imprévisible et les structures profondes de son écriture ne sont perçues qu’au terme d’un long chemin pavé d’intuitions provisoires et d’interprétations avortées. L’apparente simplicité du texte accroit les difficultés de l’herméneute à effacer totalement l’opacité elliptique d’un verbe si bellement imagé. De « Giroflées » au « Secret de ma jeunesse », l’auteur éprouve assurément la puissance de tous ses sens et le lecteur se surprend à exercer à son tour ses propres facultés pour mieux en apprécier le lyrisme et la sensualité. Sensuelle et charnelle en effet, la parole du poète évoque le temps qui passe, l’intimité du logis campagnard, la nostalgie de l’enfance, le passage des saisons, l’ennui des habitudes, les intermittences du cœur et de la raison, la vie et la mort ; elle déplie les douze mois de l’année en trente-six strophes. Elle nous parle des loups perdus et des faisans rouges : du Sanglier triste du galop (« Peu d’art ») et du lion reins rompus à un bond du mirage (« Vie et mort d’un miroir de lierre »). Dans « Giroflées », elle convoque Arthur Rimbaud et son ami Ernest Delahaye : Le chapelet d’émotions que suscitent la lecture et la relecture obligée d’un poème de Pierre Peuchmaurd (Paris, 1948-Brive-la-Gaillarde, 2009) est livré par étapes successives et bien défendues. L’homme reste imprévisible et les structures profondes de son écriture ne sont perçues qu’au terme d’un long chemin pavé d’intuitions provisoires et d’interprétations avortées. L’apparente simplicité du texte accroit les difficultés de l’herméneute à effacer totalement l’opacité elliptique d’un verbe si bellement imagé. De « Giroflées » au « Secret de ma jeunesse », l’auteur éprouve assurément la puissance de tous ses sens et le lecteur se surprend à exercer à son tour ses propres facultés pour mieux en apprécier le lyrisme et la sensualité. Sensuelle et charnelle en effet, la parole du poète évoque le temps qui passe, l’intimité du logis campagnard, la nostalgie de l’enfance, le passage des saisons, l’ennui des habitudes, les intermittences du cœur et de la raison, la vie et la mort ; elle déplie les douze mois de l’année en trente-six strophes. Elle nous parle des loups perdus et des faisans rouges : du Sanglier triste du galop (« Peu d’art ») et du lion reins rompus à un bond du mirage (« Vie et mort d’un miroir de lierre »). Dans « Giroflées », elle convoque Arthur Rimbaud et son ami Ernest Delahaye :

|
Je vois Rimbaud. Il est avec Delahaye. Il cueille des giroflées sur le vieux rempart. C’est prouvé. La mer est noire, le sang compté.
D’une main, le gant de crin ; de l’autre une pierre ou un biscuit. L’eau rêve doucement entre ses ruines. Personne n’est vivant, ces jours-ci.
Verdeur ? Verdure ? On n’a pas d’exemple à citer, mais il y a sûrement un terme à tout ça.
|
Issu du recueil « Le Secret de ma jeunesse », Bois parfaits exhale la même tension dans ses laisses et une égale aspiration à l’épure, à la nudité, à l’écorché :

|
Bois parfaits aux lisières
et dans leur centre, enfers
Des eaux rouges roulent dans l’ombre
de lourds moutons y flottent
gonflés et sourds à ce printemps
Quand la lisière bleuit
tout le temps recommence
Le rond des pluies
des nuits violettes
fourrées de lions
et de clous vierges
et de sang de perdrix
sur la dalle des silences
Le rond des pluies
autour du lit
Rose l’épine de ta chair
Rose ta griffe dans le rouge
J’allais vers tes raisons
avec des dents de lait
J’allais me pendre au vent
aux violons de ton vent
et à tes crocs de lait
Octobre est là, tiens-le serré
Les brumes y filent le bas des songes
les bêtes y filent vers la boucherie
Ce qui s’égoutte ressemble au vin
et l’eau des veaux à la lumière
|
Tout à trac, Pierre Peuchmaurd interpelle les gens et les bêtes, les plantes et les lieux qu’il dote parfois de la capacité de lui répondre. Émotif autant que narratif, les registres qu’il fait jouer composent une œuvre qui dissimule en ses tréfonds tout son suc, une œuvre qui favorise l’écart et adopte le pas de côté. Aussi, comme on s’arrête en lisière d’un bois de haute futaie ou sur le seuil d’une porte corrodée par les griffes du lierre, il convient de nous arrêter quelques instants avant d’entrer et relire plusieurs fois les confidences du conteur afin de ressentir le souffle épique qui le porte.
Pierre Peuchmaurd © Photo Antoine Peuchmaurd
- Giroflées, par Pierre Peuchmaurd, frontispice de Jean-Pierre Paraggio, Pierre Mainard éditeur, 82 pages, 2017 ;
- Le Secret de ma jeunesse suivi de Les Jours de rangement, par P. Peuchmaurd, frontispice de Jean-Pierre Paraggio, Pierre Mainard éditeur, 112 pages, 2019.
Portrait
Le Greco ou la résurrection d’un génie
 « Fond abstrait, doré à la feuille d’or, niant toute perspective, figures hiératiques et stylisées, draperies irréalistes enveloppant des corps immatériels de savantes calligraphies » : l’historien de l’art et journaliste Jérôme Coignard (né en 1957) explique pertinemment comment Domenikos Theokopoulos (1541-1614), plus connu sous son surnom d’El Greco, est né à la peinture dans la stricte observance byzantine. Ce Crétois naît à Candie (Héraklion) en 1541 dans une famille de marins et de marchands : son frère aîné, collecteur d’impôts, subvient à ses besoins le temps qu’il apprenne la peinture. Créateur d’icônes (madonniero) jusqu’en 1567, il passe de la tempera à la peinture à l’huile, du panneau de bois à la toile, du souvenir de Byzance à la Venise de Titien et de Tintoret, puis de Venise à Rome et à l’austère Tolède, au travers de tableautins de dévotion de quelques centimètres jusqu’aux retables de plus de 3 mètres, sans pour autant être un grand mystique. « Fond abstrait, doré à la feuille d’or, niant toute perspective, figures hiératiques et stylisées, draperies irréalistes enveloppant des corps immatériels de savantes calligraphies » : l’historien de l’art et journaliste Jérôme Coignard (né en 1957) explique pertinemment comment Domenikos Theokopoulos (1541-1614), plus connu sous son surnom d’El Greco, est né à la peinture dans la stricte observance byzantine. Ce Crétois naît à Candie (Héraklion) en 1541 dans une famille de marins et de marchands : son frère aîné, collecteur d’impôts, subvient à ses besoins le temps qu’il apprenne la peinture. Créateur d’icônes (madonniero) jusqu’en 1567, il passe de la tempera à la peinture à l’huile, du panneau de bois à la toile, du souvenir de Byzance à la Venise de Titien et de Tintoret, puis de Venise à Rome et à l’austère Tolède, au travers de tableautins de dévotion de quelques centimètres jusqu’aux retables de plus de 3 mètres, sans pour autant être un grand mystique.
Le Crétois de Tolède
Il ne reste que deux années dans la cité vénitienne (dont la Crète est une colonie depuis le début du XIIIe siècle) avant de s’établir, en 1570, à Rome où il est hébergé deux ans plus tard au palais Farnèse. S’il revient à Venise en 1575, il quitte définitivement la péninsule italienne en raison de l’épidémie de peste à laquelle succombe Titien à la fin de 1576. En octobre de cette année-là, il est en Espagne, où il accomplit l’essentiel de son œuvre, installé à Tolède où il meurt en 1614. Dans l’ouvrage « El Greco, le Crétois de Tolède », Richard Aboaf (né en 1954) avance que « l’établissement d’El Greco en Espagne peut avoir été favorisé par le sculpteur maniériste toscan, Pompe Leoni, qui travaillait à la cour d’Espagne, et dont il aurait fait le portrait à Rome ». Il semble que le peintre candiote espérait rejoindre à Madrid le cercle très fermé des peintres officiels de Philippe II (1527-1598). Mais son style maniériste, son influence byzantine, sa vision de l’espace, son chromatisme osé ont, semble-t-il, déplu au monarque. Dès 1577, El Greco vit et travaille à Tolède qui rassemble une petite colonie grecque. Liée à l’industrie textile et aux ateliers de fabrication d’épées, l’ancienne capitale politique du royaume convient au Crétois qui apprécie la ville et ses populations, sa cathédrale et ses églises, ses couvents et ses monastères. La ville où il passe trente-sept ans témoigne de son mariage avec Dona Jeromina de Las Cuevas, avec laquelle il vécut toute sa vie, et qui lui donna un fils, Jorghe Manuel, qui travaillera avec lui et sera son exécuteur testamentaire. « El Greco mourut le 7 avril 1614 à l’âge probable de 73 ans, retrace R. Aboaf ; il fut enterré dans le tombeau qu’il avait acquis à Santo Domingo el Antiguo. Ses restes, on ne sait pourquoi, furent transportés en 1619 par son fils au couvent de San Torcuato, et furent dispersés par la suite, on ne sait exactement où ni à quelle date. »
Un génie posthume
Est-ce le manque de clairvoyance des amateurs ? On comprend mal comment un tel génie a pu être oublié durant près de quatre siècles. Aujourd’hui, des experts - plus lucides que leurs ascendants ? - assurent que l’art du Crétois de Tolède a influencé les peintres romantiques de la seconde moitié du XXe siècle, les impressionnistes, les cubistes, les expressionnistes allemands, la peinture américaine contemporaine. Celui qui appariait l’héritage vénitien au maniérisme toscan avec des réminiscences nordiques et byzantines aurait intimidé Manet, enthousiasmé Degas et bouleversé Francis Bacon ! Le Greco préférait l’œuvre sculptée de Michel Ange à son œuvre peinte, ainsi qu’il le confia, en 1611, à Francisco Pacheco, le maître et beau-père de Velázquez qui lui avait rendu visite à Tolède. L’homme n’était pas commode assure, vers 1775, F. G. De Salas : « Cet original de Greco, sec et parcheminé, fut de la couleur du scorbut, la figure longue et les flancs maigres. Il parlait d’un ton grave, avec des accès de toux caverneuse, et il se plaignait sans cesse. Mais il était capable avec son flegme et sa patience somnolente d’engager une querelle pour un grain de moutarde ».
- El Greco, le Crétois de Tolède, par Richard Aboaf, éditions du Signe, 140 pages, 2014 ;
- « Les titubantes icônes du Greco », par Jérôme Coignard, quotidien Le Figaro, samedi 21 et dimanche 22 février 2004.
Lecture complémentaire :
- Temps modernes XVe- XVIIIe siècles, sous la direction de Claude Mignot et Daniel Rabreau, Histoire de l’art/Flammarion, 604 pages, 2011.
Varia : la ferme piscicole, une fausse bonne idée ?
« Se tourner vers les produits importés de l’aquaculture n’est pas une solution, et encore moins une alternative durable. "Interactions des poissons échappés avec les espèces sauvages, pollution des eaux par des rejets de produits chimiques, densité au mètre carré excessive… l’impact environnemental et social des fermes intensives d’élevage de saumon en Norvège, en Écosse ou au Chili, ou des crevettes tropicales en Asie et en Équateur, est épouvantable !", alerte Élodie Martinie-Cousty, responsable du réseau Océans de l’association France nature environnement. Pour oublier le saumon, les truites élevées en France sont une bonne option. "Les acteurs de la pisciculture française sont plus vertueux car la réglementation est nettement plus restrictive", soutient Selim Azzi, chargé du programme Pêche et aquaculture durable au WWF. Le label bio garantit l’absence  d’antibiotiques et d’OGM dans l’alimentation des poissons mais n’apporte aucune garantie sur la densité de concentration ou l’origine de l’élevage. Comme pour les légumes et les fruits, apprenez aussi à identifier les saisons des poissons des côtes françaises. En jeu, le respect de la période de reproduction des espèces. "Par exemple, on ne mange pas de bar de fin décembre à fin mars car c’est la période où il se reproduit", analyse Élodie Martinie-Cousty. "Théoriquement, on ne trouvera pas de bar pêché à la ligne en hiver car la plupart des ligneurs respectent la biologie du poisson, mais ce n’est pas le cas des chaluts qui le pêchent dans des quantités monstres pendant sa période de reproduction." d’antibiotiques et d’OGM dans l’alimentation des poissons mais n’apporte aucune garantie sur la densité de concentration ou l’origine de l’élevage. Comme pour les légumes et les fruits, apprenez aussi à identifier les saisons des poissons des côtes françaises. En jeu, le respect de la période de reproduction des espèces. "Par exemple, on ne mange pas de bar de fin décembre à fin mars car c’est la période où il se reproduit", analyse Élodie Martinie-Cousty. "Théoriquement, on ne trouvera pas de bar pêché à la ligne en hiver car la plupart des ligneurs respectent la biologie du poisson, mais ce n’est pas le cas des chaluts qui le pêchent dans des quantités monstres pendant sa période de reproduction."
« Et attention à la sole minuscule sur l’étal ! La capture de certaines espèces (anchois, dorade, sardine, merlu, bar…) doit respecter une taille minimale, définie par arrêté ministériel. Cela permet de s’assurer que le poisson acheté est adulte et s’est reproduit au moins une fois. »
Extrait de « Local et de saison, mon poisson ! », une enquête de Ingrid Van Houdenhove, parue dans le bimestriel « 4 Saisons » n° 244 de septembre-octobre 2020, édité par la scop Terre vivante, 100 pages.
Carnet : vous avez dit biographie ?
Littré définit la biographie comme une « sorte d’histoire qui a pour objet la vie d’une seule personne ».
(Lundi 26 avril 2021)
De la méchanceté
La méchanceté humaine, prétend André Maurois, qui est grande, se compose, pour une large part, de jalousie et de crainte. Le malheur la désarme…
Un bon conseil
Le seul conseil important que Bernard Buffet estime avoir reçu de Narbonne (l’unique professeur qu’il appréciait à l’École des Beaux-Arts) ne pouvait que lui plaire : « N’écoutez pas ce que je vous dis. Faites ce que vous êtes ! » (Yann Le Pichon, Bernard Buffet, peintre (1943-1981), éd. Maurice Garnier-La Bibliothèque des Arts. Année 1950)
(Vendredi 30 avril 2021)
Contemplation picturale
Presque résigné, presque désolé, l’écrivain Jean Tardieu (1903-1995) reconnaît : « … nous n’avons pas d’autres moyens que la parole pour rendre compte de notre étonnement, de notre délectation, de tout ce qui se met en route dans notre esprit à la vue d’une toile de maître. »
(Samedi 15 mai 2021)
|
Billet d’humeur
Des hêtres en migration
Depuis mai 2008, la forêt varoise de hêtres matures de la Sainte-Baume figure sur la Liste des unités conservatoires inscrites au registre national, unités dont la finalité est de préserver in situ les ressources génétiques forestières d’intérêt national et de pourvoir si nécessaire à la (re)plantation des espèces conservées. Centrée sur un noyau dur de 14 hectares, l’unité conservatoire de la Sainte-Baume se prévaut de sauvegarder l’originalité génétique de la population de hêtres qui, isolée dans une zone refuge, possède un phénotype particulier adapté aux conditions climatiques. Dans le cadre d’une opération de « migration assistée », l’Office national des forêts a été sollicité pour exporter semences et plants de hêtres issus de son unité de la Sainte-Baume à Verdun (Meuse) dont le massif forestier s’étend sur près de 10 000 hectares. L’entreprise a été baptisée « Projet Giono », d’après Jean Giono (1895-1970), l’auteur de « L’homme qui plantait des arbres » - l’histoire d’un berger, Elzéard Bouffier, qui a fait pousser seul quelque 10 000 chênes sur les hauteurs de Manosque, en mettant simplement en terre des glands. Issu de la famille des fagacées et procédant de l’ordre des fagales, le genre Fagus (ancien nom latin du hêtre, du grec phagein, « manger ») concerne 10 espèces des régions tempérées de l’hémisphère nord. On le nomme aussi faou, fau, fou, fouteau, foyard, fayard qui sont autant d’altérations du nom latin fagus. Le mot hêtre dérive du germanique heister et du francique haistr. Le vocable latin a donné à la fois « fouet », instrument primitivement constitué d’une baguette de hêtre, et « fouine », parce que le mustélidé affectionne les anfractuosités des vieux hêtres pour se loger. Au IIIe s., les Scandinaves - du Danemark - utilisaient son écorce intérieure, celle qui touche directement l’aubier, pour dérouler les signes runiques de leur alphabet : ils appelaient le hêtre boeki, d’où dérivèrent les mots anglais book, allemand buch et français bouquin. Avec le réchauffement climatique, le hêtre pourrait disparaître d’une parte de l’Hexagone, s’inquiètent botanistes et forestiers. Dans la forêt de l’Hubac et plus spécialement dans le Jardin du Garde, l’Association scientifique pour la protection et l’amélioration de la forêt de la Sainte-Baume (ASPAF) a recensé des hêtres vénérables âgés entre 150 et 250 ans.
|
Lecture critique
Lawrence Durrell, épicurien et taoïste
 Tout au long de sa vie, Lawrence Durrell (Jalandhar, 27 février 1912-Sommières, 7 novembre 1990) approfondit sa connaissance du tao, une philosophie dont la découverte le bouleverse dès l’enfance, à Darjeeling notamment, au pied de l’Himalaya. Dans « Le Sourire du tao », il explique comment il est devenu, à l’approche de la trentaine, adepte du taoïsme. Déclinaison du bouddhisme mahâyanâ, cette religion populaire chinoise s’inspire des doctrines de Lao Tseu, contemporain de Confucius et d’antiques traditions locales. Deux rencontres déterminantes nourrissent son credo : celle de Jolan Chang, érudit et gérontologiste qui séjourne dans sa maison de Sommières, dans le Gard ; et celle de Vega, la femme qu’il accompagne en Italie, au lac d’Orta, sur les traces de Friedrich Nietzsche et Lou Andreas-Salomé. Tout au long de sa vie, Lawrence Durrell (Jalandhar, 27 février 1912-Sommières, 7 novembre 1990) approfondit sa connaissance du tao, une philosophie dont la découverte le bouleverse dès l’enfance, à Darjeeling notamment, au pied de l’Himalaya. Dans « Le Sourire du tao », il explique comment il est devenu, à l’approche de la trentaine, adepte du taoïsme. Déclinaison du bouddhisme mahâyanâ, cette religion populaire chinoise s’inspire des doctrines de Lao Tseu, contemporain de Confucius et d’antiques traditions locales. Deux rencontres déterminantes nourrissent son credo : celle de Jolan Chang, érudit et gérontologiste qui séjourne dans sa maison de Sommières, dans le Gard ; et celle de Vega, la femme qu’il accompagne en Italie, au lac d’Orta, sur les traces de Friedrich Nietzsche et Lou Andreas-Salomé.
« Le taoïste est le joker du jeu de cartes, écrit l’écrivain britannique, le poète du foyer. Son attitude dépend d’une proposition bien simple, à savoir que ce monde est un Paradis et qu’il est de notre devoir de le rendre le plus présent possible avant de le quitter. Le grand impératif, en cette affaire, c’est de ne supporter aucun gaspillage, si minime soit-il, dans ce grand festin de vie innocente. » Très tôt, cependant, il se rend compte que le taoïsme n’est pas seulement une religion ou une philosophie mais également une théorie médicale et un guide des joies simples du quotidien terrestre dès lors qu’il est vécu pleinement. Il apprend en outre que les Chinois sont à la fois taoïstes dans leurs vues philosophiques et esthétiques, et confucéens dans le domaine du dogme, de la théologie : le Tao, considère-t-il, « c’est une démarche visant à circonscrire une expérience, elle-même trop vaste pour pouvoir se couler dans le moule étroit du langage ». « L’héraldique du langage, explique-t-il encore, sert à souligner l’instinct purement analogique, à témoigner de son existence, à en percer l’écorce et à circonscrire, une fois pour toutes, le mystère, c’est-à-dire l’endroit où gîte le Tao. »
Adepte du bouddhisme zen, Larry n’en est pas moins resté l’ogre épicurien et le copieux buveur irlandais que portraiturent à l’envi ses amis dont l’écrivain Frédéric Jacques Temple. Né dans la région du Pendjab, en Inde, d’un père anglais ingénieur en génie civil et d’une mère irlandaise, eux-mêmes nés dans l’Empire des Indes, Lawrence Durrell suit des études médiocres en Angleterre où il multiplie par la suite les petits boulots : porteur dans les gares, employé dans une agence immobilière, pianiste de jazz. Méditerranéen de cœur, il s’installe en Grèce, à Corfou, en 1935 où Henry Miller, l’auteur du Tropique du cancer (1934) fait sa connaissance confortant une amitié durable. Fuyant les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, il part en Crète puis en Égypte (1941-1945). Alexandrie (Égypte), Córdoba (Argentine), Belgrade (Yougoslavie) et Nicosie (Chypre) marqueront les prochaines étapes de ses pérégrinations avant qu’il ne s’installe, définitivement, en terre languedocienne, en 1957, à Sommières : il avait baptisé sa demeure gardoise le château de Dracula !
- Le Sourire du Tao (A Smile in The Mind’s Eye), par Lawrence Durrell, traduction de l’anglais par Paule Guivarch, éditions Gallimard - collection L’Imaginaire, 136 pages, 1982/2017.
Portrait
Les plaisirs démodés de Michel Chaillou
 La langue du romancier, essayiste et diariste est belle, inventive, coruscante et musclée. Elle fait la conquête de Georges Lambrichs et Philippe Soupault à la parution de son premier livre, « Jonathamour » (1968), très éloigné des orientations littéraires du moment. Cet ancien professeur de lettres est venu tardivement à l’écriture. Passionné par la littérature baroque, Michel Chaillou (Nantes, 15 avril 1930-Paris, 10 décembre 2013) sera véritablement adoubé par ses pairs en 1976 avec la publication de son troisième roman, « Le Sentiment géographique », une rêverie autour du roman classique L’Astrée d’Honoré d’Urfé, brillante pastorale qu’admirent les poètes Michel Deguy et Jacques Réda. La langue du romancier, essayiste et diariste est belle, inventive, coruscante et musclée. Elle fait la conquête de Georges Lambrichs et Philippe Soupault à la parution de son premier livre, « Jonathamour » (1968), très éloigné des orientations littéraires du moment. Cet ancien professeur de lettres est venu tardivement à l’écriture. Passionné par la littérature baroque, Michel Chaillou (Nantes, 15 avril 1930-Paris, 10 décembre 2013) sera véritablement adoubé par ses pairs en 1976 avec la publication de son troisième roman, « Le Sentiment géographique », une rêverie autour du roman classique L’Astrée d’Honoré d’Urfé, brillante pastorale qu’admirent les poètes Michel Deguy et Jacques Réda.
 En 1983, « Domestique chez Montaigne » agrandit son lectorat à un plus large public. Parallèlement à l’écriture, il produit des émissions éducatives de télévision ou de radio tout en continuant d’enseigner. À la même époque, l’homme érudit mais effacé dirige chez l’éditeur Hatier la collection d’histoire littéraire « Brèves littérature », une mission qu’il accomplit avec bonheur de 1990 à 1996 accueillant entre autres confrères Michel Butor, Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant, Jacques Darras, Dominique Noguez, Pierre Pachet, Bernard Pingaud, Jacques Roubaud, Jean Roudaut et Paul Louis Rossi. Il achève sa carrière en qualité de maître de conférences à l’université Paris VIII (1991-1995) et dès lors se consacre exclusivement à l’écriture.
En 1983, « Domestique chez Montaigne » agrandit son lectorat à un plus large public. Parallèlement à l’écriture, il produit des émissions éducatives de télévision ou de radio tout en continuant d’enseigner. À la même époque, l’homme érudit mais effacé dirige chez l’éditeur Hatier la collection d’histoire littéraire « Brèves littérature », une mission qu’il accomplit avec bonheur de 1990 à 1996 accueillant entre autres confrères Michel Butor, Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant, Jacques Darras, Dominique Noguez, Pierre Pachet, Bernard Pingaud, Jacques Roubaud, Jean Roudaut et Paul Louis Rossi. Il achève sa carrière en qualité de maître de conférences à l’université Paris VIII (1991-1995) et dès lors se consacre exclusivement à l’écriture.
Roland Barthes directeur de thèse…
 Du bocage nantais à Casablanca, son enfance est mouvementée. À 14 ans, il est aide-comptable dans une épicerie en gros. Si l’écolier est capricieux, inconstant - quatre tentatives pour obtenir le baccalauréat -, le lecteur est passionné, boulimique. L’étudiant en philosophie - à Poitiers - obtient le capes (certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré) de lettres, qui lui permet de devenir enseignant. Appelé sous les drapeaux en Algérie, de 1957 à 1960, il en retient des souvenirs difficiles et poignants. Installé à Paris à son retour d’Afrique du Nord, il rencontre Roland Barthes et amorce sous sa direction une thèse consacrée au « Visage au cinéma ». Le philosophe est sensible à la pratique de l’écriture de son protégé. Mais les velléités du thésard tournent court. Il prend congé du septième art et se lance dans l’écriture d’un roman, « Jonathamour », qui paraît huit ans plus tard à l’enseigne de Gallimard. Du bocage nantais à Casablanca, son enfance est mouvementée. À 14 ans, il est aide-comptable dans une épicerie en gros. Si l’écolier est capricieux, inconstant - quatre tentatives pour obtenir le baccalauréat -, le lecteur est passionné, boulimique. L’étudiant en philosophie - à Poitiers - obtient le capes (certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré) de lettres, qui lui permet de devenir enseignant. Appelé sous les drapeaux en Algérie, de 1957 à 1960, il en retient des souvenirs difficiles et poignants. Installé à Paris à son retour d’Afrique du Nord, il rencontre Roland Barthes et amorce sous sa direction une thèse consacrée au « Visage au cinéma ». Le philosophe est sensible à la pratique de l’écriture de son protégé. Mais les velléités du thésard tournent court. Il prend congé du septième art et se lance dans l’écriture d’un roman, « Jonathamour », qui paraît huit ans plus tard à l’enseigne de Gallimard.
Un style heureusement démodé
Parmi les cinq romans autobiographiques qu’il a publiés, « Mémoires de Melle » (1993) est particulièrement attachant dans l’évocation douloureuse des démêlés aventureux et fantasques de Charlotte Canoby  et de son fils Samuel, revenus après cinq années du Maroc à Melle, petite bourgade des Deux-Sèvres. L’originalité du conteur se révèle ici dans ses vertus descriptive, lyrique et poétique. Michel Chaillou est bien le romancier des petites gens, des quartiers délaissés et de l’enfance (lire à cet égard « La France fugitive »). Quant à la veine imaginaire et fantastique, nous la trouvons exacerbée dans son ultime roman, « L’Hypothèse de l’ombre », paru le mois précédant sa disparition des suites d’une longue maladie. Couronné de distinctions dont le prix de la langue française en 2002 et le grand prix de littérature de l’Académie française en 2007, l’écrivain écrivait à contre-courant des modes littéraires et despotiques : ses admirateurs se délecteront de son « Journal 1987-2012 », chef d’œuvre d’érudition et d’invention stylistique. et de son fils Samuel, revenus après cinq années du Maroc à Melle, petite bourgade des Deux-Sèvres. L’originalité du conteur se révèle ici dans ses vertus descriptive, lyrique et poétique. Michel Chaillou est bien le romancier des petites gens, des quartiers délaissés et de l’enfance (lire à cet égard « La France fugitive »). Quant à la veine imaginaire et fantastique, nous la trouvons exacerbée dans son ultime roman, « L’Hypothèse de l’ombre », paru le mois précédant sa disparition des suites d’une longue maladie. Couronné de distinctions dont le prix de la langue française en 2002 et le grand prix de littérature de l’Académie française en 2007, l’écrivain écrivait à contre-courant des modes littéraires et despotiques : ses admirateurs se délecteront de son « Journal 1987-2012 », chef d’œuvre d’érudition et d’invention stylistique.
Michel Chaillou à Montpellier en 2010 © Photo X. droits réservés
- Journal 1987-2012, par Michel Chaillou, préface de Jean Védrine, éditions Fayard, 544 pages, 2015 ;
- L’Hypothèse de l’ombre, par M. Chaillou, éditions Gallimard/collection haute enfance, 192 pages, 2013 ;
- Mémoires de Melle, par M. Chaillou, éditions du Seuil, 336 pages, 1993.
Varia : le tresseur de nasses de Méditerranée
Bel ouvrage de l’écrivain-paysan Bernard Bertrand qui retrace le parcours d’un des derniers pescadous et tresseurs de nasses du Lavandou, Blaise Obino. Né à Tunis en 1933, d’un père sarde et d’une mère sicilienne, ce dernier révèle les petits secrets de la pêche à la nasse en mer Méditerranée et explique la manière de fabriquer ces fameuses nasses qui occupe à nouveau tout son temps depuis sa retraite en 1995.
« La nasse est un engin de pêche dans lequel entre le poisson et duquel il ne peut plus sortir. L’usage de ces vanneries ajourées, généralement ovales ou oblongues, est attesté en archéologie dès la préhistoire. Elles ont été enfouies dans les vases, conservées à l’abri de toute oxydation. Les vestiges retrouvés montrent à quel point nos aïeux maîtrisaient aussi bien l’art du tressage que celui de la pêche. […]
 « Autrefois, les bateaux de pêche transportaient et calaient 200 à 300 nasses chacun. […] Les nasses étaient aussi plombées avec des galets ! […] Les fonds sont à seulement 5 ou 6 m. Lestée, la nasse y repose ; elle est descendue le soir et sarpée (relevée) le lendemain matin. […] « Autrefois, les bateaux de pêche transportaient et calaient 200 à 300 nasses chacun. […] Les nasses étaient aussi plombées avec des galets ! […] Les fonds sont à seulement 5 ou 6 m. Lestée, la nasse y repose ; elle est descendue le soir et sarpée (relevée) le lendemain matin. […]
« Les nasses de Méditerranée sont souvent en forme de cuve cylindrique, à peine plus large à la bouche qu’au fond. Certaines sont aplaties (girelier) ou quasiment sphériques (jambin). Ce type de vannerie est considéré comme une vannerie à deux nappes passives superposées (séries de montants parallèles entre eux, superposés et disposés en nappes diagonales… reliées entre elles par des brins cordés ou liés), l’une est horizontale, l’autre diagonale, cette dernière étant double. Ces nappes sont dites "passives" parce qu’il n’y a pas d’alternance dessus-dessous qui permet leur assemblage. Elles sont simplement superposées et liées par couture. Le lien était autrefois cordé en végétal, puis enroulé sur une aiguille ou navette, en bois (bruyère, buis ou olivier) ou en métal, réalisée par les vanniers eux-mêmes.
« Il est très intéressant de constater que ces vanneries sont fabriquées à partir de la ressource végétale locale et sauvage ; il est rare que l’osier ait pris la place de l’une de ces ressources, principalement pour des raisons de coût mais aussi de résistance à l’eau de mer. Ainsi on peut raisonnablement penser que cet art est très ancien, qu’il est le fidèle reflet de ce que faisaient déjà les plus anciens pêcheurs de Méditerranée. Sont principalement utilisés : le myrte (Myrtus communis Linné), la canne de Provence (Arundo donax L.) et le jonc aigu (Juncus acutus L.), rarement le saule. Le choix des matériaux dépend des prises convoitées, de leur taille, mais aussi de leur capacité à briser les parois de leur prison pour en sortir. Ainsi, si le myrte convient aux nasses à congres et à murènes, il est remplacé par le jonc pour la pêche aux langoustes. »
Extraits de l’ouvrage « Le Tresseur de nasses de Méditerranée, Blaise Obino », de Bernard Bertrand, éditions de Terran, 128 pages, 2017.
Carnet : corvée de pluche !
Les patates, on trouve qu’il y en a trop quand on les épluche et pas assez quand on les mange.
(Léonce Bourliaguet, « De sel et de poivre », éditions Magnard, 1963)
(Mardi 18 mai 2021)
La vue et l’esprit
« La vision de l’esprit, ne l’oublie pas - dit une nuit Socrate à Alcibiade qui cherchait à le séduire par les attraits immédiatement tangibles de sa jeune beauté - n’est perçante que lorsque les yeux se mettent à perdre de leur acuité. » Ce que suggérait autrement Giorgio de Chirico : « On ne voit bien les choses qu’en fermant les paupières. » Elles pénètrent alors vos ombres. (Yann Le Pichon, Bernard Buffet, peintre (1943-1981), éditions Maurice Garnier, 1950)
Sans rire
Le protoxyde d’azote, ou oxyde nitreux (N2O), ou encore hémioxyde d’azote, c’est aussi le « gaz hilarant » qu’utilisent, sans rire, les anesthésistes…
(Mercredi 26 mai 2021)
Habitudes
Quand Sylvie avait fini de nourrir ses chats, elle apprêtait sa vêture, se recoiffait et commençait à grignoter en regardant à la télévision Antoine de Caunes ou Dechavanne qui ne disaient rien mais le disaient avec drôlerie.
La simplicité de Stevenson
« J’ai repris la lecture de Stevenson, évoque l’écrivain Jacques Meunier (1941-2004). J’y ai alors découvert un écrivain : à savoir un homme qui - à force de patience, de travail sur lui-même et sur les mots - accède à la simplicité. Sa littérature "sujet-verbe-complément" me semblait à chaque lecture plus forte et plus complexe. "L’Île au Trésor" n’a pas une phrase de trop ! »
Comment ça va ?
On demandait à M. de Fontenelle mourant :
- Comment cela va-t-il ?
- Cela ne va pas, dit-il, cela s’en va.
Bernard Le Bouyer de Fontenelle (1657-1787) était le neveu de Corneille
(Mercredi 9 juin 2021)
|
Billet d’humeur
La béarnaise de Saint-Germain
Cuisinier et gérant du pavillon Henri-IV que lui louait la Compagnie des chemins de fer de l’Ouest à Saint-Germain-en-Laye, sur la rive droite de la Seine, Jean-Louis François Collinet est chargé le 24 août 1837 de préparer le repas de la reine Marie-Amélie de Bourbon (1782-1866) à l’occasion de l’inauguration de la ligne ferroviaire Paris-Saint-Germain. Le retard du train inaugural en provenance de la gare Saint-Lazare bouleverse la préparation des agapes. À l’arrivée de la souveraine au débarcadère du Pecq, le chef qui a dû retirer les rondelles de pomme de terre à frire les replonge à demi cuites dans le bain de friture, ce qui les fait souffler comme des balles : la recette des pommes soufflées est établie ce jour-là. Dans le même temps, un des cuisiniers de la brigade rate complètement une sauce à l’échalote et à l’estragon censée accompagner des escalopes grillées. Pour la rattraper dans un bain-marie, le chef lui ajoute un œuf avec du vinaigre (ou du vin blanc) et, hors du feu, du beurre clarifié. L’émulsion saucière régale les papilles des prestigieux invités qui questionnant le maître-queue apprennent qu’il s’agit de la sauce béarnaise. En fait, pris au dépourvu, Jean-Louis Collinet s’est rappelé ses origines béarnaises en contemplant le buste royal du Vert-Galant trônant dans la salle à manger de l’auberge, ancien pavillon de l’Oratoire du Château-Neuf de Saint-Germain en fait où naquit Louis XVI. Des historiens prétendent que le cuistot de Saint-Germain aurait déniché la recette originelle de la béarnaise dans un ouvrage fort ancien, La Cuisine des villes et des campagnes, et qu’il aurait quelque peu arrangée à sa façon. Cuisinier émérite et petit-fils d’aubergiste par sa mère, Alexandre Dumas tenait ses quartiers au pavillon du sieur Collinet, un endroit que prisait un autre fin gourmet, le compositeur Jacques Offenbach.
|
Lecture critique
Yves Saint Laurent et la soierie lyonnaise
Si des foires aux tissus portent, dès le Moyen Âge, la cité sur le devant de la scène, Lyon est considérée comme une ville tisserande à partir du règne de François Ier, au moment où elle produit ses propres soieries. Peu à peu, la notoriété des soies lyonnaises est telle qu’elle surpasse la concurrence européenne dans l’ameublement comme dans « la robe », c’est-à-dire les habits. Intervenu à la fin du XVIIe siècle, le phénomène de la « mode » amène les Italiens et les Anglais à imiter très rapidement les productions françaises où s’épanouit la manière lyonnaise. Et à la fin du XIXe s., l’action combinée des couturiers parisiens et des soyeux lyonnais consacre la suprématie de la France dans ce qui a pris le nom de haute couture. Dans l’entre-deux-guerres, les « folles années de la soie » à Lyon voient surgir trois noms, trois maisons de soyeux qui sauront influencer et nourrir l’imaginaire d’Yves Saint Laurent et d’autres grands couturiers du XXe s. Ce sont François Ducharne (1920-1960), Coudurier-Fructus-Descher (1896-1978) et Jean-Claude Dognin (1805-1985).
Yves Saint Laurent repère la soierie lyonnaise par l’intermédiaire des journaux qu’il feuillette à Oran, sa ville natale : « La librairie Manès reçoit régulièrement les revues américaines parmi lesquelles "Vogue" qui relate les tendances de la mode parisienne à travers les chroniques photographiques d’André Ostier, évoque Aurélie Samuel dans l’ouvrage "Yves Saint Laurent - Les coulisses de la haute couture à Lyon".
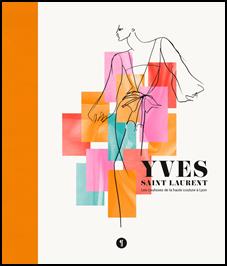 Yves Saint Laurent y découvre également les pages dédiées aux fournisseurs de tissus qui ont pour habitude de publier des photographies de leurs collections avec les caractéristiques principales des étoffes. » Auprès de Christian Dior dont il a été l’assistant puis le successeur, il peut aiguiser son goût et parfaire ses connaissances des tissus. Il aime à souligner que les tissus « sont la base de tout, (ce sont) eux qui déterminent la pensée, la ligne. Si je me trompe dans leur emploi, mes modèles sont ratés et je dois les abandonner. Leur choix c’est pour moi l’un des temps les plus forts de la création, celui qui requiert la plus forte concentration et me donne aussi le maximum de joie ». Interrogé par un journaliste du quotidien Le Monde en 1983, le couturier énumère les matériaux et les accessoires qu’il affectionne : « La toile de lin, le velours - beaucoup -, le satin, les tissus d’hommes (prince de Galles, rayures, tweed), les imperméables en soie, le tulle, l’ottoman, tous les tissus qui évoquent les vêtements militaires (drap, coton écru, bâches, coton blanc des officiers de marine) et la flanelle des cabans ».
Yves Saint Laurent y découvre également les pages dédiées aux fournisseurs de tissus qui ont pour habitude de publier des photographies de leurs collections avec les caractéristiques principales des étoffes. » Auprès de Christian Dior dont il a été l’assistant puis le successeur, il peut aiguiser son goût et parfaire ses connaissances des tissus. Il aime à souligner que les tissus « sont la base de tout, (ce sont) eux qui déterminent la pensée, la ligne. Si je me trompe dans leur emploi, mes modèles sont ratés et je dois les abandonner. Leur choix c’est pour moi l’un des temps les plus forts de la création, celui qui requiert la plus forte concentration et me donne aussi le maximum de joie ». Interrogé par un journaliste du quotidien Le Monde en 1983, le couturier énumère les matériaux et les accessoires qu’il affectionne : « La toile de lin, le velours - beaucoup -, le satin, les tissus d’hommes (prince de Galles, rayures, tweed), les imperméables en soie, le tulle, l’ottoman, tous les tissus qui évoquent les vêtements militaires (drap, coton écru, bâches, coton blanc des officiers de marine) et la flanelle des cabans ».
L’histoire de la soierie lyonnaise est naturellement conditionnée par l’innovation artistique, mais surtout technologique qui a permis d’aboutir à un niveau de performance exceptionnel. Reposant sur le métier à mécanique Jacquard (qui utilise crochets, aiguilles et cartons perforés) entre autres équipements de haute qualité, la Fabrique lyonnaise présente une certaine complexité en mettant en œuvre des savoir-faire, des métiers, réputés aux différents niveaux de la création : les dessinateurs, les préparateurs de fils, les tisseurs (les fameux canuts), les apprêteurs, les blanchisseurs et les teinturiers. Le dessin tient une place importante et particulière dans la création d’Yves Saint Laurent : il explique « aborder une collection avec cinq cents dessins ou sans le moindre dessin, ce qui m’amène à travailler directement sur le corps d’un mannequin ». Il raconte avoir découvert à 13 ans, au grand théâtre d’Oran, les merveilles des décors et des costumes de Christian Bérard (1902-1949) : « de retour à la maison, j’ai voulu refaire "L’École des femmes". Ma mère m’a donné un vieux drap de lit. Je l’ai teint de plusieurs couleurs avec des gouaches normales et j’en ai fait des morceaux pour habiller mes petits personnages. […] Nous avions une lingère, elle venait le jeudi, mon jour de congé. Je ramassais ses chutes, parfois même je découpais des robes de ma mère »… C’est fou comme les événements de l’enfance oranaise ont marqué le destin du couturier.
- Yves Saint Laurent - Les coulisses de la haute couture à Lyon, sous la direction d’Esclarmonde Monteil, conservatrice en chef du patrimoine, directrice générale et scientifique du musée des Tissus à Lyon, et d’Aurélie Samuel, conservatrice du patrimoine, directrice des collections du musée Yves Saint Laurent à Paris, éditions Libel, 168 pages, 2019.
Portrait
Les difficultés de raconter la guerre d’Algérie
 Au gré de l’actualité politique, l’attention se polarise sur la guerre d’Algérie (1954-1962). Et le nombre d’ouvrages portant sur le conflit - que le Parlement français a reconnu très tardivement (le 5 octobre 1999) - procède du record éditorial. Pourtant, les ouvrages de référence, offrant une synthèse pertinente de ce qu’on qualifiait par euphémisme d’« événements », d’« opération de maintien de l’ordre » ou de « pacification » restent rares. Et celui de l’écrivain et journaliste Jean Sévillia (Paris, 1952), « Les Vérités cachées de la guerre d’Algérie », rejoint assurément les désormais classiques études de Charles-Robert Ageron (L’Algérie des Français, 1993), Charles-André Julien (Histoire de l’Algérie contemporaine, 1964) et Daniel Rivet (Le Maghreb à l’épreuve de la colonisation, 2002). Sans en épuiser le sujet, toutefois. Tant il est difficile de parcourir sur près de deux siècles l’aventure tumultueuse, faite d’attractions, de fascination et de tensions, de tragédies aussi, qui lie à jamais la France à l’Algérie. Au gré de l’actualité politique, l’attention se polarise sur la guerre d’Algérie (1954-1962). Et le nombre d’ouvrages portant sur le conflit - que le Parlement français a reconnu très tardivement (le 5 octobre 1999) - procède du record éditorial. Pourtant, les ouvrages de référence, offrant une synthèse pertinente de ce qu’on qualifiait par euphémisme d’« événements », d’« opération de maintien de l’ordre » ou de « pacification » restent rares. Et celui de l’écrivain et journaliste Jean Sévillia (Paris, 1952), « Les Vérités cachées de la guerre d’Algérie », rejoint assurément les désormais classiques études de Charles-Robert Ageron (L’Algérie des Français, 1993), Charles-André Julien (Histoire de l’Algérie contemporaine, 1964) et Daniel Rivet (Le Maghreb à l’épreuve de la colonisation, 2002). Sans en épuiser le sujet, toutefois. Tant il est difficile de parcourir sur près de deux siècles l’aventure tumultueuse, faite d’attractions, de fascination et de tensions, de tragédies aussi, qui lie à jamais la France à l’Algérie.
Se débarrasser des préjugés idéologiques
À l’exemple de bien d’autres exégètes, l’auteur se prévaut de débarrasser le Maghreb colonial des préjugés idéologiques, des mythes et des partis pris qui compromettent le plus souvent la compréhension des questions, nombreuses, qui surgissent dès lors qu’on souhaite se libérer des sempiternelles considérations coloniales qui empoisonnent les débats autour de la guerre d’Algérie. Parvient-il à raconter le plus froidement possible l’histoire passionnelle d’une terre où les rêves et les espoirs se heurtent davantage qu’ils ne se conjuguent pour le bien des différents acteurs ? Les lecteurs donneront leur avis au terme d’une narration sobre, marquée par une justesse d’analyse et d’une réelle conscience de la complexité du sujet.
Un examen chronologique
Jean Sévillia examine en les commentant toutes les étapes et les points chauds de la guerre d’Algérie, replaçant au besoin des faits souvent déformés et parfois mythifiés. Dans la chronologie du récit, il évoque les moments clefs : le coup de chasse-mouches du dey Hussein au consul français Deval en 1827, la conquête de l’Algérie par la France dès 1830, l’abrogation du décret Crémieux (7 octobre 1940) et sa remise en vigueur (26 octobre 1943),
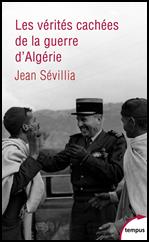 l’émeute de Sétif le 8 mai 1945 et la répression qu’elle a suscitée, la création en octobre 1954 du Front de libération nationale (FLN) et de sa branche militaire l’Armée de libération nationale (ALN), les premières traques des hors-la-loi (ou fellaghas) dans le massif de l’Aurès en janvier 1955, l’insurrection du Constantinois en août 1955, l’engagement du contingent en Algérie décidé par le socialiste Guy Mollet, président du Conseil, le vote des pouvoirs spéciaux, la bataille d’Alger en 1957, le regroupement des populations algériennes par l’armée française, la proclamation de la Ve République en octobre 1958, le procès des « porteurs de valises » du réseau Jeanson - titre que revendique Jean-Paul Sartre - et le Manifeste des 121 (déclaration sur le droit à l’insoumission dans la guerre d’Algérie) lancé par Maurice Blanchot et Dionys Mascolo en septembre 1960, le putsch des généraux du 22 avril 1961, la constitution de l’Organisation armée secrète (OAS) présidée par le général Salan dit Soleil, les manifestations des Algériens à Paris le 17 octobre 1961, les accords d’Évian-les-Bains signés le 19 mars 1962, l’exode des pieds noirs et la loi Boulin (accueil et réinstallation des Français d’outre-mer), le drame des harkis ou supplétifs musulmans de l’armée française, entre autres événements marquants.
l’émeute de Sétif le 8 mai 1945 et la répression qu’elle a suscitée, la création en octobre 1954 du Front de libération nationale (FLN) et de sa branche militaire l’Armée de libération nationale (ALN), les premières traques des hors-la-loi (ou fellaghas) dans le massif de l’Aurès en janvier 1955, l’insurrection du Constantinois en août 1955, l’engagement du contingent en Algérie décidé par le socialiste Guy Mollet, président du Conseil, le vote des pouvoirs spéciaux, la bataille d’Alger en 1957, le regroupement des populations algériennes par l’armée française, la proclamation de la Ve République en octobre 1958, le procès des « porteurs de valises » du réseau Jeanson - titre que revendique Jean-Paul Sartre - et le Manifeste des 121 (déclaration sur le droit à l’insoumission dans la guerre d’Algérie) lancé par Maurice Blanchot et Dionys Mascolo en septembre 1960, le putsch des généraux du 22 avril 1961, la constitution de l’Organisation armée secrète (OAS) présidée par le général Salan dit Soleil, les manifestations des Algériens à Paris le 17 octobre 1961, les accords d’Évian-les-Bains signés le 19 mars 1962, l’exode des pieds noirs et la loi Boulin (accueil et réinstallation des Français d’outre-mer), le drame des harkis ou supplétifs musulmans de l’armée française, entre autres événements marquants.
Une histoire commune entre Français et Algériens
Dans cet ouvrage, tout ou presque est dit du conflit qui aura causé la mort de 250 000 à 300 000 individus, une guerre dont l’évocation continue de résonner obstinément dans la conscience de nos contemporains en 2021, avec la question de l’intégration, de l’identité culturelle des musulmans français, de l’islamisme et du terrorisme. « La guerre d’indépendance a été violente des deux côtés, observe Jean Sévillia : quelle guerre n’est pas violente ? La souveraineté française sur l’Algérie, de 1830 à 1962, est cependant une histoire commune entre Français et Algériens. Cette histoire, il faut la regarder en face, sans l’embellir ni la noircir. »
Jean Sévillia en 2016 © Photo Bruno Klein
- Les Vérités cachées de la guerre d’Algérie, par Jean Sévillia, éditions Perrin, collection Tempus, 458 pages, 2021.
Varia : la belle vie désespérée des agriculteurs
« La question de la souffrance au travail connaît aujourd’hui un retentissement sans précédent. En cause : les répercussions qu’aurait le travail sur la santé mentale des travailleurs. Aussi vieille que l’industrialisation, cette question s’est, récemment, vue réactivée à la suite des 35 suicides enregistrés chez France Télécom entre 2008 et 2009, globalement interprétés comme une conséquence désastreuse de l’organisation moderne du travail. Cette interprétation, tout comme la reconnaissance de la réalité même d’une vague de suicides dans l’entreprise, est loin de faire l’unanimité et suscite de vives controverses.
« Aussi contradictoires qu’ils puissent être, ces débats étonnent par le peu de place qu’ils réservent au travail agricole et aux agriculteurs bien que cette profession soit, depuis longtemps, connue pour son taux élevé de suicides significativement corrélés à la profession. […]
 « Il apparaît que le métier d’agriculteur comporte de réels dangers. Le nombre d’accidents mortels du travail y est significativement supérieur à celui de la population générale. Les enquêtes sur les conditions de travail viennent compléter ce tableau, interdisant toute vision sublimée de la vie "au grand air", "en prise avec la nature". Ces enquêtes disent, en effet, la dureté de cette vie, appréhendée selon les trois éléments que sont les gestes du travail, son emprise sur la vie des agriculteurs et les agents biologiques et chimiques auxquels cette vie les expose. Sur ces trois aspects, la situation des exploitants et celle de leurs salariés se valent au point de se confondre.
« Il apparaît que le métier d’agriculteur comporte de réels dangers. Le nombre d’accidents mortels du travail y est significativement supérieur à celui de la population générale. Les enquêtes sur les conditions de travail viennent compléter ce tableau, interdisant toute vision sublimée de la vie "au grand air", "en prise avec la nature". Ces enquêtes disent, en effet, la dureté de cette vie, appréhendée selon les trois éléments que sont les gestes du travail, son emprise sur la vie des agriculteurs et les agents biologiques et chimiques auxquels cette vie les expose. Sur ces trois aspects, la situation des exploitants et celle de leurs salariés se valent au point de se confondre.
« Malgré les puissantes machines et les dispositifs complexes qui assistent aujourd’hui la production, l’engagement des corps reste décisif dans les métiers de l’agriculture, ce qui se traduit par un niveau de pénibilité physique et de nuisance beaucoup plus élevé que dans les autres domaines d’activité. Aux agriculteurs : les plus longues semaines de travail, les plus grandes variations horaires d’une semaine à l’autre, la plus forte intrication du lieu de travail et du domicile, et l’impression la plus tenace de constamment manquer de temps. Enfin, les agriculteurs sont trois fois plus exposés que l’ensemble des salariés aux substances toxiques et aux risques infectieux, comme l’ont montré les épizooties récentes des bovins, des oiseaux et des porcs. On soupçonne d’ailleurs cette exposition d’être responsable de la survenue de certains cancers, même si les processus à l’œuvre sont certainement complexes. »
Extraits de « La belle vie désespérée des agriculteurs - ou les limites de la mesure des risques psychosociaux liés au travail », un propos de Sylvie Célérier, sociologue, maître de conférences habilitée, Centre Pierre Naville, Université d’Évry-Val-d’Essonne et Centre d’études de l’emploi, Noisy-le-Grand, issu de la revue « Études rurales » n°193, janvier-juin 2014, sur le thème « Souffrances paysannes », éditions de l’École des hautes études en sciences sociales.
In memoriam : le credo écologique de Jean-Michel Sanejouand
Né à Lyon le 18 juillet 1934, Jean-Michel Sanejouand est décédé dans sa maison de Vaulandry (Maine-et-Loire) le 18 mars 2021. J’avais évoqué la vie et l’œuvre du peintre et sculpteur dans ma chronique de l’hiver 2017 (n° 24).
 Œuvres sculptées, dessinées, peintes, photographiées et mises en espaces, ses réalisations permettent au néophyte curieux et à l’amateur chevronné de repérer plusieurs orientations fondamentales de l’art d’aujourd’hui. Dans le questionnement perpétuel des lieux et de la représentation auquel il se livrait, très souvent l’artiste divulguait ses priorités, son credo : conserver la forêt nourricière, défendre l’espace agricole utile, déplacer les zones d’habitation vers certains des espaces agricoles et prévoir suffisamment de zones de loisirs à proximité des espaces d’habitation. Il aimait à diffuser ses idées quant à la défense et à l’illustration de l’espace et de l’environnement afin d’inverser, disait-il, l’image de la solitude moderne : multiplier la circulation souterraine, concevoir des avertisseurs antipollution, généraliser l’information permanente en faveur de l’environnement et de la biodiversité, favoriser de nouvelles communications entre l’homme et la nature. « La richesse d’une forme, d’une figure chez Jean-Michel Sanejouand est son ambiguïté, développe avec pertinence la critique d’art Anne Tronche (1938-2015). Parfois sculpture, parfois peinture, parfois photographie, d’autres fois présence monumentale, elle a une curieuse propension à brouiller les catégories entre réel et artificialité. La pratique et la réflexion qu’elle suscite en lui ne visent pas à éliminer ces confusions, mais à les rendre évidentes. Le tour de force auquel est parvenu l’artiste consiste à inscrire dans ses formes un besoin de devenir. »
Œuvres sculptées, dessinées, peintes, photographiées et mises en espaces, ses réalisations permettent au néophyte curieux et à l’amateur chevronné de repérer plusieurs orientations fondamentales de l’art d’aujourd’hui. Dans le questionnement perpétuel des lieux et de la représentation auquel il se livrait, très souvent l’artiste divulguait ses priorités, son credo : conserver la forêt nourricière, défendre l’espace agricole utile, déplacer les zones d’habitation vers certains des espaces agricoles et prévoir suffisamment de zones de loisirs à proximité des espaces d’habitation. Il aimait à diffuser ses idées quant à la défense et à l’illustration de l’espace et de l’environnement afin d’inverser, disait-il, l’image de la solitude moderne : multiplier la circulation souterraine, concevoir des avertisseurs antipollution, généraliser l’information permanente en faveur de l’environnement et de la biodiversité, favoriser de nouvelles communications entre l’homme et la nature. « La richesse d’une forme, d’une figure chez Jean-Michel Sanejouand est son ambiguïté, développe avec pertinence la critique d’art Anne Tronche (1938-2015). Parfois sculpture, parfois peinture, parfois photographie, d’autres fois présence monumentale, elle a une curieuse propension à brouiller les catégories entre réel et artificialité. La pratique et la réflexion qu’elle suscite en lui ne visent pas à éliminer ces confusions, mais à les rendre évidentes. Le tour de force auquel est parvenu l’artiste consiste à inscrire dans ses formes un besoin de devenir. »
Jean-Michel Sanejouand à Nantes en 2012 © Photo Fanny Trichet
- Jean-Michel Sanejouand : Rétrospectivement…, textes de Julie Portier et Anne Tronche, éditions Skira Flammarion, 216 pages, 2012.
Haut de page
|





