Les Papiers collés
de Claude Darras
Printemps 2024
Carnet : Comédie
D’où vient cette envie de me cacher ? Et ce goût pour la comédie, dans le même temps ! Mais c’est évident. Un comédien est un homme qui se cache. Qui a peur. Tout en voulant être vu, voire jugé, sous un autre angle que celui de tout un chacun. D’où il est - devrait - être impossible de jouer la comédie très longtemps, le jeu perdant très vite sa chandelle. Je ne conçois pas - plus - une vie tout entière consacrée au théâtre, au cinéma. Ni ne supporte un acteur plus de deux fois.
(Georges Perros, « Échancrures 1977 », Œuvres, Quarto Gallimard, 2017)
La couleuvre et la Loire
« Les rivières ont les mouvements des couleuvres en colère. Elles enflent leurs grands corps et leur peau a parfois de ténébreux éclairs » (L’Athlète bien fait). « D’ici, du haut du talus rongé par cette grande couleuvre lumineuse, on voit la Loire s’épanouir, s’étendre, s’élancer, se tordre, mordre, sucer, battre et se débattre. Elle déplace son lit à volonté. Elle roule ses eaux soyeuses sur un sable roux et fin. Elle se démène comme un grand serpent musclé et qui a faim. » (Ceux qui se défendent sans armes). Citations issues de l’ouvrage « À la recherche du bonheur en 1937 », de Jules Mougin, TraumFabrik éditions, 50 pages, 1994.
Un bon conseil
N’imite pas le buvard qui comprend tout à l’envers.
(Léonce Bourliaguet, De sel et de poivre, éditions Magnard, 1963)
Le rêve de tout auteur
Gabriel Garcia Márquez soulignait la nécessité pour un écrivain de trouver la bonne structure de son récit. « Je reste marqué à jamais, affirmait l’écrivain colombien (1927-2014), par ma découverte d’"Œdipe roi" de Sophocle. C’est le rêve de tout auteur : une histoire centrée sur un détective qui enquête et découvre au bout du compte que c’est lui l’assassin. Je demeure, jusqu’à la fin de la rédaction d’un livre, obsédé par sa structure. On peut vérifier : dans mes livres, chaque chapitre possède à peu près le même nombre de pages. Je suis capable de transférer un élément d’un bout à l’autre simplement pour maintenir cet équilibre. »
(Lundi 29 janvier 2024)
|
Billet d’humeur
La révolution de Godillot
Révolutionnaire, Godillot ? Assurément, mais dans la chaussure. En 1858, l’entrepreneur franc-comtois différencie le pied droit du pied gauche dans la conception de chaussures montantes à usage militaire de différentes pointures ; une semelle en cuir épouse la voûte plantaire et l’application de gutta-percha (gomme plastique et isolante provenant d’un arbre de Malaisie) entre la semelle et la chaussure en assure l’imperméabilité. Jusqu’alors, les bottiers fabriquaient des chaussures sur des formes droites, sans distinguer le soulier droit du soulier gauche, et la plupart du temps avec des semelles en bois. Né le 15 mars 1816 à Besançon, Alexis Godillot est mort le 13 avril 1893 dans le 16e arrondissement de Paris : son grand-père maternel était un cafetier jurassien. Il a 23 ans lorsqu’il reprend à Paris, rue de Rochechouart (9e arr.), l’entreprise de sellerie de son père, un soldat de l’Empire à la retraite. En cinq années, il en transforme l’activité qui connaît une réussite ascendante avec un effectif d’ouvriers multiplié par quinze et une double production, les équipements militaires (selles, chaussures, casques et képis) et les accessoires de voyage (sacs, coffres et malles de rangement). Les années suivantes, le « Bazar du voyage » et ses ateliers parisiens acquièrent une notoriété nationale et son fondateur devient le « malletier du Roi ». Tant et si bien qu’à la Révolution de 1848, la manufacture Godillot chausse et habille la Garde nationale, l’armée piémontaise et les régiments français en Algérie : tenue de fantassin, tente de troupe, matériel d’ambulance, mobilier de campement et autres fournitures de campagne font désormais partie du catalogue. Un premier marché de cent mille paires de brodequins est passé en 1859. Dix ans plus tard, le manufacturier produit jusqu’à 1 200 000 paires de chaussures et de bottes. Très vite, le brodequin militaire prend le nom de son inventeur et l’éponyme « godillot » désignera les chaussures des soldats jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Outre ses usines parisiennes (bientôt mécanisées), Alexis Godillot dispose d’une tannerie à Saint-Ouen (dont il est maire de 1857 à 1870, nommé par Napoléon III), d’unités de production à Bordeaux, Bourges, Nantes et Reims, toutes employant près de 3 000 ouvriers. L’industriel se double d’un esthète et d’un mécène : amoureux de la cité varoise d’Hyères où il réside l’hiver, il confie à l’architecte Pierre Chapoulart (1849-1903) l’édification de nombreux édifices dont la tour Jeanne, les villas Mauresque et Tunisienne, l’église anglicane et la Bicoque à tourelle que la reine Victoria a tenu à visiter en 1892, lors d’un séjour dans la cité des palmiers.
|
Lecture critique
La révolte et les espérances de Jean Rhys
 Le lecteur ou la lectrice de Jean Rhys (Roseau, 1890-Exeter, 1979) est souvent confronté à une tristesse inlassable, voire à la violence du désespoir qui marquent ses romans et ses nouvelles. L’écriture de l’écrivaine britannique est belle, experte à saisir l’échec et le destin tragiques de ses personnages parmi lesquels Miss Dorothy Dufreyne : « L’envie sauvage qui la tenait de prendre sa revanche sur le genre humain s’était transformée en une extraordinaire lucidité. Elle venait de comprendre, encore maladroitement, mais pour la première fois, que seuls ceux qui n’ont plus d’espoir peuvent se permettre de ne plus mentir, que seuls ceux qui sont malheureux peuvent offrir de la sympathie ou en recevoir - qu’ils partagent l’amère et dangereuse volupté de la misère » (dans la nouvelle Rue de l’Arrivée du recueil « L’Oiseau moqueur »). En livrant l’état d’âme de la dessinatrice de mode américaine qui trompe son ennui au Zanzibar, un café parisien de Montparnasse, elle se livre elle-même, souffrante et désemparée face à la détresse et à la solitude de sa propre vie. Le lecteur ou la lectrice de Jean Rhys (Roseau, 1890-Exeter, 1979) est souvent confronté à une tristesse inlassable, voire à la violence du désespoir qui marquent ses romans et ses nouvelles. L’écriture de l’écrivaine britannique est belle, experte à saisir l’échec et le destin tragiques de ses personnages parmi lesquels Miss Dorothy Dufreyne : « L’envie sauvage qui la tenait de prendre sa revanche sur le genre humain s’était transformée en une extraordinaire lucidité. Elle venait de comprendre, encore maladroitement, mais pour la première fois, que seuls ceux qui n’ont plus d’espoir peuvent se permettre de ne plus mentir, que seuls ceux qui sont malheureux peuvent offrir de la sympathie ou en recevoir - qu’ils partagent l’amère et dangereuse volupté de la misère » (dans la nouvelle Rue de l’Arrivée du recueil « L’Oiseau moqueur »). En livrant l’état d’âme de la dessinatrice de mode américaine qui trompe son ennui au Zanzibar, un café parisien de Montparnasse, elle se livre elle-même, souffrante et désemparée face à la détresse et à la solitude de sa propre vie.
Jean Rhys, de son vrai nom Ella Gwendoline Rees Williams, naquit d’un père gallois et d’une mère créole à la Dominique, l’une des îles Sous-le-Vent, dans les Antilles anglaises. Venu d’Ecosse, le père de sa mère, James Gibson Lockhart, s’y installa au XVIIIe siècle dans une plantation, nommée Coulibri et exploitée par des esclaves… « Son père, un médecin, était un homme triste, explique sa biographe Christine Jordis (Alger, 1942), remâchant sans cesse sa condition d’exilé dans une petite île des Caraïbes ; sa famille, et pour cause, peu aimée des gens de la région. Très jeune, Jean fit l’expérience de la haine, et donc de l’exclusion. » Adolescente, elle vécut en Angleterre où elle mena des études d’art dramatique, épousa un poète et compositeur franco-néerlandais et poursuivit une existence errante dans l’entre-deux-guerres à travers l’Europe de la bohème. En France, elle partagea les aventures insouciantes et fantasques du Montparnasse des années 1920-1930. Entre 1927 et 1939, elle publia un recueil de nouvelles (Les tigres sont plus beaux à voir, publié en 1968) et cinq romans (Rive gauche, en 1927 ; Quartet, 1928 ; Voyage dans les ténèbres, 1934 ; Quai des Grands-Augustins, 1937 ; Bonjour minuit, 1939). Durant de longues années, elle s’effaça de la scène littéraire. À la fin des années cinquante, une version radiophonique de Bonjour minuit renouvela l’intérêt public pour son œuvre. Elle se remit à écrire et connut enfin le succès en 1966 avec la publication de La Prisonnière des Sargasses dont l’héroïne, la créole Antoinette Cosway s’inspire du personnage de Bertha Mason dans le roman Jane Eyre de Charlotte Brontë.
Les nouvelles de « L’Oiseau moqueur » égrène le temps mémorable de la vie de bohème de Jean Rhys en Europe, notamment à Paris, à Budapest et à Vienne au côté de son premier mari, Jean Lenglet (elle se remariera deux fois, avec Leslie Tilden Smith et Max Hamer, cousin du précédent). Des nouvelles hantées par la cruauté et le désir, la misère et la beauté, la révolte et l’espoir. Par l’esprit caribéen aussi. Dans « Temps perdi » (c’est du patois créole), elle rend un bel et nostalgique hommage aux origines de sa parentèle : « Quand on parle du peuple caraïbe, évoque-t-elle, on emploie toujours l’adjectif "décadent", alors que les gens ignorent presque tout de lui, sinon de façon fragmentaire, et ils ne peuvent plus désormais en savoir davantage. Ce peuple ne représente plus que quelques centaines de personnes, dispersées dans le monde, ou restées aux Antilles occidentales, dans un quartier de l’île Salybia. Comme les mariages  avec des Noirs ont été rarissimes, ils ont gardé leurs longs cheveux de jais, très souples, leur teint cuivré, leurs hautes pommettes, leurs petits yeux bridés. Ils tressent des paniers magnifiques, aériens, étanches, colorés en rouge et brun, ou en noir et blanc. Les plus grands peuvent servir de malles, un chausson de bébé tiendrait à peine dans les plus petits. Certains s’emboîtent les uns dans les autres, comme les boîtes chinoises. » Les souvenirs de la Dominique réveillent les anciennes angoisses, les antiques espérances de la narratrice : « On se croit à l’abri de tout, hors du monde, et soudain arrive un cyclone, ou une maladie qui anéantit les récoltes et dont on ignore le remède, et on se retrouve sans rien - la plus grande partie des Antilles occidentales ravagée, le travail perdu. C’est ainsi depuis plus de trois cents ans - oui, et on dit qu’il y a plus de trois cents ans que quelqu’un a gravé "Temps perdi" sur un tronc d’arbre. » avec des Noirs ont été rarissimes, ils ont gardé leurs longs cheveux de jais, très souples, leur teint cuivré, leurs hautes pommettes, leurs petits yeux bridés. Ils tressent des paniers magnifiques, aériens, étanches, colorés en rouge et brun, ou en noir et blanc. Les plus grands peuvent servir de malles, un chausson de bébé tiendrait à peine dans les plus petits. Certains s’emboîtent les uns dans les autres, comme les boîtes chinoises. » Les souvenirs de la Dominique réveillent les anciennes angoisses, les antiques espérances de la narratrice : « On se croit à l’abri de tout, hors du monde, et soudain arrive un cyclone, ou une maladie qui anéantit les récoltes et dont on ignore le remède, et on se retrouve sans rien - la plus grande partie des Antilles occidentales ravagée, le travail perdu. C’est ainsi depuis plus de trois cents ans - oui, et on dit qu’il y a plus de trois cents ans que quelqu’un a gravé "Temps perdi" sur un tronc d’arbre. »
Jean Rhys à Cheriton Fitzpaine, dans le Devon, où elle a fini ses jours
© Photo X, droits réservés
- L’Oiseau moqueur et autres nouvelles, par Jean Rhys, préface de Christine Jordis, traduit de l’anglais par Jacques Tournier, éditions Denoël, 176 pages, 2019.
Lectures complémentaires :
- Bonjour minuit, éditions Denoël, 240 pages, 2014 ;
- La Prisonnière des Sargasses, éditions Gallimard, 239 pages, 1995 ;
- Correspondance 1931-1966, éditions Denoël, 496 pages, 1987.
Portrait
Robert Schuman aux prémices de l’Europe
Député, ministre et président du Conseil, Robert Schuman (Clausen, 29 juin 1886-Scy-Chazelles, 4 septembre 1963) aura pleinement réalisé sa vocation d’homme et de chrétien 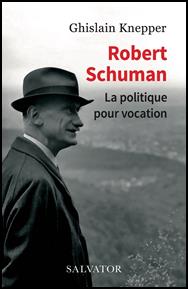 au service du bien commun. Dès septembre 1948, deux mois après son arrivée au Quai d’Orsay, il préfigure ce qui deviendra l’Assemblée du Conseil de l’Europe. Il s’est décidé en quelques heures, semble-t-il, après une longue conversation avec Duncan Sandys, diplomate et gendre de Winston Churchill. Après avoir négocié et signé le pacte atlantique, il lance, le 9 mai 1950, le projet de Communauté européenne du charbon et de l’acier qu’il a préparé avec Jean Monnet (1888-1979) et dont la neuvième et dernière version porte en germe le Marché commun. « Dans l’esprit de celui qui allait devenir le père de l’Europe, explique Ghislain Knepper dans son livre "Robert Schuman - La politique pour vocation", il s’agissait de mettre fin à des décennies de guerres fratricides entre la France et l’Allemagne et d’établir de nouveaux rapports entre États qui rendraient un conflit non seulement impensable, mais matériellement impossible. » au service du bien commun. Dès septembre 1948, deux mois après son arrivée au Quai d’Orsay, il préfigure ce qui deviendra l’Assemblée du Conseil de l’Europe. Il s’est décidé en quelques heures, semble-t-il, après une longue conversation avec Duncan Sandys, diplomate et gendre de Winston Churchill. Après avoir négocié et signé le pacte atlantique, il lance, le 9 mai 1950, le projet de Communauté européenne du charbon et de l’acier qu’il a préparé avec Jean Monnet (1888-1979) et dont la neuvième et dernière version porte en germe le Marché commun. « Dans l’esprit de celui qui allait devenir le père de l’Europe, explique Ghislain Knepper dans son livre "Robert Schuman - La politique pour vocation", il s’agissait de mettre fin à des décennies de guerres fratricides entre la France et l’Allemagne et d’établir de nouveaux rapports entre États qui rendraient un conflit non seulement impensable, mais matériellement impossible. »
Un chrétien convaincu et engagé
Né à Clausen, un faubourg de la ville de Luxembourg, il grandit en Allemagne, avant de s’établir à Metz comme avocat en 1912. Il gère un temps la ferme familiale en Moselle, dans une région dénommée jusqu’en 1870 le « Luxembourg français ». Il poursuit ses études à Metz, Berlin, Munich, Bonn et Strasbourg, considérant toutefois le français comme sa langue maternelle. C’est dans la capitale du Grand-Duché de Luxembourg qu’il fait la connaissance d’Eugénie Duren qui deviendra sa femme et qui lui donnera un fils, Jean-Baptiste Nicolas Robert : d’origine alsacienne, Eugénie est de 27 ans sa cadette. « Entre 1871 et 1918, rappelle son biographe, un fossé législatif, juridique, culturel et linguistique s’était creusé entre la France et l’Alsace-Lorraine. Dans ce climat particulier, Robert Schuman, devenu Français à l’âge de 32 ans, fit ses premiers pas en politique après avoir cédé à la pression de son entourage. Il participa à la fondation d’un parti régional, l’Union républicaine lorraine, héritier de l’ancien Zentrum allemand et des démocrates-chrétiens, et soutenu par l’Église catholique de Moselle. » Plus qu’aucun homme politique de ce temps, il fut avant tout un chrétien convaincu et engagé, soucieux de soumettre tous les actes de sa vie, publique et privée, aux impératifs de sa foi et de la morale qu’elle commande.
« De Gaulle l’a tué ! »
Sous-secrétaire d’État aux réfugiés dans le cabinet Paul Reynaud, en 1940, il décide de rentrer avec ses administrés à Metz où il est arrêté par la Gestapo. Après une courte détention, il s’évade et gagne la zone libre tout en cherchant des refuges dans des couvents. Renommé sous-secrétaire d’État aux réfugiés dans le gouvernement Pétain, il vote les pleins pouvoirs au maréchal à l’exemple de la majorité des parlementaires. Période douloureuse pour le député Schuman qui est frappé d’indignité nationale en 1945 et devient inéligible. Son incarcération, son évasion et son action en faveur des réfugiés alsaciens-mosellans lui valurent de recouvrer ses droits civiques et de retrouver ses fonctions politiques d’avant-guerre. On lui propose le ministère des Finances avant de devenir président du Conseil. « Il considérait que cela faisait partie de l’ordre des choses, estime G. Knepper. Il savait rester serein face à ses plus farouches opposants. Dix ans après avoir été taxé de "boche" à l’Assemblée nationale par le communiste Jacques Duclos, ces mots revinrent dans les propos du général de Gaulle. Quand il l’apprit, Robert Schuman, quoique profondément blessé par cette attaque gratuite qui réveilla à nouveau des douleurs familiales, réagit publiquement par un sourire et par cette phrase : "Il est assez soupe au lait." » Conseil. « Il considérait que cela faisait partie de l’ordre des choses, estime G. Knepper. Il savait rester serein face à ses plus farouches opposants. Dix ans après avoir été taxé de "boche" à l’Assemblée nationale par le communiste Jacques Duclos, ces mots revinrent dans les propos du général de Gaulle. Quand il l’apprit, Robert Schuman, quoique profondément blessé par cette attaque gratuite qui réveilla à nouveau des douleurs familiales, réagit publiquement par un sourire et par cette phrase : "Il est assez soupe au lait." »
Après des années aux affaires sous la IVe République comme président du Conseil, ministre des Affaires étrangères et garde des Sceaux, De Gaulle l’a évincé dès son retour au pouvoir en 1958. Il l’a reçu le vendredi 27 juin 1958, une heure durant sans lui laisser la parole : il lui a simplement conseillé de prendre sa retraite et de ne plus s’occuper de l’Europe… Robert Schuman venait de subir l’épreuve suprême : en une heure, il avait perdu tout ce pourquoi il s’était battu durant des années. Le mépris du général s’est manifesté lors des obsèques de Robert Schuman. Durant sept ans, le botaniste Jean-Marie Pelt déjeuna avec Robert Schuman tous les samedis, « avec un menu immuable, rappelle l’écologiste, omelette, fromage, fruit de saison ou tarte aux mirabelles » : « De Gaulle l’a tué, s’insurge le célèbre écologue. Adenauer, le chancelier allemand, avait annoncé sa venue, il s’est décommandé sur ordre de l’Élysée. » Charles de Gaulle avait également demandé au préfet de ne pas inviter Jean Monnet au repas à la préfecture en présence de cinq anciens présidents du conseil, qui, lorsqu’ils l’ont appris, ont refusé l’invitation… Petitesses posthumes exercées au détriment d’un grand homme dont l’histoire a retenu qu’il a mis en œuvre la réconciliation franco-allemande et l’idée européenne avec Konrad Adenauer en Allemagne, Alcide De Gasperi en Italie et Paul-Henri Spaak en Belgique.
Ghislain Knepper, inspecteur des finances publiques et écrivain
© Photo X, droits réservés
- Robert Schuman - La politique pour vocation, par Ghislain Knepper, préface du cardinal Jean-Claude Hollerich, postface de Mgr Jean-Christophe Lagleize, éditions Salvator, 154 pages, 2022 ;
- Schuman : « De Gaulle l’a tué », de Patrick Perotto, dans Est magazine, grand angle, quotidien l’Est Républicain, 25 août 2013.
Varia : le premier club de rugby français a été créé par deux Britanniques !
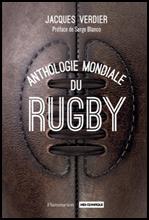 « Comment s’en défendre ? Ce furent, comme souvent, comme toujours, comme à peu près partout, deux jeunes Britanniques, Dreyfus et O’Connor, appartenant à la communauté anglophone du Havre, qui créèrent en 1872 le premier club de rugby français : le Havre Athletic Club. Et ce furent naturellement les Britanniques qui, à la même période, donnèrent naissance au Paris Football Club, avant de le propager de Nantes à Bordeaux, comme ils surent si savamment le faire aux antipodes, en Afrique du Sud, en Argentine et dans bien d’autres endroits. « Comment s’en défendre ? Ce furent, comme souvent, comme toujours, comme à peu près partout, deux jeunes Britanniques, Dreyfus et O’Connor, appartenant à la communauté anglophone du Havre, qui créèrent en 1872 le premier club de rugby français : le Havre Athletic Club. Et ce furent naturellement les Britanniques qui, à la même période, donnèrent naissance au Paris Football Club, avant de le propager de Nantes à Bordeaux, comme ils surent si savamment le faire aux antipodes, en Afrique du Sud, en Argentine et dans bien d’autres endroits.
« Question : d’où vint qu’ils furent aussitôt entendus par une jeunesse française plus encline alors à pratiquer l’athlétisme, à jouer au football, ou plus simplement encore à ne rien faire de son corps, selon la morale de l’époque ? L’anglomanie de la bonne société parisienne joua d’évidence un rôle éminent dans l’affaire. Un homme prit ici une importance que nul ne saurait sérieusement dénoncer : il s’agit de Pierre de Frédy, baron de Coubertin, qui se fixa pour projet de "rebronzer une jeunesse veule et confinée par l’enseignement du sport". Son message s’adressait avant tout à la jeune aristocratie française, aux élèves du lycée Condorcet où naîtra en 1882 le Racing Club de France.  À la manière des cercles de gentlemen de Londres, les jeunes bourgeois parisiens du Racing et du Stade français, déjà en lice, se retrouvaient alors pour s’adonner à ce jeu qui empruntait plus à la barette, sorte de "rugby à toucher", qu’au sport de combat tel qu’on l’entend désormais. L’activité retrouvant son droit de cité, on organisa dès 1890 un tournoi scolaire disputé dans les différents établissements de la capitale. En 1892, naquit le premier championnat auquel participaient trois clubs de Paris : l’Olympique, le Racing et le Stade. Le vainqueur reçut des mains du baron de Coubertin un bouclier ciselé par Charles Brennus. L’histoire était en marche. Et de fait, le rugby gagna bientôt la province : Bordeaux, Toulouse, Lyon. » À la manière des cercles de gentlemen de Londres, les jeunes bourgeois parisiens du Racing et du Stade français, déjà en lice, se retrouvaient alors pour s’adonner à ce jeu qui empruntait plus à la barette, sorte de "rugby à toucher", qu’au sport de combat tel qu’on l’entend désormais. L’activité retrouvant son droit de cité, on organisa dès 1890 un tournoi scolaire disputé dans les différents établissements de la capitale. En 1892, naquit le premier championnat auquel participaient trois clubs de Paris : l’Olympique, le Racing et le Stade. Le vainqueur reçut des mains du baron de Coubertin un bouclier ciselé par Charles Brennus. L’histoire était en marche. Et de fait, le rugby gagna bientôt la province : Bordeaux, Toulouse, Lyon. »
Extrait de l’« Anthologie mondiale du rugby », de Jacques Verdier [Photo Didier Pruvot © éditions Flammarion], préface de Serge Blanco, éditions Flammarion/Midi Olympique, 512 pages 2023.
Carnet : soyez original !
Certaines incitations des réseaux sociaux m’agacent : gagnez en originalité, en nouveauté dans votre écriture. Mais on ne peut pas apprendre à être original. On l’est, et c’est tout. En outre, une des caractéristiques de la nouveauté, c’est de ne pas être visible du tout.
(Mardi 30 janvier 2024)
|
Billet d’humeur
Les « boîtes » du préfet Poubelle
Les chiffonniers en ont beaucoup voulu au préfet de la Seine, en mars 1884, quand un de ses arrêtés assigna aux propriétaires d’immeubles parisiens l’obligation de mettre à la disposition des locataires des « récipients communs de capacité suffisante pour recevoir les résidus du ménage… », des ustensiles en bois garnis de fer blanc à l’intérieur. Relayés par les concierges, lesdits propriétaires ont vigoureusement protesté qu’on ne cessait de les accabler de charges et de sujétions supplémentaires intolérables. De surcroît, l’administration va plus loin puisqu’elle prévoit des conteneurs différents pour les déchets putrescibles, les papiers et chiffons, le verre, les faïences et les coquilles d’huîtres. Ce qui n’a pas manqué de provoquer davantage encore la puissante corporation des chiffonniers et autres biffins, placiers, triqueurs, rouleurs et chineurs, champions du recyclage avant la lettre, que la décision du préfet allait priver de leur gagne-pain. Les journalistes à l’époque brocardèrent le haut fonctionnaire et ses « drôles de boîtes ». Lui tint bon, convaincu de faire œuvre de salubrité publique. Issu d’une famille bourgeoise, Eugène Poubelle - c’est son nom - naît le 15 avril 1831 à Caen, une cité normande dont les édiles, dès 1699, avaient mis à la disposition des habitants des petits paniers destinés à recevoir les détritus ménagers. L’homme connaît une carrière brillante : préfet de Charente, d’Isère, de Corse, des Bouches-du-Rhône et de Seine, il est nommé au printemps 1896 ambassadeur de France au Vatican. Juste avant son départ de Rome, le pape le nomme comte par un bref du 1er décembre 1898. Lorsqu’il meurt à Paris le 16 juillet 1907, la ville lui réserve des funérailles solennelles à la Madeleine auxquelles prend part l’ancien président de la République Émile Loubet. Douze ans après, les traditionnels tombereaux tirés par des chevaux sont mis à la retraite et remplacés par un véhicule prototype comportant une benne à couvercles de 7 m3. Un nouveau pas est franchi en 1934 quand l’ingénieur lyonnais Fernand Rey lance sur le marché de l’assainissement public la benne tasseuse avec caisson fermé dans lequel les immondices sont comprimées par un piston. Le même système de compression automatique équipe les bennes des éboueurs aujourd’hui et les fameuses « boîtes » du préfet de la Seine, qui sont fabriquées en plastique et non plus en métal, ont pris le nom de leur inventeur.
|
Lecture critique
Nimrod, poète d’ascendance sylvestre
 Fils de pasteur luthérien, Nimrod Bena Djangrang (1959, Koyom, Tchad) a été nourri au verbe biblique. Il est entré en littérature par la poésie (Pierre poussière, éditions Obsidiane, 1989), marqué par les lettres françaises et engagé dans une modernité d’expression précoce. Nourri de références classiques, Gracq, Montesquieu et Platon, Chateaubriand, Racine et Valéry, Nimrod a quitté son pays en 1984, fuyant le régime d’Hissène Habré pour la Côte d’Ivoire, puis la France et Amiens (Somme), où ce docteur en philosophie vit et travaille aujourd’hui (enseignant la philo à l’université de Picardie Jules-Verne). Lorsqu’il quitte son pays natal, il a le même âge que le protagoniste de son roman, « La Traversée de Montparnasse ». Kouassi, 25 ans, a choisi de vivre à Paris, rue Alexis Vavin, au cœur de Montparnasse (6e arrondissement), une situation complexe et malaisée pour cet Ivoirien d’Abidjan partagé entre les codes ancestraux de son lieu d’origine et les codes en usage dans la capitale française. Orphelin à Bingerville, petite commune située près de la lagune Ébrié, dans la métropole abidjanaise, il est pris en charge à l’âge de 5 ans par Florence et Matthieu, des parents adoptifs et lettrés (tous deux professeurs). À ses 18 ans, ils lui apprennent qu’il est l’un des vingt-quatre enfants (douze filles, douze garçons), issus des vingt-quatre départements du pays, que le président a adoptés. Le baccalauréat en poche, il entre en faculté avec des chemises et des sous-vêtements frappés aux initiales du président ivoirien ! En dépit des avantages et des privilèges que lui octroie la condition de « fils de roi », Kouassi n’est pas à l’aise dans la montagne imaginaire qu’est Montparnasse. Noir entre les blancs, noble parmi les bourgeois, son appartenance baoulé et son ascendance sylvestre le soutiennent néanmoins dans cette quête qui lui ouvrira le cénacle prestigieux des littérateurs. Car le baoulé qu’il demeure viscéralement se souvient des contes que lui disait sa mère adoptive en plaçant les hommes des bois sur les plus hautes marches de l’imagination. Sa mère est la seule personne au monde, selon Kouassi, à avoir inventé le concept de "littérature chlorophyllienne". Elle enseignait la littérature des peuples réputés sans écriture, autrement dit elle enseignait la forêt, la bonne forêt, verte, luxuriante, nourricière. La forêt des peuples réputés sans écriture mais pas sans histoire. Fils de pasteur luthérien, Nimrod Bena Djangrang (1959, Koyom, Tchad) a été nourri au verbe biblique. Il est entré en littérature par la poésie (Pierre poussière, éditions Obsidiane, 1989), marqué par les lettres françaises et engagé dans une modernité d’expression précoce. Nourri de références classiques, Gracq, Montesquieu et Platon, Chateaubriand, Racine et Valéry, Nimrod a quitté son pays en 1984, fuyant le régime d’Hissène Habré pour la Côte d’Ivoire, puis la France et Amiens (Somme), où ce docteur en philosophie vit et travaille aujourd’hui (enseignant la philo à l’université de Picardie Jules-Verne). Lorsqu’il quitte son pays natal, il a le même âge que le protagoniste de son roman, « La Traversée de Montparnasse ». Kouassi, 25 ans, a choisi de vivre à Paris, rue Alexis Vavin, au cœur de Montparnasse (6e arrondissement), une situation complexe et malaisée pour cet Ivoirien d’Abidjan partagé entre les codes ancestraux de son lieu d’origine et les codes en usage dans la capitale française. Orphelin à Bingerville, petite commune située près de la lagune Ébrié, dans la métropole abidjanaise, il est pris en charge à l’âge de 5 ans par Florence et Matthieu, des parents adoptifs et lettrés (tous deux professeurs). À ses 18 ans, ils lui apprennent qu’il est l’un des vingt-quatre enfants (douze filles, douze garçons), issus des vingt-quatre départements du pays, que le président a adoptés. Le baccalauréat en poche, il entre en faculté avec des chemises et des sous-vêtements frappés aux initiales du président ivoirien ! En dépit des avantages et des privilèges que lui octroie la condition de « fils de roi », Kouassi n’est pas à l’aise dans la montagne imaginaire qu’est Montparnasse. Noir entre les blancs, noble parmi les bourgeois, son appartenance baoulé et son ascendance sylvestre le soutiennent néanmoins dans cette quête qui lui ouvrira le cénacle prestigieux des littérateurs. Car le baoulé qu’il demeure viscéralement se souvient des contes que lui disait sa mère adoptive en plaçant les hommes des bois sur les plus hautes marches de l’imagination. Sa mère est la seule personne au monde, selon Kouassi, à avoir inventé le concept de "littérature chlorophyllienne". Elle enseignait la littérature des peuples réputés sans écriture, autrement dit elle enseignait la forêt, la bonne forêt, verte, luxuriante, nourricière. La forêt des peuples réputés sans écriture mais pas sans histoire.
- La Traversée de Montparnasse, par Nimrod, éditions Gallimard, collection Continents noirs, 128 pages, 2020.
Portrait
Genèse d’une œuvre et généalogie d’une vocation
avec le vidéaste Richard Skryzak
Explicitant pourquoi et comment ses créations vidéographiques concernent directement et exaltent d’une certaine façon la notion de vanité (dans l’acception d’une nature morte symbolisant les fins dernières de l’homme) et les concepts qui lui sont associés, Richard Skryzak (Quarouble, Nord, 1960) se livre complètement dans « Vanité et art vidéo ». C’est-à-dire que l’ouvrage fournit par la rétrospection d’un parcours commencé au début des années 1980 des éléments d’appréciation extrêmement précieux sur la création du vidéaste et les raisons les plus intimes de sa vocation. 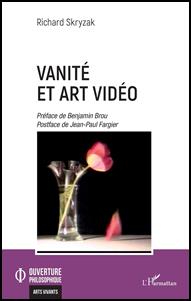 La démonstration est savamment étayée par des réflexions écrites, théoriques et poétiques ; elle est nourrie de références historiques, philosophiques, esthétiques et artistiques qui favorisent la compréhension du lecteur qu’il soit ou non déjà initié à la vidéographie (littéralement écriture de la vision). La démonstration est savamment étayée par des réflexions écrites, théoriques et poétiques ; elle est nourrie de références historiques, philosophiques, esthétiques et artistiques qui favorisent la compréhension du lecteur qu’il soit ou non déjà initié à la vidéographie (littéralement écriture de la vision).
Une trilogie d’exception
La peinture et le dessin qu’il pratique à dix-huit ans (disciplines continuées aujourd’hui), lorsqu’il intègre un double cursus d’arts plastiques à l’École des beaux-arts et à l’université de Valenciennes s’inspire de la figuration narrative qui se nourrit notamment des apports du cinéma et de la bande dessinée (citons Fromanger, Klasen, Monory, Schlosser, Sandorfi, Veličković) et de l’hyperréalisme américain où la figuration observe le réel à travers la photographie (Close, Don Eddy, Morley). La marée montante de l’art conceptuel l’incite à s’initier au cinéma expérimental avant de s’engager dans la recherche vidéographique la plus élaborée. « Électron » est sa première œuvre vidéographique (vidéo, couleur et son, 2mn45) créée en 1986 et montrée à l’École d’art de Dunkerque dans une exposition Art et Vidéo à laquelle prennent part le Coréen Nam June Paik (1932-2006) et l’Allemand Wolf Vostell (1932-1998). Ces deux pionniers de l’art vidéo constituent avec l’Américain Bill Viola (né en 1951) une sorte de trilogie d’exception de laquelle le vidéaste français se sent le plus proche. Suivront parmi les œuvres les plus marquantes : « Écran » (1988), « Coups de dés », « In Video Vanitas » (1995), « Vanité à la Tulipe » (1995-2009), « Coups de foudre » (1996), « Les Attributs du vidéaste », « Éclipse » (1999), « L’Arc-en-Ciel » (2001), « Autoportrait à la bulle » (2002), « La Lune ment toujours », « Rien de nouveau sous le soleil » (2009), « Impressions du soleil levant » (2011) et « Désir » (2016).
Le rôle déterminant de l’enfance
Lorsqu’il s’est plongé dans l’étude de l’histoire de l’art, il s’est très tôt intéressé à la peinture de Vanité en raison d’un questionnement métaphysique récurrent sur le temps et la mort. « Enfant, écrit-il dans "Vanité et art vidéo", j’ai d’abord "vu" les astres, les paysages, les êtres et les images, avant d’être en mesure de les reproduire et de les analyser.  De même que j’ai "vu" la plupart de mes vidéos avant de les filmer et de les conceptualiser. Je crois qu’il y a une pensée visuelle et que le monde sensible précède le monde intelligible. » « Ce n’est qu’avec le temps, explique-t-il plus loin, que j’ai réalisé à quel point mon enfance avait joué un rôle déterminant à la fois dans mon désir de devenir artiste, mais aussi comme source d’inspiration de beaucoup de mes réalisations. La lune, le soleil, la foudre, l’arc-en-ciel, les images dessinées, peintes, filmées, télévisées caressaient déjà ma fibre créatrice comme autant de lucioles, de lueurs, d’illuminations passagères, de petites vanités. » Ainsi le héros masqué Zorro a initié en quelque sorte la vidéo « Coups de foudre ». Même si le poème de Stéphane Mallarmé Un coup de dés n’abolira jamais le hasard l’a quelque peu influencé, « Coups de dés » renvoie aux joueurs de cartes et de 421 réunis dans l’estaminet de village tenu par ses parents ; elle s’appuie en outre sur tout un faisceau de réflexions sur le jeu, le hasard et la condition humaine et artistique. De même que j’ai "vu" la plupart de mes vidéos avant de les filmer et de les conceptualiser. Je crois qu’il y a une pensée visuelle et que le monde sensible précède le monde intelligible. » « Ce n’est qu’avec le temps, explique-t-il plus loin, que j’ai réalisé à quel point mon enfance avait joué un rôle déterminant à la fois dans mon désir de devenir artiste, mais aussi comme source d’inspiration de beaucoup de mes réalisations. La lune, le soleil, la foudre, l’arc-en-ciel, les images dessinées, peintes, filmées, télévisées caressaient déjà ma fibre créatrice comme autant de lucioles, de lueurs, d’illuminations passagères, de petites vanités. » Ainsi le héros masqué Zorro a initié en quelque sorte la vidéo « Coups de foudre ». Même si le poème de Stéphane Mallarmé Un coup de dés n’abolira jamais le hasard l’a quelque peu influencé, « Coups de dés » renvoie aux joueurs de cartes et de 421 réunis dans l’estaminet de village tenu par ses parents ; elle s’appuie en outre sur tout un faisceau de réflexions sur le jeu, le hasard et la condition humaine et artistique.
Poésie électronique et image-nomade
Ses œuvres, ses dessins, ses peintures, ses installations relèvent de la « poésie électronique », une expression qu’il qualifie de « prise de position esthétique, voire politique, au regard d’une conception trop largement répandue dans l’art contemporain mettant la primauté du discours de l’œuvre sur le concept ou l’idée, au détriment du sensible, de l’émotif et du plaisir ».  « De fait, complète-t-il, j’inscris mon entreprise dans le projet plus vaste d’une "Poétique de l’Art Vidéo". » Il revendique de la même façon le concept d’« Image-Nomade » pour qualifier la vidéo en général et les siennes en particulier. Qualifiées d’immatérielles, de temporelles, d’éphémères, d’instables, d’évanescentes, de fluides, ses images, ses vidéos voyagent en effet, de Valenciennes à Paris, de Marseille à Rotterdam, du Chili à la Lettonie, de l’Argentine à la Palestine, des lieux, des nations qui le sollicitent à partager ses créations vidéographiques. Ce concept lui vient de ses affinités télévisuelles : circulation spatiale des ondes, énergies des flux, connexions internationales et mondiales. « L’"Image-Nomade" est proche de l’"Image-Vanité", explique-t-il, en ce sens où c’est une image instable, fluctuante, fuyante, insaisissable, éphémère, de passage » ; l’une et l’autre cherchent un endroit où se poser, l’écran en l’occurrence qui se mue alors en territoire, en une terre d’accueil. « De fait, complète-t-il, j’inscris mon entreprise dans le projet plus vaste d’une "Poétique de l’Art Vidéo". » Il revendique de la même façon le concept d’« Image-Nomade » pour qualifier la vidéo en général et les siennes en particulier. Qualifiées d’immatérielles, de temporelles, d’éphémères, d’instables, d’évanescentes, de fluides, ses images, ses vidéos voyagent en effet, de Valenciennes à Paris, de Marseille à Rotterdam, du Chili à la Lettonie, de l’Argentine à la Palestine, des lieux, des nations qui le sollicitent à partager ses créations vidéographiques. Ce concept lui vient de ses affinités télévisuelles : circulation spatiale des ondes, énergies des flux, connexions internationales et mondiales. « L’"Image-Nomade" est proche de l’"Image-Vanité", explique-t-il, en ce sens où c’est une image instable, fluctuante, fuyante, insaisissable, éphémère, de passage » ; l’une et l’autre cherchent un endroit où se poser, l’écran en l’occurrence qui se mue alors en territoire, en une terre d’accueil.
« La grande affaire de Skryzak, estime Jean-Paul Fargier dans la postface du livre, est de démontrer en théorie et prouver en pratique que la Vidéo et la Peinture sont de forces égales quand elles se décident à lutter sur le sujet des Vanités. Bien plus : la Vidéo n’est "elle-même" que quand elle affronte la Vanité. Car en quelque sorte elle est faite pour ça. »
Richard Skryzak, 2016 © Photo Florentine Skryzak
Richard Skryzak, « Autoportrait à la bulle », 2001, vidéo, couleur, son, 1 mn.
- Vanité et art vidéo, par Richard Skryzak, préface de Benjamin Brou (professeur à la Sorbonne, université Paris 1), postface de Jean-Paul Fargier (réalisateur et producteur de télévision, maître de conférences à l’université Paris VIII), éditions L’Harmattan, collection Ouverture philosophique, 236 pages, 2024.
Dans les Papiers collés :
Varia : Lily Pastré, la comtesse au grand cœur
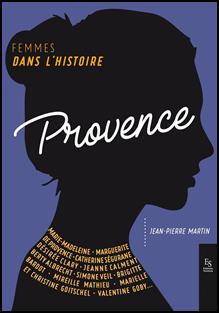 « Elle a soutenu les artistes de son temps, elle a caché de nombreux proscrits traqués par la Gestapo, elle est à l’origine du festival d’Aix-en-Provence, elle a hébergé les Chiffonniers d’Emmaüs. C’était Lily Pastré, la comtesse au grand cœur. « Elle a soutenu les artistes de son temps, elle a caché de nombreux proscrits traqués par la Gestapo, elle est à l’origine du festival d’Aix-en-Provence, elle a hébergé les Chiffonniers d’Emmaüs. C’était Lily Pastré, la comtesse au grand cœur.
« Marie-Louise Double de Saint-Lambert voit le jour à Marseille le 9 décembre 1891 (décédée à Marseille le 8 août 1974). Elle est russe par sa mère et descend de la famille Noilly-Prat, riches liquoristes marseillais. Elle épouse en 1916 le comte Jean Pastré, dont elle divorce en 1939. Son aisance financière lui permet de se consacrer aux autres, notamment par le biais du mécénat. En 1940, la cité phocéenne est devenue le refuge d’innombrables proscrits ayant quitté la zone occupée. Lily aménage une belle résidence campagnarde, la Villa provençale, à Montredon, pour y recevoir qui bon lui semble. Elle crée la même année "Pour que l’esprit vive", une association destinée à venir en aide aux exilés. "Dans sa villa de Montredon, écrit Alain Paire (Un mécène dans la tourmente de l’histoire : la comtesse Lily Pastré, Choses vues, choses lues, 2014), c’est à présent un va-et-vient incessant. On y croise des musiciens (Pablo Casals, Darius Milhaud, Georges Auric, Samson François, Rudolf Firkušný), des peintres (André Masson, Rudolf Kundera qui sera son portraitiste) et des hommes de lettres (Lanza Del Vasto, Marcel Brion, Gérard Bauer."
« Surtout, elle y protège plusieurs musiciennes d’origine juive, Lily Laskine, Youra Guller, Monique Haas, Madeleine Grey et particulièrement la pianiste Clara Haskil, à qui elle permet de se faire opérer d’une tumeur au cerveau. Après la guerre, en 1948, elle s’associe avec Gabriel Dussurget pour organiser, à Aix-en-Provence, un festival d’art lyrique. Pour la première édition, elle fait venir l’orchestre allemand d’Hans Rosbaud pour y interpréter "Cosi fan tutte" ; trois ans après la fin de la guerre, il fallait oser… Très liée à l’abbé Pierre, elle met une partie de son domaine à la disposition des chiffonniers d’Emmaüs. Sa générosité et son altruisme étaient ses marques de fabrique. Peut-être avait-elle fait sienne la maxime de Georges Guynemer : "Tant qu’on n’a pas tout donné, on n’a rien donné." »
Extrait de l’ouvrage « Femmes dans l’histoire : Provence », de Jean-Pierre Martin, éditions Sutton, 120 pages, 2019.
Carnet : portraits de parlementaires
Parmi les portraits de parlementaires que brosse Theodor Herzl (1860-1904) dans « Le Palais Bourbon - Tableaux de la vie parlementaire française » (éditions de l’Aube, 1998), j’ai noté celui de Paul Deschanel (11e président de la République française). C’est « le numéro un des jeunes premiers du centre gauche, décrit le journaliste et écrivain austro-hongrois, un politicien de salon qui bavarde en s’appuyant nonchalamment contre la cheminée et qui résout les problèmes plus ardus après le rôti, entre la poire et le fromage ». Je ne veux pas retenir la formule assassine qui vient sous sa plume à propos du suffrage universel : « Être obligé de serrer des mains sales. »
La poésie, un tour de cartes…
Jean Cocteau définissait la poésie comme « un tour de cartes exécuté par l’âme ».
Classique ou moderne ?
Assurément je me complais dans un certain classicisme littéraire. Je cherche néanmoins le moyen de devenir très moderne, rêvant de figurer parmi ces précurseurs qui font « retarder toutes les pendules du monde ».
(Mardi 20 février 2024)
De Shakespeare à Voltaire
Poète et écrivain indien d’expression anglaise, Vikram Seth se plaît à souligner le plaisir qu’il prend à la lecture de Shakespeare et de Voltaire. Les personnages que le second met en scène dans ses ouvrages historiques ou philosophiques, dans ses récits et tragédies le comblent au point qu’il a placé en épigraphe de son roman « Un garçon convenable » (éd. Grasset, 1995) deux citations du philosophe des Lumières : « Le secret d’ennuyer, c’est de tout dire » et « Le superflu, cette chose si nécessaire. »
(Vendredi 23 février 2024)
|
Billet d’humeur
Le syndrome de Stockholm
Le jeudi 23 août 1973, au centre de Stockholm, Jan-Erik Olsson, 32 ans, qui vient de s’évader d’une prison de la banlieue pénètre dans la succursale de la Sveriges Kreditbank, le visage grimé, portant perruque et armé d’une mitraillette. Expert en perçage de coffres-forts et en explosifs, il est déterminé à en repartir avec suffisamment d’argent pour rebâtir sa vie ailleurs dans l’anonymat. Le cambrioleur a pris en otages des employés, trois femmes et un homme. Et il a obtenu de la police - et du ministère de la Justice - de faire sortir de prison son camarade Clark Olofsson, 26 ans, afin qu’il le rejoigne à la banque. Les deux braqueurs sont retranchés avec leurs otages dans la salle des coffres, au rez-de-chaussée, tandis que la police a installé son état-major au premier étage de l’établissement. Le siège dure six longues journées et fascine les Suédois, inquiets à l’idée que les ravisseurs pourraient tuer les captifs. Anxieux et perplexe, le Premier ministre Olof Palme, 46 ans, suit les événements : le roi Gustave VI Adolphe, 90 ans, souffre d’une pneumonie aiguë et ses jours sont comptés. Avant le dénouement, le Premier ministre s’est entretenu avec une des otages ; l’employée Kristin Ehnmark, sténographe de 22 ans, l’a assuré de sa confiance dans les hors-la-loi et de sa défiance envers les représentants de l’ordre ! La situation relève de la plus pure tragi-comédie. Durant toutes les péripéties de la prise d’otages, ravisseurs et otages se lient les uns aux autres. Olof Palme est épouvanté par le fait que les quatre victimes éprouvent une telle empathie vis-à-vis de leurs bourreaux. Les otages craignent même pour la vie des braqueurs ! Par la suite, ils refuseront tous les quatre de témoigner à charge contre Olsson et Olofsson. Étrange processus d’identification de l’agressé à l’agresseur, qui garantit au premier, semble-t-il, une certaine sécurité sans être tenaillé par l’angoisse, un tel phénomène peut apparaître dans des états de survie. C’est ainsi que le braquage de la Sveriges Kreditbank a donné son nom au syndrome de Stockholm.
|
Lecture critique
Yannick Le Marec et le bon temps des colonies…
Ces dernières années, le retour des objets « arrachés à leurs cultures d’origine par la violence du colonialisme » bat son plein. Culturel et politique, le processus de restitution impose au préalable de déterminer si l’extraction des objets concernés provient d’un don, d’un achat en bonne et due forme, d’une collecte scientifique, 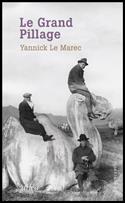 religieuse, d’un vol, d’une extorsion, d’une confiscation ou d’un butin de guerre. La plus ancienne demande de restitution réfère à un tambour Djidji Ayokwe du peuple Ébrié, de Côte d’Ivoire, symbole royal réclamé depuis 1958. Ledit instrument fut confisqué par un administrateur colonial en 1916 en représailles, parce que des villageois avaient refusé de se soumettre à un travail forcé : il n’a toujours pas été rendu à ses propriétaires… Biens mal acquis, pièces à conviction, les objets ethnologiques, sculptures, masques, têtes naturalisées, manuscrits, photographies, amulettes, stèles, mobilier, orfèvrerie ou instruments de musique se trouvent au cœur de l’ouvrage de Yannick Le Marec (Lorient, 1954). L’historien et écrivain ne mâche pas ses mots pour dire la monstruosité et la barbarie des pillages et des crimes commis par les sujets des puissances coloniales. Dans son réquisitoire, il place deux hommes de lettres, tous deux militaires, au nombre des auteurs ou complices des exactions incriminées, en Chine principalement après la révolte des Boxers (1899-1901) et lors de la mise à sac de la Cité interdite par les troupes anglaises et françaises, l’officier de marine Pierre Loti (1850-1923) religieuse, d’un vol, d’une extorsion, d’une confiscation ou d’un butin de guerre. La plus ancienne demande de restitution réfère à un tambour Djidji Ayokwe du peuple Ébrié, de Côte d’Ivoire, symbole royal réclamé depuis 1958. Ledit instrument fut confisqué par un administrateur colonial en 1916 en représailles, parce que des villageois avaient refusé de se soumettre à un travail forcé : il n’a toujours pas été rendu à ses propriétaires… Biens mal acquis, pièces à conviction, les objets ethnologiques, sculptures, masques, têtes naturalisées, manuscrits, photographies, amulettes, stèles, mobilier, orfèvrerie ou instruments de musique se trouvent au cœur de l’ouvrage de Yannick Le Marec (Lorient, 1954). L’historien et écrivain ne mâche pas ses mots pour dire la monstruosité et la barbarie des pillages et des crimes commis par les sujets des puissances coloniales. Dans son réquisitoire, il place deux hommes de lettres, tous deux militaires, au nombre des auteurs ou complices des exactions incriminées, en Chine principalement après la révolte des Boxers (1899-1901) et lors de la mise à sac de la Cité interdite par les troupes anglaises et françaises, l’officier de marine Pierre Loti (1850-1923)  et le médecin Victor Segalen (1878-1919). Hormis le casque de liège, le teint hâlé sous la visière et les bottes couvertes de poussière, presque tout sépare les deux hommes, tandis que l’aîné est l’objet de la détestation obsessionnelle du cadet… et le médecin Victor Segalen (1878-1919). Hormis le casque de liège, le teint hâlé sous la visière et les bottes couvertes de poussière, presque tout sépare les deux hommes, tandis que l’aîné est l’objet de la détestation obsessionnelle du cadet…
Au travers des récits des deux voyageurs, l’auteur montre de quelle façon l’un et l’autre n’ont pas condamné avec une très grande fermeté le commerce et la captation d’objets cultuels et culturels - a fortiori quand il s’agissait d’administrateurs et de militaires français - ainsi que la violence guerrière employée à ces fins. Il révèle assez crûment ce qui se cache dans les coulisses de leurs pérégrinations (en Chine, Polynésie, île de Pâques) et tout ce qui est tu dans les récits, les faits, des conduites pas très honorables. Dans des chroniques, dans les reportages qu’il livre aux journaux, Pierre Loti raconte la violence coutumière de la colonisation avec ses canonnades, ses exécutions, ses razzias comme si elle allait de soi en temps de conquête. Victor Segalen qui voyage avec l’aristocrate Auguste Gilbert de Voisins va même plus loin : en 1909, dans une pagode chinoise, il se prend d’une folie destructrice en séparant à la hache la tête d’un bouddha de bois pour l’emporter au retour ! D’où la cinglante conclusion de Yannick Le Marec : « C’est un bouddha dont on devine les couches successives de peintures qui animaient son visage, aux joues rondes, à la peau craquelée, la bouche aux lèvres un peu épaisses, sans rictus, le nez sectionné, camard lui aussi, les yeux clos, "les longues et nobles oreilles étirées par des anneaux d’or pesants - comme en portaient les fils de rois dans la vallée du Gange" -, le front ceint d’un bandeau, peut-être la trace d’une couronne disparue et, à l’endroit de la décollation, je remarque le bois éclaté, les marques des coups, de la hache, ces indices que je ne peux m’empêcher de déceler sur toutes les têtes de bouddhas qui ornent et font la gloire de nos musées, et j’y vois les traces d’un grand pillage du monde. »
Yannick Le Marec © Photo X, droits réservés
- Le Grand Pillage, par Yannick Le Marec, éditions Arléa, 208 pages, 2022. En couverture, les frères Grant posant sur le chemin sacré de la tombe de l’empereur Ming Hongwu, à Nankin. © Bridgeman Images.
Portrait
La permaculture au secours de notre planète
 Si les réponses de l’agroécologie et de l’agriculture biologique à la lente dégradation des conditions de la vie humaine, animale et végétale présentent un intérêt et une pertinence indéniables, elles sont loin d’être suffisantes. La permaculture en propose d’autres, complémentaires. C’est Blaise Leclerc qui l’assure dans son livre « Ma bible de la permaculture ». La forte consommation d’énergies fossiles, l’épuisement des ressources minières, les conséquences du réchauffement climatique, l’effondrement de la biodiversité naturelle, la pollution généralisée (de l’air, de l’eau et du sol) mettent en péril la santé de notre Terre et de tous les humains. La qualité des sols est compromise, avertit justement l’ingénieur agronome et expert en fertilisation organique dans un autre livre, « Les Clés d’un sol vivant ». « Depuis un peu plus d’un siècle, la fertilité du sol, c’est-à-dire sa capacité à nourrir les plantes, n’a cessé de décliner un peu partout, déplore-t-il, consécutivement à l’emploi massif de fertilisants chimiques, au recours systématique à des labours profonds permis par la généralisation de tracteurs de plus en plus puissants, à l’absence de restitutions organiques, à la monoculture, au surpâturage. » En outre, il faut savoir que les sols (sable, limon, argile) sont très longs à se former : « La vitesse de formation d’un sol est très lente, observe-t-il. Pour obtenir un sol de 10 cm d’épaisseur, il faut donc a minima 10 000 ans ! ». Si les réponses de l’agroécologie et de l’agriculture biologique à la lente dégradation des conditions de la vie humaine, animale et végétale présentent un intérêt et une pertinence indéniables, elles sont loin d’être suffisantes. La permaculture en propose d’autres, complémentaires. C’est Blaise Leclerc qui l’assure dans son livre « Ma bible de la permaculture ». La forte consommation d’énergies fossiles, l’épuisement des ressources minières, les conséquences du réchauffement climatique, l’effondrement de la biodiversité naturelle, la pollution généralisée (de l’air, de l’eau et du sol) mettent en péril la santé de notre Terre et de tous les humains. La qualité des sols est compromise, avertit justement l’ingénieur agronome et expert en fertilisation organique dans un autre livre, « Les Clés d’un sol vivant ». « Depuis un peu plus d’un siècle, la fertilité du sol, c’est-à-dire sa capacité à nourrir les plantes, n’a cessé de décliner un peu partout, déplore-t-il, consécutivement à l’emploi massif de fertilisants chimiques, au recours systématique à des labours profonds permis par la généralisation de tracteurs de plus en plus puissants, à l’absence de restitutions organiques, à la monoculture, au surpâturage. » En outre, il faut savoir que les sols (sable, limon, argile) sont très longs à se former : « La vitesse de formation d’un sol est très lente, observe-t-il. Pour obtenir un sol de 10 cm d’épaisseur, il faut donc a minima 10 000 ans ! ».
Système inspiré des écosystèmes naturels
Système de culture intégré et évolutif associant maraîchage et jardinage amateur, la permaculture s’inspire des écosystèmes naturels. La démarche - la philosophie du système en quelque sorte - repose sur trois « commandements » : prendre soin de la Terre,  se préoccuper des humains et partager équitablement les ressources. Le terme permaculture a été inventé en 1970 par les Australiens Bill Mollison (1928-2016) et David Holmgren (1955) qui ont fixé les règles de la nouvelle discipline en s’inspirant des pratiques de l’agriculteur japonais Masanobu Fukuoka (1913-2008). La permaculture favorise une agriculture pérenne, elle n’épuise pas les sols, exclut toute pollution et limite la production de déchets. Pour parvenir à ses fins, le permaculteur diversifie ses cultures en s’adaptant étroitement aux conditions locales, à savoir la biodiversité environnante, la température, l’hygrométrie et les caractéristiques pédologiques. Les systèmes permacoles gagnent à être autonomes et auto-suffisants, ce qui entraîne généralement une efficacité énergétique et un bon niveau de production. « Quarante ans après sa naissance, reconnaît Blaise Leclerc, on ne peut pas dire que la permaculture ait chamboulé le modèle agricole dominant. Cependant, de nombreux mouvements alternatifs, proches de la permaculture, se développent de plus en plus. En France, l’agriculture est encore majoritairement "l’affaire des agriculteurs", encadrée par un puissant syndicalisme. se préoccuper des humains et partager équitablement les ressources. Le terme permaculture a été inventé en 1970 par les Australiens Bill Mollison (1928-2016) et David Holmgren (1955) qui ont fixé les règles de la nouvelle discipline en s’inspirant des pratiques de l’agriculteur japonais Masanobu Fukuoka (1913-2008). La permaculture favorise une agriculture pérenne, elle n’épuise pas les sols, exclut toute pollution et limite la production de déchets. Pour parvenir à ses fins, le permaculteur diversifie ses cultures en s’adaptant étroitement aux conditions locales, à savoir la biodiversité environnante, la température, l’hygrométrie et les caractéristiques pédologiques. Les systèmes permacoles gagnent à être autonomes et auto-suffisants, ce qui entraîne généralement une efficacité énergétique et un bon niveau de production. « Quarante ans après sa naissance, reconnaît Blaise Leclerc, on ne peut pas dire que la permaculture ait chamboulé le modèle agricole dominant. Cependant, de nombreux mouvements alternatifs, proches de la permaculture, se développent de plus en plus. En France, l’agriculture est encore majoritairement "l’affaire des agriculteurs", encadrée par un puissant syndicalisme.  Toutefois, les ponts entre les agriculteurs et les consommateurs sont de plus en plus nombreux, comme en témoigne la mise en place des Amap (Association pour le maintien d’une agriculture paysanne). […] Mais il faudra sans doute attendre le début de la descente énergétique pour observer des changements plus radicaux dans la manière de concevoir la production agricole, car elle reste fortement dépendante des énergies fossiles. » Toutefois, les ponts entre les agriculteurs et les consommateurs sont de plus en plus nombreux, comme en témoigne la mise en place des Amap (Association pour le maintien d’une agriculture paysanne). […] Mais il faudra sans doute attendre le début de la descente énergétique pour observer des changements plus radicaux dans la manière de concevoir la production agricole, car elle reste fortement dépendante des énergies fossiles. »
La riche biodiversité des villes et des campagnes
Au nombre des espèces végétales qui peuplent le territoire français, on dénombre des arbres et des fleurs qui sont plantés par les services techniques des mairies et par des particuliers. Mais des plantes plus sauvages germent sur les trottoirs, entre les pavés ou dans les fissures du bitume, sur les vieux murs et les remparts, dans les parcs et jardins, au bord de la mer, sur les quais, les plages et les dunes, sur les talus des routes et des autoroutes, parmi les remblais et les décombres, au milieu des friches et des coupes forestières, dans les champs, 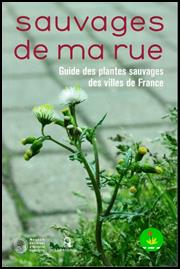 les vignes et les vergers, le long des cours d’eau, sur les toits, dans les haies ou les sols pollués. Des habitants couvrent les murs de leur maison de plantes grimpantes. Toutes ces espèces végétales dites sauvages qui participent à la biodiversité urbaine et rurale font l’objet de deux livres très intéressants, « Ça pousse près de chez vous » et « Sauvages de ma rue », le Muséum national d’histoire naturelle étant partie prenante du second. Les contributeurs de ces deux ouvrages rappellent à juste raison que les espèces sauvages ainsi que les espaces verts des villes et des villages tempèrent les canicules, prennent part à l’absorption des gaz à effet de serre, aident à la dépollution de l’eau et du sol et s’avèrent salutaires sinon essentiels au bien-être et à la santé des populations. les vignes et les vergers, le long des cours d’eau, sur les toits, dans les haies ou les sols pollués. Des habitants couvrent les murs de leur maison de plantes grimpantes. Toutes ces espèces végétales dites sauvages qui participent à la biodiversité urbaine et rurale font l’objet de deux livres très intéressants, « Ça pousse près de chez vous » et « Sauvages de ma rue », le Muséum national d’histoire naturelle étant partie prenante du second. Les contributeurs de ces deux ouvrages rappellent à juste raison que les espèces sauvages ainsi que les espaces verts des villes et des villages tempèrent les canicules, prennent part à l’absorption des gaz à effet de serre, aident à la dépollution de l’eau et du sol et s’avèrent salutaires sinon essentiels au bien-être et à la santé des populations.
240 espèces sauvages et une moisson d’anecdotes
Parmi les 240 espèces sauvages présentées dans le « Guide des plantes sauvages des villes de France », le lecteur apprend une multitude d’informations historiques, vernaculaires, scientifiques, médicinales et culinaires. Il apprend ainsi : que le céleri est une plante des marais, qu’à l’origine le fraisier est une plante de sous-bois (la fraise des bois), que la région d’origine de l’abricotier est l’Himalaya, que le sureau noir est aussi appelé « arbre de Judas » car c’est à la branche d’un tel arbre que le douzième apôtre du Christ, Judas Iscariote, se serait pendu, que la prêle des champs existait déjà au carbonifère (il y a environ 250 millions d’années), que l’envahissante vergerette de Buenos Aires résiste au glyphosate, que le génome très simple de l’arabette des dames lui vaut d’être devenue la "souris de laboratoire" des généticiens des plantes, que les baies rouges toxiques de l’arum d’Italie l’impliquent comme 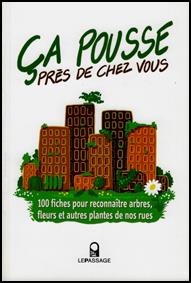 première cause d’appel aux centres antipoison du pays, que les propriétés de la berce commune lui permettent de traiter efficacement l’impuissance masculine, que la pâquerette vivace fleurit toute l’année avec un pic de floraison vers Pâques (d’où son nom), que la famille de l’arbre ginkgo, originaire de Chine, est apparue sur Terre il y a plus de 270 millions d’années, que les fleurs du robinier faux-acacia peuvent se manger en beignet et qu’on fabrique les touches de piano avec le tilleul argenté. L’occasion est donnée de rappeler aussi que les marrons glacés ou grillés, comestibles, sont en réalité des châtaignes, fruits du châtaignier : ce ne sont donc pas les fruits du marronnier d’Inde. On sait désormais que les graines du paulownia tomenteux ont été utilisées par les Chinois pour caler les objets en porcelaine destinés à voyager sur de longues distances : cet usage a fatalement induit la propagation de l’espèce par-delà les océans. Quant aux semences du laurier-cerise, elles sont dispersées par les oiseaux et les… chauves-souris frugivores. Vous ne savez peut-être pas non plus que le pétunia à grandes fleurs et le tabac étaient utilisés de la même manière en Amazonie, fumés, et inclus dans des potions ; certaines espèces de pétunias seraient même psychotropes… Enfin, sachez que les fleurs de la cymbalaire des murailles manifestent un comportement assez singulier : elles sont initialement tournées vers la lumière (phototropisme positif) puis, après fécondation, elles se détournent de celle-ci (phototropisme négatif). première cause d’appel aux centres antipoison du pays, que les propriétés de la berce commune lui permettent de traiter efficacement l’impuissance masculine, que la pâquerette vivace fleurit toute l’année avec un pic de floraison vers Pâques (d’où son nom), que la famille de l’arbre ginkgo, originaire de Chine, est apparue sur Terre il y a plus de 270 millions d’années, que les fleurs du robinier faux-acacia peuvent se manger en beignet et qu’on fabrique les touches de piano avec le tilleul argenté. L’occasion est donnée de rappeler aussi que les marrons glacés ou grillés, comestibles, sont en réalité des châtaignes, fruits du châtaignier : ce ne sont donc pas les fruits du marronnier d’Inde. On sait désormais que les graines du paulownia tomenteux ont été utilisées par les Chinois pour caler les objets en porcelaine destinés à voyager sur de longues distances : cet usage a fatalement induit la propagation de l’espèce par-delà les océans. Quant aux semences du laurier-cerise, elles sont dispersées par les oiseaux et les… chauves-souris frugivores. Vous ne savez peut-être pas non plus que le pétunia à grandes fleurs et le tabac étaient utilisés de la même manière en Amazonie, fumés, et inclus dans des potions ; certaines espèces de pétunias seraient même psychotropes… Enfin, sachez que les fleurs de la cymbalaire des murailles manifestent un comportement assez singulier : elles sont initialement tournées vers la lumière (phototropisme positif) puis, après fécondation, elles se détournent de celle-ci (phototropisme négatif).
Nous ne résistons pas au souhait de vous communiquer un autre inventaire à la Prévert relatif au vocabulaire particulièrement imagé que les botanistes et les jardiniers ont attribué aux variétés des espèces légumières et fruitières : l’aubergine connaît ainsi des variétés nommées dourga, little finger, monstrueuse de New York ou barbentane ; la carotte distingue la blanche de Küttingen et la jaune du Doubs ; le céleri-branche affiche des variétés appelées lino, mambo et tango ; lady godiva et sweet dumpling patidou sont des variétés de courges ; géant mammouth (fenouil), bandit et fantassin (poireau), petit marseillais (poivron), boule de neige et white rock (chou-fleur), dauphine et grise de Saint-Jean (figuier), grosse mignonne et téton de Vénus (pêcher), doyenne du comice (poirier), bénédictin, court pendu et patte de loup (pommier), loch ness et navaho (mûrier), cornichon blanc et dattier de Beyrouth (vigne). Que de fantaisie et de poésie dans ces dénominations !
Blaise Leclerc © Photo Jean-Jacques Raynal
- Ma bible de la permaculture, par Blaise Leclerc, éditions Leduc, 372 pages, 2020 ;
- Les Clés d’un sol vivant, par Blaise Leclerc, éditions Terre vivante, 176 pages, 2017 ;
- Ça pousse près de chez vous - 100 fiches pour reconnaître arbres, fleurs et autres plantes de nos rues, par Nathalie Machon (professeur d’écologie urbaine au Muséum national d’histoire naturelle) et Éric Motard (botaniste à l’université Paris VII Denis-Diderot), éditions Le Passage, 240 pages, 2016 ;
- Sauvages de ma rue - Guides des plantes sauvages des villes de France, sous la direction de Nathalie Machon et Éric Motard, éditions Le Passage/Muséum national d’histoire naturelle, 416 pages, 2012.
Varia : une centrale thermique à l’épreuve de la transition énergétique
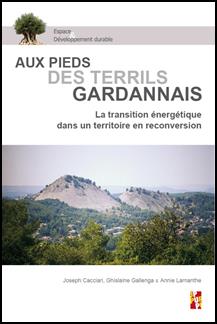 « Le Bassin minier de Provence se présente comme un laboratoire de la transition énergétique, de différents points de vue. […] « Le Bassin minier de Provence se présente comme un laboratoire de la transition énergétique, de différents points de vue. […]
« La Centrale thermique de Gardanne-Meyreuil (Bouches-du-Rhône) est implantée au début des années 1950 par Charbonnages de France (CDF), entité issue de la nationalisation du gaz et de l’électricité à la Libération. Elle a longtemps été un opérateur important du secteur public de l’énergie. C’est dans ce cadre qu’elle apparaît et qu’elle va fonctionner pendant plusieurs décennies. Mise en service à partir de 1954, elle a pour vocation de produire de l’électricité en offrant au lignite extrait sur le territoire son principal débouché. En 1995, CDF filialise certaines de ses activités avec la création de la société anonyme Société nationale d’électricité thermique (SNET), premier pas vers la privatisation du secteur qui prend place dans le Pacte charbonnier de 1994. CDF sera dissout en 2007. En 2000, le capital de la SNET est ouvert et le groupe privé espagnol Endesa y entre à hauteur de 30 %. Avec le temps, la centrale rompt son lien avec l’approvisionnement local pour se fournir en charbon d’importation, moins cher, qui transite par le port minéralier de Fos-sur-Mer. Une orientation qui suscita de nouvelles problématiques - coût de la matière, problèmes d’approvisionnement et de transfert des ressources, problèmes environnementaux. En 2005, Endesa devient majoritaire, entérinant la privatisation de cette entité. C’est ensuite E.ON, un groupe allemand qui en deviendra propriétaire en 2008. En 2014, le groupe opère une scission de ses activités, les centrales thermiques passent sous la coupe d’UNIPER, une entité qui sera cédée à une holding tchèque EPH pour, en 2019, être intégrée à sa filiale GazelEnergie. Cette histoire témoigne, comme celle de nombreux tissus productifs localisés, des méandres dans lesquels les activités productives ont été prises au cours des dernières décennies. En l’occurrence ici, le désengagement de l’État, l’entrée des opérateurs privés et internationaux dans le secteur, avec son lot de fusions et de rachats, l’éloignement des centres de décision, les menaces de fermeture et de délocalisations, la mobilisation des acteurs locaux pour conserver, dans un tel contexte, les activités et les emplois. Égrenée de plans successifs de réduction de l’emploi et de licenciements, l’histoire de la Centrale est émaillée de nombreux conflits sociaux et mobilisations locales. Les effectifs sont passés de 350 en 2001 à 210 en 2004 (magazine communal Énergies, 2 décembre 2004) et à 160 en 2020. »
Extraits de l’ouvrage « Aux pieds des terrils gardannais - La transition énergétique dans un territoire en reconversion », par Joseph Cacciari (†), docteur en sociologie, Ghislaine Gallenga, professeure des universités en anthropologie à Aix-Marseille Université, et Annie Lamanthe, professeur émérite de sociologie à Aix-Marseille Université, Presses universitaires de Provence, 126 pages, 2023.
Carnet : romancier et cerbère…
« Un roman raconte une crise avec un événement, intérieur ou extérieur, un héros, une société donnée, un accident… Depuis que le roman est roman, les écrivains combinent à l’infini sur ce thème, comme les musiciens combinent à l’infini sur les notes de la gamme. La fortune et le danger d’une telle forme sont qu’elle est prête à tout accueillir. Par essence, le roman est un fourre-tout, et la tentation est grande de vouloir, en effet, tout y mettre. Les romans mal faits pèchent généralement par le "trop", davantage que par le "pas assez", et la maîtrise du métier romanesque se reconnaît d’abord à la qualité du filtrage. Un bon romancier est un cerbère impitoyable, un vétilleux censeur de lui-même. » (Pierre Lepape, Le Monde, à propos de « Blessures exquises », de Dominique Autié, éditions Belfond, 1996)
Le beau parleur à l’étrange lucarne
Quel bagout ! Ce journaliste de télévision est brillant et mondain, beau parleur, vif à saisir le ridicule des situations ou l’insolite des choses. Mais à force de frotter le silex des lieux communs, il fait jaillir un feu d’étincelles qui ne laisse que des cendres désolées.
Vacarme et solitude
Ce siècle est celui du vacarme, donc de la taciturnité ; de la foule, donc de la solitude.
(Gilbert Cesbron, « Journal sans date », tome 1, éditions Robert Laffont, 1963)
Du Gai Savoir
Aux détracteurs patentés, il conviendrait d’opposer ce mot de Talleyrand : « Il y a trois sortes de savoirs : le savoir tout court, le savoir-vivre et le savoir-faire, les deux derniers dispensent assez bien du premier. »
(Mercredi 13 mars 2024)
La chimie des médicaments
On oublie que la création d’espèces chimiques a ouvert une ère nouvelle dans le traitement médical. Ainsi la chimie moderne a permis d’extraire des principes actifs et d’élaborer des substances pures particulièrement salutaires. L’iode a été extraite des varechs en 1811, la morphine de l’opium en 1817, l’insuline des pancréas animaux en 1912. Il n’est plus question dès lors de parler de substances minérales ou végétales, mais d’ajouter à la nature des médicaments synthétiques.
Une vertu dans un ministère
L’institution judiciaire ne peut être regardée comme les autres. Qu’est-ce que c’est, après tout, la justice ? Une vertu qu’on a fourrée dans un ministère.
(Jeudi 14 mars 2024)
|
Billet d’humeur
Maqroll et son double
Comme les enfants choisissent des compagnons imaginaires avec lesquels ils conversent et jouent, Alvaro Mutis (Bogota, 1923-Mexico, 2013) a créé Maqroll le Gabier. Matelot chargé de l’entretien et de la manœuvre de la voilure, ce gabier ne l’a jamais quitté. Bourlingueur toujours en cavale, apatride et volage, Maqroll entraîne le lecteur de la Volga à Chypre, de l’Alaska à la Terre de Feu, des marécages de Guyane à la banlieue de Kaboul, des bordels de Tanger aux bouges du Pirée, au gré d’une saga de sept romans, La Neige de l’amiral (1986), Llona arrive avec la pluie (1988), Un bel morir (1989), La Dernière Escale du Tramp Steamer (1988), Écoute-moi, Amirbar (1990), Abdul Bashur, le rêveur de navires (1990) et Le Rendez-vous de Bergen (1995). Maqroll el Gaviero est apparu chez l’écrivain et poète colombien dès le troisième poème publié, « Voyage », en 1948, avant de devenir, en 1985, le protagoniste de son premier roman, poursuivant ainsi sa vie de miroir, de double d’Alvaro Mutis. De poème en poème, quarante ans durant, puis, à partir des années 1980, de roman en roman, il est devenu si présent, si réel, si encombrant qu’il a fini par échapper à son auteur. On a souvent questionné le romancier s’il avait rencontré son personnage fétiche en chair et en os. « Oui, la seule fois où j’ai vu de mes yeux Maqroll, a-t-il un jour répondu, c’était à Barcelone, la ville de Carmen [sa femme]. C’est une ville que j’adore. Devant la Sagrada Familia tournait une ronde de danseurs de sardane. C’est une danse qui me transporte de joie. Soudain, un type venu de nulle part, un grand diable élégant à la crinière de soie, s’est joint au groupe, le plus naturellement du monde, instantanément lié au cercle des danseurs sans que personne l’ait vu fondre, l’air grave et sans sourire aucun, c’était lui, Maqroll, au-delà de toute évidence. » Des lecteurs ont demandé à Mutis s’il n’a pas souhaité, un jour, se débarrasser une fois pour toutes de Maqroll, de le tuer à la fin d’un récit. « Oh ! que oui ! Par deux fois, j’ai presque réussi. Mais il tient bon. Il est solide. Les lecteurs le défendent et mes collègues aussi. Gabo [Gabriel Garcia Márquez, écrivain colombien] m’a écrit à ce sujet : "Je te préviens. D’homme à homme. Tu n’en a pas le droit. Si tu le fais disparaître, je t’attaque en justice. Pour homicide volontaire". »
|
Lecture critique
Un dictionnaire général de l’archéologie
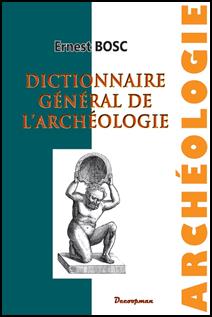 Il est difficile de donner à l’archéologie une date de naissance précise. Auteur en 1881 du « Dictionnaire général de l’archéologie chez les divers peuples », l’architecte Ernest Bosc de Vèze (1837-1913) en situe les origines au XVIe siècle, argumentant cependant que Dante Alighieri (1265-1321) et Pétrarque (1304-1374) ont sans doute été les premiers archéologues. L’ouvrage concerne les archéologies classique et orientale dont les limites du domaine géographique circonscrivent en somme un monde méditerranéen dans sa plus grande extension auquel ont été ajoutées les régions orientales qui ont entretenu avec lui des échanges permanents, à savoir l’Anatolie, la Mésopotamie et la Perse. Ainsi, en plus des archéologies des temps modernes, c’est-à-dire celles des époques romano-byzantine, ogivale et de la Renaissance, le lecteur trouvera des termes identifiant les antiquités hindoues, mexicaines, péruviennes et phéniciennes. Les définitions fixant les mots de l’abécédaire gagneraient sans doute à être révisées parfois, sinon complétées. Il reste que ce volume ouvre un très large horizon historique et archéologique au-delà des civilisations classiques et orientales. Il restitue surtout l’itinéraire d’une science humaine riche et tributaire, dans sa formation et son évolution, des liens qu’elle tisse avec les autres disciplines attachées à la connaissance du passé dont l’épigraphie et la numismatique, la préhistoire et l’anthropologie. Il est difficile de donner à l’archéologie une date de naissance précise. Auteur en 1881 du « Dictionnaire général de l’archéologie chez les divers peuples », l’architecte Ernest Bosc de Vèze (1837-1913) en situe les origines au XVIe siècle, argumentant cependant que Dante Alighieri (1265-1321) et Pétrarque (1304-1374) ont sans doute été les premiers archéologues. L’ouvrage concerne les archéologies classique et orientale dont les limites du domaine géographique circonscrivent en somme un monde méditerranéen dans sa plus grande extension auquel ont été ajoutées les régions orientales qui ont entretenu avec lui des échanges permanents, à savoir l’Anatolie, la Mésopotamie et la Perse. Ainsi, en plus des archéologies des temps modernes, c’est-à-dire celles des époques romano-byzantine, ogivale et de la Renaissance, le lecteur trouvera des termes identifiant les antiquités hindoues, mexicaines, péruviennes et phéniciennes. Les définitions fixant les mots de l’abécédaire gagneraient sans doute à être révisées parfois, sinon complétées. Il reste que ce volume ouvre un très large horizon historique et archéologique au-delà des civilisations classiques et orientales. Il restitue surtout l’itinéraire d’une science humaine riche et tributaire, dans sa formation et son évolution, des liens qu’elle tisse avec les autres disciplines attachées à la connaissance du passé dont l’épigraphie et la numismatique, la préhistoire et l’anthropologie.
Dictator, senatus et wouwou…
Au fil des quelque six cents pages, nous avons grappillé quelques définitions édifiantes, de celles qui nous confrontent à une révision du grec et du latin et nous rappellent des origines méconnues ou oubliées. Ainsi le vocable acoustique se rapporte à un vase de terre ou de bronze qui servait dans les théâtres de l’antiquité romaine à renforcer la voix des acteurs : le moyen âge aurait utilisé également ces sortes de vases, car l’architecte Oberlin, en réparant la voûte du chœur de l’ancienne église des dominicains à Strasbourg, y découvrit des vases acoustiques. Agate, pierre quartzeuse utilisée par les graveurs de l’antiquité a ainsi été nommée par corruption du mot Achates, rivière de Sicile le long de laquelle on trouvait de nombreuses variétés de cette pierre : les Égyptiens ont taillé des scarabées dans l’agate ; et on a retrouvé des cylindres babyloniens faits en cette matière. Dans les anciens couvents, on nommait canonarque le moine qui sonnait de la cloche pour annoncer les divers exercices de la communauté. La caracalla était une sorte de tunique gauloise avec manche ; c’était un vêtement presque collant qui était fendu par devant et par derrière jusqu’à l’entrejambes. Les Romains adoptèrent la caracalla sous le règne du fils de Septime Sévère, Aurélius-Antonius Bassianus, qui l’avait introduite à Rome et fut dès lors surnommé Caracalla. Le cloacarium était une taxe que les habitants de Rome payaient pour l’entretien, les réparations et le nettoyage des égouts, l’impôts des égouts en somme. Columnarium était un autre impôt, sur les colonnes celui-là ; il y avait à Rome un si grand nombre de colonnes que les empereurs, pour se procurer de l’argent, frappèrent d’un impôt les propriétaires des dites colonnes. Un delator est un espion ou un délateur public ; chez les Romains, il n’exerçait pas d’autre métier et vivait de ses délations. Le magistrat suprême de la république romaine appelé dictator n’exerçait ses fonctions que pour un temps délimité et selon des circonstances exceptionnelles ; il remplaçait les deux consuls. Les épidémies étaient des fêtes célébrées à Argos en l’honneur de Junon, à Délos et à Milet en l’honneur d’Apollon. On les nommait ainsi parce qu’on supposait que ces divinités venaient s’y mêler avec le peuple (épi, dans, et demos, peuple). L’examen est la languette du fléau de la balance qui indique ou l’égalité de poids des deux plateaux ou leur inégalité. Le frigidarium est une chambre ou salle dépendant d’un établissement de bains ; c’est aussi un local frais servant de garde-manger. Les gémonies consistaient en un escalier qui descendait de la prison au forum ; les cadavres des criminels étaient exposés plusieurs jours sur les degrés de cet escalier. Le mausoleum était un tombeau élevé en l’honneur de Mausole, roi de Carie ; sa magnificence sans égale le fit ranger parmi les sept merveilles du monde. Depuis on donna ce nom aux tombeaux d’une masse et d’une richesse imposantes. Peculum était une petite somme que pouvait amasser un esclave afin de pouvoir acheter sa liberté. Les proletarii ou prolétaires étaient des citoyens romains de la dernière classe du peuple, ainsi nommés parce qu’ils ne contribuaient à la force de la république que par leurs enfants (proles), étant trop pauvres pour payer des impôts. Senatus ou sénat désigne une assemblée délibérante composée de personnages ayant ordinairement occupé de hautes situations dans un pays et qui par conséquent n’accèdent à cette assemblée que fort âgés (senex, vieillards) d’où senatus. Rome, Athènes, Sparte et Carthage disposaient de leur propre sénat. Au titre de l’antiquité égyptienne, on relève le mot wou ou wouwou, qui est le nom du chien, une onomatopée évidente, de même que le nom du chat, qui s’écrit maaou…
- Dictionnaire général de l’archéologie chez les divers peuples, par Ernest Bosc, architecte, illustré de 450 gravures dans le texte, éditions Decoopman, 590 pages, 1881/2016.
Lecture complémentaire :
- Dictionnaire biographique d’archéologie 1798-1945, d’Ève Gran-Aymerich, Préface de Jean Leclant (secrétaire perpétuel de l’Académie des inscriptions et belles-lettres), CNRS Éditions, 744 pages, 2001.
Portrait
Les terreurs fantastiques d’Alfred Kubin
Dessinateur et graveur visionnaire, ayant illustré Oscar Wilde, Barbey d’Aurevilly, Fiodor Dostoïevski, Edgar Poe et August Strindberg, Alfred Kubin (Leibmeritz, Bohême, 1877-Zwickledt, 1959) se rend compte à vingt ans qu’il peut convertir au moyen de la plume et de l’encre de Chine ses angoisses perpétuelles qui ne cessent de l’habiter depuis l’enfance. Certains exégètes lui délèguent le rôle du continuateur des mouvements symboliste et fantastique du XIXe siècle, quand d’autres n’hésitent pas à le placer parmi les précurseurs du surréalisme. En fait, il semble que les œuvres de Ensor, Goya, Klinger, Munch, Redon et Rops, découvertes lors de ses études à l’Académie des beaux-arts de Munich (1898-1901) l’aient quelque peu influencé et incliné à traduire son caractère pessimiste et morbide par des thématiques sadomasochistes. Dans son autobiographie, « Ma vie », l’artiste autrichien se borne à préciser que « c’était une seule et même force qui m’avait poussé, dans mon enfance, vers le rêve, plus tard, dans des frasques stupides puis dans la maladie et finalement vers l’art ». « Cet ultime et véritable mobile de mes actes, complète-t-il, il ne m’est pas possible de le caractériser plus en détail. Il est trop étroitement lié à ma vie tout entière et me demeure, même à moi, énigmatique. » », l’artiste autrichien se borne à préciser que « c’était une seule et même force qui m’avait poussé, dans mon enfance, vers le rêve, plus tard, dans des frasques stupides puis dans la maladie et finalement vers l’art ». « Cet ultime et véritable mobile de mes actes, complète-t-il, il ne m’est pas possible de le caractériser plus en détail. Il est trop étroitement lié à ma vie tout entière et me demeure, même à moi, énigmatique. »
Une œuvre d’énigmes et d’incertitudes
Sur le papier, à la craie noire, à l’encre, avec des lavis ou de l’aquarelle, il fomente des représentations imaginaires, fantastiques et symboliques, burlesques et métaphysiques. Une pendule dont l’aiguille coupe des têtes, des renards qui regardent pourrir des pendus, une femme nue adorant un monstre adipeux dans une grotte, un iceberg devenu un morse à crâne humain, une corne de cerf sortant du front d’une paroissienne en prière. L’œuvre porte autant d’énigmes que d’incertitudes, autant d’étrangeté que de tragédie. S’il multiplie les relations avec les milieux artistiques de Vienne, de Prague, de Paris, de Munich et de Berlin où le marchand et éditeur allemand Paul Cassirer lui apporte un soutien financier, il se retire en 1906 à Zwickledt-bei-Wernstein dans la région de Passau. Une vie recluse dans un château isolé qu’il a acheté dans cette région de Haute-Autriche qui convient mieux aux états d’âme de cet individu indifférent à son époque et aux préoccupations de ses contemporains. En 1907, la mort de son père, ancien officier de l’armée impériale et géomètre de profession, cause une rechute de ses troubles psychiques, une pathologie survenue, semble-t-il, à la mort de sa mère alors qu’il n’avait que dix ans. C’est sous le choc de cette perte qu’il écrivit en 1909 « Die andere Seite » (L’Autre Côté, Paris, 1964), un roman fantastique autobiographique qu’il illustra de ses dessins. La même année, soucieux de rassembler les artistes russes et allemands de la jeune école munichoise, son ami Vassily Kandinsky fonde la Nouvelle Association des artistes et y inclut d’office Kubin. L’institution ne semble cependant pas l’avoir marqué dans ses orientations, à l’exemple du groupe du Blaue Reiter (Cavalier bleu) d’ailleurs qu’il fréquente de 1911 à 1913.
« Je suis ardemment et passionnément un artiste »
Devenue plus libre, son œuvre graphique à la plume le conduit à se rapprocher de l’expressionnisme, au moment où Paul Klee accroche une exposition de ses œuvres dans une galerie. Les deux hommes se sont liés d’amitié en 1911, l’année où Kubin rencontre Franz Kafka. La veine littéraire de son œuvre lui vaut de multiples admirations venues d’écrivains relevant plus ou moins du fantastique, dont Thomas Mann qui le choisit en 1903 pour illustrer un choix de ses nouvelles, 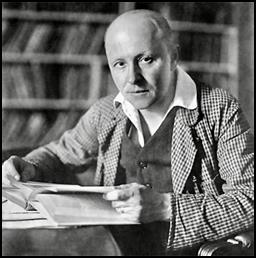 André Breton et Jean Paulhan qui apprécient sa métaphysique burlesque, Ernst Jünger et Hermann Hesse avec lesquels il noue une correspondance suivie. Jusqu’à la fin, il poursuit ses travaux de dessinateur visionnaire, notamment sur le verso vierge de plans du cadastre (où travaille son père géomètre). Le fantastique reste sa marque de fabrique, comme chez Jérôme Bosch ou Max Ernst. Il confie ses doutes et ses enthousiasmes à ses amis peintres Max Beckmann, Paul Klee, Franz Marc. Il aime à souligner que le jaillissement et l’invention n’ont jamais cessé chez lui, plaçant deux périodes parmi les plus fécondes, de 1899 à 1905 et de 1916 à 1926. « Je ne suis ni un philosophe, ni un écrivain, explique-t-il dans "Ma vie", mais bien ardemment et passionnément un artiste. Je passe mes meilleures heures avec du papier, des crayons et des bâtons d’encre de Chine. C’est pour moi la joie la plus profonde que d’exercer mon métier avec opiniâtreté. Si, dans l’abstraction de l’esprit, j’ai cherché des informations pour trouver ma voie, je n’ai pas renoncé d’un iota à ma qualité d’artiste. La richesse n’est pas plus une honte que la pauvreté. » André Breton et Jean Paulhan qui apprécient sa métaphysique burlesque, Ernst Jünger et Hermann Hesse avec lesquels il noue une correspondance suivie. Jusqu’à la fin, il poursuit ses travaux de dessinateur visionnaire, notamment sur le verso vierge de plans du cadastre (où travaille son père géomètre). Le fantastique reste sa marque de fabrique, comme chez Jérôme Bosch ou Max Ernst. Il confie ses doutes et ses enthousiasmes à ses amis peintres Max Beckmann, Paul Klee, Franz Marc. Il aime à souligner que le jaillissement et l’invention n’ont jamais cessé chez lui, plaçant deux périodes parmi les plus fécondes, de 1899 à 1905 et de 1916 à 1926. « Je ne suis ni un philosophe, ni un écrivain, explique-t-il dans "Ma vie", mais bien ardemment et passionnément un artiste. Je passe mes meilleures heures avec du papier, des crayons et des bâtons d’encre de Chine. C’est pour moi la joie la plus profonde que d’exercer mon métier avec opiniâtreté. Si, dans l’abstraction de l’esprit, j’ai cherché des informations pour trouver ma voie, je n’ai pas renoncé d’un iota à ma qualité d’artiste. La richesse n’est pas plus une honte que la pauvreté. »
Alfred Kubin © Photo X, droits réservés
- Ma vie, par Alfred Kubin, traduit de l’allemand par Christophe David, éditions Allia, 160 pages, 2000.
Lectures complémentaires :
- Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs, par E. Benezit, tome 8, notice de Jacques Busse, éditions Gründ, 1999 ;
- Dictionnaire de l’art moderne et contemporain, sous la direction de Gérard Durozoi, éditions Hazan, 2002 ;
- La métaphysique burlesque de Kubin, article de Philippe Dagen, dans « Le Monde », vendredi 2 novembre 2007
Varia : le développement des écoles de pilotes dans l’entre-deux-guerres
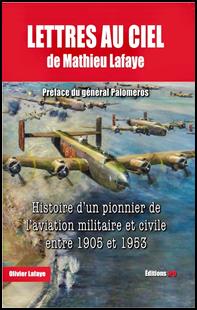 « Au sortir de la guerre 1914-1918, le rapprochement entre civils et militaires correspondit à des intérêts bien compris pour développer l’armée aérienne. Le Comité français de propagande aéronautique (CFPAÉ) fut créé en 1921 par les frères Michelin qui intégrèrent le maréchal Lyautey au conseil d’administration, avec l’idée de donner aux Français "l’esprit aviateur" et de parer aux attaques aériennes des Allemands auxquels on prêtait l’idée de raids aérochimiques pour prendre leur revanche. « Au sortir de la guerre 1914-1918, le rapprochement entre civils et militaires correspondit à des intérêts bien compris pour développer l’armée aérienne. Le Comité français de propagande aéronautique (CFPAÉ) fut créé en 1921 par les frères Michelin qui intégrèrent le maréchal Lyautey au conseil d’administration, avec l’idée de donner aux Français "l’esprit aviateur" et de parer aux attaques aériennes des Allemands auxquels on prêtait l’idée de raids aérochimiques pour prendre leur revanche.
« L’aviation était devenue un nouveau terrain de concurrence internationale, combinant le prestige des raids réalisés, de records repoussant sans cesse les performances des appareils, de l’arrivée de nouveaux aéronefs, associant une nouvelle industrie aux besoins militaires et aux prometteurs débouchés civils. Les aéro-clubs avaient besoin de pilotes pour développer leurs activités, l’armée aussi. Les aéro-clubs avaient en effet remarqué que la plupart des pilotes étaient des militaires, la totalité des as en tout cas. Les exploits étaient réalisés par des militaires ou sous contrôle militaire. Ainsi de l’adjudant pilote Bonnet, détenteur du record du monde de vitesse, à 448,170 km/h, fin 1924 à bord d’un monoplan, le Bernard SIMB. Rares étaient les civils qui pouvaient suivre à leurs frais ces formations et acquérir des avions. De plus, la majorité des pilotes étaient des sous-officiers. Il convenait donc de développer l’attraction de cette filière aéronautique vers les jeunes. La Compagnie française d’aviation avait été créée au sortir de la guerre. En 1920, à la suite de la visite du secrétaire d’État à l’Aéronautique, Flandrin, à Angers, un centre d’entraînement des pilotes de réserve fut créé ; en 1922,  un centre d’entraînement civil suivit, sous la supervision de Paul-Louis Richard, représentant la société France-Aviation, possédant plusieurs centres d’entraînement en France et trois écoles. Ancien aviateur au parcours exemplaire pendant la guerre, il en était le directeur des écoles après les avoir créées. Les décisions angevines de soutenir et d’encourager un pôle aéronautique local avec un soutien militaire rejoignaient les préoccupations du ministère de la Guerre qui avait établi la nécessité d’écoles pour l’armée et instauré un système de bourses de pilotage. En joignant leurs efforts, l’aéroclub et le centre d’entraînement civil, constituèrent une école civile d’élèves pilotes boursiers militaires, située à Avrillé, à proximité d’Angers. Elle prit le nom d’"École d’aviation Richard" sous le patronage de l’Aéro-club de l’Ouest. Elle fut l’une des huit écoles alors habilitées, à côté de l’école Caudron au Crotoy, l’école de la Société anonyme pour la fabrication de moteurs et d’appareils nouveaux à Orly, l’école Farman à Toussus-le-Noble, l’école Blériot à Buc, l’école Camplan à Bordeaux, l’école de l’Aéro-club de Bourgogne à Chalon-sur-Saône, l’école de l’Aéro-club d’Auvergne à Clermont-Ferrand. » un centre d’entraînement civil suivit, sous la supervision de Paul-Louis Richard, représentant la société France-Aviation, possédant plusieurs centres d’entraînement en France et trois écoles. Ancien aviateur au parcours exemplaire pendant la guerre, il en était le directeur des écoles après les avoir créées. Les décisions angevines de soutenir et d’encourager un pôle aéronautique local avec un soutien militaire rejoignaient les préoccupations du ministère de la Guerre qui avait établi la nécessité d’écoles pour l’armée et instauré un système de bourses de pilotage. En joignant leurs efforts, l’aéroclub et le centre d’entraînement civil, constituèrent une école civile d’élèves pilotes boursiers militaires, située à Avrillé, à proximité d’Angers. Elle prit le nom d’"École d’aviation Richard" sous le patronage de l’Aéro-club de l’Ouest. Elle fut l’une des huit écoles alors habilitées, à côté de l’école Caudron au Crotoy, l’école de la Société anonyme pour la fabrication de moteurs et d’appareils nouveaux à Orly, l’école Farman à Toussus-le-Noble, l’école Blériot à Buc, l’école Camplan à Bordeaux, l’école de l’Aéro-club de Bourgogne à Chalon-sur-Saône, l’école de l’Aéro-club d’Auvergne à Clermont-Ferrand. »
Diplômé d’histoire et de la Harvard Business School, l’auteur, Olivier Lafaye, a été cadre dirigeant à l’international chez Safran, Thales et Technicolor. Il est le petit-fils aîné de Mathieu Lafaye.
Olivier Lafaye © Photo X., droits réservés
Extraits de l’ouvrage d’Olivier Lafaye, « Lettres au ciel de Mathieu Lafaye - Histoire d’un pionnier de l’aviation militaire et civile entre 1905 et 1953 », éditions LPO, 234 pages, 2023.
Carnet : nostalgie en clef de sol
Chacun d’entre nous sait reconnaître des centaines et des centaines de chansons : Piaf ou Cabrel, Aznavour ou Patachou, Jennifer ou Montand, Le jour où la pluie viendra ou Syracuse, Jolie Môme ou L’Été indien, Ne me quitte pas ou Le Temps des cerises, mais on ne chante plus comme avant. Certes, on fredonne, on chantonne sous la douche, on bouffonne au karaoké, mais la rue ne chante plus comme naguère. Il n’était pas de mariage sans qu’un des convives en voix ne brame La Chanson des blés d’or tandis qu’un autre n’entonne Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante. Et aux refrains, la tablée reprenait…
Tanka et haïku
On doit beaucoup à ce poème court du genre tanka : c’est lui qui donnera naissance, au XVIe siècle, à une expression encore plus elliptique, le haïku.
Satané Freud !
Curieux tout de même l’acharnement de Sigmund Freud à soutenir qu’Édouard de Vere, comte d’Oxford (1550-1604), était le véritable auteur des pièces attribuées à William Shakespeare (1564-1616).
(Dimanche 17 mars 2024)
Haut de page
|





