







 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Retour à l'accueil du site |
|
Un adolescent ayant grandi à Athènes juste après-guerre se raconte de ses quinze à ses vingt ans. C’est un garçon issu de la bourgeoisie, timide avec les filles et inquiet quand les examens approchent, auquel l’aspect étriqué de son milieu pèse. Son cœur qu’une silhouette, un regard ou un visage de fille ou de garçon peuvent émouvoir pareillement, la curiosité aiguë qu’il manifeste à ce et ceux qui l’entourent, l’entraînent à la découverte de l’inconnu du côté des marginaux et des mauvais anges avec une attirance non dépourvue d’ambiguïté. L’histoire et la politique complexe de son pays (le bruit des bottes allemandes, le décembre sanglant et la guerre civile), le cloisonnement de la société athénienne mais aussi les découvertes culturelles au travers des concerts, des films américains, des livres qu’il dévore et de l’écriture à laquelle il s’essaye, se retrouvent également au programme de cette période d’initiation. Le garçon sage et discret, au-delà de la population aisée de ce quartier central d’Omonia avec sa place Kyriakou, le Champ de Mars tout proche, le vieux cinéma Kronos, le théâtre Olympia et l’immeuble cossu où se trouve l’appartement familial, porte plus volontiers son attention sur les femmes employées pour s’occuper de la cuisine, le linge ou l’entretien, sur les soldats, marins ou voyous (et parfois tout cela en même temps) aux merveilleux récits d’aventures. Ce sont donc des gens ordinaires à la vie simple que l’auteur met ici en scène, ceux que le garçon a croisés durant cette période et qui lui ont inconsciemment ouvert les portes du monde des adultes avant de s’installer à jamais dans sa mémoire comme d’aimables fantômes. Mènis Koumandarèas parvient, en une vingtaine de pages, à donner corps et épaisseur à ses personnages mis en situation. Plus que décrit ou analysé, tout ici est suggéré, avec le flou qu’impliquent l’ambivalence des êtres, la force du désir et le trouble du narrateur. C’est leur interaction avec lui et son parcours qui fait sujet à partir des émotions partagées ou non dont cette rencontre fut la source. Le contraste flagrant, constaté par l’adolescent lors de ses escapades, entre les conditions de vie des « mercenaires » qui se tuent à la tâche pour un salaire leur permettant à peine de survivre, prompts à tout oublier à la chaleur des bars, des autres et de l’alcool, et celles d’un univers familial aisé qui tire reconnaissance sociale et pouvoir de son confort et sa fortune mais se trouve miné de l’intérieur par une morale rigide et des idées réactionnaires, par la crainte du jugement des autres et celle de perdre ses privilèges, parle de lui-même. C’est dans cette confrontation que la critique des institutions, de l’hypocrisie mortifère de la bourgeoisie, de l’ordre moral à l’œuvre dans la Grèce conservatrice d’après-guerre, exprimée en creux par l’auteur dans chacune de ces scènes, prend racine. Face à ces injustices sociales criantes, ce milieu familial qui ne hait rien plus que le communisme et ne craint rien davantage que ce petit peuple qu’il côtoie par nécessité mais non sans dégoût et sans méfiance, en prend pour son grade : Le huitième chapitre intitulé « la Juive », plus long que les neufs autres, est le point d’orgue du roman. La rencontre lors d’un concert du jeune homme avec une troublante femme d’âge mûr, connue par la bonne société sous le nom de « la Juive », une ex-riche épouse déchue socialement depuis son internement à Auschwitz et unanimement rejetée à son retour, sert de loupe grossissante à la mesquinerie et l’antisémitisme animant cette grande bourgeoisie installée dans la capitale. Comme l’explique l’un d’entre eux à l’adolescent : « Les juifs constituent une catégorie à part. (...) Ils se soutiennent mutuellement, bien souvent aux dépends des chrétiens, et détestent évidemment, la société à laquelle ils n’appartiennent pas. Quand ils ont de la fortune, ils sont acceptables, respectables, ils contribuent au progrès économique, ils font circuler l’argent et stimulent ainsi le développement. Mais quand ils s’appauvrissent, tous leurs défauts remontent, leur bassesse, leur fausseté, (…) alors bien sûr la société les rejette. C’est une loi. (…) Les Allemands avaient leurs raisons, et cela, quels que soient nos griefs à leur égard, il nous est difficile de l’ignorer. » Hitler, fort admiré du reste par une frange de la bourgeoisie locale, sera d’ailleurs dans cet édifiant discours tout aussi franchement absout pour l’arrestation des homosexuels, des francs-maçons et des communistes. Une fois de plus, aucun commentaire ne viendra se surajouter à cette scène mais sa simple juxtaposition aux divers échanges entre l’adolescent et la femme juive dans l’univers feutré et élégant de la salle de spectacle ou de son bar met la monstruosité de tels propos encore plus en relief. Si parfois la nostalgie s’invite au détour d’un chapitre : Avec des mots simples et justes et avec délicatesse c’est, plus qu’un document historique d’archive, un monde sensible et des questionnements restés sans réponses que Mènis Koumandarèas partage dans Mauvais anges. Une façon au-delà du roman d’initiation et du temps qui passe, de nous dire dans ce livre publié dans les années quatre-vingt en Grèce, sa désillusion face à son pays et face au monde. « Bien des rêves sont tombés en cendres. » L’épilogue (Rassemblement) où le jeune narrateur a laissé place à l’auteur cinquantenaire clôt l’ouvrage sur une note moins sombre. « Ce que je cherche, (…) c’est l’innocence d’une époque disparue, bonne ou mauvaise. (…) On a beau dire qu’elle [la Juive] n’a jamais retrouvé la mémoire, moi je suis sûr qu’elle est toujours là, dans celle des autres personnes. En particulier de certains garçons qui vont le dimanche au concert, sans savoir où la journée va les mener. » Si cet étrange roman d’inspiration autobiographique – peut-être plus réinventé que réaliste – qui pourrait être envisagé par certains comme un « roman par nouvelles » brouille les pistes, il constitue un élément-clé de la bibliographie de l’auteur. Dans ces Mauvais Anges, « placé sous le signe de l’équivoque (…) entre merveilleux et sordide (…) dans un balancement perpétuel entre l’individuel et le collectif » (postface de Michel Volkovitch), les anges qui paraissent sur la couverture de cette édition et le paradis sont bien loin. Mais, par la grâce de l’écriture, la séduction, l’émotion et l’humanité profonde de ces histoires venues ricocher en nous, Séraphin, Chérubin, la Juive, la femme du général et ce narrateur naïf dont la curiosité n’a d’égale que la générosité, nous attachent à leurs pas, laissent en nous un trouble silencieux et suspendent le temps comme un ange qui passerait tout près un doigt sur les lèvres. Dominique Baillon-Lalande (30/12/19) |
Sommaire Lectures 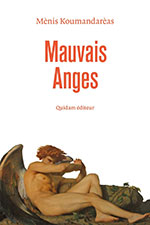 Quidam (Avril 2019) 236 pages - 20 € Traduction du grec par Michel Volkovitch
Bio-bibliographie sur Wikipédia Découvrir sur notre site un autre livre du même auteur : Les neiges de décembre ne préviennent jamais |
||||||