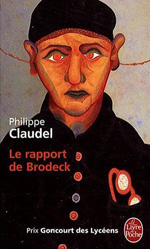|
|
Philippe CLAUDEL
Le paquet
Un homme seul, anonyme, semblable à un SDF que la vie aurait abîmé en une suite de dégringolades, âgé de la cinquantaine, chemise douteuse et pantalon élimé, arrive dans un square. Il semble fatigué, usé. Il vérifie anxieusement que personne n'apparaît dans son champ de vision et s'installe sur le banc public. Il traîne derrière lui un lourd paquet, un tapis mystérieusement roulé autour d'un contenu non identifié. Un corps peut-être, comme sa forme peut le laisser croire ?
L’homme souffle un peu puis entame un long monologue, parle comme s'il vidait son sac d'un trop-plein accumulé depuis des années.
Autrefois sa popularité, dit-il, était immense, les amis et les honneurs s'offraient à lui généreusement. Il prétend avoir été un homme d'affaires toujours pris entre deux réunions ou deux avions, mais endosse à d'autres moments le costume d'un simple employé de banque ou d'un mécanicien automobile... Vraies et fausses confidences, et si tout n'était qu'illusion ?
L'étrange personnage, ambigu à souhait évoque aussi sa femme disparue. Il aurait été un "jeune homme fougueux" et un mari "passionné". « Ma femme aimait beaucoup les supermarchés. Nous y allions environ tous les samedis. Je pense que c’est l’ambiance qui lui plaisait, les lumières, les belles musiques diffusées dans les haut-parleurs d’une remarquable qualité stéréophonique, les sourires des hôtesses de caisse, la prestance des vigiles, souvent de superbes Africains à la peau d’ébène et aux dents d’ivoire, sanglés dans d’élégants costumes croisés en viscose, et qui portaient, par nostalgie sans doute, des cravates ornées de palmiers et de régimes de bananes. »
Naviguant d'un rôle à l'autre, baladant son auditeur comme le pécheur à la ligne son appât pour mieux ferrer le poisson, il nous entraîne dans son délire. Et on ne sait si l’homme ment ou s’il se berce avec les souvenirs d'une splendeur perdue. Il nous noie dans une logorrhée verbale composée d'un mélange curieux de fragments d'un passé dont on ne sait pas s'il a vraiment existé ailleurs que dans son imagination, de déclarations contradictoires, de réflexions entremêlées de clichés ou de formules publicitaires. « Nous mourrons de trop posséder. Nous possédons trop. Trop d’argent. Trop de choses. »
Au fil de ce long monologue, l’homme saute du coq à l'âne, change de registre, de ton, d’humeur, répète fièrement un alexandrin, « Jeannot a validé sa grille de Loto », entrecoupe ses propos de moments de silence, de rires grinçants, de colère. L'angoisse suinte. Quand la charge est trop lourde, il se réfugie dans l'humour et la moquerie, pour ne pas s’effondrer, ne pas crever.
« C'est agréable les imbéciles. Il n'y a pas de quoi en rire. Ils sont toujours heureux. Ce sont des leçons de bonheur. Ils nous apaisent. En leur compagnie, on n'est pas obligé de penser, ni de réfléchir. Ce sont de grands trous noirs dans lesquels pendant quelques heures on peut plonger et flotter avec délice. On devrait toujours avoir un imbécile avec soi. Et il devrait être remboursé par la Sécurité sociale. Je suis persuadé que si le nombre d'imbéciles au mètre carré était multiplié, ne serait-ce que par deux, les taux de suicide et de dépression diminueraient d'autant. L'imbécile donne de l'espoir. C'est sa mission sur terre. C'est d'ailleurs pour cela que dans bien des pays progressistes et démocrates nous en élisons un à la tête de l'État. »
Tout cela ne serait-il pas, pour l'auteur, qu'un prétexte pour pointer les travers et les dérives de notre société, la mondialisation permanente qui phagocyte les gens d'ici ou d'ailleurs, les êtres humains transformés en consommateurs béats, les discours politiques qui formatent l'esprit ?
« Nous sommes vraiment un très petit pays dirigé par un tout petit homme. Nous méritons d’être devenus ce que nous sommes devenus. C'est-à-dire rien. Rien du tout. Un peuple fatigué et arrogant. Oublieux. Sans reconnaissance. Notre monde s'est effondré. Notre culture est calcinée. Nous fûmes grand jadis, et de cette grandeur dont les échos ébranlaient les peuples et les terres envieuses, il ne reste rien. Nous sommes passés, en l'espace de cinquante ans à peine du mètre quatre-vingt-treize du Général de Gaulle aux ridicules 1670 millimètres de l'actuel résident du Faubourg Saint-Honoré. J'exige une minute de silence. »
Le bonhomme semble errer comme une souris de laboratoire dans un labyrinthe à la recherche d'une sortie, en triturant son paquet. Il le serre, le caresse, le repousse et dans l'ignorance de son contenu, on se contente d’imaginer, de supposer, en se laissant bercer par le récit décousu, parfois incohérent de ce fou qui aurait bien des parentés avec ceux qui parfois hantent, hagards, les quais du métro.
Cela part dans tous les sens, l'homme qui parle semble avoir perdu le contrôle de ses émotions, du flot de paroles qui s'en échappe. C'en devient dérangeant, oppressant.
Et si son seul compagnon était ce paquet qu'il traîne partout ?
« Lorsque le monde s'effondre, la question n'est pas de savoir ce que l'on sauve, mais ce dont on ne peut se débarrasser », commente fort justement la quatrième de couverture.
Au-delà de ses mensonges, de ses divagations, c'est un être seul et abandonné, prêt à tout pour quelques instants de reconnaissance, qui se dessine sous nos yeux. « Je suis ridicule. Je suis seul. » « Je rêve encore de la terre, mais je m'éloigne sans cesse. (...) Je ne suis qu'un pauvre type sans intérêt, cousu avec la peau de tous les autres. ». « Allez. Allez-y. J'ai l'habitude. Partez. »
Une fois la dernière page tournée, le mystère restera entier : Qui est vraiment cet individu ? Quelle fut son itinéraire ? Quel trésor ou horreur recèle cet encombrant paquet ?
Philippe Claudel, avec la maîtrise parfaite qu'on lui connaît, oscille en permanence entre poésie, philosophie, fable et critique sociale d'un réalisme sombre. Avec sa partition pour homme solitaire qui joue toute la gamme des émotions, il réussit le pari de mettre en mots l'angoisse du vide, d'incarner un quidam qui s'interroge face au monde, à la société qui le dépasse et le broie, de nous confronter à la capacité de chacun à affabuler ou à dériver vers la marge.
Cette pièce aux accents tragicomiques qui flirte avec l'absurde, n'est pas (est-ce l'omniprésence du banc ou le temps en suspens ?) sans nous rappeler En attendant Godot de Samuel Beckett. Il ne s'y passe rien. La vie du personnage ne tient qu'à ces mots qu'il déroule dans l'espace. « Je n'ai plus que mes mots, et encore, souvent je n'ai pas les bons. Je prends ceux qui traînent. Ce ne sont pas les miens. (...) Des lambeaux. L'écume sale du monde. J'emprunte, je n'ai pas de parole. Rien ne m'appartient. » En se délestant de son fardeau, non le tapis qui n'en est qu'un symbole, mais celui qui le plombe, chargé d'échecs, d'angoisses, de frustration, d'abandons, le narrateur piège le lecteur dans un jeu de miroirs pour le renvoyer à son propre exil.
Simultanément à son édition en janvier 2010, la pièce a été créée au Petit Théâtre de Paris interprétée par Gérard Juniot. On imagine assez bien dans ce rôle de clown triste, ce comédien pudique et fantasque, pour recommander à ceux qui pourraient bénéficier à proximité de sa tournée en région, d'en profiter.
Un texte fort et émouvant, qui gratte là où ça fait mal.
Dominique Baillon-Lalande
(26/10/10)
|
|
|
Retour
Sommaire
Théâtre

Stock / Théâtre
96 pages, 10 €

Découvrir sur notre site
d'autres livres
du même auteur :
La petite fille
de Monsieur Linh
Trois petites histoires
de jouets
Le rapport de Brodeck
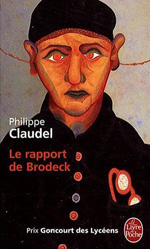
|
|