Lecture critique
Petites histoires des phares racontées par González Macias
Chaque soir, la lanterne lance son signal au-dessus des eaux en direction des ténèbres. Puis l’éclat lumineux s’éteint, brièvement, deux fois, puis une fois, toutes les douze secondes. Une ampoule unique d’au moins 250 watts porte à près de 40 kilomètres grâce à d’ingénieuses lentilles, un jeu de miroirs imaginé par un cousin de Prosper Mérimée, Augustin Fresnel, qui a mis au point le système en 1822 avec un opticien au nom prédestiné, Jean-Baptiste Soleil ! Depuis deux cents ans on n’a encore rien inventé de mieux pour équiper tous les phares du monde.
L’écrivain et designer espagnol González Macías (Ponferrada, 1973) a la passion de ces vigies de la mer. Il les a recensés avant d’en sélectionner trente-quatre sur tous les continents dont la plupart sont encore actifs même si aujourd’hui les technologies de communication maritime ont rendu leur fonction de plus en plus superflue. De ces trente-quatre phares du bout du monde, il raconte l’histoire et souligne les faits mémorables qui ont marqué leur activité et celle de leurs gardiens. Habile dessinateur, l’auteur illustre ses propos de croquis et de cartes qui donnent à l’ensemble une belle harmonie graphique.
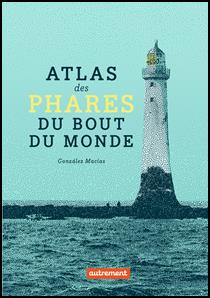 La quête de José Luis González Macías commence avec le phare d’Adzuigol, à Rybalche, en Ukraine. L’ingénieur qui le dessina, Vladimir Shukhov, s’est inspiré de la manière des tisserandes ukrainiennes lorsqu’elles assemblent leurs justkas (écharpes ou foulards) : il a tressé le phare comme un panier en osier ! Les charpentes extrêmement simples à l’aspect frêle, constituées de treillis en acier, ont été usitées avec la même réussite sur des tours, des toitures, des pavillons et des bâtiments qui ont consacré son inventeur comme l’un des ingénieurs russes les plus brillants de son temps. En novembre 1864, à San Jaime de Enveija, en Espagne, un gardien gravit les trois cent soixante-cinq marches jusqu’à la lanterne du phare de l’île de Buda ; il y alluma pour la première fois la mèche d’une lampe Degrand alimentée à l’huile d’olive. Près d’un siècle durant, ses successeurs l’ont imité toutes les huit heures pour aller remonter le mécanisme de rotation du système optique. Le phare des îles Flannan, à Eilean Mòr, en Écosse, est un lieu baigné de légendes et de mystères. Allez savoir pourquoi les marins qui débarquent sur l’île ôtent leur chapeau dès qu’ils foulent le rocher et font le tour de la bâtisse en direction du soleil avant de rejoindre le sommet du phare ? En 2018, Kristoffer Nyholm a réalisé un film à suspense (« The Vanishing ») intégrant la disparition inexpliquée des gardiens du phare. Jusqu’au groupe de rock britannique Genesis qui a composé un de ses tubes (« The Mystery of the Flannan Isle ») sur le même thème. L’écrivaine Virginia Woolf visita le phare de Godrevy, sur la côte des Cornouailles, le 12 septembre 1892, alors qu’elle était âgée de dix ans. Elle parapha le carnet des visites qui fut vendu aux enchères de Bonhams, cent vingt ans plus tard, pour plus de dix mille livres. À Bari, en Somalie, le dernier gardien du phare du cap Guardafui, Antonio Selvaggi, exerça son métier jusqu’en 1957. Pour rejoindre Alula, le village le plus proche où il pouvait retirer vivres et courrier, il lui fallait deux jours de voyage à dos de chameau : il disposait de trois camélidés pour unique moyen de transport… Le phare de Lime Rock, à Newport (États-Unis) est tout aussi connu sous l’appellation de phare d’Ida Lewis. La postérité a retenu l’intrépide gardienne des lieux (dès 1879) pour avoir sauvé dix-huit naufragés. De 1964 à 1981, Nelson Mandela resta enfermé dans une cellule de quatre mètres carrés sur l’île Robben, au Cap (Afrique du Sud). Il réalisa rétrospectivement une série de dessins où il évoque le port, l’église, le phare, sa cellule et la fenêtre.
La quête de José Luis González Macías commence avec le phare d’Adzuigol, à Rybalche, en Ukraine. L’ingénieur qui le dessina, Vladimir Shukhov, s’est inspiré de la manière des tisserandes ukrainiennes lorsqu’elles assemblent leurs justkas (écharpes ou foulards) : il a tressé le phare comme un panier en osier ! Les charpentes extrêmement simples à l’aspect frêle, constituées de treillis en acier, ont été usitées avec la même réussite sur des tours, des toitures, des pavillons et des bâtiments qui ont consacré son inventeur comme l’un des ingénieurs russes les plus brillants de son temps. En novembre 1864, à San Jaime de Enveija, en Espagne, un gardien gravit les trois cent soixante-cinq marches jusqu’à la lanterne du phare de l’île de Buda ; il y alluma pour la première fois la mèche d’une lampe Degrand alimentée à l’huile d’olive. Près d’un siècle durant, ses successeurs l’ont imité toutes les huit heures pour aller remonter le mécanisme de rotation du système optique. Le phare des îles Flannan, à Eilean Mòr, en Écosse, est un lieu baigné de légendes et de mystères. Allez savoir pourquoi les marins qui débarquent sur l’île ôtent leur chapeau dès qu’ils foulent le rocher et font le tour de la bâtisse en direction du soleil avant de rejoindre le sommet du phare ? En 2018, Kristoffer Nyholm a réalisé un film à suspense (« The Vanishing ») intégrant la disparition inexpliquée des gardiens du phare. Jusqu’au groupe de rock britannique Genesis qui a composé un de ses tubes (« The Mystery of the Flannan Isle ») sur le même thème. L’écrivaine Virginia Woolf visita le phare de Godrevy, sur la côte des Cornouailles, le 12 septembre 1892, alors qu’elle était âgée de dix ans. Elle parapha le carnet des visites qui fut vendu aux enchères de Bonhams, cent vingt ans plus tard, pour plus de dix mille livres. À Bari, en Somalie, le dernier gardien du phare du cap Guardafui, Antonio Selvaggi, exerça son métier jusqu’en 1957. Pour rejoindre Alula, le village le plus proche où il pouvait retirer vivres et courrier, il lui fallait deux jours de voyage à dos de chameau : il disposait de trois camélidés pour unique moyen de transport… Le phare de Lime Rock, à Newport (États-Unis) est tout aussi connu sous l’appellation de phare d’Ida Lewis. La postérité a retenu l’intrépide gardienne des lieux (dès 1879) pour avoir sauvé dix-huit naufragés. De 1964 à 1981, Nelson Mandela resta enfermé dans une cellule de quatre mètres carrés sur l’île Robben, au Cap (Afrique du Sud). Il réalisa rétrospectivement une série de dessins où il évoque le port, l’église, le phare, sa cellule et la fenêtre.  L’île fut reconnue Patrimoine de l’humanité par l’Unesco en 1999 et l’ancienne prison héberge à présent un musée dédié à la mémoire des victimes de l’apartheid. Le phare de San Juan de Salvamento, en Patagonie (Argentine), inspira l’écrivain Jules Verne pour la création d’un de ses derniers romans, « Le Phare du bout du monde ». Son confrère Roberto J. Payró décrit l’île des États où a été édifié le phare comme une prison naturelle et une tombe pour les navires (« La Australia Argentina »). En pays de Galles, le phare des Smalls fut construit avec une délicatesse propre à… l’assemblage d’un violon par Henry Whiteside, fabriquant d’instruments de musique de Liverpool. Sur un des rochers de Smalls, à Pembrokeshire, l’artisan éleva une lanterne sur neuf piliers en chêne, de façon que les vagues traversent sa structure avant d’aller mourir trente kilomètres plus loin, en rejoignant la côte. Alors que les travaux touchaient à leur fin, il se trouva en graves difficultés, sans eau ni vivres. Il jeta trois bouteilles à la mer contenant un message désespéré : l’une fut repêchée et le luthier fut secouru à temps. L’incident a inspiré romanciers et cinéastes dont Robert Eggers, réalisateur de « The Lighthouse » (Le Phare), en 2019.
L’île fut reconnue Patrimoine de l’humanité par l’Unesco en 1999 et l’ancienne prison héberge à présent un musée dédié à la mémoire des victimes de l’apartheid. Le phare de San Juan de Salvamento, en Patagonie (Argentine), inspira l’écrivain Jules Verne pour la création d’un de ses derniers romans, « Le Phare du bout du monde ». Son confrère Roberto J. Payró décrit l’île des États où a été édifié le phare comme une prison naturelle et une tombe pour les navires (« La Australia Argentina »). En pays de Galles, le phare des Smalls fut construit avec une délicatesse propre à… l’assemblage d’un violon par Henry Whiteside, fabriquant d’instruments de musique de Liverpool. Sur un des rochers de Smalls, à Pembrokeshire, l’artisan éleva une lanterne sur neuf piliers en chêne, de façon que les vagues traversent sa structure avant d’aller mourir trente kilomètres plus loin, en rejoignant la côte. Alors que les travaux touchaient à leur fin, il se trouva en graves difficultés, sans eau ni vivres. Il jeta trois bouteilles à la mer contenant un message désespéré : l’une fut repêchée et le luthier fut secouru à temps. L’incident a inspiré romanciers et cinéastes dont Robert Eggers, réalisateur de « The Lighthouse » (Le Phare), en 2019.
José Luis González Macías © Photo X, droits réservés
- Atlas des phares du bout du monde, par González Macías, traduit de l’espagnol par Nelly Guicherd, éditions Autrement, 160 pages, 2021.
Portrait
Le lamento bouleversant de Louis-René des Forêts
Écrivain secret et rare, peintre méconnu et onirique, il publie peu et montre ses peintures et dessins avec parcimonie. Homme du retrait et du silence, Louis-René des Forêts (Paris, 1918-2000) se livre peu dans les deux états de la création. Il ne cesse de mettre en doute l’écriture, la capacité des mots à témoigner de l’expérience humaine jusqu’au tréfonds de l’âme. Il lui faut signifier l’au-delà et l’en deça des sentiments, des pensées, des émotions. Il lui faut « exprimer par une concentration de plus en plus grande des éléments rythmiques la pulsation intérieure, la scansion de l’être ». L’activité graphique mêle l’observation des êtres et des choses, des figures et des lieux, aux sollicitations et fantaisies de l’imagination convoquant la culture romanesque et/ou musicale. Parfois, le même dessin réunit les deux registres distincts.
Il rêve d’être marin et se passionne pour la musique
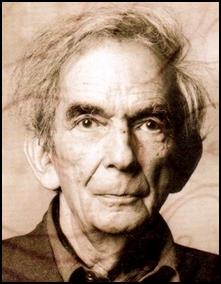 Louis-René Pineau des Forêts naît à Paris le 28 janvier 1918. Il est le troisième enfant d’Armand-René Pineau des Forêts et d’Edmée du Petit-Thouars (l’ont précédé Gérard, né en 1914, et Nicole, née en 1915). Les De Petit-Thouars comptent des ascendants dans la noblesse poitevine qui se sont illustrés dans la Marine. Son enfance se partage entre la capitale et le Berry familial. Pensionnaire au collège Saint Charles de Saint-Brieuc qui prépare à l’école navale, il découvre Baudelaire, Goethe, Joyce, Pascal, Rimbaud, Shakespeare et Verlaine en cachette parce que les pères marianistes ne prisent pas beaucoup la littérature. L’élève rêve d’être marin, mais de retour à Paris, quelques années avant la Seconde Guerre mondiale, il choisit la voie du droit et des sciences politiques (section « diplomatique »). À cette époque, il se plaît à rédiger des chroniques musicales dont la pertinence séduit mélomanes et compositeurs. Il se lie d’amitié avec Patrice de La Tour du Pin et Jean de Frotté (qui sera fusillé par les nazis en 1945, à l’âge de 25 ans). Mobilisé à la déclaration de la guerre en 1939, il interrompt une formation musicale qu’il regretta souvent de n’avoir pas prolongée, affectant une certaine prédilection pour l’opéra et le chant. Son père meurt en 1940, quatre ans après sa mère. Officier de réserve en 1941, il se retire à la campagne et entre dans la Résistance en intégrant le réseau belge Comète. Il rencontre cette année-là André Frénaud et Raymond Queneau.
Louis-René Pineau des Forêts naît à Paris le 28 janvier 1918. Il est le troisième enfant d’Armand-René Pineau des Forêts et d’Edmée du Petit-Thouars (l’ont précédé Gérard, né en 1914, et Nicole, née en 1915). Les De Petit-Thouars comptent des ascendants dans la noblesse poitevine qui se sont illustrés dans la Marine. Son enfance se partage entre la capitale et le Berry familial. Pensionnaire au collège Saint Charles de Saint-Brieuc qui prépare à l’école navale, il découvre Baudelaire, Goethe, Joyce, Pascal, Rimbaud, Shakespeare et Verlaine en cachette parce que les pères marianistes ne prisent pas beaucoup la littérature. L’élève rêve d’être marin, mais de retour à Paris, quelques années avant la Seconde Guerre mondiale, il choisit la voie du droit et des sciences politiques (section « diplomatique »). À cette époque, il se plaît à rédiger des chroniques musicales dont la pertinence séduit mélomanes et compositeurs. Il se lie d’amitié avec Patrice de La Tour du Pin et Jean de Frotté (qui sera fusillé par les nazis en 1945, à l’âge de 25 ans). Mobilisé à la déclaration de la guerre en 1939, il interrompt une formation musicale qu’il regretta souvent de n’avoir pas prolongée, affectant une certaine prédilection pour l’opéra et le chant. Son père meurt en 1940, quatre ans après sa mère. Officier de réserve en 1941, il se retire à la campagne et entre dans la Résistance en intégrant le réseau belge Comète. Il rencontre cette année-là André Frénaud et Raymond Queneau.  En 1943, il publie son premier livre, « Les Mendiants », chez Gallimard. Georges Bataille, Michel Leiris et Maurice Blanchot saluent « Le Bavard » en 1946. Conseiller littéraire aux éditions Robert Laffont en 1945, il quitte Paris l’année suivante et s’installe aux Pluyes, en Berry, avec sa femme, Janine Carré, résistante comme lui au groupe clandestin Comète. Il revient dans la capitale en 1953 où les éditions Gallimard lui proposent de collaborer à l’Encyclopédie de la Pléiade, dirigée par Raymond Queneau. En 1954, l’écrivain s’engage politiquement par la création du Comité contre la guerre d’Algérie, un acte suivi en 1960 de la signature du « Manifeste des 121 » pensé puis rédigé par ses amis Dionys Mascolo et Maurice Blanchot. En septembre 1960, son troisième livre est un recueil de nouvelles intitulé « La Chambre des enfants ». La mort accidentelle de sa fille, en juin 1965, lors d’une baignade à Venise est l’événement le plus douloureux de sa vie : Élisabeth avait 14 ans. Il cessera de publier durant plus de vingt ans.
En 1943, il publie son premier livre, « Les Mendiants », chez Gallimard. Georges Bataille, Michel Leiris et Maurice Blanchot saluent « Le Bavard » en 1946. Conseiller littéraire aux éditions Robert Laffont en 1945, il quitte Paris l’année suivante et s’installe aux Pluyes, en Berry, avec sa femme, Janine Carré, résistante comme lui au groupe clandestin Comète. Il revient dans la capitale en 1953 où les éditions Gallimard lui proposent de collaborer à l’Encyclopédie de la Pléiade, dirigée par Raymond Queneau. En 1954, l’écrivain s’engage politiquement par la création du Comité contre la guerre d’Algérie, un acte suivi en 1960 de la signature du « Manifeste des 121 » pensé puis rédigé par ses amis Dionys Mascolo et Maurice Blanchot. En septembre 1960, son troisième livre est un recueil de nouvelles intitulé « La Chambre des enfants ». La mort accidentelle de sa fille, en juin 1965, lors d’une baignade à Venise est l’événement le plus douloureux de sa vie : Élisabeth avait 14 ans. Il cessera de publier durant plus de vingt ans.
Une œuvre singulière et baroque
Cofondateur de la revue « L’Éphémère » (1965), il y côtoie Michel Leiris, André du Bouchet, Yves Bonnefoy, Paul Celan, Jacques Dupin et Gaëtan Picon. Il intègre le comité de lecture de Gallimard en 1966 où il siègera jusqu’en 1983. Long poème d’inspiration musicale, « Les Mégères de la mer » paraît au Mercure de France en 1967. Durant toute cette période (de 1968 à 1974), il se consacre au dessin et à la peinture et expose à plusieurs reprises au château d’Ancy-le-Franc en Bourgogne et au Centre Pompidou de Paris (sous le parrainage éclairé de Pierre Bettencourt et de Pierre Klossowski).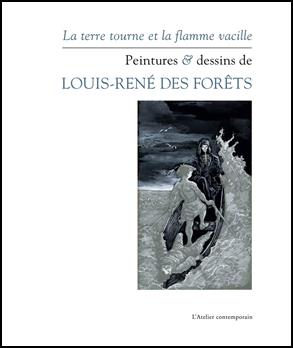 Crayons, encres de Chine, crayons de couleur, gouaches, feutres et découpages se conforment principalement à un univers singulier et baroque, lesté de secrets, d’intrigues et de fantasmes. Éditée par François-Marie Deyrolle (L’Atelier contemporain), une monographie rassemble pour la première fois en 2021 l’ensemble de ces peintures et dessins. Parmi les contributeurs de l’ouvrage, le critique et universitaire Pierre Vilar indique : « On notera grâce aux archives mises en ordre par ses proches l’émergence du dessin, chez Des Forêts, au moment de l’adolescence, et dans le contexte précis de l’oppression éducative, au collège Saint Charles notamment. » À quatorze-quinze ans, le jeune des Forêts a sans conteste un bon coup de crayon, estime Bernard Vouilloux, professeur de littérature française à la Sorbonne : « Le trait est rude, mais jamais grossier, il est vif et enlevé, habile à planter ou suggérer les décors, à identifier des situations, à camper des caractères, à restituer les expressions et les attitudes, à saisir les corps en mouvement. » De son côté, le poète et essayiste Nicolas Pesquès répond assez précisément à la question qu’il pose : « Que dessine-t-il donc ? Souvent des scènes complexes, plutôt littéraires mais comme transcrites de songes autant que de lectures, de rêveries tourmentées mais dont tout le tourment ne se réalise que sous la forme de drames étranges et non d’évocations directes ; drames abondamment peuplés comme dans certains tableaux de la peinture ancienne où plusieurs histoires peuvent coexister ».
Crayons, encres de Chine, crayons de couleur, gouaches, feutres et découpages se conforment principalement à un univers singulier et baroque, lesté de secrets, d’intrigues et de fantasmes. Éditée par François-Marie Deyrolle (L’Atelier contemporain), une monographie rassemble pour la première fois en 2021 l’ensemble de ces peintures et dessins. Parmi les contributeurs de l’ouvrage, le critique et universitaire Pierre Vilar indique : « On notera grâce aux archives mises en ordre par ses proches l’émergence du dessin, chez Des Forêts, au moment de l’adolescence, et dans le contexte précis de l’oppression éducative, au collège Saint Charles notamment. » À quatorze-quinze ans, le jeune des Forêts a sans conteste un bon coup de crayon, estime Bernard Vouilloux, professeur de littérature française à la Sorbonne : « Le trait est rude, mais jamais grossier, il est vif et enlevé, habile à planter ou suggérer les décors, à identifier des situations, à camper des caractères, à restituer les expressions et les attitudes, à saisir les corps en mouvement. » De son côté, le poète et essayiste Nicolas Pesquès répond assez précisément à la question qu’il pose : « Que dessine-t-il donc ? Souvent des scènes complexes, plutôt littéraires mais comme transcrites de songes autant que de lectures, de rêveries tourmentées mais dont tout le tourment ne se réalise que sous la forme de drames étranges et non d’évocations directes ; drames abondamment peuplés comme dans certains tableaux de la peinture ancienne où plusieurs histoires peuvent coexister ».
Quand il entreprend à partir de 1975 « Légendes » qui deviendra « Ostinato » (1997), il remise définitivement crayons et pinceaux. Les premiers linéaments de cette œuvre ultime et testamentaire apparaissent dès janvier 1984 dans la revue de la NRF. Lamento bouleversant, « Ostinato » - en musique « ostinato » désigne le « maintien d’une formule rythmique pendant tout ou partie d’une œuvre » - célèbre la conspiration d’une extraordinaire prodigalité lyrique et de la plus pénétrante concision. Nombreux auront été ses commentateurs les plus lucides, parmi lesquels Marc Comina, Florence Delay, Edmond Jabès, Roger Laporte, Maurice Nadeau, Bernard Pingaud, Jean-Benoît Puech et Jean Roudault. Louis-René des Forêts est mort samedi 30 décembre 2000 à Paris des suites d’une pneumonie, à l’âge de quatre-vingt-deux ans.
Louis-René des Forêts
© Photo X, droits réservés
- Œuvres complètes, de Louis-René des Forêts, présentation de Dominique Rabaté, éditions Gallimard, collection Quarto, 1344 pages, 2015 ;
- La terre tourne et la flamme vacille - Peintures & dessins de Louis-René des Forêts, édition établie par Guillaume des Forêts (fils de l’écrivain) et Dominique Rabaté (critique et universitaire), avec les contributions de Pierre Bettencourt, Pierre Klossowski, Nicolas Pesquès, Dominique Rabaté, Pierre Vilar et Bernard Vouilloux, éditions L’Atelier contemporain, 256 pages, 2021.
Varia : à travers la France des canaux
« La France possède un grand réseau de voies navigables, constitué de canaux, de rivières et de fleuves ponctués d’ouvrages d’art remarquables. De Dunkerque à Bordeaux, en passant par Paris, Dijon, Strasbourg, Lyon, Avignon, Toulouse... À ce réseau s’ajoutent des cours d’eau à l’ouest de la France, par exemple ceux de Bretagne. Canal du Midi, Seine, canal du Nivernais, Saône, canal de la Somme, Charente, canal de Nantes à Brest... Ces voies invitent à découvrir ou redécouvrir la France, ses paysages à couper le souffle, ses perles architecturales, ses spécialités locales... […]
« 174 kilomètres de long, entre Saint-Léger-de-Vignes (Nièvre) et Auxerre (Yonne), le canal du Nivernais traverse la région Bourgogne-Franche-Comté ainsi que les départements de la Nièvre et de l’Yonne. C’est une des voies qui relient les bassins de la Loire et de la Seine. Il traverse principalement le département de la Nièvre qui occupe le territoire de l’ancienne province du Nivernais. […]
« Le musée de l’élevage et du charolais
« Après Cercy-la-Tour, se trouve à courte distance Saint-Honoré-les-Bains qui, comme son nom l’indique, est une station thermale. Situé également non loin du 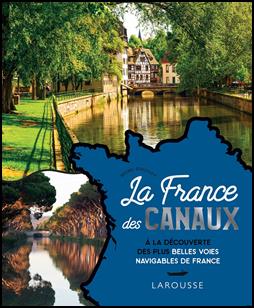 canal, Moulins-Engilbert invite à découvrir le musée de l’Élevage et du Charolais qui raconte l’histoire de la célèbre vache charolaise, animal de première importance dans l’économie de la région ; dans ce bourg se tient d’ailleurs un très grand marché aux bestiaux. […]
canal, Moulins-Engilbert invite à découvrir le musée de l’Élevage et du Charolais qui raconte l’histoire de la célèbre vache charolaise, animal de première importance dans l’économie de la région ; dans ce bourg se tient d’ailleurs un très grand marché aux bestiaux. […]
« Un musée du Flottage
« L’écomusée du Flottage du bois de la confrérie Saint-Nicolas de Clamecy présente cette activité essentielle à la région, de même que le musée d’Art et d’Histoire Romain-Rolland, qui possède également des salles consacrées à la peinture, la sculpture, l’archéologie, aux faïences, ou encore à l’écrivain qui lui donne son nom. Né à Clamecy, lauréat du prix Nobel de littérature en 1915, il fut notamment l’auteur du manifeste pacifiste Au-dessus de la mêlée. »
Extraits de « La France des canaux », de Michel Doussot, éditions Larousse, 224 pages, 2021.
Carnet : alors, mon vieux, comment ça va ?
La notion de « vieux » a été bel et bien fixée en 1880, tandis que l’espérance de vie passait de 60 à 80 ans. Dans les années 1940, déjà, certains esprits dénonçaient la retraite comme une véritable escroquerie. Ne devait-on pas cotiser toute sa vie pour en profiter à peine quelques années, 4 ans en moyenne ?
Plébiscite pour les droitiers
Le 21 février 1972, le numéro un chinois Mao Zedong accueille le président des États-Unis, Richard Nixon, dans sa résidence de Zhongnanhai, non loin de la Cité interdite, à Pékin. Mao flatte d’emblée son hôte : « J’aime bien les droitiers, lui lance-t-il, je suis heureux quand ils arrivent au pouvoir. J’ai voté pour vous. »
Camarades d’école
Chaque identité est formée aussi par le destin des autres. Les récits de vos camarades d’école font partie de votre vie d’une façon que vous ne pouvez pas distinguer. (Claudio Magris, Microcosmes, éditions Gallimard)
(Lundi 28 février 2022)
Un capitaine oublié
Comment se fait-il qu’Édouard Peisson (1896-1963) ne dispose que d’un strapontin parmi les capitaines de la flotte ? Je veux parler des écrivains de la mer. Inoubliable auteur du « Voyage d’Edgar » (1938) et de « Le Sel de la mer » (1954), ce Marseillais a pourtant droit à un rang plus qu’honorable parmi les équipages. Depuis qu’il est mort, il y a bientôt soixante ans, à Ventabren, dans une Provence qu’il chérissait tant, on l’a un peu perdu de vue à l’horizon. Pourtant ses livres sont solides, bien charpentés, inoubliables comme des voiliers bien bâtis et bien gréés. Lisez ce qu’en dit son ami Blaise Cendrars dans « L’Homme foudroyé » (1945).
(Mercredi 10 mars 2022)
Lecture critique
Hortense Dufour : un Bel Ange sans miséricorde
Hortense Dufour (Marennes, 1946) ne m’en voudra pas, du moins je l’espère, mais je dirai d’emblée que « Le Jeune Homme sous l’acacia » est un roman qui finit bien. Que cette révélation intempestive n’empêche pas les lecteurs de dévorer comme je l’ai fait les quatre cents pages de l’ouvrage, ils ne se lasseront assurément pas de suivre les péripéties les plus tendres, les plus poignantes aussi d’une histoire d’amour, de haine et de fureur.
 L’intrigue s’ancre dans la Saintonge des marais limoneux et des fermes basses, chaulées de blanc, où règne en maître l’esprit de la terre et de ses ressources, où l’on cultive par héritage l’esprit du gain et celui du silence, où les cuisinières se transmettent de mère à fille la recette des beignets aux fleurs d’acacia. De la veulerie des uns à la mesquinerie des autres, les paysans du hameau ont gardé de leurs ancêtres un puissant instinct animal, avec l’intuition, l’odorat, l’ouïe et le regard aigu des bêtes sauvages. Le jeune homme dont il est question s’appelle Michel Arthur Thomas, né par accident en 1999 de parents quinquagénaires (Catherine et Arthur), catastrophés d’accueillir un nouveau-né qu’ils détestent déjà. Sa mère lui interdit de l’appeler Maman : il doit lui dire Mémé comme ses neveux et nièces plus âgés que lui. Sœur de Catherine, Ludivine, fragile et souffrante, s’attache à l’enfant dont la beauté l’apparente à l’archange saint Michel. Dès lors, Didine nommera son neveu Bel Ange et elle l’inondera de l’affection et de la douceur dont le privent ses géniteurs.
L’intrigue s’ancre dans la Saintonge des marais limoneux et des fermes basses, chaulées de blanc, où règne en maître l’esprit de la terre et de ses ressources, où l’on cultive par héritage l’esprit du gain et celui du silence, où les cuisinières se transmettent de mère à fille la recette des beignets aux fleurs d’acacia. De la veulerie des uns à la mesquinerie des autres, les paysans du hameau ont gardé de leurs ancêtres un puissant instinct animal, avec l’intuition, l’odorat, l’ouïe et le regard aigu des bêtes sauvages. Le jeune homme dont il est question s’appelle Michel Arthur Thomas, né par accident en 1999 de parents quinquagénaires (Catherine et Arthur), catastrophés d’accueillir un nouveau-né qu’ils détestent déjà. Sa mère lui interdit de l’appeler Maman : il doit lui dire Mémé comme ses neveux et nièces plus âgés que lui. Sœur de Catherine, Ludivine, fragile et souffrante, s’attache à l’enfant dont la beauté l’apparente à l’archange saint Michel. Dès lors, Didine nommera son neveu Bel Ange et elle l’inondera de l’affection et de la douceur dont le privent ses géniteurs.
 Les années passant, elle se saigne aux quatre veines pour lui offrir à ses dix-huit ans une motocyclette, le Pégase de ses rêves ! La réussite scolaire et un réel talent de dessinateur lui valent de poursuivre ses études à l’université de La Rochelle. À Grand-Bourg, distant de 5 km de la cité rochelaise, il prend à loyer une chambre chez la veuve Rose Lechant pour laquelle il éprouve une profonde estime. Il partage la même sympathie avec Lili, son amourette de la Belle Anse, et Tiphaine, fille d’un couple de paumés. Toutes les deux trouvent chez lui secours et compassion. Comme Ludivine et Rose, les deux jeunes femmes vivent mal leur condition et la désaffection de leurs proches. Michel les immortalise d’un trait tendre et léger sur les planches de ses bandes dessinées. Il y portraiture tout autrement les autres témoins de son adolescence au hameau. Au côté d’une Didine florale et apaisée, en son champ de navets et de plantes vivaces, il croque son père en fauve atroce. Et tous ceux qui ont tenté de gâcher son enfance comme ceux qui ont brisé les rêves de Ludivine et Rose, de Lili et Tiphaine, il les portraiture en personnages artificiels et meurtriers d’un crayon et d’un feutre enragés et onglés comme des griffes. « Créer au sens fort, considère Bel Ange devant sa table à dessin, c’est tuer. C’est une guerre. C’est oser pointer un crayon, des mots, des notes, que sais-je, sur les blessures les plus universelles. C’est peut-être une envie de justice. »
Les années passant, elle se saigne aux quatre veines pour lui offrir à ses dix-huit ans une motocyclette, le Pégase de ses rêves ! La réussite scolaire et un réel talent de dessinateur lui valent de poursuivre ses études à l’université de La Rochelle. À Grand-Bourg, distant de 5 km de la cité rochelaise, il prend à loyer une chambre chez la veuve Rose Lechant pour laquelle il éprouve une profonde estime. Il partage la même sympathie avec Lili, son amourette de la Belle Anse, et Tiphaine, fille d’un couple de paumés. Toutes les deux trouvent chez lui secours et compassion. Comme Ludivine et Rose, les deux jeunes femmes vivent mal leur condition et la désaffection de leurs proches. Michel les immortalise d’un trait tendre et léger sur les planches de ses bandes dessinées. Il y portraiture tout autrement les autres témoins de son adolescence au hameau. Au côté d’une Didine florale et apaisée, en son champ de navets et de plantes vivaces, il croque son père en fauve atroce. Et tous ceux qui ont tenté de gâcher son enfance comme ceux qui ont brisé les rêves de Ludivine et Rose, de Lili et Tiphaine, il les portraiture en personnages artificiels et meurtriers d’un crayon et d’un feutre enragés et onglés comme des griffes. « Créer au sens fort, considère Bel Ange devant sa table à dessin, c’est tuer. C’est une guerre. C’est oser pointer un crayon, des mots, des notes, que sais-je, sur les blessures les plus universelles. C’est peut-être une envie de justice. »
Hortense Dufour © Photo Arnaud Février
- Le Jeune Homme sous l’acacia, par Hortense Dufour, éditions Presses de la cité, collection Terres de France, 464 pages, 2018.
Portrait
Glorieuse postérité pour les peintres de Bretagne et de Normandie
Une longue et patiente maturation est plus que nécessaire à l’analyse du phénomène pictural en un lieu donné, province ou continent. Le temps de la création et la conception de ses praticiens doivent être scrutés avec la distance intellectuelle que requiert toute connaissance réflexive se rapportant à l’univers des formes. C’est assurément ce qui a guidé les auteurs des deux superbes volumes publiés par les éditions Ouest-France :
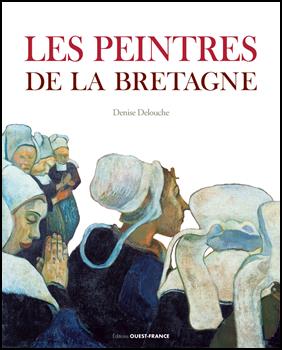 Denise Delouche, professeur émérite de l’université de Haute-Bretagne Rennes 2 (Les Peintres de la Bretagne), Jacques-Sylvain Klein et Philippe Piguet, historiens de l’art (Les Peintres de la Normandie). Sans prétendre à l’exhaustivité d’un sujet si vaste, les ouvrages racontent une histoire des peintres de chacune des provinces, une histoire heureusement éloignée des idées reçues et des modes qui façonnent trop complaisamment nos regards.
Denise Delouche, professeur émérite de l’université de Haute-Bretagne Rennes 2 (Les Peintres de la Bretagne), Jacques-Sylvain Klein et Philippe Piguet, historiens de l’art (Les Peintres de la Normandie). Sans prétendre à l’exhaustivité d’un sujet si vaste, les ouvrages racontent une histoire des peintres de chacune des provinces, une histoire heureusement éloignée des idées reçues et des modes qui façonnent trop complaisamment nos regards.
La Bretagne aux expérimentations audacieuses
Si la Bretagne commence à intéresser les peintres à la charnière du XVIIIe et du XIXe siècle, le paysage le plus ancien date de 1543 : aquarelle et gouache, rehaussée d’or et d’argent sur vélin, c’est une vue de Rennes nichée au cœur de sa campagne bocagère qui figure parmi les vingt-deux peintures d’un manuscrit évoquant la navigation sur la Vilaine, de Redon à Rennes. Le pays breton satisfait aux goûts et aux aspirations du romantisme (Jean-Baptiste Corot, Victor Hugo, Eugène Isabey, William Turner) ; il attire les passionnés d’histoire rurale (Olivier Perrin et François Valentin) et offre une escale privilégiée aux marinistes (Louis Garneray, Pierre Gilbert et Auguste Mayer). Certaines expérimentations audacieuses sont perpétrées en Bretagne : « De son aveu même, Matisse y a découvert la couleur quelques années avant le scandale de la Cage aux Fauves », rappelle opportunément Denise Delouche. La novation s’est aussi développée en Bretagne : « En 1886, c’est à Belle-Île que Claude Monet affirme, pour la première fois aussi nettement, l’approche sérielle de son sujet. La même année à Saint-Briac, le jeune Paul Signac expérimente les préceptes néo-impressionnistes, qu’il va approfondir ensuite à Portrieux et Concarneau. En 1888, c’est depuis Pont-Aven et Le Pouldu que la proposition radicale de Paul Gauguin va s’imposer : non plus copier, représenter le monde extérieur (la photographie le fait déjà vite et bien, elle le fera très bientôt en couleurs), mais rêver devant la nature et créer, comme la musique l’a toujours fait. » L’ouvrage aborde certains phénomènes spécifiques comme la vogue des « bretonneries » (« bignouseries » disent certains) où s’imposent dans l’entre-deux-guerres Mathurin Méheut et Jean-Julien Lemordant ainsi qu’un groupe de jeunes artistes qui se nomment Ar Seiz Breur (Les Sept Frères). Nés à partir des années 1860, les centres picturaux continuent à attirer les créateurs les décennies suivantes. « Dans la seconde moitié du siècle, c’est le poète Georges Perros qui s’installe à Douarnenez et le peintre René Quéré qui y peint à demeure. En 1929, deux artistes viennent y travailler de concert, le Quimpérois Max Jacob et l’Anglais Christopher Wood. ». De nouvelles esthétiques et de nouvelles figurations s’y donnent rendez-vous : Jacques Villeglé, Bernard Buffet, Jean Le Merdy, Pierre Alechinsky, François Dilasser, Alfred Manessier, Jean Bazaine, Yves Tanguy, André Marchand, Jean Le Moal, Charles Lapicque, Geneviève Asse, Léopold Survage et Pierre Tal-Coat. La liste n’est pas limitative.
Normandie : dans la lignée de Claude Monet
En dépit de l’influence considérable qu’a jouée l’impressionnisme sur une grande population d’artistes nés, ayant vécu ou séjourné en Normandie, Jacques-Sylvain Klein et Philippe Piguet ont relevé avec brio le pari de raconter, par le texte et par l’image, la fantastique aventure picturale qui s’est déroulée en Normandie durant quatre siècles et qui se poursuit aujourd’hui. Ils se sont cependant limités à n’évoquer que les artistes majeurs, ceux qui ont vraiment compté dans l’histoire de l’art. Certes, l’émergence du paysage dans la peinture va doter la Normandie d’une place de choix à une époque dominée en Europe par les deux capitales artistiques que sont Londres et Paris.
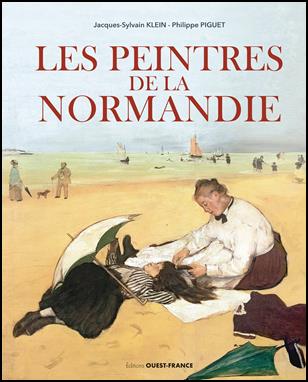 « Cette émergence du paysage va être favorisée, considèrent les deux historiens, par la mode des bains de mer, venue d’Angleterre qui, à partir des années 1810, va faire de Dieppe un second Brighton, en attirant toute l’aristocratie de l’Empire puis de la Restauration. » À l’aube du XXe siècle s’élaborent de nouveaux modes de pensée, de nouvelles sensibilités, de nouvelles formes. Bientôt émergent en Europe fauvisme, expressionnisme, cubisme, futurisme, abstraction, dadaïsme, surréalisme… Selon J.-S. Klein et P. Piguet, l’impressionnisme auquel la Normandie est si intimement liée a marqué durablement les esthétiques nouvelles portées par des artistes qui ne savent pas toujours ou ne se souviennent pas combien leur apprentissage a puisé ses sources au mouvement animé par Claude Monet et ses pairs. « Les Peintres de la Normandie » citent en bonne place certains d’entre eux parmi les majors de la discipline : Théodore Géricault, William Turner, Eugène Delacroix, Jean-Baptiste Corot, Jean-François Millet, Gustave Courbet, Théodule Ribot, Charles Daubigny, Eugène Boudin, Johan Barthold Jongkind, Édouard Manet, Edgar Degas, Berthe Morisot, Albert Lebourg, Pierre-Auguste Renoir, Gustave Caillebotte, Jacques-Émile Blanche, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Georges Seurat, Félix Vallotton, Louis Valtat, Claude Monet, Jacques Villon, Marcel Duchamp, Fernand Léger, Georges Braque, Nicolas de Staël, Jean Dubuffet et, moins connus, Constant Troyon, Paul Huet, Léon-Jules Lemaître, Charles Angrand, Joseph Delattre, Charles Frechon et Louis Anquetin. Tous ces artistes portent des propositions multiples et variées. Mais soulignent-ils vraiment une dualité radicale entre le traditionnel impressionnisme et l’art contemporain ? Pas du tout. Les contemporains De Staël et Dubuffet restent dans la lignée de Monet, s’accordent à penser J.-S. Klein et P. Piguet, un précurseur de génie que nous imaginons aménager son jardin de Giverny, cette minuscule étendue d’eau dans laquelle, comme le dit si joliment Gaston Bachelard, « le monde prend conscience de sa beauté ».
« Cette émergence du paysage va être favorisée, considèrent les deux historiens, par la mode des bains de mer, venue d’Angleterre qui, à partir des années 1810, va faire de Dieppe un second Brighton, en attirant toute l’aristocratie de l’Empire puis de la Restauration. » À l’aube du XXe siècle s’élaborent de nouveaux modes de pensée, de nouvelles sensibilités, de nouvelles formes. Bientôt émergent en Europe fauvisme, expressionnisme, cubisme, futurisme, abstraction, dadaïsme, surréalisme… Selon J.-S. Klein et P. Piguet, l’impressionnisme auquel la Normandie est si intimement liée a marqué durablement les esthétiques nouvelles portées par des artistes qui ne savent pas toujours ou ne se souviennent pas combien leur apprentissage a puisé ses sources au mouvement animé par Claude Monet et ses pairs. « Les Peintres de la Normandie » citent en bonne place certains d’entre eux parmi les majors de la discipline : Théodore Géricault, William Turner, Eugène Delacroix, Jean-Baptiste Corot, Jean-François Millet, Gustave Courbet, Théodule Ribot, Charles Daubigny, Eugène Boudin, Johan Barthold Jongkind, Édouard Manet, Edgar Degas, Berthe Morisot, Albert Lebourg, Pierre-Auguste Renoir, Gustave Caillebotte, Jacques-Émile Blanche, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Georges Seurat, Félix Vallotton, Louis Valtat, Claude Monet, Jacques Villon, Marcel Duchamp, Fernand Léger, Georges Braque, Nicolas de Staël, Jean Dubuffet et, moins connus, Constant Troyon, Paul Huet, Léon-Jules Lemaître, Charles Angrand, Joseph Delattre, Charles Frechon et Louis Anquetin. Tous ces artistes portent des propositions multiples et variées. Mais soulignent-ils vraiment une dualité radicale entre le traditionnel impressionnisme et l’art contemporain ? Pas du tout. Les contemporains De Staël et Dubuffet restent dans la lignée de Monet, s’accordent à penser J.-S. Klein et P. Piguet, un précurseur de génie que nous imaginons aménager son jardin de Giverny, cette minuscule étendue d’eau dans laquelle, comme le dit si joliment Gaston Bachelard, « le monde prend conscience de sa beauté ».
- Les Peintres de la Bretagne, par Denise Delouche, avec la contribution de Catherine Puget (ancien conservateur du musée de Pont-Aven), éditions Ouest-France, 352 pages, 2016 ;
- Les Peintres de la Normandie, par Jacques-Sylvain Klein et Philippe Piguet, éditions Ouest-France, 352 pages, 2019.
Varia : l’Art Brut ou la face cachée de l’art contemporain
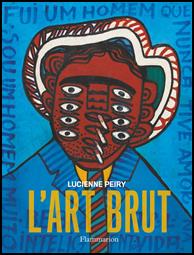 « Jean Dubuffet présente les créateurs marginaux comme des "personnes obscures", des "pensionnaires d’hospices", des "prisonniers" ou des "individus bien récalcitrants dans tous les domaines aux conventions sociales" (Prospectus et tous écrits suivants, 1967-1995). […]
« Jean Dubuffet présente les créateurs marginaux comme des "personnes obscures", des "pensionnaires d’hospices", des "prisonniers" ou des "individus bien récalcitrants dans tous les domaines aux conventions sociales" (Prospectus et tous écrits suivants, 1967-1995). […]
« Près de trois quarts de siècle se sont écoulés depuis les premières affirmations de Dubuffet. L’auteur d’Art Brut d’aujourd’hui ne peut plus être le même que celui d’hier. Le contexte artistique, social et économique a changé et les enjeux sont différents ; les sources de l’Art Brut se sont déplacées. […]
« Judith Scott, Hidenori Motooka ou Josef Hofer comme beaucoup d’autres arpentent ainsi des chemins de traverse inexplorés. […] Gaston Teuscher, Hans Krüsi ou Francis Mayor sont au nombre des nouveaux créateurs marginaux, à la vocation tardive. Par ailleurs, même si le théoricien de l’Art Brut s’est abstenu d’inscrire dans son fonds "des productions originaires d’autres ethnies", centrant ses prospections uniquement en Europe, l’internationalisation se dessine à la fin du XXe siècle et s’accentue après le cap de l’an 2000. De nouvelles recherches menées par la Collection de l’Art Brut [à Lausanne] s’avèrent fécondes, notamment à Cuba, au Japon, en Chine, en Inde et au Bénin ; d’importantes découvertes sont faites par d’autres musées et collections d’Art Brut qui dépassent également les frontières, débusquant des créations au Brésil, en Argentine et en Amérique du Nord. L’éventail des prospections s’élargissant ainsi, celui des perspectives de découvertes se déploie de manière kaléidoscopique. Ce mouvement centrifuge s’intensifie aussi grâce à l’extension des connaissances sur l’Art Brut ainsi que sa croissante diffusion ces dernières années. Des productions du passé ont été récemment mises en lumière, comme les turbulentes machines à voler de Gustav Mesmer, les étranges écrits gravés sur les façades de l’asile par Fernando Nannetti, les personnages singuliers de Charles Steffen ou l’extraordinaire cellule n° 117 aux murs peints de Julius Klingebiel.
« L’expansion mondiale des recherches et des découvertes d’Art Brut ainsi que la multiplication des expositions, des publications et des films constituent une ouverture sur une "face cachée de l’art contemporain", exerçant une fascination exaltante. »
Extraits de l’ouvrage « L’Art Brut », de Lucienne Peiry, éditions Flammarion, 400 pages, 2016. Historienne de l’art, Lucienne Peiry (Lausanne, 1961) a succédé en 2001 à Michel Thévoz à la direction de la Collection de l’art brut à Lausanne (Suisse).
Haut de page





